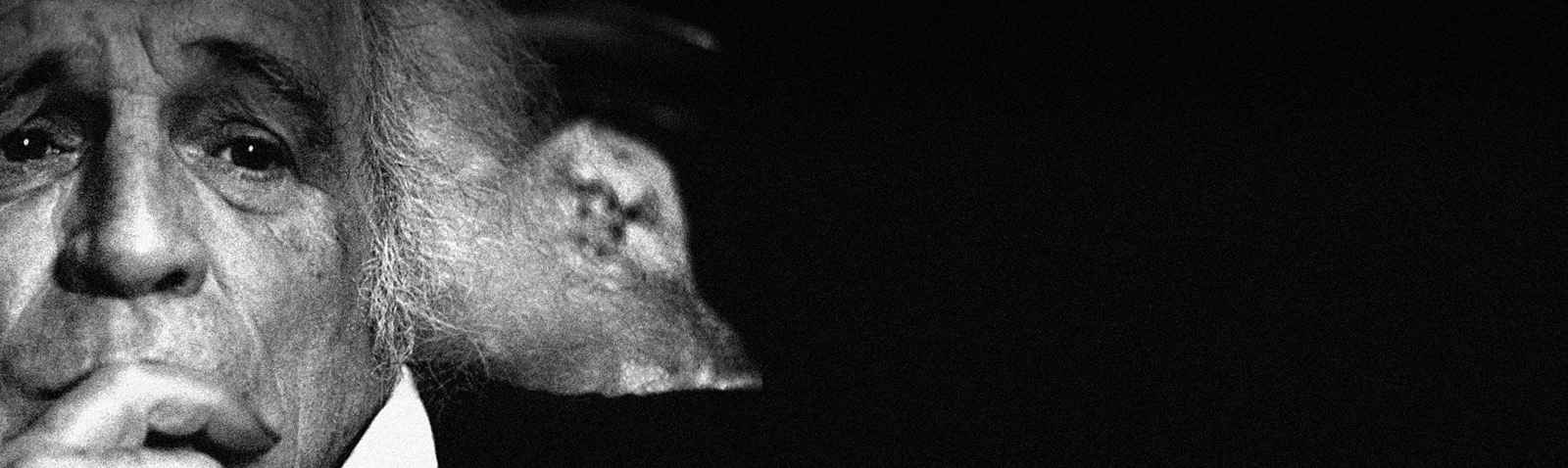Aragon estimait qu’il faudrait, après Léo Ferré, « réécrire l’histoire littéraire un peu différemment ». Nous publions l’un de ses textes en prose, « Le Style », peu connu hors des cercles ferréens. Nul n’ignore que le chanteur était anarchiste — il aimait mieux, toutefois, parler d’anarchie, tant, fidèle à la tradition individualiste, il se méfiait de sa mise en « isme ». L’anarchie, qu’il avait découverte grâce à des Espagnols en exil au lendemain de la guerre civile, était à ses yeux « la formulation politique du désespoir » : « Divine Anarchie, adorable Anarchie, tu n’es pas un système, un parti, une référence, mais un état d’âme. Tu es la seule invention de l’homme, et sa solitude, et ce qui lui reste de liberté. Tu es l’avoine du poète. »
J’étais dans le cabinet des métaphores, la loupe à l’œil, à regarder dans le mécanisme compliqué du style. Le style c’était une invention de l’âme pour distraire l’esthète que j’étais. Je trouvais du style à tout et préfigurais même une télévision odorante, une télévision à diriger l’économie olfactive. Nous y arrivons, patience !
Le style c’est cette partie du beau qui s’analyse, dans le repos, quand le spectacle flanche. C’est un arrêt dans la culture, pour mieux goûter. Le style c’est cette dame qui descendait l’autre matin les Champs-Elysées, plantée sur des aiguilles et dont le balancement se ressentait de cette position perchée et voulue telle. C’est ainsi que déambulent les hommes efféminés, me disais-je. Le style c’était la « femme », bateau à voile dérivant parmi la foule, tout envergué de chair gonflée et de prescience, l’œil en vigie à scruter le pirate. Le faux, la basse imitation gisait dans mon for intérieur quand j’échangeais les sexes. Le style meurt d’une intention frauduleuse. Le style c’est une prison dans un champ libre. C’est le bâillon du superflu.
La poésie est une fureur qui se contient juste le temps qu’il faut, pendant que se bande l’arc, là, au milieu de la flèche. Elle doit respirer, elle s’étire d’aise et puis s’en va, vers sa destination. J’avais la phrase dans les mains, comme une grenade avant l’éclatement. Eh bien, je lancerai des mots, dans la foule, au hasard, et les livres ne seront plus de mise. On lancera la poésie, avec les mains, avec des caractères gutturaux, — du romain de glotte — : des cris jetés comme des paquets parleurs à la face de la commodité et du confort plastifié.
J’étais au milieu de la rue. J’étais aussi là-haut, aux fenêtres, entre la vitre et l’univers clos de l’inconnu et du possible, comme un store, et je mesurais de là, l’étendue, la forme, les cris de la ville : les murs à la verticale de la chaussée, autant de jambes prometteuses de « bonnes confitures », murs de nylon, murs de graines, murs des slips, des moutardes, des consommés à légumes déshydratés, mur des lignes d’aviation comme des bras d’oiseaux à la limite du mur voisin où il n’y a plus de mur mais un montant de ciment et une porte. La porte.
Je finirai bien par le trouver ce style de l’invective. J’ai le papier qu’il faut, et l’encre aussi. J’attends. Les idées sont dans l’homme, toutes. La difficulté c’est tout simplement de les contenir. J’ai en moi un commissariat de police des idées. Il ne chôme jamais : de jour et de nuit, on travaille. Actuellement mes idées sont en Bretagne, près d’une tombe, mes idées ont pris le deuil de mon chien Arkel. Quand elles rentreront je leur demanderai des comptes. Les idées qui se promènent dans la rue sont souvent miennes. Si vous les trouvez, téléphonez à Odéon 84–00. Elles me ressemblent : des idées de chansons, des idées de meurtre, qui sait ? Les chevaux, dans la rue, qui ramassent mes idées et qui me les rendent sont des sages. Avec des idées d’homme ils ne trouvent subitement plus aucun goût à l’avoine et ne comprennent plus. Quelque chose de très important est enrayé dans leur mécanique. Ils sont malades.
J’étais quelquefois tout près de convaincre les imbéciles que la révolte est plus facile à agripper souvent, qu’il est au fond facile à l’automobiliste de brûler un feu rouge à condition de bien regarder ce qui se passe à droite, à gauche, en face, derrière et qui n’en est pas à une contravention près. La révolte est sur le buffet, comme une monnaie d’or : il suffit de se hisser un peu sur les pieds. La révolte c’est tout de même une idée qui est à la portée de vos mains.
Les mains giflent, les mains caressent ; les mains tuent, les mains travaillent. La révolte est manuelle, hommes radio-téléguidés ! Elle est votre lot. Le jour où vous comprendrez l’importance de vos mains, ce jour-là vous serez riches et vous ne ferez plus la guerre en Australasie… Il y a toujours une Australasie qui vous empêche d’être heureux, hommes radio-téléguidés ! II y a toujours une guerre quelque part, comme une esthétique de la politique. Sans la guerre, plus de sublime : il faudra alors s’en remettre à d’autres divertissements, à l’Art, par exemple.
Notre langage à nous autres artistes est à la portée de toutes les oreilles, et de tous les yeux, parce qu’il est chant, lumière, galbe, sourire. C’est donc à nous de préparer votre révolte. Nous écrivons la psychologie de la révolte avec des techniques d’oiseaux. Nous marchons sur le ventre des tyrans avec des pattes d’oiseaux, nous donnons l’alarme avec des cris d’oiseaux. Malheur à ceux qui moquent l’Art, seul ferment devenu possible de vos résurrections. Je ne clamerais que pour un seul que cela vaudrait la peine d’être clamé. J’écris pour moi, s’il le faut, je me fais mon univers de révolté. Enfant déjà, dans mon lit, j’étais un meurtrier, les nerfs en bave à la bouche et je désirais la mort instantanée de mes tyrans d’alors. Depuis, je me suis écarté de la ligne commune et je marche en marge, et je médite dans une tour que je me suis payée avec mes paroles de révolte. J’ai toujours été seul. Aujourd’hui j’accepterai peut-être de me mêler à vous, si vous m’écoutez bien.
D’abord, les journaux. N’en lisez plus, ou bien alors faisons-en un ensemble et dont je serais le rédacteur en chef. Le journal est un poison où s’exténuent les démocraties. Les journalistes sont des démiurges que démange un prurit de littéraire. En achetant un journal vous payez pour votre propre malheur. Le talent de quelques-uns de ces plumitifs n’est jamais à hauteur de votre cœur et flatte tout au plus certaines de vos passions apprises à l’école. Je ne parle pas aux imbéciles, en ce moment, mais aux hommes qui se reconnaîtront à me lire et qui me prennent par le bras comme on prend un ami, son frère. Le journal est votre maître à penser, mais un maître qui sait, un qui connaît la question. Le journal est une idée de financier, c’est aussi le bâton de la puissance. Brûlez le journal, vous brûlerez le bâton, et la puissance s’évanouit. N’oubliez pas qu’en achetant Machin-Soir, tous les soirs, vous achetez un patron portable, que vous installez chez vous et que vous écoutez. Avec celui de l’usine cela fait un peu trop dans la journée. Il vous dit d’aller à Colombes pour le match France-Angleterre. N’y allez pas. Allez plutôt voir les fleurs dans un jardin, même dans un jardin photographié. L’évasion n’est jamais qu’une construction de l’esprit.
Texte paru dans la collection « Poètes d’aujourd’hui », aux éditions Seghers, en 1962
(et repris dans le numéro 9 des Cahiers d’études Léo Ferré)