Texte — légèrement modifié — paru dans le n°4 de la revue papier Ballast (printemps 2016)
Le refrain est connu : nos pays, baignés dans l’illusion des Trente Glorieuses, doivent faire un retour « douloureux mais nécessaire » à la réalité. Ce discours de la nécessité est très répandu : respect des 3 % de déficit, remboursement de la dette, ouverture à la concurrence, équilibre financier, etc. Mais qu’en est-il de la douleur ? Comment la justifier ? Toute la perversité d’un pouvoir, aligné en outre sur l’agenda du capital, se loge là — et elle est sans limite : elle donne au caractère vertueux du courage le sens de l’abattement et de l’inaction. En somme, plus les réformes sont dures socialement, plus nous serions courageux d’accepter leur nécessité. Cette équation est une ritournelle médiatique d’autant plus redoutable qu’elle se base sur un certain bon sens populaire. À l’heure des mobilisations contre les réformes du gouvernement Philippe et forts de l’expérience de ces dernières années (grecque, notamment), levons à nouveau le voile sur ces faux appels au courage. ☰ Par Julien Chanet

Fait 2. Les actes terroristes sur le territoire européen ont généré un ensemble de discours sur le courage. On a salué le courage des forces de l’ordre intervenant sur le terrain et celui des populations sous le choc, des familles et des proches des victimes. S’y sont mêlés la sécurité et son lot de décisions à prendre. Décisions difficiles. Courageuses. Pêle-mêle : interdiction de manifester, lockdown de Bruxelles, perquisitions, assignations à résidence, état d’urgence. À la sécurité s’est joint le sécuritaire, la face la plus sombre du courage politique institutionnel2.
« Pour accéder à la reconnaissance, nous devons nous dépasser : le mérite fait loi. »
Fait 3. Le courage s’inscrit aussi au long cours dans notre quotidien. Face aux épreuves administratives, bureaucratiques, interpersonnelles, nous devons montrer notre capacité à faire front ; pour accéder à la reconnaissance, nous devons nous dépasser : le mérite fait loi. Dans un contexte de crise, la souffrance peut devenir une échelle de mérite. La politique d’accueil des réfugiés divise ; sans cesse, les rumeurs sur leur confort ou sur les allocations qu’ils percevraient doivent être démontées. Une pensée égalitaire dévoyée apparaît, où un lit et un toit temporaire ressemblent à des courts-circuits au regard des épreuves à devoir endurer. Les critères de justice et d’injustice sont relus à l’aune des efforts méritoires, et non plus en termes d’analyse systémique à même de garantir, par le recul, une vision claire des rapports de force et des intérêts des uns et des autres, à hauteur de la société. Bref, c’est une guerre intraclassiste : la guerre des dominés entre eux. La précarité, ou même la crainte qu’elle suscite — puissant dopant des intérêts égoïstes —, alimente cet état d’esprit délétère.

[Richard Vergez]
Le courage : sens commun et ambiguïtés des termes
« Notre ignorance et notre résignation sont les principaux instruments de nos défaites » : c’est avec ces mots que le collectif des Économistes atterrés a communiqué sur Facebook son amertume, en prévision du résultat attendu du Front national et de l’abstention aux élections régionales françaises, le 6 décembre 2015. Le constat est imparable, mais tragique. Le sursaut, dès lors, viendrait-il d’un courage politique ? La formule est tentante, engageante. Insuffler le courage de dépasser ses appréhensions, de lutter, de se prendre en main. Ne plus se résigner à la vie morne de la société de consommation, créer du lien tout en combattant notre bêtise qui, toujours, nous menace. Au carrefour du discours et de l’action politique, le courage, que l’on accueille de prime abord si volontiers, comporte pourtant ses zones d’ombre. Sans doute en ces temps troubles voudrions-nous voir le courage comme étant mobilisateur, réconfortant, valorisant. Mais comme nous le rappelle l’anthropologue Éric Chauvier, « c’est en cassant l’ambiance que le sens apparaît3 ». Tentons de coller à cette proposition, et postulons que poser la question de l’instrumentalisation du courage par le pouvoir apparaît comme un levier indispensable pour désembuer le regard que nous portons sur notre condition de sujets politiques. Autrement dit, suivre des consignes sans les interroger, parce qu’elles nous semblent naturelles, est souvent le meilleur moyen de se résigner — quelquefois sans s’en apercevoir.
« C’est précisément un des éléments du succès de l’hégémonie culturelle du néolibéralisme que de savoir rendre invisibles nombre de ses préceptes et injonctions. »
Les mots, on le sait, peuvent être capturés, tordus, sémantiquement essorés par le pouvoir pour créer une langue officielle, des fictions théoriques et des discours de propagande. Orwell, Klemperer, ou encore Wittgenstein et Chomsky, nous auront averti des usages et mésusages de la langue, de son pouvoir et des principes de légitimation à l’œuvre dans les institutions. Mais avec le courage, et plus précisément son injonction, le pouvoir travaille une matière bien plus plastique et plus sensible que les mots seuls : il vise au cœur des sentiments moraux, de la dynamique des passions. Peu importe ici l’expression utilisée : elle décrit la part inconsciente qui irrigue nos consentements, nos opinions, et apparaît généralement comme constitutive de notre singularité. En d’autres mots, ce qui nous rassemble et nous différencie en tant qu’êtres humains. Le courage — ou la lâcheté — est un trait de caractère que l’on remet rarement en question. C’est par un travail de colonisation des émotions que le néolibéralisme prend ses racines les plus profondes, pouvant se faire oublier au profit, par exemple, du ressenti narcissique. Dans le même ordre d’idée, phagocytant les valeurs de mérite et de compétition, le néolibéralisme se fait l’apôtre de la valorisation symbolique dans l’espace social : les accents, les attitudes, les centres d’intérêt entrent en concurrence sur le marché des « bons comportements ». L’élévation entrepreneuriale de soi, par l’extraction de ses conditions initiales par gain monétaire — tel qu’un (meilleur) salaire —, est essentielle dans l’analyse sociologique du néolibéralisme ; mais les conditions morales du travail à fournir ne le sont pas moins, tant par le regard que l’on porte sur soi que par le regard des autres. Se sentir courageux ou bien se sentir lâche ; être perçu comme courageux ou être perçu comme lâche. Ce qui fait passer la question du courage sous le radar des luttes et de la pensée critique. Mais c’est précisément un des éléments du succès de l’hégémonie culturelle du néolibéralisme que de savoir rendre invisibles nombre de ses préceptes et injonctions — ce qui tend à rendre ce dernier à la fois insaisissable et performant.
C’est, en substance, l’une des thèses de l’ouvrage des sociologues Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme : « Si le capitalisme, non seulement a survécu […], mais n’a cessé d’étendre son empire, c’est bien aussi qu’il a pu prendre appui sur un certain nombre de représentations et de justifications partagées […] qui le donnent pour ordre acceptable et même souhaitable, le seul possible, ou le meilleur des ordres possibles. Ces justifications doivent reposer sur des arguments suffisamment robustes pour être acceptées comme allant de soi par un assez grand nombre de gens, de façon à contenir ou à surmonter le désespoir ou le nihilisme que l’ordre capitaliste ne cesse d’inspirer[…]4. » Les politiques du capital travaillent sans cesse à se rendre vraies, sans hésiter à user de la violence que leur offre l’espace institutionnel des démocraties capitalistes. Mais là où la violence sémantique s’associe à la violence physique, « ou, au moins, à sa menace, pour stabiliser les interprétations, et par là, éloigner le risque de dispute ouverte5 », l’injonction au courage intègre le risque de dispute ouverte — et c’est bien là toute son originalité. L’enjeu devient binaire : soit faire face à l’épreuve (« prendre son courage à deux mains »), soit fuir et être un lâche. Le contenu s’efface et laisse place à la morale.

[Richard Vergez]
L’injonction au courage, gardienne de l’ordre capitaliste
Dans un essai sorti en 2010, intitulé Du courage — Une histoire philosophique6, Thomas Berns, Laurence Blésin et Gaëlle Jeanmart décortiquent cette notion si commune et pourtant polysémique, dans le but de « rendre manifeste la morale du courage et en montrer la diversité, les contradictions, les marges7 ». Le courage est une notion qui évolue et se transforme au contact des valeurs et doctrines qui l’environnent, selon les lieux et les époques. Nous manipulons cet héritage conceptuel par les outils pratiques et les « fictions théoriques8 » qui sont à notre portée. Le courage est dès lors un objet propice à la récupération politique — plus particulièrement, par les politiques du capital. Politiques qui s’alimentent des critiques (en les vidant de leurs arguments les plus aiguisés), ce qui leur permet d’actualiser leurs valeurs et leurs morales sans renoncer à leurs fondamentaux : « Le capitalisme a besoin de ses ennemis, de ceux qu’il indigne et qui s’opposent à lui, pour trouver des points d’appui moraux qui lui manquent et incorporer des dispositifs de justice dont il n’aurait sans cela aucune raison de reconnaître la pertinence9. »
« Le discours de résignation se perpétue par des conventions sociales qui frappent les esprits par leur apparente évidence, telles que
Soyons courageux, c’est plus difficile ailleurs. »
L’injonction au courage intervient lorsque la volonté de mettre en place ces dispositifs de justice — qui eux-mêmes ne permettent pas la remise en cause du modèle capitaliste — dépasse la limite que fixe le pouvoir. C’est ici que le discours sur les vertus peut prendre le relais. Le discours de résignation, qui résulte dès lors de l’injonction au courage, se perpétue par des conventions sociales qui frappent les esprits par leur apparente évidence, telles que « Soyons courageux, c’est plus difficile ailleurs » — et toutes ses déclinaisons possibles. Dans le champ du discours économique libéral, la compétitivité repose d’ailleurs sur cette convention : si d’autres pays sont plus attractifs, c’est qu’il y a de la marge (pour une compression des salaires, pour un allègement des cotisations sociales, etc.)10. Cette expression de force morale, dite de la « comparaison au voisin », est une rengaine politique qui détourne le regard du contenu de la chose à comparer.
Exprimons-le par un exemple éloquent11. Sophia Aram, chroniqueuse à France Inter, a relaté un jour le témoignage d’une femme « déprimée et plongée dans le désespoir par la situation actuelle », minorée socialement, qui se « demande qui a vraiment envie d’avoir 25 ans aujourd’hui ». Son interlocuteur politique, Stéphane le Foll, alors ministre socialiste, s’était fendu d’une réponse qui, pour paternaliste qu’elle fût, n’était en rien délirante ; elle était même l’illustration d’une condescendance — voire d’une obscénité — à la hauteur de l’incapacité politique de prendre en charge les questions sociales : « J’ai regardé un reportage sur la Syrie avec des jeunes du lycée français de Damas. Ils disaient : Nous, on sait ce que c’est d’être en guerre. On voudrait bien que chacun se préoccupe de la guerre qu’on subit.
[…] C’est aussi ce message que je voudrais envoyer à la jeunesse. Que rien n’est jamais acquis. On peut avoir du désespoir, on peut être mélancolique, j’en ai parfaitement conscience, j’ai parfaitement compris. Mais de temps en temps, il faut aussi regarder le monde tel qu’il est. Et que, dans ce pays, on a encore le choix d’être libre, d’avoir la capacité de s’exprimer, de voter, d’écouter de la musique, d’aller sur des terrasses, d’avoir toute cette liberté. Et je pense que c’est magnifique la liberté. La liberté, c’est fragile. » Se voir comparer des revendications minimales d’émancipation à des vies en zone de guerre est un procédé qui en dit long sur les stratégies d’évitement de la question des intérêts divergents des classes sociales.

[Richard Vergez]
Par un rétrécissement du champ des possibles, même le dépassement de cette impuissance se fait au prix d’une adhésion au courage : il nous faut renforcer notre position dans le champ circonscrit par les institutions déjà existantes et jouer le jeu d’une méritocratie largement imaginaire mais fortement normative. Autrement dit, nous sommes enjoints, non pas à travailler de concert à l’émancipation et à l’égalité, mais à chérir les causes et les effets de notre aliénation. C’est en somme ce que nous dit le philosophe Vladimir Jankélévitch, cité par Cynthia Fleury dans son ouvrage La Fin du courage12 : « C’est toute la paradoxologie de la relation méritante que de nous renvoyer ainsi du contradictoire : le mérite est raison inverse de la perfection en acte, c’est-à-dire que plus l’agent est vertueux, moins il est vertueux. » Elle poursuit : « Avec le courage, la paradoxologie continue d’être la loi morale : plus on sera aux confins du découragement et plus l’on sera près du courage. […] C’est parce qu’on flirte avec le manque de courage qu’on connaît son goût et sa nécessité. » Mais Cynthia Fleury, enrôlant Jankélévitch dans sa démonstration visant la « reconquête d’une vertu démocratique », ne pense cependant pas l’institution capitaliste dans ses rapports concrets, et reste enfermée dans une perspective profondément métaphysique.
Une fausse égalité
« Le discours sur l’assistanat, très en vogue, est simple et puissamment évocateur, au point qu’il n’est aucunement le produit exclusif des nantis. »
Le discours sur l’assistanat, très en vogue, est simple et puissamment évocateur, au point qu’il n’est aucunement le produit exclusif des nantis. Certes, il est stigmatisant, mais suffisamment mâtiné de « bon sens » pour qu’il fasse mouche partout où les inconséquences tragiques d’un modèle économique libéral unique13 ont fait leurs ravages. Autant dire qu’à la guerre entre pauvres, qu’un mépris de classe d’une rare violence aura alimenté — cette folklorique « France d’en bas » —, s’est ajouté un imaginaire méritocratique du besogneux. Le courage est un effort vertueux, volontaire : « Si on veut, on peut. » Pourtant, il y a malaise, mal-être entre le discours et sa réalisation. La dissonance est éprouvante, quand toute une éthique de vie basée sur la valeur travail, formatée par les conditions de la reproduction matérielle, rencontre la crise économique, les faillites qui s’ensuivent, le chômage de longue durée, les emplois pénibles et les paies indignes. Une échappatoire à sa propre impuissance, en forme de métadiscours, consiste à « faire de nécessité vertu », à jouer le jeu jusqu’au bout. Une logique s’installe. Pourtant, le sociologue Pierre Bourdieu écrivait déjà : « Les véritables révolutions symboliques sont sans doute celles qui, plus que le conformisme moral, offensent le conformisme logique, déchaînant la répression impitoyable que suscite pareil attentat contre l’intégrité morale14. »
La pression inconfortable qu’implique cette dissonance s’évacue dans un second temps vers des boucs émissaires qui ne respectent pas la logique suivante : celle de l’effort qu’il s’agit nécessairement d’entreprendre. Lutter contre la logique capitaliste, ce n’est pas seulement lutter contre la logique de l’extraction de la plus-value, c’est aussi lutter contre une logique conservatrice, ankylosée par le poids de son évidence, de son « bon sens ». Les injonctions, produites notamment par le marché de l’emploi, se cristallisent dans un discours populaire. Ce dernier peut, dès lors, malheureusement épargner le self-made-man richissime ou le « capitaine d’industrie » car « il a mérité son argent, il a travaillé pour ». En conséquence de quoi, le travail — encapsulé dans cet imaginaire — lisse tous les rapports de classes et devient à la fois la ligne de fracture et l’élément central d’une égalité dévoyée : « Il faut arrêter de jouer les bons samaritains, de mettre les aides sociales… et nous on est obligés de travailler combien d’heures par mois et on n’a jamais rien ! » ; « Ils se croient tout permis et ils pensent que tout leur est dû » ; « On voit des gens qui ne se lèvent pas le matin, qui ne bossent pas. » ; « Il y en a marre de se lever à 6 heures tous les jours pour travailler alors que d’autres gagnent la même chose à ne rien faire15 ».
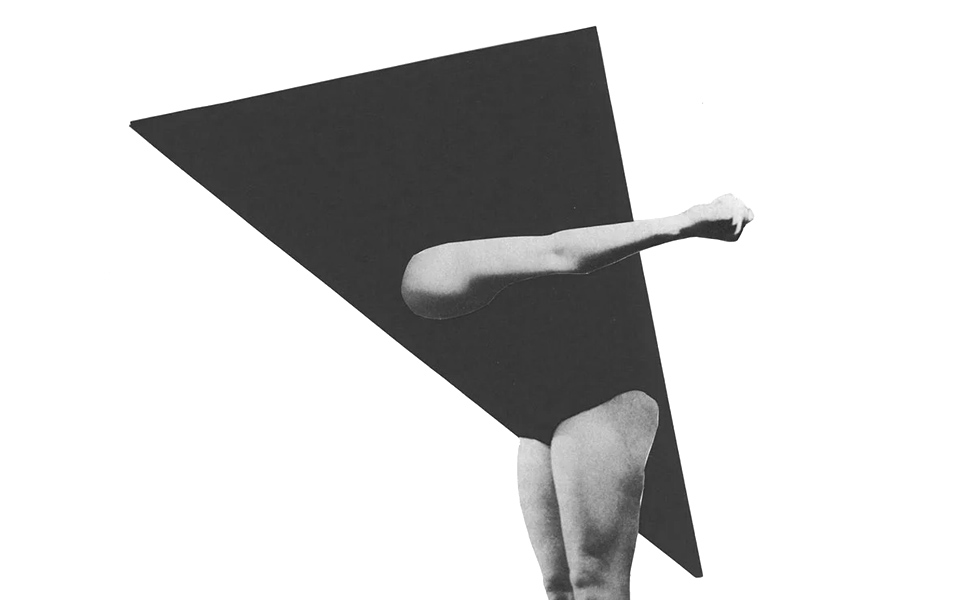
[Richard Vergez]
« Le courage de réformer »
De ces considérations sur le corps social, prenons la tangente, et voyons comment l’injonction au courage est promue par les politiques du capital et ses relais institutionnels. Le terme de « réforme » est depuis longtemps analysé par les discours critiques, où il n’est plus que synonyme d’agression contre les conquêtes sociales des mouvements progressistes syndicaux, associatifs, ouvriers. La profusion de livres portant sur la question sémantique16 témoigne de la persistance et de l’efficacité de la propagande néolibérale. Cependant, le phénomène de répétition inscrit dans le discours dominant est aussi le signe d’une incomplétude des institutions qui lui sont accolées : ces dernières, de manière générale, « sont acculées à la tâche de redire sans cesse ce qu’elles veulent dire, comme si les affirmations les plus péremptoires et, en apparence, les plus imparables étaient toujours confrontées à la menace du déni, ou encore comme si la possibilité de la critique ne pouvait jamais être complètement écartée17. »
« L’injonction au courage est donc le mécanisme agissant qui permet au discours prônant le
courage de réformerde trouver cet équilibre toujours précaire entre sémantique et pragmatisme. »
Mais s’arrêter à la question sémantique — ici, la question de la réforme en tant qu’idéologie —, c’est manquer l’élément pragmatique qui fera que cette réforme prendra dans l’espace public. Cet élément pragmatique, qui se doit d’être commun et rassembleur, passe par l’injonction au courage. En d’autres mots, le discours réformiste (qui est objet de débat) prônant la nécessité du changement, et venant d’en haut, doit s’ancrer le plus naturellement possible dans notre quotidien pour espérer être entendu. Le naturel, ne faisant, lui, pas débat. L’injonction au courage est donc le mécanisme agissant, pourvoyeur de réel, qui permet au discours prônant le « courage de réformer » de trouver cet équilibre toujours précaire entre sémantique et pragmatisme. Ce qu’une simple recherche préliminaire [réforme + courage] sur Google vérifie rapidement, donnant un tombereau de résultats. Le courage « audacieux » d’Emmanuel Macron, s’attaquant aux « tabous », « blocages », « freins », pour « faire avancer », « moderniser », « adapter », ou encore « assouplir » la société française, synthétise la majorité du contenu des résultats de cette recherche. Dans cette même ligne, deux livres de catéchisme libéral apparaissent en tête des résultats18). La tribune du Mouvement des jeunes socialistes plaidant pour le « courage de la réforme19 », le discours de politique générale d’un Manuel Valls (« Le courage de gouverner, le courage de réformer », 16 septembre 2014.), ou encore les réformes « courageuses » de l’Allemagne, ne laissent planer aucun doute : il faut du courage pour réformer.
Confirmation avec une intervention de Bruno Leroux — alors président du groupe socialiste à l’Assemblée — sur David Cameron, particulièrement éclairante : déclarant que si le conservateur britannique est arrivé en tête lors des dernières élections, c’est parce qu’il a eu le « courage de réformer ». Il ajoutait : « J’en tire une leçon : c’est que, quand on a le courage de réformer, ça peut payer au niveau de l’opinion publique20. » Le succès politique, dans le cadre électif, serait donc tributaire de la mise en œuvre — courageuse — des réformes, elles-mêmes courageuses. À cette référence à David Cameron par Bruno Leroux s’ajoute celle d’Emmanuel Macron à Margaret Thatcher quelques mois plus tard21.

[Richard Vergez]
François Hollande s’est lui aussi avancé sur cette ligne — faire appliquer des mesures de droite par un gouvernement de gauche — quand il déclarait dans les pages du Monde, le 31 octobre 2012, à propos de sa volonté de réformer la France : « Je pense que, pour la France, c’est mieux que ce soit la gauche qui fasse cette mutation, qu’elle le fasse par la négociation, dans la justice, sans blesser les plus fragiles ni les déconsidérer. Les autres l’auraient fait sans doute, mais brutalement22. » Cela pose un cadre cohérent : toutes les réformes ne sont pas bonnes en soi. Et si choisir, c’est renoncer, le gouvernement français — la gauche dite « responsable » — a choisi : les réformes de la finance, la séparation des activités banques-assurances, la taxe Tobin et les outils anti-paradis fiscaux sont torpillés.
« Et si choisir, c’est renoncer, le gouvernement français a choisi : les réformes de la finance, la séparation des activités banques-assurances, la taxe Tobin et les outils anti-paradis fiscaux sont torpillés. »
Cohérence également avec notre définition de l’injonction au courage. Voir un manque de courage à ne pas appliquer ces réformes, c’est encore se tromper de cible : l’injonction au courage n’est pas le courage politique de sens commun. Il s’agit d’instaurer un état d’esprit propice à accepter les difficultés inhérentes aux décisions prises. Dans leur article sur la production de l’idéologie dominante23 (1976), Pierre Bourdieu et Luc Boltanski résument ce qui apparaît comme une doctrine du pouvoir : « Le discours dominant sur le monde social n’a pas pour fonction seulement de légitimer la domination mais aussi d’orienter l’action destinée à la perpétuer, de donner un moral et une morale, une direction et des directives à ceux qui dirigent et qui le font passer à l’acte. » Le courage de réformer le Code du travail par exemple, pour « stimuler la croissance et l’emploi », est cohérent avec la décision de ne pas mettre en œuvre la réforme bancaire — celle-ci risquant de « casser la croissance » (selon l’avis du lobby bancaire auquel s’est raccroché le gouvernement) — et constitue dès lors cette « directive », au sens évoqué par Bourdieu et Boltanski.
Le cas de la Grèce : un courage destructeur
La Grèce de Syriza, l’Europe néolibérale, les mémorandums, les réformes, les affrontements institutionnels autant que personnels, le tout commenté par la caste médiatico-politique et universitaire mondiale : autant dire que la séquence ouverte en janvier 2015 (élection de Syriza) et refermée le 16 juillet avec la signature à l’arraché du bailout24 aura été pour le moins haute en couleur — et faite de discours, de comportements, de réactions qui permettent d’illustrer notre propos. Cette crise aura mis en émoi le personnel médiatico-politique au point qu’au cours des derniers mois de négociations, il fut difficile de savoir si nous, lecteurs et spectateurs, devions louer ou craindre Tsípras. Au terminus des affrontements institutionnels entre l’Europe et la Grèce, ce sont sans doute les mots de Laurent Joffrin (directeur de la rédaction de Libération) qui résumèrent le mieux l’état d’esprit de ses congénères éditocrates : un sentiment de soulagement. Parlant de la signature de l’accord, Joffrin salua le courage de celui qui aurait fini par lui donner raison : Alexis Tsípras, « homme d’État responsable qui fait la part du feu au nom de l’intérêt national ». D’autres, moins centristes, auront à cœur de parler de « coup d’État financier », voire de « capitulation ».

[Richard Vergez]
Le courage est ici lié à une position « responsable » — pourtant, ce terme a été peu entendu après l’annonce du précédent référendum : le gouvernement grec a, au contraire, été qualifié de tout, sauf de « courageux » ou de « responsable ». Dans le même ordre d’idée, le courage de négocier face à une eurozone hostile ne fut jamais mis en avant dans la presse mainstream, quand bien même l’état du rapport de force était objectivement décrit. Encore une fois, le courage ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’anticiper une décision inévitable, surtout si l’on sait qu’elle causera, par euphémisation, quelques désagréments à la population. Même son de cloche « responsable » du côté de François Hollande — à la manœuvre durant le dernier round, véritable facilitateur entre acteurs allemands et grecs —, qui salua « le choix courageux » de Tsípras : « Il a été élu sur un programme très à gauche et se retrouve à porter des réformes très difficiles, il a été courageux. » À la violence brutale des institutions européennes — formelles et informelles —, le président français joua une partition plus feutrée, arrivant d’autant mieux à faire avaler les couleuvres qu’elles furent épaisses25.
« En un parallèle troublant avec le courage chrétien, la Grèce — intrinsèquement, voire presque congénitalement fautive — se devait d’expier ses péchés. »
Avec l’optimisme qui le caractérise, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, mit également en avant la bravoure du dirigeant grec, semblant prendre la signature d’un accord comme étant de facto une bonne nouvelle : « Si un accord est signé, c’est grâce au courage d’Alexis Tsípras. » Étrange formule, qui renversait les rôles des acteurs en désignant ce dernier comme meneur de négociations — sa position de faiblesse était pourtant avérée, au lendemain de son revirement post référendum. Nigel Farage (UKIP), néoconservateur anglais et chantre du Grexit, usa également du terme, sur le mode de l’interpellation : « M. Tsípras, si vous en avez le courage, vous devriez sortir le peuple grec de la zone euro, la tête haute. » Et l’on n’oubliera pas de mentionner Guy Verhofstadt, président du groupe ALDE (libéral) au Parlement européen, qui, dans une intervention à la grandiloquence presque gênante, implorait littéralement Tsípras de mener à bien toutes les réformes promises… Sans émettre le moindre jugement à l’égard de ces réformes, l’eurodéputé libéral exigeait du Premier ministre grec un courage politique hors-sol, faisant fi du temps politique délibératif et exécutif, considérant de fait Tsípras comme un autocrate omniscient. Du côté de l’Eurogroupe, on relèvera également une déclaration du Premier ministre slovaque, saluant le plan courageux du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaüble, consistant à exclure la Grèce de l’eurozone pour une période de cinq ans26. Mais de quel courage parle-t-on ? Du courage d’un homme politique qui, sans même tenir compte de ses errements et de ses erreurs stratégiques, aura été contraint d’accepter un accord qualifié d’« indigne », « scandaleux » et « désastreux » par des figures intellectuelles aussi peu révolutionnaires que Jürgen Habermas, Paul Krugman et Joseph Stiglitz. Autant dire que l’on dépasse le strict point de vue économique pour appréhender des questions à valeur historique, où l’impression d’assister à un saut qualitatif dans le déroulement des événements est susceptible de laisser une trace qui, on le sait, pourra provoquer le retour du stigmate. Une telle dévalorisation peut être la source d’un ressentiment aux conséquences difficilement prévisibles. Ainsi va l’Europe et ses rêves de concorde.
À la domination politique qu’impliqua la signature de l’accord mémorandaire, la rhétorique du courage se révéla être une humiliation. En un parallèle troublant avec le courage chrétien, la Grèce — intrinsèquement, voire presque congénitalement fautive — se devait d’expier ses péchés. Et de « l’examen intime de l’âme » ne pouvait ressortir que la source du mal : « La morale chrétienne a engagé une éthique de l’humilité considérant l’homme comme un pécheur ayant à en prendre conscience pour combattre plus efficacement et plus lucidement le mal qui l’habite27. » Bien que conscient des limites des comparaisons anachroniques, l’on ne trouvera pas de description plus juste de la visée politique, voire idéologique, de l’Eurogroupe à l’encontre de la Grèce que ce commentaire décrivant le rappel à l’humilité de l’homme pécheur dans les Confessions de saint Augustin : « La poigne du seigneur maintient ferme le pécheur, le nez sur l’immondice, comme la truffe du chien sur l’excrément coupable, encore un peu, qu’il lui devienne odieux et qu’il ne recommencera plus28. »

[Richard Vergez]
Ce à quoi nous aurons à nouveau droit, c’est à l’indigence des réponses apportées. Car ce qui se décide dans les cénacles feutrés des institutions européennes se répercute sur toute une population. Le courage dont aurait fait preuve le Premier ministre grec en capitulant ne peut se lire dans l’abstrait des articles de presse ou des commentaires politiques, où la préservation de quelques fétiches — tel que l’euro ou la dette — compte plus que le sort de la population. Le « dire vrai », si souvent mis en avant par les réformistes (« Il faut avoir le courage de dire la vérité aux Français. ») est une instrumentalisation à vocation pédagogique de la volonté et de la nécessité. Il faut vouloir un changement inévitable, douloureux mais nécessaire. Le courage de dire vrai, la franchise, la parrêsia29, furent instrumentalisés, enfermant le débat dans — au mieux — les dérapages budgétaires de la Grèce, et — au pire — dans le supposé penchant insatiable, voire génétique, du Grec pour la fraude, le vol et le farniente. Une autre vérité, c’est ce qui résulte réellement de ce courage, c’est-à-dire la poursuite d’une austérité ayant déjà démontré son caractère destructeur. Le principe de responsabilité collective prend l’ascendant sur le caractère — théorisé par Hannah Arendt — fondamentalement imprédictible d’une action. Celle-ci prenant dès lors place dans le creuset des actions passées, les relations de cause à effet peuvent être identifiées. Les conséquences de ce courage, présentées dans leur réalité crue, sans misérabilisme, rendent toutes manifestations de contentement particulièrement déplacées. Parlons cru : l’austérité tue. Les laudateurs du courage dont aurait fait preuve Tsípras sont donc à ranger du côté des inconscients et des bourreaux. L’austérité tue, et souvent en silence. Nous renvoyons le lecteur à une étude du journal médical britannique The Lancet, disant en résumé ceci : les conséquences sanitaires des politiques austéritaires sont dramatiques. Épidémies, réapparitions de maladies comme la malaria ou la dengue, dépressions, suicides30.
« Les conséquences de ce courage, présentées dans leur réalité crue, sans misérabilisme, rendent toutes manifestations de contentement particulièrement déplacées. Parlons cru : l’austérité tue. »
Il est intéressant de noter, avec un recul qui oblige au bilan, que nous — un très large « nous », d’ailleurs — avons projeté, en solidarité tant politique que morale, du courage sur Tsípras, sur Varoufákis, tant les raisons d’espérer s’étaient faites rares ces dernières années. Mais cet élan fut pris en étau entre passion politique (surtout) et raison analytique (un peu moins). Refroidis par les concessions successives, enhardis par un référendum mais toujours proportionnels aux épreuves que durent subir les responsables grecs, nos encouragements témoignaient autant d’un besoin de construction de figures héroïques que de notre volonté de faire front, face aux attaques des tenants de l’ordre économique européen. Les mois et les années ont passé ; désormais, Tsípras, bien d’avoir modifié les rapports de force, use de cette même terminologie : le « courage politique » ayant consisté à ne pas « précipiter la Grèce dans l’inconnu » et à « assum[er] les responsabilités ». Une nouvelle incarnation du discrédit de la parole politique.
Ne renoncer à rien
Pour parler des luttes sociales, le champ lexical médiatique mobilise largement la notion d’endurance : « la contestation s’essouffle », « le mouvement perd en intensité », etc. C’est d’ailleurs bien souvent le cas. L’économiste Frédéric Lordon fait remarquer que le pouvoir — synonyme de notre dépossession politique — nous fatigue. « Car la sortie de la passivité réclame son supplément d’énergie. Et les pratiques de la réappropriation ne commencent qu’après les huit heures de la vie professionnelle — effet pratique, extrêmement prosaïque et concret, mais écrasant, de la division du travail politique31. » Un encouragement à la critique, trop appuyé, mal contextualisé, a peu de chances d’aboutir. Les démocraties capitalistes ont séparé jusqu’à l’absurde gouvernants et gouvernés. Et si l’autonomie quasi autistique des premiers est bien documentée par la gauche critique, il est moins dit des seconds qu’ils risquent la catatonie politique suite aux réflexions en vase clos et aux impératifs idéologiques qui en découlent32. Reste à se constituer un arsenal émancipateur qui ne conduise pas à la frustration, celle de l’impuissance individuelle, et soit en mesure de forger une conscience et une pratique collectives — à chacun selon ses capacités d’action — passant par le refus de la logique de l’injonction au courage. Pour mieux se réapproprier un courage proprement politique, et non plus normatif et réactionnaire. Un courage intime et quotidien, politique sans être politicien, constitutif d’une communauté plus ou moins imaginaire : une cartographie mentale de la lutte et de la résistance que chacun se construit au contact du collectif, suivant ses propres complexions33, afin de réinvestir les possibles latéraux — autrement dit, d’ouvrir des alternatives contradictoires et désobéissantes.
- Désigne des dispositifs institutionnels et bureaucratiques qui, sur base d’un pouvoir rationnel-légal, reproduisent ou mettent en œuvre les conditions et structures sociales favorables à la reproduction du capital. Sa forme contemporaine, le néolibéralisme, peut être entendue comme totalitaire dans sa visée normalisatrice, mais non-totalisante dans sa pratique, dans le sens où des espaces de compromis et d’insoumission coexistent. Les « politiques du capital », passant notamment par la puissance de l’État, sont la conséquence de cette subordination incomplète aux rapports sociaux de production du capitalisme — et un de leurs objectifs est la recherche d’évitement de la sédition, c’est-à-dire promouvant des politiques de rassemblement mais sous l’onction capitaliste. L’injonction au courage y participe.[↩]
- Voir le travail de l’association de défense des droits et libertés des citoyens, sur Internet, la Quadrature du Net, fournissant un recensement des possibles abus liés à l’état d’urgence en France, après les attentats de Paris (2015).[↩]
- Éric Chauvier, Les Mots sans les choses, Éditions Allia, 2014.[↩]
- Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 2011, pp. 44–45.[↩]
- « […] la violence sémantique, opérée dans la texture du langage afin d’en fixer les usages et d’en stabiliser les références, n’est pas suffisante pour réaliser la conformation des conduites, en sorte qu’il faut toujours, ou presque, l’associer à une violence physique ou, au moins, à sa menace, pour stabiliser les interprétations et, par là, éloigner le risque de dispute ouverte. » Luc Boltanski et Ève Chiapello, ibid., p. 144.[↩]
- Thomas Berns, Laurence Blesin, Gaëlle Jeanmart, Du Courage — Une histoire philosophique, Encre Marine, 2010.[↩]
- Ibid., p. 13.[↩]
- « […] soit un modèle conceptuel surplombant plaqué sur le vécu de chacun au point de rendre celui-ci inexprimable. » Éric Chauvier, op.cit., p.25.[↩]
- Luc Boltanski et Ève Chiapello, op.cit., p. 72.[↩]
- « Concernant la France, la rengaine est connue : notre pays souffrirait d’un déficit de compétitivité dû à un coût du travail trop élevé. Les pertes de parts de marché et la comparaison avec l’Allemagne sont évoquées pour justifier ce diagnostic, le patronat prônant un « choc de compétitivité » basé sur un allègement massif des cotisations sociales. » dans Thomas Coutrot, Jean-Marie Harribey, Norbert Holcblat Michel Husson, Pierre Khalfa, Jacques Rigaudiat, Stéphanie Reillet, En finir avec la compétitivité, Attac, Fondation Copernic, octobre 2012.[↩]
- Aude Lorriaux, « La leçon de morale de Stéphane Le Foll à une femme au RSA, symbole de la déconnexion des politiques », Slate.fr, 14 décembre 2015.[↩]
- Cynthia Fleury, La Fin du courage : la reconquête d’une vertu démocratique, Le Livre de poche, 2011.[↩]
- Connu sur l’acronyme TINA, pour « There Is No Alternative », attribué à la Première ministre conservatrice du Royaume-Uni (1979–1990), signifiant qu’« il n’y a pas d’alternative » à l’économie de marché, à la mondialisation et au capitalisme.[↩]
- Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Éditions Points, 1996, p. 103.[↩]
- Patrick Artinian, « Nationale 43 : sur la route du FN à 50 % (et plus) », Mediapart, 12 décembre 2015 et «
Marine… qu’est-ce qu’on risque à l’essayer ?
: Paroles de néolepénistes », L’Obs, 4 décembre 2015.[↩] - Entre autres : Gérard Mauger, Repères pour résister à l’idéologie dominante, Édition du Croquant, 2013 ; Alain Bihr, La novlangue néolibérale : la rhétorique du fétichisme capitaliste, Les Éditions Page deux, 2007 ; Mateo Alaluf, Contre la pensée molle — Dictionnaire du prêt-à-penser, Édition Couleur livre, 2014 ; Pascal Durand, Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique, Aden Éditions, 2007 ; Éric Hazan, LQR, la propagande du quotidien, Raison d’agir, 2010 ; Thierry Guilbert, L’« évidence » du discours néolibéral. Analyse dans la presse écrite, Édition du Croquant, 2011.[↩]
- Luc Boltanski, op.cit., p. 151.[↩]
- Le Courage de réformer (Claude Bébéar, 2002) et Le Courage du bon sens (Michel Godet, 2009[↩]
- Grégoire Chapuis, Jade Dousselin, Jérémy Pinto, « Le courage de la réforme », Le Huffington Post, 1 octobre 2014.[↩]
- Michel Soudaix, « Bruno Le Roux ou l’art d’être du côté du manche », Politis, 9 mai 2015.[↩]
- Jérome Latta, « Emmanuel Macron en flagrant délit d’apologie du thatchérisme », Regards, 25 mars 2015.[↩]
- Cité par Christian Salmon, La cérémonie cannibale. De la performance politique, Pluriel, 2014. p. 96.[↩]
- Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, « La production de l’idéologie dominante », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 2, n° 2–3, juin 1976, 3–73.[↩]
- Littéralement : renflouer. Dans le cas présent : décision politique ayant conduit à remettre les banques grecques à flots, mais au prix d’un code de conduite austéritaire.[↩]
- Comme le rapporte Médiapart, François Hollande réitère cet appel au courage dans son livre Les Leçons du pouvoir (2018). Le journal en ligne nous apprend que l’ancien président se voit comme celui « qui a aidé Alexis Tsípras à avaler
courageusement
la pilule du plan de sauvetage de la Troïka. »[↩] - Gabriele Steinhauser, « Schäuble’s Timeout Plan for Greece Was ‘Courageous,’ Says Slovak Minister », The Wall Street Journal’s Brussels blog, 15 juillet 2015.[↩]
- Thomas Berns, Laurence Blesin, Gaëlle Jeanmart, op.cit., p. 100.[↩]
- Ibid. p.102.[↩]
- « Il y a ce que Foucault appelle le
pacte parresiastique
: la parrêsia montre le courage d’un individu qui se lie à une vérité à laquelle il croit en disant cette vérité envers et contre tout, et celui à qui elle est adressée doit en retour montrer de la grandeur d’âme en acceptant cette vérité difficile à entendre parce qu’elle est sans compromis et sans flatterie. » Thomas Berns, Laurence Blesin, Gaëlle Jeanmart, op.cit., p. 76.[↩] - Marina Karanikolos, Philipa Mladovsky, Jonathan Cylus, Sarah Thomson, Sanjay Basu, David Stuckler, Johan P. Mackenbach, Martin McKee, « Financial crisis, austerity, and health in Europe », The Lancet, vol. 381, 13 avril 2013, pp. 1323–1331. Citons également : David Stuckler et Sanjay Basu, Quand l’austérité tue. Épidémies, dépressions, suicides : l’économie inhumaine, Éditions Autrement, 2014. Karen McVeigh, « Austerity a factor in rising suicide rate among UK men-study », The Guardian, 12 novembre 2015.[↩]
- Frédéric Lordon, Imperium — Structure et affect des corps politiques, La Fabrique, 2015, p. 198.[↩]
- Ce qui est visé ici, ce sont par exemple les incitations impérieuses à la critique ou au débat, qui, aussi pertinentes soient-elles, peuvent venir renforcer un paradoxe : répondre à la nécessité d’être critique tout en restant soumis (même peu, voire en y trouvant quelque agréable confort) à l’ordre dominant — vivre dans une grotte : seule échappatoire à ce paradoxe.[↩]
- « La complexion entend saisir dans sa complexité l’entrelacs des déterminations physiques et mentales qui font l’originalité d’une vie singulière. La complexion représente ainsi l’incorporation d’un nœud de dispositions façonné par l’histoire individuelle. », dans Nicolas Martin-Breteau, « D’une classe à l’autre ». À propos de : Chantal Jaquet, « Les Transclasses, ou la non-reproduction », La Vie des idées, 26 décembre 2014.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « L’émancipation comme projet politique », Julien Chanet, novembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Yanis Varoufakis : « Que voulons-nous faire de l’Europe ? », septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Stathis Kouvélakis : « Le non n’est pas vaincu, nous continuons », juillet 2015
☰ Lire notre entretien avec Cédric Durand : « Les peuples, contres les bureaucrates et l’ordre européen », juillet 2015
☰ Lire notre article « Grèce — L’Europe agit comme si elle était en guerre contre les Grecs
», Gwenaël Breës, juillet 2015


