Entretien inédit pour le site de Ballast
Amandine Gay a cofondé le Mois des adopté·e·s en 2018, dans le but d’ouvrir un espace d’échange et d’accueil pour les personnes adoptées et leurs parents. L’occasion de « remettre au cœur du débat public le sujet de la filiation et de la transmission », d’œuvrer collectivement à de nouvelles modalités de faire famille. Cette initiative a conduit la réalisatrice à la création de son deuxième documentaire, Une histoire à soi, et d’un livre, plus personnel, à paraître en septembre 2021, Une poupée en chocolat. Dans cette seconde partie, elle interroge la prise en charge des questions familiales au sein des mouvements de contestation sociale et réfléchit à la place que pourraient occuper les penseurs des Caraïbes pour travailler à l’émancipation.

Il y a aujourd’hui une corrélation entre classe et adoption. Dans les années 1980, les choses étaient moins régulées et il n’était pas obligatoire, dans certains pays, de se déplacer pour aller chercher l’enfant. Jusque dans les années 1990/2000, il y avait des enfants qu’on récupérait simplement à l’aéroport. Ça concernait alors des familles de petites classes moyennes. Aujourd’hui, en conséquence de la Convention de La Haye, un principe de double subsidiarité a été mis en place : il impose un cadre au pays de départ de l’adoption internationale comme au pays d’arrivée. C’est un grand changement car ça force le pays de départ à justifier par exemple d’un manque de ressources ou de services sociaux compétents capables, localement, de prendre en charge les enfants. Et ça impose aussi de déterminer des règles en fonction de la société et de son rapport spécifique à l’adoption. Par exemple, la Colombie s’est fermée à l’adoption internationale sauf si les demandes émanent de ressortissants colombiens. Les processus se sont complexifiés. Adopter à l’international sans visiter le pays de son enfant est devenu assez peu probable. Certains pays exigent même que les parents résident un certain temps dans le pays de départ. Tout ça demande évidemment plus de moyens.
« Aujourd’hui, on dénombre davantage de personnes appartenant à la classe moyenne supérieure, c’est-à-dire ayant les capacités financières pour adopter. »
Ensuite, il y a la question des préférences raciales, et là on tombe dans une réalité qui n’est pas étayée par des chiffres. Il est tout de même possible de les deviner à partir du coût moyen d’une adoption internationale — il ne s’agit pas du coût de l’achat d’un enfant mais des frais administratifs, des billets d’avion… Ce coût moyen est accessible sur le site du ministère des Affaires étrangères de tous les pays où l’adoption internationale est possible. C’est là le reflet d’un marché reposant sur l’offre et la demande, en parallèle de difficultés plus ou moins importantes imposées par le pays de départ de l’adoption. Au Canada, on adopte beaucoup d’enfants venus de Corée du Sud, mais en d’autres temps on y adoptait plus d’enfants originaires d’Haïti. Pour la Corée du Sud, la demande est forte. Seuls les parents adoptants pourraient en donner les raisons : les enfants asiatiques étant souvent perçus comme appartenant à une « minorité modèle », on peut imaginer que ça impacte les demandes.
Concernant Haïti, suite au séisme et à nombre de dérèglements et de tentatives de faire sortir les enfants de manière illégale, le pays a fermé ses portes à l’adoption internationale entre 2010 et 2013. Ça a mis des parents en attente. Haïti est devenu l’un des pays les plus difficiles d’accès pour l’adoption et, de fait, plus cher pour les parents adoptants. Historiquement, aux États-Unis, où c’est documenté, il est plus facile et moins coûteux d’adopter localement un enfant afro-américain ou métis. De manière plus générale, on peut rappeler que la Convention de la Haye a posé de plus grandes restrictions sur les conditions de l’adoption internationale, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter ses coûts. Aujourd’hui, on dénombre davantage de personnes appartenant à la classe moyenne supérieure, c’est-à-dire ayant les capacités financières pour adopter.

[Maya Mihindou | Ballast]
Vous avez choisi d’arrêter le film sur le commentaire de Mathieu, adopté au Brésil : il dit explicitement qu’il faudrait que l’adoption soit avant tout une affaire gérée localement, à l’intérieur des États, pour éviter les conséquences difficiles de trop grands déplacements géographiques. Est-ce un ressenti largement partagé par les personnes adoptées ?
Il est certain que quand tu es un adopté issu du Brésil et que tu as grandi en Picardie, tu te demandes un peu pourquoi on t’a mis dans ce plan. (rires) Ce ressenti repose parfois sur des choses très triviales. C’est à géographie variable, ces questions de déracinement. Mais, d’une manière générale, il y a en commun ce sentiment d’acculturation, de ne jamais appartenir complètement ni à son pays d’origine, ni à celui dans lequel on a grandi. Si on demande à des femmes qui ont été adoptées en Corée du Sud ce qu’elles ressentent d’être retournées dans leur pays d’origine, il y a fort à penser que leurs réponses seront encore différentes. La Corée du Sud est un pays extrêmement capitaliste et patriarcal, avec une pression monstrueuse mise sur les femmes et les enfants pour qu’ils soient performants. C’est un pays qui n’appartient plus aux « Sud », justement, qui est à présent riche et « développé ». Ce qui est à l’origine de l’adoption massive en Corée du Sud, ce n’est pas la pauvreté mais le patriarcat. Car c’est une société qui continue à stigmatiser les mères célibataires, qui refuse de leur donner les aides sociales qui leur permettraient de garder leurs enfants, tout en stigmatisant les enfants et les mères.
« Et oui, nous pensons qu’effectivement, ça reste mieux de pouvoir grandir dans son pays et sa communauté d’origine. »
De nombreuses femmes continuent d’être forcées de se séparer de leurs enfants, même quand elles veulent le garder. Joohee, dans le film, affirme que notre rôle en tant adopté·es est aussi de militer sur place pour que des moyens soient alloués aux mères célibataires afin qu’elles ne soient pas poussées à abandonner leurs enfants. Il nous faut questionner la gestion des services sociaux — quand il y en a — dans les pays d’où viennent les enfants adoptés. Les raisons d’un abandon sont-elles toujours liées à la pauvreté ? N’existe-t-il pas des préjugés sur tel ou tel pays en matière d’adoption ? C’est ce que nous questionnons aussi dans nos mobilisations. Nous voulons lutter contre les adoptions internationales illégales. Et oui, nous pensons qu’effectivement, ça reste mieux de pouvoir grandir dans son pays et sa communauté d’origine.
Qu’est-ce qui peut être mis en place en prenant en compte l’état politique, économique et social du pays d’origine ? À chaque pays, une réponse différente. Il y a des actions à entreprendre pour faire baisser la nécessité des adoptions à l’international dans chaque pays d’origine. Il y a des choses à faire en France aussi, du côté de l’État, concernant le personnel d’associations d’adoption ayant pris part à des pratiques opaques, voire illégales. Les adultes adoptés au Mali qui ont porté plainte l’an dernier contre l’association Le Rayon de soleil de l’enfant étranger1 ont été déboutés. Ils ont à nouveau porté plainte après avoir pu affirmer, accompagnés des parents adoptants, qu’une association encore en exercice en France avait organisé des adoptions illégales. Comment des associations régulièrement impliquées dans des scandales de trafic d’adoption peuvent-elles encore être agréées par l’État français ?

[Maya Mihindou | Ballast]
Une partie de votre réflexion interroge ce qui fait famille. Vous en avez discuté longuement lors d’un échange avec la journaliste Alice Coffin2. Vous affirmiez que le féminisme de gauche a longtemps laissé de côté les questions liées à la parentalité, et a manqué l’occasion d’en faire une discussion centrale quand était débattu le « Mariage pour tous ». Ça a changé, depuis ?
Je vois effectivement que ça bouge. Mais il faut prendre le taureau par les cornes. Au début, quand j’ai annoncé que nous allions aborder ces questions au cours du Mois des Adopté·e·s, des militantes m’ont fait remarquer que c’était possiblement lesbophobe et se demandaient pourquoi nous reprenions les thématiques de la Manif pour tous. Mais ce ne sont pas les thématiques de la Manif pour tous ! Ça devrait être aussi nos thématiques. C’est depuis 2018, après la sortie d’Ouvrir la voix, que mon investissement s’est tourné vers la justice reproductive3. Je le dis dans l’introduction de l’échange avec Alice : il est nécessaire de décorréler les fonctions reproductives de l’identité « femme ». C’était important dans les années 1970, oui, mais maintenant il faut reprendre le sujet en main ! On ne peut pas laisser ces réflexions sur la famille à l’extrême droite ! Et c’est ce qui nous coupe d’un certain nombre de solidarités avec d’autres mouvements.
« On ne peut pas laisser ces réflexions sur la famille à l’extrême droite ! C’est ce qui nous coupe d’un certain nombre de solidarités avec d’autres mouvements. »
J’aime ce concept de justice reproductive car il implique qu’on réfléchisse sur les techniques de stérilisation, l’avortement, l’accès à la contraception, mais aussi sur les placements en foyer, et tout un ensemble d’autres sujets appartenant aux violences systémiques et aux discriminations raciales, sexistes, etc. Pour moi c’est important car on en revient à la question du continuum colonial. Prenons par exemple la question des mineurs isolés étrangers en France. Pendant le premier Mois des Adopté·e·s, on avait organisé une table ronde avec un mineur isolé étranger, une avocate, Françoise Vergès et moi. La conversation portait là-dessus : quels enfants sont les bienvenus en France ? Une personne adoptée à l’international et un mineur isolé logé dans un hôtel à Paris avec un ticket resto quotidien pour s’acheter un kebab ont le même statut, légalement. Mais ceux qui sont bienvenus en France sont ceux qui sont destinés à être adoptés par une famille blanche française. Ils ne reçoivent pas le même traitement et n’ont pas le même statut socialement.
Quand on s’intéresse à l’adoption, quand on cherche à politiser les questions Nord/Sud comme les rapports de classe, on devrait s’intéresser à la question des mineurs isolés étrangers4. Ça devrait couler de source. De la même façon que, quand on s’intéresse à l’adoption, on devrait s’intéresser à ce qui se déroule dans les foyers5. Aujourd’hui en France, il y aurait assez d’enfants à adopter pour tous ceux qui ont des agréments d’adoption6. Pourquoi ne le sont-ils pas ? Car ils le seraient en adoption simple. Et la différence entre l’adoption simple et la plénière, c’est que la première ne rompt pas tout contact et tout lien de filiation avec les premières familles. On en revient à la conception occidentale de l’exclusivité parentale, qui refuse de considérer les enfants comme appartenant à la communauté. Alors il y a énormément d’enfants dans les foyers. Et effectivement, ce ne sont pas des bébés. Ils sont grands. Et quand ils sont bébés, les parents ne signent pas toujours pour une rupture totale du lien de filiation. Ces personnes adoptées-là passeront leur enfance et adolescence en institution, car elles ne peuvent être adoptées de manière plénière.

[Maya Mihindou | Ballast]
Or, si l’enjeu est de faire famille avec quelqu’un, faut-il pour autant faire de l’enfant adopté une « tabula rasa » ? Agir comme s’il n’avait pas de famille avant ? Adoption plénière ou pas, je ne serais pas là si une femme n’avait pas dû se séparer de son enfant. Et j’ai grandi toute ma vie en ayant bien conscience que ma présence dans une famille blanche était due à un certain nombre d’inégalités sociales, raciales, historiques, qui font que je me suis trouvée là, et que mes parents, qui étaient infertiles, ont pu avoir des enfants parce que des personnes noires se sont trouvées séparées des leurs. Pourquoi avoir besoin de masquer ce fait par l’adoption plénière ? À quoi sert-elle ? à masquer les inégalités qui expliquent la disponibilité de certains enfants, issus généralement de familles pauvres, racisées ou non, à être adoptés par des familles de classe moyenne.
« Tous ces enjeux, je ne les vois pas investis dans les milieux féministes, antiracistes, décoloniaux. Et ça me met en colère. »
Là encore, nous ne disposons ni de statistiques ethniques ni de données de recherches sur le sujet des enfants placés dans des foyers. Aux États-Unis, ça a été fait. Des ouvrages comme ceux de l’avocate Dorothy Roberts ou le livre de l’essayiste Michelle Alexander sur le complexe industriel de la prison abordent la question de la pipeline existant entre les foyers, les centres éducatifs fermés et la prison. Il y a aujourd’hui une fraction de la population française qui passe une grande partie de sa vie enfermée. On peut s’interroger sur le fait qu’aujourd’hui personne n’en soit ému. Faut-il avoir la plume de Jean Genet7 pour s’en sortir ? Ou est-ce parce qu’il est plus compliqué de voir leur humanité, car en plus d’être pauvres, ces enfants sont racisés ? Si nous considérions simplement les enfants comme étant des personnes plus jeunes, avec moins d’expérience que les adultes, ce serait plus facile de « faire famille » avec des enfants déjà grands. Le livre de Fatima Ouassak a été important pour moi à cet égard. Dans les communautés racisées, l’enfance est vraiment l’un des endroits où s’exerce la violence d’État. Avant d’être de jeunes hommes noirs qu’on tue dans la rue, ces personnes ont d’abord été des enfants punis à l’école plus que les autres, ils ont été placés en foyer. La violence policière dont ils sont victimes est la suite logique de la violence institutionnelle qui a pu s’abattre sur ces enfants. C’est un enjeu de préservation de nos communautés que d’en rendre compte.
Tous ces enjeux, je ne les vois pas investis dans les milieux féministes, antiracistes, décoloniaux. Et ça me met en colère, car justement, c’est quelque chose qui détruit nos communautés. Peut-on accepter qu’aujourd’hui il y ait une proportion inconnue — puisqu’il n’y a pas d’études sur le sujet — d’hommes racisés dans des foyers ? Car ce sont souvent des garçons. C’est quelque chose qui me questionne beaucoup et que je tente de ramener aux avant-postes ; je ne suis pas la seule. Et je suis heureuse de voir que dans les nouvelles revues féministes qui se lancent, on réaborde la question de la naissance et des droits. Dans les milieux queers, a‑t-on une vision de la parentalité si différente de celle du monde hétéronormé ? Quand je vois que l’objectif est d’avoir « des bébés qui nous ressemblent », je constate que ce n’est pas ma vision de la libération. Je trouve étrange qu’il n’ y ait pas eu plus de mobilisations pour s’assurer, dans le sillon de la loi de 2013, que les couples gays et lesbiens ont bien accès à l’adoption. Je comprends que ce soit important pour certains et certaines, mais je note l’énorme mobilisation autour de la PMA, alors qu’il n’y a rien autour de l’accès à l’adoption. Les personnes queers ont grandi dans des familles hétéronormées ; il ne suffit pas d’avoir une autre orientation sexuelle ou une identité de genre différente pour se départir de la vision de l’exclusivité parentale ou de l’envie d’un bébé qui nous ressemble pour faire famille. Il est plus que temps, dans nos mouvements, de parler de ces questions sans que ça ne signifie « faire le jeu de l’extrême droite ».

[Maya Mihindou | Ballast]
Comment s’est passé l’accompagnement de ce deuxième film ? Nous n’avons pas oublié que toutes les portes vous ont été fermées pour le premier !
Je n’avais plus besoin de faire deux cents conférences pour financer le film. (rires) Mais, évidemment, on se sent attendus au tournant. Nous avions peur, Enrico Bertolucci et moi, de la perte de liberté éditoriale. Finalement on a pu faire tout ce qu’on avait en tête : un film avec seulement des archives et des voix off. Nous avons eu cette fois le temps de travailler comme nous le voulions. Notre film « témoin » pour Une histoire à soi, c’est Concerning violence de Göran Olsson. Qu’est-ce qui a fait que le film soit si spécial ? En observant qui avait bossé dessus, on s’est aperçus que le réalisateur avait travaillé avec une designer suédoise qui avait permis d’unifier, de lier tout son projet : images, musiques, sujet. Alors on a choisi de faire de même. Par le biais du Mois des Adopté·e·s, j’avais rencontré Constance Guisset. Elle est conceptrice d’objets et fait de la scénographie mais elle n’avait encore jamais travaillé sur un film. Elle a accepté de travailler avec nous. C’était assez génial, surtout que travailler sur un film d’archives induit de regarder beaucoup d’images : quand tu commences à faire tes choix, avoir deux interlocutrices (Constance et sa collaboratrice, Lucie Verlaguet) tout au long du processus est vraiment riche. Isolée, on ne voit plus rien.
« Les personnes adoptées et celles issues de couples mixtes permettent de remettre en perspective ce que ça signifie d’incarner les fameuses
frontières raciales. »
Il y a eu des moments de doute, comme dans toute création. L’hiver dernier, en décembre 2020, on avait vraiment des soucis sur le montage — on ne savait pas si on arriverait à faire tenir le film avec seulement des archives : on avait un contenu inégal de photos, de vidéos. On a même filmé, en dernière minute, des entretiens face caméra ! La chose la plus casse-gueule qu’on ait faite, par rapport à Ouvrir la voix, c’est de ne pas avoir testé notre dispositif de montage ; on a testé le dispositif après avoir tout collecté, et pendant six mois, ça ne fonctionnait pas ! On a d’abord fait des montages audio des personnes en tablant sur vingt minutes de portrait. Mais Joohee avait moins de vidéo que les autres, ça nous a mis dans un désespoir pas possible. (rires) Une fois le premier montage terminé, c’est la monteuse, Pauline Gaillard, qui nous a suggéré de croiser les témoignages, et ça a été l’ultime changement.
Ce film se passe de commentaire politique, ce qui tranche peut-être avec le précédent. Vous étiez certaine de la suffisance des images ?
Les questions raciales, abordées de manière plus banalisée aujourd’hui, couplées à la puissance des images, sont efficaces pour résumer un sujet politique. Non pas à la Paris Match — « La puissance des mots, le choc des photos »… (rires) Ça dit malgré tout quelque chose de vrai sur la puissance iconographique. L’accumulation d’images de personnes racisées dans des familles blanches, en plein dans la grande époque des adoptions transnationales et transraciales, est le reflet de nombreuses vies. En France, les personnes adoptées et celles issues de couples mixtes permettent, dans ce moment en particulier, de remettre en perspective ce que ça signifie d’incarner les fameuses « frontières raciales » éminemment débattues aujourd’hui.
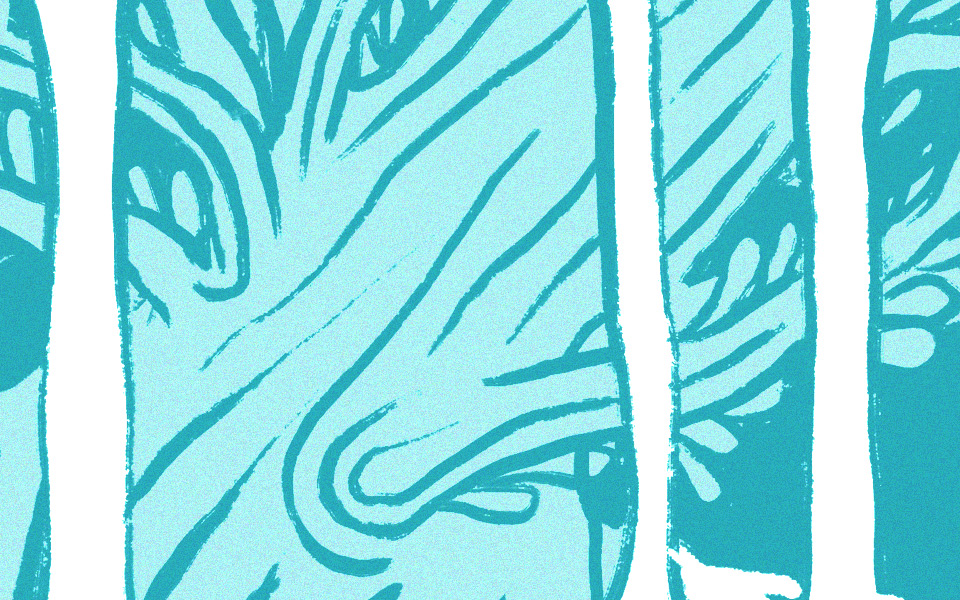
[Maya Mihindou | Ballast]
À la sortie du film Dear white people, on a demandé à des personnes nées dans des endroits très « blancs » de poster des photos de leur école, des photos de famille, etc. Rien qu’avec ces images, on comprenait. Dans une période où les questions raciales sont abordées de plus en plus frontalement dans l’espace francophone, ce type de démarche se montre très efficace. C’est aussi que ça n’avait pas été fait avant. Quand on voit un enfant racisé isolé au milieu d’une foule blanche, dans une France rurale avec des clochers d’église, on se demande ce qu’il peut bien faire là. Mais jusqu’ici on ne cherchait pas forcément à susciter de l’empathie de manière immédiate. Alors que quand tu vois ces enfants dans leurs photos de famille, tu peux immédiatement te mettre à leur place.
Il y a encore une fois un réel travail sur les textures, à l’image…
« Les cultures caribéennes baignent dans la créolisation, c’est-à-dire la reconstruction de cultures, d’identités nées à partir du trauma, de la perte, du vide et de la collision… »
On s’est bien pris la tête sur le traitement des images : ne pas scanner mais photographier. Les lettres, ce sont des photos : il a fallu numériser les images Super 8 dans de bons labos… Le problème des films d’archives, c’est que le scanner met tout au même niveau ; et le contenu analogique une fois numérisé perd de son intérêt visuel. L’idée est que dans cette accumulation d’images issues de médias si différents, ce qui allait être beau, ça serait l’alternance de tous ces grains, de l’image du Super 8 à celle d’Instagram. Il fallait pouvoir rendre ces textures.
Une designer, un travail affirmé sur les archives et le choix de travailler avec des musiciens. Notamment le musicien portoricain Ifè, lui-même adopté…
Il y a deux compositeurs dans le film. Arnaud Dolmen, qui est plus aux percussions, et Ifè. Faire un film d’archives, c’est acter qu’en tant qu’adoptée on a justement peu d’archives, c’est le reflet d’un manque ; alors c’est ce qu’il fallait montrer. Pour Ouvrir la voix, c’était l’inverse : il fallait regarder en face la présence de femmes noires et les écouter, donc faire un film de têtes parlantes. Qu’est-ce qui rend un film très télévisuel ? Ce sont les insertions de piano aux moments supposément tristes, de la musique illustrative ; on détestait ça. Il y avait un intérêt fort à travailler avec des musiciens concernés par ces questions d’acculturation. Ce besoin de traduire la perte concerne autant le travail d’Arnaud Dolmen que celui de Otura Mun, le chanteur de Ifè. Les cultures caribéennes, celles d’Amérique latine, baignent dans la créolisation, c’est-à-dire la reconstruction de cultures, d’identités nées à partir du trauma, de la perte, du vide et de la collision, pas forcément consentie, avec d’autres cultures où existent des rapports de pouvoir.
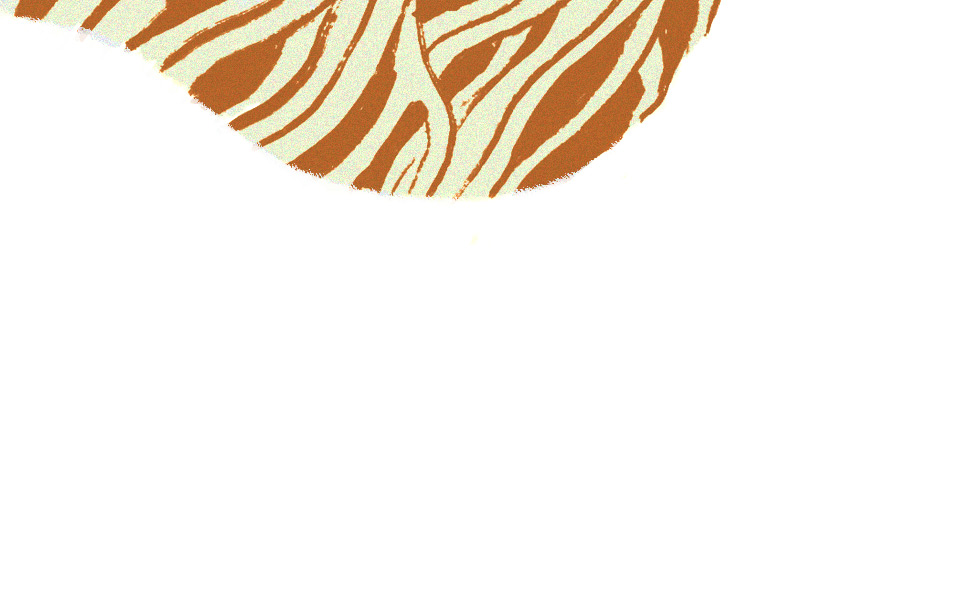
[Maya Mihindou | Ballast]
La biguine en Martinique, c’est la rencontre de la valse et du tambour ! Avoir des musiciens provenant de ces espaces géographiques-là allait forcément faire écho aux thématiques du film. Arnaud est un jazzman. Le film porte beaucoup de nostalgie, que le jazz intensifie. Et la musique d’Ifé, avec son apport électro, permet le décalage. Ce choix correspondait aussi à la structure du film : trouver quelque chose qui colle au propos, et parfois être emmené un peu ailleurs. Dans les communautés noires, finalement, toutes ces questions de déplacement, d’adoption, de grandir dans ta famille ou hors de ta famille sont une réalité qui vient parler à tout le monde, pour des raisons diverses. La question de la dislocation des familles noires, très présente alors dans mes réflexions, est posée dans le film de manière large.
Comment ces notions de créolisation, souvent incomprises ou mal utilisées, dialoguent-elles avec votre identité de personne adoptée ?
« Quand tu côtoies certains milieux antiracistes, il est effectivement possible de croiser de vrais retours essentialistes, qui ne me parlent pas du tout. »
Ça me parle du côté de l’utopie. En termes de refus des essentialismes. Quand tu côtoies certains milieux antiracistes, il est effectivement possible de croiser de vrais retours essentialistes, qui ne me parlent pas du tout. En revanche, il reste central de ne pas lâcher la compréhension des systèmes de domination. J’aime ce qui vient remettre en cause le déterminisme absolu et l’essentialisme, tout en me méfiant de concepts qui, en fonction de qui s’en empare, peuvent en fait ne s’appliquer qu’à une expérience très individuelle. « Dépasser les déterminismes » certes, mais il y a aussi des systèmes en place, et bien en place, qu’il faut contribuer à détruire. Ma vie d’outsider within, tout le temps à la frontière, absorbe tout ce qui peut permettre de comprendre et de sortir des catégories immuables et essentialisées. Je me sens très hybride comme créature — proche de Stuart Hall8 et de ses réflexions sur l’identité culturelle9. C’est encore un penseur de la diaspora caribéenne. Du côté des Anglo-Saxons on convoque le terme d’« identité culturelle », quand chez les francophones celui de « créolisation » s’impose. Le centre est le même. Il est certain que ces concepts me parlent. Mais les concepts, je les considère comme des boîtes à outils.
« Créolisation » dit aussi que, dans la collision coloniale, tout le monde est concerné par l’obligation de la réinvention. Pour autant, ce souffle de la Caraïbe reste peu mobilisé comme outil politique au sein des mouvements antiracistes…
On me reproche parfois ma « colère » — injonction venant souvent des personnes blanches. (rires) Mais je pense qu’il y a des temporalités de compréhension. Entre 2011 et 2015, essayer de parler de questions raciales en France, c’était l’enfer. Ça nous forçait à hurler pour nous faire entendre : il n’était pas possible de se projeter dans des utopies ou des visions moins centrées sur les systèmes de domination puisque nous étions pris dedans comme dans des sables mouvants. Mais dès que tu sors des sables mouvants, de la précarité absolue, se pose la question de trouver d’autres voies pour exister par rapport à ton identité propre. D’une certaine façon, il y a quelque chose de presque poétique qui se niche même dans la violence. Et, quelque part, qu’est-ce qu’il y a de plus français qu’une femme marocaine issue d’une ancienne colonie qui immigre en France et se retrouve en Hexagone, victime d’un viol par deux Caribéens, eux-mêmes descendants de la violence d’État française ? C’est comme une espèce de métaphore de l’histoire coloniale et esclavagiste.

[Maya Mihindou | Ballast]
Avec le temps, je m’intéresse de plus en plus aux réflexions sur l’hybridité culturelle et la créolisation, car je sens que ça peut être un moyen de nous soigner. M’intéresser à la justice reproductive et à la famille s’inscrit aussi dans cet élan. Car l’enjeu est de savoir comment briser le cercle de la violence. Ça ne peut venir que de nous. Paolo Freire le disait : l’objectif n’est pas juste de « libérer l’oppresseur10 » mais de se sortir de ce cycle. Il y a une histoire qui nous détermine encore aujourd’hui, des deux côtés, et à un moment donné il faut passer la barre. Du côté des utopies de dépassement qui se sont réalisées, dans la culture… il y a la musique. Et ce n’est pas une utopie, la musique, c’est déjà de la synthèse. Mais serions-nous en mesure de réaliser la même synthèse dans la vie politique, dans nos vies quotidiennes ?
Comment faire de ces expériences singulières un moteur collectif ?
Il y a tellement de personnes brillantes, volontaires, avec des capacités immenses de mobilisation ! Mais là où ça ne va pas, c’est au niveau psychique et émotionnel. Et ça révèle des dysfonctionnements. Il y a d’un côté des courants totalement dépolitisés qui parlent de « wellness », de care, jusqu’au non sens ! Et de l’autre, une focalisation sur la lutte et les systèmes de domination qui peut parfois immobiliser, à cause des injonctions à la pureté militante — voire à la pureté de ton identité. Du coup on perd de vue toute perspective de changement social ou de bien-être pour la communauté. Par exemple, le choix de ne pas vouloir porter un enfant « à moi » ne signifie pas que mon obsession ne soit pas le sort des enfants de la communauté. C’est peut-être ce qui va me permettre de me mobiliser dans une perspective politique : améliorer la question des placements en foyer, celle de l’adoption simple, etc. Rendre possible au plus grand nombre de faire famille — les enfants isolés inclus. Si j’étais musicienne, j’utiliserais la musique en ce sens ! Mais soit tu es Kassav’ et tu mets 40 000 personnes dans un stade fermé à Paris, où tout le monde pleure à un moment donné, en donnant de la beauté tout en tenant un discours politique, soit il faut trouver comment faire ça autrement.
L’illustration de bannière est la couverture de l’ouvrage Un poupée en chocolat (la Découverte, 2021).
Photographie de vignette : Cyrille Choupas | Ballast
- Pour adopter, il faut obtenir un agrément, délivré par le service d’aide sociale à l’enfance (ASE). Cet agrément sera remis par un organisme — une association à but non lucratif — autorisé par l’État pour servir d’intermédiaire. Ces procédures n’ont pas empêché les adoptions illégales.[↩]
- Cet échange a eu lieu lors du Mois des Adopté·e·es, en 2019, en présence de Pauline Pachot de l’association Pmanonyme et de la journaliste Cécile Broqua.[↩]
- « La justice reproductive, un terme inventé par les
Women of African Descent for Reproductive Justice
(Femmes de descendance africaine pour la justice reproductive) en 1994, est à la base de l’égalité des genres. Il faut que chaque individu soit capable de faire ses propres choix concernant sa vie reproductive et ait accès aux services de santé reproductive. La justice reproductive exige également que toutes les personnes aient la capacité d’élever des enfants dans des environnements sûrs et sains. Elle englobe non seulement les droits reproductifs, mais également les conditions sociales, économiques et politiques qui influent sur la capacité et la manière dont les individus peuvent être parents avec dignité. » [source][↩] - « Pour ne prendre que deux exemples de cette triste réalité, à Calais comme à Paris, des dizaines de mineurs étrangers, surtout afghans, mais aussi notamment irakiens, iraniens ou somaliens, errent en permanence et depuis des années dans les rues sans faire l’objet de la moindre prise en charge publique. Grosso modo, l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ferme les yeux ou, quand elle est contrainte de les ouvrir, oppose mille arguments à ce qui est pourtant l’évidence : ces mineurs relèvent de l’obligation de protection de l’enfance en danger. Quant à l’État, pourtant chargé par la loi de décentralisation du contrôle de la légalité, il affecte une bienveillante neutralité, se contentant, par l’entremise des directions départementales de l’Action sanitaire et sociale (DDASS), d’attribuer, aux moments où il fait le plus froid seulement, un peu de menue monnaie pour quelques mises à l’abri temporaires. En blanchissant ainsi la violation de la loi par les conseils généraux, l’État cherche aussi à préserver l’invisibilité du problème, qui serait menacée s’il advenait des accidents et, accessoirement, à annihiler les intentions initiales de ceux qui, parmi ces jeunes, auraient sollicité l’asile dans d’autres conditions. » Lettre ouverte sur les mineurs étrangers isolés[↩]
- Lorsqu’ils ne sont plus en mesure de s’occuper de lui, les parents peuvent décider de confier leur enfant hors du domicile familial, parfois de manière prolongée. Ils doivent, pour ça, contacter les services d’aide sociale à l’enfance (ASE) qui trouveront une solution selon la situation de chaque enfant. Néanmoins, ce sont le plus souvent les services sociaux qui feront la démarche de retirer un enfant d’une famille possiblement maltraitante. « La déclaration judiciaire d’abandon permet de déclarer un enfant « abandonné » si ses parents s’en sont manifestement désintéressés depuis un an et s’il a été recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’Ase. La déclaration ne peut être faite que par un tribunal de grande instance, saisi le plus souvent par les services sociaux. Elle permet le placement de l’enfant en vue de l’adoption. »[↩]
- L’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est une autorisation légale d’adopter un enfant pupille de l’État ou confié à un Organisme autorisé pour l’adoption (OAA) ou un enfant étranger.[↩]
- Jean Genet, né de père inconnu en 1910, a été abandonné par sa mère à l’Assistance publique puis recueilli dans une famille.[↩]
- Sociologue marxiste né en Jamaïque, pilier des cultural studies en Grande-Bretagne. Ses travaux abordent la question du conflit dans les rapports de domination.[↩]
- « L’identité culturelle relève autant de l’
être
que dudevenir
. Elle appartient au futur autant qu’au passé. Les identités culturelles viennent de quelque part, elles ont des histoires. Toutefois, comme tout ce qui est historique, elles font l’objet de transformations constantes. Loin d’être fixées pour l’éternité dans quelque passé essentialisé, elles sont sujettes au jeucontinu
de l’Histoire, de la culture et du pouvoir. Loin d’être fondées sur une simpleredécouverte
du passé, qui attendrait d’être accomplie et qui, lorsqu’elle le serait, assurerait pour l’éternité notre sentiment d’être nous-mêmes, les identités sont les noms que nous donnons aux diverses façons d’être situés par les récits du passé et de nous y situer. » Stuart Hall, Identité culturelle et diaspora, 1998.[↩] - « Voilà la grande tâche humaniste et historique des opprimés : se libérer eux-mêmes et libérer leurs oppresseurs. Ceux qui oppriment, exploitent et exercent la violence ne peuvent trouver dans l’exercice de leur pouvoir la force de libérer les opprimés et de se libérer eux-mêmes. Seul le pouvoir qui naît de la faiblesse sera suffisamment fort pour libérer les deux. »[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Françoise Vergès : « La question du métissage m’a toujours interrogée », juin 2020
☰ Lire notre entretien avec Nadia Yala Kisukidi : « Le conflit n’est pas entre le particulier et l’universel », juin 2020
☰ Lire notre traduction « Le nouveau mestizaje », Gloria Anzaldúa, juin 2020
☰ Lire notre notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimées », Hourya Bentouhami, mai 2019
☰ Lire notre entretien avec Patrick Chamoiseau : « Il n’y a plus d’ailleurs », février 2019


