Texte inédit pour le site de Ballast
« Qui suis-je ? J’avais répondu au début : d’abord une romancière de langue française… Pourquoi ne pas terminer en me reposant la question à moi-même ? Qui suis-je ? Une femme dont la culture est l’arabe et l’islam… » L’auteure de Rouge l’aube a disparu le 6 février 2015. Traduite en une vingtaine de langues, elle enseigna, sa vie durant, l’histoire, le cinéma et la littérature en Algérie, en France et aux États-Unis. Rendre voix aux femmes reléguées, dire la mémoire étouffée sous le poids colonial, dénoncer les « fous de Dieu » qui cherchent à tuer la pluralité des langues à laquelle elle tenait tant : voilà ce que pouvait à ses yeux l’écriture, cette « quête presque à perdre souffle ». ☰ Par Jonathan Delaunay

« Ironie de la situation : son diplôme d’histoire lui file entre les doigts puisque l’Histoire se déploie sous ses yeux et qu’elle ne peut s’y soustraire. »
C’est à cette langue du pouvoir que se familiarise très tôt la jeune fille, par l’entremise d’un père qui la pousse à suivre les cours qu’il donne dans l’école du village, lui offrant dès lors la possibilité de s’extirper de la réclusion à laquelle on la destinait certainement. « Le père m’avait tendu la main pour me conduire à l’école : il ne serait jamais le futur geôlier ; il devenait l’intercesseur. Le changement profond commençait là : parce qu’il était instituteur de langue française, il avait assumé un premier métissage dont je serais bénéficiaire1. » L’écrivaine se souviendra, au point de l’évoquer à deux reprises dans son œuvre2, de cet homme lui tenant la main sur le chemin de l’école et du regard accusateur des autres alentour. Elle en tire une fierté certaine, celle d’avancer plus librement — lorsqu’elle obtient son certificat d’études, elle est accusée de trahison, par certains conservateurs, pour qui l’accès d’une fille à l’éducation tient de l’entorse à la tradition islamique, et pour qui l’apprentissage du français relève de la fraternisation avec l’occupant.
Une « sortie du harem3 », confiera-t-elle pourtant. Puis l’occasion d’un départ en France, au début des années 1950, afin de prolonger ses études supérieures, entamées à Blida. Le français est l’idiome de la puissance dominante autant que, pour certains, la possibilité d’améliorer leur condition. Imalayène, qui ne s’appelle pas encore Djebar, intègre l’École normale supérieure de Sèvres, où elle étudie l’histoire — du Moyen Âge arabe et du Maghreb du XIXe siècle : elle est l’unique étudiante arabe (et la première femme maghrébine à rentrer à l’École normale). Mais elle vit ce départ comme le début d’une déchirure, qui ne l’abandonnera jamais : elle se sent émigrée sur sa propre terre natale à chacun de ses retours, tiraillée tout au long de son existence entre deux nations, étrangère et familière à la fois dans celles qui se font face. La guerre d’Algérie éclate alors qu’Imalayène est étudiante : solidaire d’un peuple, le sien, qui se soulève contre l’oppression coloniale de l’autre côté de la Méditerranée, celle qui était promise à une carrière studieuse participe à la grève des étudiants algériens en signe de protestation. Ironie de la situation : son diplôme d’histoire lui file entre les doigts puisque l’Histoire se déploie sous ses yeux et qu’elle ne peut s’y soustraire. Elle se tient néanmoins à l’écart des groupes de résistance qui se constituent dans la jeunesse algérienne de France : les dissensions idéologiques et les rivalités pour le pouvoir entre le MNA et le FLN enveniment déjà la lutte.

N° 13 (White, Red on Yellow), Mark Rothko, 1985
Imalayène signe son premier roman, La Soif, paru en 1957 chez Julliard, sous le nom d’Assia Djebar. Ce nom de plume n’est pas qu’une simple précaution pour éviter à sa famille quelques ennuis avec le pouvoir, il illustre l’ambivalence de l’auteure en pleine construction : « Assia », en arabe dialectal, c’est « celle qui console, qui accompagne de sa présence » ; « Djebar » signifie en arabe littéraire « l’intransigeant » (c’est aussi l’un des nombreux attributs du Prophète). Se dessine déjà ce double projet d’écriture : consoler les cœurs meurtris ou les rayés de l’Histoire et dénoncer, sans pudeur ni égard pour une quelconque autorité, les bourreaux de ces derniers. Djebar se démarque, dans ces pages, du verbe accusateur en vigueur dans les milieux anticolonialistes ; elle conte à sa manière, singulière, l’altérité, la femme, l’Islam, la nuit du colonialisme, les heures sombres des deux pays qu’elle côtoie, ceux dont les mots coulent en elle comme deux sangs mélangés. Aux critiques qu’elle essuie, et continuera d’essuyer longtemps encore au sujet de l’absence de dimension politique de ce premier texte, l’écrivaine déclarera un jour à la radio : « La Soif est un roman que j’aime encore et assume […]. Vous ne pouvez m’empêcher d’avoir préféré lors de mes débuts d’écrivain un air de flûte à tous vos tambours4 ! »
« Elle conte à sa manière, singulière, l’altérité, la femme, l’Islam, la nuit du colonialisme, les heures sombres des deux pays qu’elle côtoie, ceux dont les mots coulent en elle comme deux sangs mélangés. »
Si l’écrivaine se détache du chaos ambiant, c’est pour mieux cerner les contours de son écriture et comprendre les enjeux de la langue française, de ce choix qu’elle considère comme une confiscation — un « butin de guerre » arraché aux mains du colon, pour reprendre la célèbre expression de Kateb Yacine (expression qu’elle fera sienne en 1989, avec l’article « Du français comme butin », repris par après en chapitre de son essai Ces voix qui m’assiègent, en marge de ma francophonie : « J’ai senti que pour moi, dans le français, il y avait du sang dans cette langue5. ») Comme tant d’autres intellectuels algériens francophones, Djebar entend la retourner contre celui qui la manie en hauts lieux : le colon. Elle y insuffle, en outre, la musicalité propre à la langue arabe, son rythme, et convoque les sonorités arabo-berbères afin de sculpter ce français à sa mesure, atypique, intimement lié à la langue maternelle. « Oui, ramener les voix non-francophones — les gutturales, les ensauvagées, les insoumises — jusqu’à un texte français qui devient mien […], faire réaffleurer les cultures traditionnelles mises au ban, maltraitées, longtemps méprisées, les inscrire, elles, dans un texte nouveau, dans une graphie qui devient mon
français6. »
Un français chantant, musical, fait d’allitérations. « Long silence, nuits chevauchées, spirales dans la gorge. / Râles, ruisseaux de sons précipices, sources d’échos entrecroisés, cataractes de murmures, chuchotements en taillis tressés, surgeons susurrant sous la langue, chuintements, et souque la voix courbe qui, dans la soute de sa mémoire, retrouve souffles souillés de soûlerie ancienne7. » L’écriture s’apparente à la musique. Un « air de flûte », avons-nous vu… La langue est un chant et ses romans s’avancent en plusieurs « mouvements », composés de mineurs (les récits ordinaires, les parcours) et de majeurs (où l’Histoire revêt l’habit du personnage principal). Dans cette architecture sonore, les femmes jouent le rôle du chœur — ainsi des premières pages des Enfants du nouveau monde, lorsque le village est bombardé par quelque avion français : « Il se trouve toujours une femme, vieille, jeune, peu importe, qui prend la direction du chœur : exclamations, soupirs, silences gémissants quand la montagne saigne et fume, couplets passionnés8. »

Mark Rothko
L’enjeu de la mémoire
« Dans tout cela la poésie ? / La poésie filtre autant entre les mots que dans les mots, dans le rythme, dans la pause… Le blanc, couleur du deuil chez nous, c’est aussi celle où l’on respire9. » Assia Djebar devient professeure d’histoire moderne et contemporaine du Maghreb à la faculté des lettres de Rabat, de 1959 à 1962, puis à l’Université d’Alger, jusqu’en 1965 — tout en contribuant au journal El Moudjahid, à Tunis. Après un nouveau passage à Paris, elle revient à Alger pour enseigner la littérature et le cinéma, de 1974 à 1980. Elle a déjà écrit Les Impatients, dans la foulée de son premier livre, puis Les Enfants du nouveau monde, en 1962, ainsi que Les Alouettes naïves, cinq ans plus tard, où elle dénonçait plus directement les atrocités de la guerre d’indépendance — mais toujours à hauteur d’hommes. S’ensuivent un recueil de poèmes et une pièce de théâtre publiés à Alger, en 1969. Après quoi, Djebar se réfugie dans un silence — qui se veut plutôt une gestation — de presque 10 ans, au cours duquel elle poursuit sa réflexion sur la langue et cherche dans le cinéma un nouveau moyen d’expression. Dans son premier long-métrage, La Nouba des femmes du mont Chenoua, qui recevra le prix de la Critique internationale à Venise en 1979, elle rend hommage aux femmes de sa région natale après avoir séjourné auprès de la tribu maternelle des Berkani, qui perpétue la tradition, de génération en génération, des conteuses, transmettant oralement l’histoire de la tribu et du pays aux femmes et jeunes filles.
« Combien ont cousu des drapeaux dans l’ombre des patios, nourri, caché et guéri les soldats dans les villes et villages, ou rejoint définitivement le maquis ? »
La musique du film est signée du compositeur hongrois Béla Bartók — la musique, encore et toujours… La femme-conteuse est une figure récurrente, sinon centrale, dans son œuvre ; Djebar entend lui donner la place qu’elle mérite dans la littérature pour qu’enfin l’écriture grave le chant de celles sans qui la langue et le savoir n’auraient pas tenu tête au temps passant. La mémoire est une voix de femme, en Algérie, et l’Histoire y est avant tout affaire d’oralité, de transmission d’aînée à cadette, de diseuse à écouteuse. « Zohra Oudai a hoché la tête, replongée dans ce passé pour le revivre — l’amertume ayant disparu de sa voix, elle est devenue conteuse presque joyeuse, en tout cas impétueuse, comme si le temps de la lutte ouverte
subsistait10. » La Femme sans sépulture est sans doute son plus grand hommage. Dame Lionne et Zouhra Oudai y rapportent le récit glorieux et oublié de Zoulikha, maquisarde durant les premières années de la guerre d’Algérie, qui joua un rôle crucial de liaison entre la ville et la montagne dans la région de Césarée, avant d’être capturée par les soldats français puis portée disparue. À travers la reconstitution de ces témoignages, la narratrice — derrière laquelle Djebar se déguise à peine — le passé resurgit et le conte lui confère une teinte nouvelle. Et Dame Lionne de confier : « Que tout cela semble loin et pourtant, me faire ainsi parler d’elle, dans les détails, je t’assure, ô ma petite, que c’est un baume sur ma peine11 ! »
Panser les plaies du passé, soulager les mauvaises cicatrices. Libérer de l’oubli et du silence ces invisibles au monde. L’histoire de Zoulikha est une parmi tant d’autres : combien de femmes ont-elles lutté durant la guerre afin qu’advienne l’indépendance ? Combien ont cousu des drapeaux dans l’ombre des patios, nourri, caché et guéri les soldats dans les villes et villages, ou rejoint définitivement le maquis ? « Ils veulent que rien ne se soit passé, ou presque pas passé… […] La foule, à Alger, et presque pareillement à Césarée, est emportée dans le fleuve morne du temps12. » Plus que tout, Djebar écrit pour lutter contre cette peur du souvenir, cette paresse de la mémoire qui paraît affecter l’Algérie contemporaine. Face à l’amnésie généralisée, le devoir de témoignage et d’hommage se fait d’autant plus nécessaire que l’Histoire telle que narrée par le vainqueur oblitère à dessein ce qui la gêne. En premier lieu, c’est la version du colon qu’il s’agit de réécrire et de tordre pour permettre à l’ancien colonisé de se réapproprier son passé. Son documentaire La Zerda et les Chants de l’oubli, diffusé en 1982 par la télévision algérienne et primé « meilleur film historique » au Festival de Berlin un an plus tard, est le fruit d’une telle motivation : des bandes de films originellement tournés par les Français durant l’occupation, montées par ses soins et mises en musique arabe… L’Histoire peut-être retravaillée dans son matériau même.
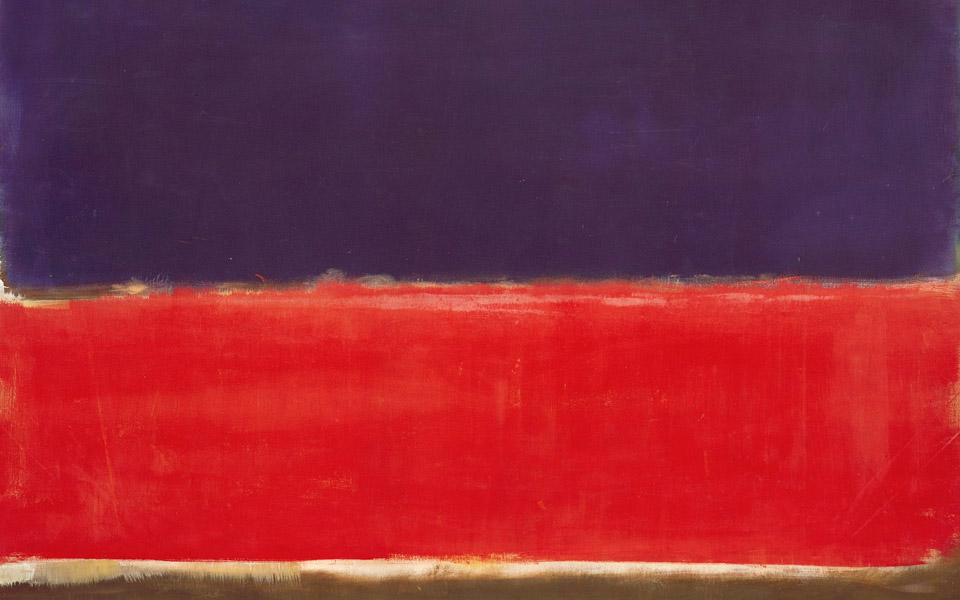
Mark Rotkho
Aux images, filmées par le colon qui scrute, qui chosifie le colonisé, répond le chant des femmes et à travers lui le passé d’un peuple qui perpétue sa tradition en dépit du regard de l’Autre. « La chanteuse anonyme traîne sa voix éraillée hors des tavernes. Son chant encagé dénonce le sucre de tout exotisme : sérails du silence et du deuil13. » Avant même la guerre, c’est le regard du premier porté sur le second qu’il s’agit de dévoiler, l’orientalisme qui fantasme en même temps qu’il enferme. « L’orientalisme ne serait ni francophone ni anglophone, il aurait tué la voix… Il était avant tout regard venu d’ailleurs : il rendait objet — objet de désir, mais objet — l’être qui tentait de parler, de s’essayer à parler à l’Autre, à l’étranger14… » Mais Assia Djebar procède par détour ; elle n’évince pas mais construit sa critique de manière oblique. Ainsi, Femmes d’Alger dans leur appartement, recueil de nouvelles paru en en 1980 par lequel elle sort de son long silence littéraire15, se veut un dialogue avec la toile éponyme d’Eugène Delacroix, représentant des femmes dans un sérail d’Alger. Djebar ne condamne pas tant ce regard qu’elle se l’accapare, le fait sien pour inverser la situation et donner voix à ces femmes enfermées.
Pluriel des langues
« Djebar revient sur l’assassinat de trois de ses amis, intellectuels algériens tués dans les années 1990 par les fanatiques islamistes. »
Historienne de formation, l’écrivaine a su puiser dans cette discipline les armes nécessaires à même de tenir tête à la déformation et au réductionnisme historiques — conséquences d’un colonialisme qui refuse d’avouer ses crimes —, autant qu’à la domination et à l’autoritarisme, manifestations du patriarcat dans lequel est entravée la société algérienne. Djebar ne cesse de rappeler combien son pays possède une histoire riche et plurielle, depuis Carthage jusqu’aux invasions arabes, en passant par l’occupation romaine : elle ne peut se sentir proche du discours nationaliste d’après-guerre porté par le FLN — après le colonialisme, c’est cette parole qu’elle s’évertue donc à dénoncer. La victoire a permis au pays de retrouver son autonomie mais charrie depuis un certain nombre de mesures liberticides : l’arabe est érigé en langue unique, le français et le berbère fortement condamnés, et le regain de liberté gagné par les femmes s’étouffe aussitôt apparu. Dans Le Blanc de l’Algérie, dont le titre seul suffit à évoquer le deuil qui l’accable, Djebar revient sur l’assassinat de trois de ses amis, intellectuels algériens tués dans les années 1990, celles de la « décennie noire », par les fanatiques islamistes16.
L’assassinat du poète Jean Sénac en 1973, sur lequel revient l’écrivaine, annonce à ses yeux les suivants : le romancier Tahar Djaout, le poète Youcef Serbi ou encore celui, plus anonyme mais non moins atroce, d’une de ses anciennes étudiantes, devenue directrice d’école, mitraillée dans son bureau pour avoir désobéi aux islamistes en ouvrant aux filles la porte de son établissement. Elle évoque également le suicide désespéré de Josie Fanon, femme de Frantz Fanon et amie intime de l’écrivaine, en 1989. Mais Djebar ne se lamente pas ; elle rappelle plus que jamais la nécessité d’écrire, « l’urgence de dire » à quel point la culture de l’oubli peut conduire à pareil désespoir. Pourquoi cette « nouvelle saignée17 » ? Pourquoi cette marche arrière ? L’Algérie, écrit-elle, « renie sa tradition d’ouverture et de pluralité18 » et occulte la pluralité linguistique qui fait sa force. « Ils appellent l’arabe la langue nationale
entre guillemets, ce qui me paraît un intitulé dérisoire. Une nation, c’est tout un faisceau de langues et cela est vrai plus particulièrement pour l’Algérie19 », dira-t-elle à propos de son roman Vaste est la prison. Djebar aime à rappeler l’ancienneté de la langue berbère et réfute l’idée reçue selon laquelle celle-ci n’aurait pas de fondement écrit.

Mark Rothko
Ode aux femmes
Assia Djebar s’interroge sur ce que sa mère et sa grand-mère lui ont transmis. La femme musulmane qu’elle connaît vit encore dans l’ombre du masculin : l’homme est maître de la maison comme du dehors et la femme vouée à l’espace intérieur. « Quand je suis venue m’installer à Paris, en 1980, après Femmes d’Alger dans leur appartement, les gens considéraient que j’étais un écrivain féministe. Comme Algérienne, le féminisme était une sorte d’état naturel, si je puis dire20. » Djebar n’eut de cesse d’écrire sur la condition des femmes de son pays natal, de se lever contre cette assignation. Mais si le ton est cinglant, la critique, elle, n’est jamais méprisante : elle déploie seulement son irréfutabilité. L’espace de son écriture devient celui de la libération des femmes, « elles dont le corps reste rivé dans une pénombre et un retrait indûment injustifié par quelque loi pseudo-islamique21 ». Djebar utilise volontiers le champ lexical de l’intériorité afin de retranscrire l’atmosphère étouffante et étouffée des femmes qu’elle dépeint, tapies dans le « fond » des maisons, dans le « silence » où percent des « chuchotements », celui des femmes « cernées » par les murs. Dès Les Enfants du nouveau monde, l’écrivaine dépeint celles qui ont le sentiment de n’avoir « jamais connu le visage de la rue22 ».
« De la dénonciation du colonialisme à celui du nationalisme arabe, de la haine des langues à la domination patriarcale : un même fil rouge. »
L’émancipation de la femme passera par une réappropriation de l’espace et l’échappée au-dehors, à l’instar de Zoulikha la combattante, partie au maquis, dont le départ n’est probablement pas sans faire écho au départ d’Assia Djebar elle-même. Cette conquête du monde extérieur s’accompagne irrémédiablement d’une affirmation du corps, « corps de femme devenu mobile et, parce qu’il se trouve en terre arabe, entré dès lors en dissidence23 ». La femme qui ose sortir dans les rues, se montrer au regard extérieur assume par là même son dévoilement — Djebar symbolise à l’envi cette prise de liberté par l’enlèvement du voile : une sorte de mise à nu. Le corps de la femme s’assume alors, autant que son désir, que Djebar retranscrit dans une véritable poétique de l’enlacement : « étendue, après avoir tant navigué, j’affleure au matin. Me voici mince pliure entre la moire de la nuit et le métal du jour nouveau24 ». Dans ces scènes d’amour suggérées, les rideaux sont ouverts sur l’espace avoisinant. « Tandis qu’au-dehors la poitrine est noyée sous la grosse laine, que les chevilles et les poignets sont soustraits à la vue par le cuir de la botte et du gant, tout, dans la chambre, reprend autonomie. Sous la poussée d’une calligraphie nocturne, les épaules, les bras ou les hanches se délient25. » Son féminisme tient en effet de l’évidence. Assia Djebar rendra hommage aux femmes de son pays jusqu’à sa mort puisque, lors de son enterrement, celles-ci sont conviées à assister aux funérailles, contrairement à la coutume — ainsi qu’elle l’avait exigé. Ce geste, dernier pied de nez à la tradition, symbolise l’engagement de toute une vie.
De la dénonciation du colonialisme à celui du nationalisme arabe, de la haine des langues à la domination patriarcale : un même fil rouge. Une seule et même volonté de lutter, par l’écriture, contre la mémoire qui s’efface et l’Histoire qui ne retient que ce qui l’arrange. Lors de son discours de réception à l’Académie française, en 2006 — elle est la cinquième femme et la première Maghrébine à y entrer —, Djebar montre une nouvelle fois son goût pour la provocation : elle exhume face aux Immortels de l’assemblée les forfaits du colonialisme et, citant le poète Aimé Césaire, rappelle « comment les guerres coloniales en Afrique et en Asie ont, en fait, décivilisé
et ensauvagé
, dit-il, l’Europe26 ». Djebar contrarie les autorités illégitimes. Djebar écrit au féminin pluriel. « Un clin d’oeil, une vie. Éblouie, je la déploie, mais déjà je la détruis, j’en obscurcis les aubes, je filtre les après-midi d’indolence, j’éteins ce soleil, pâle ou resplendissant, qu’importe27 ! »
- Assia Djebar, Ces voix qui m’assiègent, Paris, Albin Michel, 1999, p. 46.[↩]
- En ouverture de L’Amour, la fantasia et dans Vaste est la prison.[↩]
- Ces voix qui m’assiègent, op. cit., p. 69.[↩]
- Retranscrit dans Ces voix qui m’assiègent, op. cit., p. 87.[↩]
- Entretien avec Lise Gauvin, dans Algérie Littérature Action, revue mensuelle, 187–190, janvier-avril 2015, Numéro spécial A. Djebar, p. 41.[↩]
- Ces voix qui m’assiègent, op. cit., p. 29.[↩]
- L’Amour, la fantasia, Paris, J. C. Lattès, 1985, p. 125.[↩]
- Les Enfants du nouveau monde, Points, 2012, p. 14.[↩]
- Ces voix qui m’assiègent, op. cit., p. 66.[↩]
- La Femme sans sépulture, Paris, Albin Michel, 2002, p. 81.[↩]
- Ibid, p. 127.[↩]
- Ibid., pp. 240–241.[↩]
- Ombre sultane, Paris, Albin Michel, 2006, p. 185.[↩]
- Ces voix qui m’assiègent, op. cit., p. 28.[↩]
- Paris, Éditions des Femmes.[↩]
- Il s’agit de son beau-frère Abdelkader Alloula, dramaturge, de son ami sociologue M’hamed Boukhobza, et du psychiatre Mahfoud Boucebci.[↩]
- La Femme sans sépulture, op. cit., p. 240.[↩]
- Le Blanc de l’Algérie, Paris, Albin Michel, 1995, p. 137.[↩]
- Entretien avec Lise Gauvin, op. cit., p. 36.[↩]
- Entretien avec Lise Gauvin, op. cit., p. 42.[↩]
- Ces voix qui m’assiègent, op. cit., p. 93.[↩]
- Les Enfants du nouveau monde, op. cit., p. 168.[↩]
- Ces voix qui m’assiègent, op. cit., p. 86.[↩]
- Ombre sultane, op. cit., p. 34.[↩]
- Ibid., p. 55.[↩]
- Extrait du discours de réception d’Assia Djebar à l’Académie française, dans Algérie Littérature Action, op. cit., p. 153.[↩]
- Ombre sultane, op. cit., p. 21.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Mohamed Saïl, ni maître ni valet », Émile Carme, octobre 2016
☰ Lire notre entretien avec Mia Couto : « Les langues sont des entités vivantes », juin 2016
☰ Lire notre article « Svetlana Alexievitch, quand l’histoire des femmes reste un champ de bataille », Laélia Véron, janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015
☰ Lire notre article « Serge Michel — amour, anarchie et Algérie », Émile Carme, février 2015
☰ Lire notre article « Jean Sénac, poète assassiné », Éric Sarner, novembre 2014


