Entretien inédit pour le site de Ballast
Démographie, changement climatique, biodiversité, spéculation internationale : « On ne peut pas s’en sortir », assure Bernard Stiegler. Reste donc à construire, inventer, bifurquer, bref, à produire de la raison face au délire d’un monde condamné. Nous le retrouvons à Paris, au Centre Pompidou. Ancien directeur général adjoint de l’INA et fondateur du collectif Ars industrialis, le philosophe — formé dans les rangs du Parti communiste et tombé pour braquage à la fin des années 1970 — s’est imposé comme l’un des penseurs de la technique. Une œuvre exigeante à ambition anthropologique, sur laquelle nous revenons à ses côtés.

Vous avez décrit la décennie post-68 comme un moment de gueule de bois : pourquoi ?
Vous me prenez un peu au dépourvu avec cette question, au demeurant très bonne. Il y a eu, en France, cet espoir que fut Mai 68 — il y eut également des mouvements similaires dans d’autres pays. Puis vint, donc, la gueule de bois. Qui se traduisit par quoi ? D’abord par un durcissement des formes classiques de luttes, c’est-à-dire les luttes sociales et ouvrières, comme on les appelait à l’époque. À Toulouse, les étudiants ont mené des bagarres assez dures au sein de l’université du Mirail. Il y a aussi eu la toxicomanie, les trahisons et les reniements, tout cela menant finalement au terrorisme, comme en Allemagne, en Italie et en France dans les années 1970 — ce qu’on appellera « les années de plomb ». La gueule de bois correspond à ce désenchantement, et même à cet effondrement, y compris psychiatrique, qui allait parfois jusqu’au suicide. C’était une époque où bien des gens avaient pris des voies inattendues, qui au départ n’étaient pas nécessairement désirées mais qui provenaient d’une dysharmonie fondamentale dans le cours de l’Histoire. Malheureusement, nous voyons aujourd’hui quel en était le sens. Au moment où, partout dans le monde, remontent de façon apparemment irrésistible les pires tentations régressives et autoritaires, on devrait prendre le temps de réinterpréter ces événements, essayer de se ressaisir très honnêtement et précisément de ce qu’il s’est passé depuis 50 ans comme après-coup des luttes sociales des années d’après-guerre.
Vous avez vous-même commis des braquages, non politiques, au milieu des années 1970. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’action violente ?
« J’ai toujours été contre l’action violente : je n’y crois pas du tout. Elle bénéficie toujours au fascisme et à l’extrême droite. La gauche perd toujours lorsqu’elle pratique la violence. »
J’ai rencontré des membres d’Action directe et de l’ETA en prison, ainsi que d’autres combattants clandestins, dont je pouvais entendre les arguments. Mais j’étais contre Action directe, contre les Brigades rouges, contre l’ETA. Je ne les aurais pas dénoncés à la police, bien entendu, je les aurais même sans doute aidés contre la répression si cela avait été nécessaire, mais j’ai toujours été contre l’action violente : je n’y crois pas du tout. Elle bénéficie toujours au fascisme et à l’extrême droite. La gauche perd toujours lorsqu’elle pratique la violence — jusqu’à aboutir au stalinisme. Mon premier avocat m’avait incité à plaider l’action politique ; je lui avais répondu par la négative : je relevais du droit commun, je n’étais pas un « terroriste » politique mais un simple délinquant. Il était hors de question de prendre la politique pour alibi ! J’ai commis ces braquages parce que j’avais besoin d’argent, voilà tout. Si l’on tient à chercher quelque aspect politique, parlons de Raymond Barre, alors Premier ministre de Giscard d’Estaing : il avait pris des dispositions vis-à-vis des règles commerciales qui avaient, par voie de conséquence, ruiné mon affaire. Cela s’est combiné avec un chantage de la police pour me faire devenir indicateur. Mon bistrot se portait plutôt bien ; le « plan Barre » l’a brisé, ma vie avec. Je me suis dit que j’allais récupérer mon argent directement à la banque… Cette histoire a l’allure loufoque de Prends l’oseille et tire-toi de Woody Allen. J’étais un peu fou à l’époque ; je le suis peut-être encore toujours un peu, d’ailleurs.
Vous avez fait l’éloge de la prison en tant que lieu monastique. Un temps d’ascèse qui permet l’émergence d’un espace philosophique, d’une forme de vertu carcérale. Mais chacun sait aussi que la prison a pour fonction de brider les corps, d’annihiler toute forme de révolte. Comment tenez-vous votre position ?
Je suis embarrassé par mes propos : ils peuvent facilement être mal interprétés. Il faut savoir que je suis arrivé en prison quatre ans après les grandes émeutes de 1974 : il y avait eu des morts, ça avait cogné très dur1. S’en sont suivies des mesures d’atténuation de la répression carcérale et de la « pénitence ». Un léger desserrement de la discipline — sans devenir en rien des « hôtels 4 étoiles » comme le prétendait alors Poniatowski, qui parlait déjà la langue de Le Pen. Mais c’était tout de même moins dur qu’avant et qu’aujourd’hui. Ce que j’ai vécu à cette époque est devenu pratiquement impossible de nos jours. Mais certains détenus ont réussi à tirer quelque chose de leur détention : je ne suis pas le seul. Ils étaient soutenus par leur famille et par un passé ; ils savaient lire et écrire — ce qui n’est hélas pas le cas, en général, des détenus. J’étais quant à moi soutenu par mon éducation familiale, et fortement soutenu par mon frère aîné et ma mère ; j’aimais la littérature et j’avais confiance dans la solitude. J’avais une culture politique, mais qui ne tenait pas seulement des livres : je savais parler, me battre, me défendre, m’organiser. J’étais un peu armé pour supporter cela. C’est très important : j’ai forgé ma culture grâce au Parti communiste. J’ai fait partie des staliniens, même si c’était avec l’espoir de les combattre « de l’intérieur ».
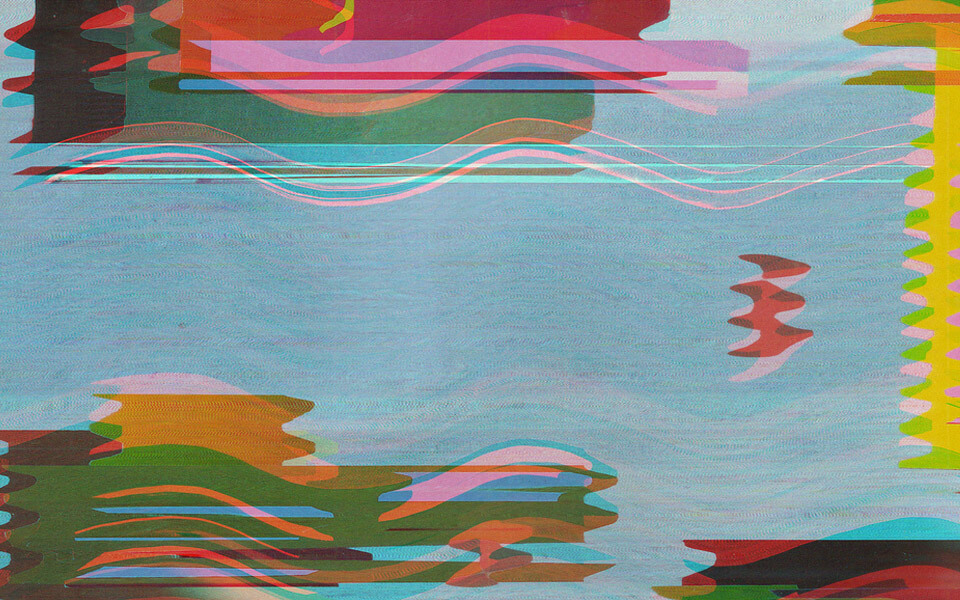
[Glitch art (1nd3x.com)]
Avant cela, j’avais été trotskyste. J’étais inculte, mais, via le PC et La Nouvelle Critique, j’ai pu découvrir Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, Saussure, la revue Tel Quel — avec laquelle La Nouvelle Critique débattait alors parfois. J’ai pu étudier le Cours de linguistique générale de Saussure. On ne peut pas imaginer ce qu’était le Parti communiste français de cette époque. C’était une école, que l’on appelait l’Université nouvelle, où enseignait quelqu’un comme Jean-Pierre Vernant, où passaient des penseurs comme Georges Canguilhem — tous deux anciens résistants. C’est inimaginable, à présent. La situation contemporaine s’explique aussi, et même d’abord, par le fait que les organisations politiques ont totalement renoncé à conduire de telles entreprises intellectuelles de très grande ambition. Un des principaux responsables, au PCF, fut Georges Marchais. C’était un vrai stalinien qui a liquidé La Nouvelle Critique et cassé cette extraordinaire logique forgée lors de la Résistance, où les communistes et leurs compagnons de route (qui n’étaient pas forcément communistes ni même marxistes) travaillaient ensemble en croyant au savoir et au débat. Marchais est le premier à avoir appliqué ce que l’on nomme « la télécratie », l’exploitation de la médiatisation — et ce avant Le Pen, tandis que le socialisme devenait la social-démocratie, tout aussi liquidatrice de toute ambition de réfléchir sans concession au temps présent. Je ne veux pas dire que Marchais et Le Pen sont comparables, mais le premier a lui aussi fait beaucoup de mal, devenant la grande gueule calamiteuse du « globalement positif » [référence au « bilan » des politiques conduites dans les pays de l’Est, ndlr]. Mais fermons cette parenthèse.
« On ne peut pas imaginer ce qu’était le Parti communiste français de cette époque. C’est inimaginable, à présent. »
Je reviens à mon expérience en milieu carcéral, racontée dans mon ouvrage Passer à l’acte. Lorsque je suis arrivé en prison, je ne connaissais rien à la phénoménologie ni à Husserl. Je connaissais vaguement la philosophie à travers ma pratique du marxisme ; j’avais un peu lu Marx et savais de loin qui était Hegel. Dans ma cellule, j’ai alors appris à pratiquer la phénoménologie d’une manière sauvage et empirique. La prison était devenue une forme de laboratoire phénoménologique.
C’est-à-dire ?
C’est une pratique principalement développée par Husserl puis Heidegger. Elle consiste en la « suspension de la thèse du monde », c’est-à-dire à se mettre dans une disposition — qu’Husserl hérite d’ailleurs de Descartes — qui considère le monde comme s’il n’était qu’un rêve. C’est par exemple l’hypothèse de Tchouang-tseu : Tchouang-tseu rêve qu’il est un papillon ; et si c’était le papillon qui rêvait qu’il était Tchouang-tseu ? Faisons un rêve qui est que nous rêvons en permanence. Un ami philosophe, Gérard Granel, qui m’a soutenu durant cette période et a contribué à payer mes frais d’avocat, m’a proposé de faire des études — ce dont j’avais toujours rêvé. Il a effectué des démarches pour que je sois inscrit à l’université, ainsi qu’auprès de l’administration pénitentiaire. À partir de ce moment, j’ai commencé à pratiquer ma cellule comme un laboratoire phénoménologique, de manière méthodique, en m’appuyant sur la philosophie. Ce qui m’intéressait avant tout, c’était de pouvoir travailler sans autre limite que la nécessité de dormir. Je dois avouer qu’il m’arrive de me dire que je retournerais bien en prison… Je dis cela pour signifier à quel point le monde est devenu absolument atroce. Il l’était pour moi beaucoup moins quand j’étais retiré en prison que dans ce monde devenu immonde qui me fait pleurer. Concluons quant à votre question : oui, on peut revendiquer une certaine vertu de la prison, même si ça n’a été possible pour moi que par ces circonstances exceptionnelles, dont, outre le soutien familial, celui de Gérard Granel, la formation politique reçue au PCF et au cours des événements de 1968, etc., et le fait que j’ai toujours réussi — en passant quelques jours au cachot, en grève de la faim ou au QHS [Quartier de haute sécurité, ndlr] — à être seul en cellule, du début à la fin.
Vous ne remettez donc pas en question l’incarcération en tant que telle ?
Si, évidemment. Mais seuls les vrais problèmes m’intéressent, et non les postures. Par exemple, cela fait drôlement bien de clamer que je vais mettre à bas le capitalisme. Mais ce qui m’intéresse, c’est de le faire pour de bon. Ou de faire autre chose en attendant. Clamer, ce n’est pas difficile ; sauf que ça fait 55 ans que j’entends ça — et que je le dis moi aussi… Et ça ne marche pas du tout. Il y a malfaçon intellectuelle. Il existe un business politique qui exploite tout cela à la recherche de places à l’Assemblée nationale, au Parlement européen, dans des cabinets, etc. Cela sonne peut-être « anti-système » à la Le Pen de dire les choses ainsi, mais c’est malheureusement vrai. Bien sûr que je suis contre la prison, contre l’injustice, contre le fait qu’il y ait des gens sur le trottoir, contre le mal… Et après ? Qui n’est pas contre le mal ? Quant à la prison, et quant à ce qu’en a pu dire Foucault, il faut l’inscrire dans les questions plus larges de la discipline et du contrôle — entre Foucault et Deleuze. À ce sujet, j’ai écrit notamment Prendre soin de la jeunesse et des générations, dont la deuxième partie est consacrée à ce que Foucault dit des prisons, des casernes, des usines, des écoles et des hôpitaux, c’est très intéressant, mais il y manque une dimension fondamentale.
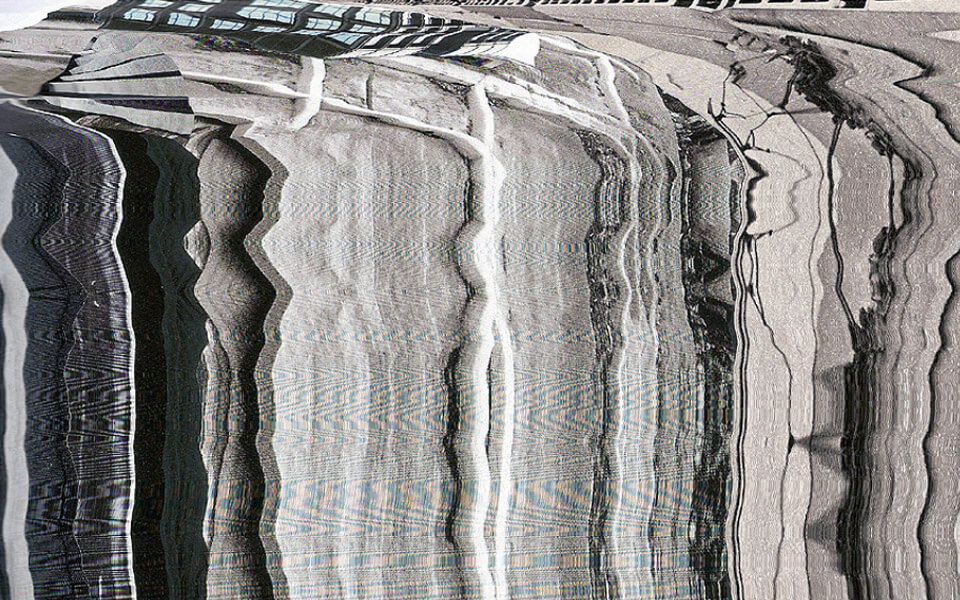
[Glitch art (1nd3x.com)]
Qui est ?
Comment peut-on appeler à tout renverser — dire que l’école est disciplinaire comme la prison, etc. — puis s’opposer aux néolibéraux qui souhaitent privatiser l’école au prétexte qu’elle ne marche pas du tout ? Vous savez très bien comment Foucault a été utilisé par les néolibéraux : ils l’ont retourné pour justifier leurs politiques anti-étatiques. Tout ce qu’écrivait Foucault visait l’État, mais le problème n’est pas l’État : c’est le marché, ou l’État au service du marché. L’État est un problème en ce qu’il exerce une violence autorisée, légale, mais la violence du capitalisme est infiniment plus grande que celle de l’État. Voilà la vraie question (je vous conseille d’ailleurs de lire un article de Gabriel Rockhill paru dans Mediapart : il raconte de quelle manière la CIA s’intéressait à l’intelligentsia française, à la French Theory, pour construire son idéologie ultralibérale). Il faut sans doute réfléchir à ce que serait une société sans prison. Voilà qui ne serait plus une posture, mais un travail de réflexion, un programme, une civilisation, même. Mais pour cela, il faut commencer par constituer une nouvelle critique, et notamment celle de l’économie politique. Le reste n’est que légitimation de son incapacité à sortir des terribles impasses dans lesquelles nous sommes enfermés.
Vous faites vôtre la notion de « prolétarisation », entendue comme externalisation de nos connaissances dues aux nouvelles technologies…
« Le problème n’est pas l’État : c’est le marché, ou l’État au service du marché. La violence du capitalisme est infiniment plus grande que celle de l’État. »
Cette notion, de même que le terme « pharmakon », est à la base de mon travail. Je cherchais à comprendre comment renverser une situation — une question qui préoccupe fondamentalement les stoïciens. Partir d’une situation où l’on est mal pour réussir à en extraire du bien, de l’intéressant. Suite à mes lectures de Derrida et de Socrate, transcrit par Platon, j’ai soutenu qu’une telle possibilité est ce qu’ouvre le pharmakon. La thèse que Deleuze reprend aux stoïciens et qu’il appelle la « quasi-causalité » est aussi de cet ordre. Ainsi de Marcel Proust concernant la maladie : comment son asthme fait de lui l’auteur d’À la recherche du temps perdu. J’ai un enfant ; comment vais-je transformer ses défauts en faisant d’eux l’objet totalement inattendu de mon amour ? C’est ce qui constitue la quasi-causalité dans la situation pharmacologique. Et le problème du vivant humain en procède toujours. Tout ce que nous pratiquons à travers nos techniques, du silex taillé — qui requiert déjà une loi, comme le comprend mal Freud — au smartphone qui détruit en ce moment la planète par l’intermédiaire des réseaux sociaux et de leurs « effets de réseau » absolument calamiteux — en cela que Peter Thiel prétend y exploiter avec Donald Trump le « désir mimétique » conçu par René Girard —, sont des remèdes qui peuvent potentiellement être des poisons, et inversement. L’Homme n’est pas enfermé dans des prescriptions génétiques qui lui imposeraient un mode de vie que l’on appellerait la nature biologique de l’Homme. L’Homme n’est pas seulement biologique, il est technologique. Il est insuffisant biologiquement, comme inachevé, et a donc le besoin de se parachever sur le plan technologique, s’ajoutant ainsi sans arrêt des organes : l’ordinateur sur lequel vous êtes en train de lire, les lunettes que j’ai sur le nez, les caméras qui nous filment ou encore l’endroit dans lequel nous sommes, le Centre Pompidou. Cela pose problème, car la technique évolue de plus en plus rapidement, jusqu’à nous dépasser et créer une dysharmonie. Le premier système technique qui a existé, il y a 3 millions d’années, a duré environ 1 million d’années, et cela pratiquement sans évoluer : il s’appelle le chopper. Il va donner lieu ensuite au biface, qui est une technique de taille déjà beaucoup plus élaborée.
À travers le temps, on peut voir que la durée des systèmes techniques va diminuer au fur et à mesure. 1 million d’années, 300 000 ans, 100 000, 30 000, 3 000 pour l’Égypte, 300 ans pour Rome, 70 ans pour la machine à vapeur ; aujourd’hui, plus rien n’est stable. Ce qu’on appelle « société », ce sont des règles qui se construisent entre groupes humains — d’abord en tout petits nombres, avec seulement quelques dizaines d’individus, puis quelques centaines, puis des milliers, telles les tribus indiennes d’Amérique du Nord. Ces sociétés avaient des règles magico-religieuses qui constituaient l’unité ethnique, s’exprimant sous une forme de droit archaïque, de règles transmises par les mythologies et les systèmes symboliques. André Leroi-Gourhan a montré que le problème d’une communauté a toujours été de devoir gérer les entrées et les sorties techniques, les transformations qu’elles peuvent engendrer sur les structures de ces sociétés. Toutes les règles sont toujours là pour contenir le pharmakon qu’est la technologie. Ce que nous vivons aujourd’hui est une incroyable accélération de la transformation de toutes ces règles qui font société. Cette accélération change radicalement depuis 250 ans, avec ce que l’on appelle dorénavant l’ère Anthropocène. Entre 1780 et 1850, la machine à vapeur passe de quatre chevaux de puissance utile dans les usines à 5 000 chevaux : cela transforme totalement les conditions d’extraction du charbon et du fer, et donc de production de l’acier. Cette transformation technique va créer ce que l’on appelle une boucle de rétroaction positive, qui a pour conséquence qu’en l’espace de 70 ans, une société complètement rurale devient une société industrielle — telle Manchester, Lille ou Paris. Cette accélération va se poursuivre bien plus vivement encore avec le taylorisme et la théorie économique de Joseph Schumpeter, la destruction-créatrice, c’est-à-dire l’articulation entre le taylorisme et les industries culturelles, qui sont là pour inciter des gens à consommer des voitures, des marchandises. Ford, qui avait proclamé qu’au bout de 10 ans il produirait un million de voitures chaque année, y est arrivé. Mais le problème est devenu de réussir à les vendre. D’où le développement d’un système de marketing, qui va lui aussi tout transformer et détruire dans son sillon les structures précédentes, telles que l’Église, le droit politique… Tout va être remplacé par Hollywood, la radio…
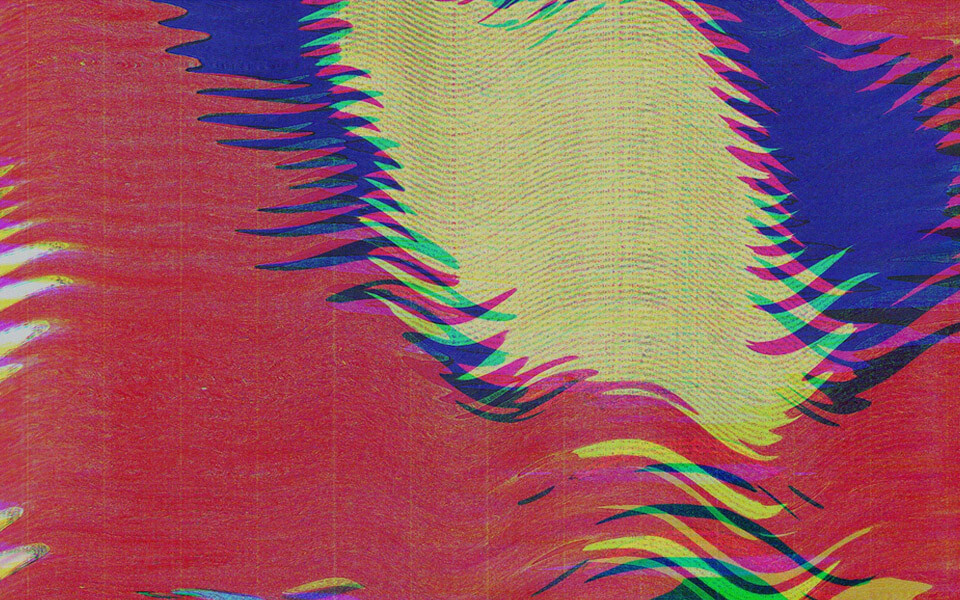
[Glitch art (1nd3x.com)]
Jusqu’à créer une nouvelle idéologie ?
Une idéologie fonctionnellement liée au marketing : « Je consomme », c’est dire « Je subsiste ». Mais je n’existe pas — et cela parce que plus rien ne consiste. Tel est le consumérisme, c’est-à-dire le capitalisme consumériste. Une nouvelle mutation se produit en 1993, lorsque le World Wide Web arrive, rend Internet accessible à tout le monde et permet en moins de 10 ans à pratiquement toute la population mondiale des pays industriels de créer et de consulter des sites Web. C’est ce qui a déclenché le pharmakon numérique, c’est-à-dire un processus qui, en passant par le smartphone et les réseaux sociaux, a totalement transformé les rapports entre les gens et les pays. J’ai siégé au Conseil national du numérique durant trois ans, où je n’ai cessé de voir des ministres ou des chefs de service de la haute fonction publique venir nous poser des questions. Mais lorsque nous y répondions, ces questions ne se posaient déjà plus, trois ou quatre mois plus tard, parce que le problème avait été déplacé, dépassé. Ce phénomène fait partie du business model des disrupteurs. Et un autre problème se posait, plus disruptif encore que le précédent. J’introduis ainsi le thème de la « disruption ».
« Même les gens dans le top management des entreprises ne savent plus comment tout cela fonctionne : eux-mêmes sont prolétarisés. »
Depuis 1993, c’est-à-dire depuis que le monde entier s’est réticulé à travers les technologies algorithmiques du calcul intensif, des services de « plateformes », des data center, du cloud computing et des smartphones, s’est imposé ce que l’on appelle la data economy, constituant l’ensemble des prescriptions contrôlant nos comportements et nos relations aux autres et sur lequel nous n’avons plus aucune prise. Pourquoi ? parce que les algorithmes se développent beaucoup plus vite que nous ne sommes capables d’apercevoir. Ils sont cachés, enfermés dans des « boîtes noires ». C’est cela, la « disruption ». Et ce fait impose une prolétarisation généralisée. Le premier à parler de « prolétarisation » est Socrate. Il n’emploie évidemment pas le mot, mais lorsqu’il dit que l’écriture est un pharmakon et que les lecteurs répètent comme des imbéciles les livres qu’ils ont lus sans comprendre ce qu’ils disent, croyant penser au moment même où ils s’arrêtent de le faire, il décrit déjà ce que Marx dira de l’ouvrier prolétarisé par la machine qui a rendu son savoir caduc et inefficient. Comme Internet aujourd’hui, où on répète des absurdités qui, à force d’être martelées, constituent le temps de la « post-vérité » qu’est le « désir mimétique ». Mais Socrate ne dit pas du tout que l’écriture doit être rejetée. Il pose que l’écriture est un pharmakon qui peut nous prolétariser, c’est-à-dire court-circuiter nos possibilités de savoir.
Pourquoi ?
Parce que cette tekhné qui met la mémoire hors de nous peut finalement nous en déposséder. Reste que ce n’est que par l’écriture comme nouvel âge du savoir que l’on peut combattre les marchands de leurre que sont à son époque les sophistes, et à notre époque les plateformes. Tout le monde éprouve ce phénomène aujourd’hui : on ne mémorise plus les numéros de téléphone ; les correcteurs orthographiques et les systèmes d’autocomplétion qui finissent les mots et les phrases à notre place sont une ruineuse externalisation du savoir linguistique. À une échelle autre, celle de la naissance de l’économie industrielle, Adam Smith décrit dans La Richesse des nations les conditions dans lesquelles les ouvriers vont arrêter de travailler — c’est-à-dire de transformer le monde à travers leurs savoir-faire — et servir des machines qui les rendent stupides : c’est ce qui provoque ce qu’il appelle la torpor, que décrira très bien Simone Weil au XXe siècle durant son passage dans l’usine d’Alsthom [aujourd’hui Alstom, ndrl]. Ce n’est plus du travail, mais de l’emploi — il faut distinguer précisément ces deux termes. Le prolétaire, pour Marx et Engels, est celui qui a perdu son savoir et se voit donc totalement dépendant du marché de l’emploi et des machines où il vend sa labour force, ce labeur n’étant plus un ouvrage, c’est-à-dire a work. Cela explique les mouvements de révolte des ouvriers brisant « leurs » machines, leur « outil de labeur » et non plus de travail, le travailleur devenant l’employé. Quand on parle des big data, et qu’on nous dit qu’ils se substituent aux statisticiens, aux médecins, aux juristes et aux urbanistes, ce sont des algorithmes qui court-circuitent les institutions sociales en prescrivant des comportements antisociaux — et toxiques au sens où ils accélèrent l’implantation de l’ère Anthropocène qui détruit la biosphère. Même les gens dans le top management des entreprises ne savent plus comment tout cela fonctionne : eux-mêmes sont prolétarisés.
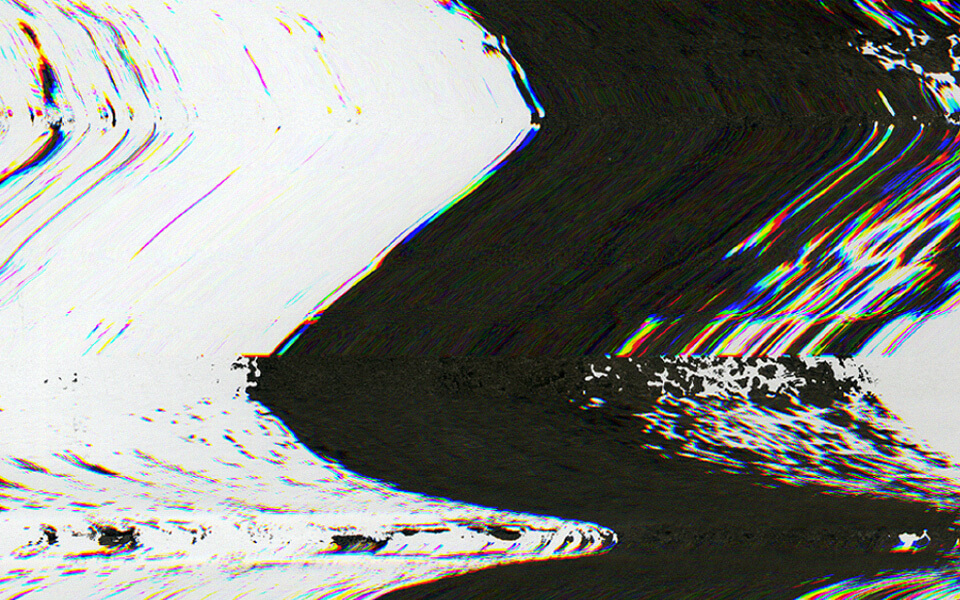
[Glitch art (1nd3x.com)]
On pense à l’affaire Greenspan, cet économiste américain qui, après avoir été sacré roi des économistes, a été accusé de n’avoir pas vu venir la crise des subprimes…
Oui. Greenspan expliquait en 2008, auditionné par une commission sénatoriale, qu’il ne pouvait être mis en cause en tant que responsable de la crise puisque personne ne savait plus comment ce système économique fonctionnait. Quand il dit cela, il explique qu’il est un prolétaire tel que le définissaient Marx et Engels dès 1848. Nous ne maîtrisons plus cette technologie : elle nous a dépassés. La prolétarisation généralisée touche tous les domaines : c’est absolument catastrophique. Toutes les personnes qui ont des enfants entre 5 et 15 ans en font l’expérience. Par la pénétration du smartphone ou du jeu vidéo, nous ne contrôlons plus rien de nos propres enfants : c’est le marketing qui les pilote et gère leur attention. On éprouve alors la prolétarisation dans la vie quotidienne. Dans tous les pans de la vie. Les chauffeurs de taxi, tous « GPSisés », ne sont plus des chauffeurs mais des automates pilotés par leur GPS, qu’Uber peut dorénavant remplacer par des robots. Cette immense transformation est en train de réaliser le discours de Marx, élaboré dans son Introduction générale à la critique de l’économie politique, et plus particulièrement dans le « Fragment sur les machines » des Grundrisse : en 1857, il y fait l’hypothèse que le capitalisme, en toute logique, conduit à une automatisation généralisée.
La critique de Marx ciblait avant tout la question de la prolétarisation du travail, non ?
« Ce n’est plus simplement le corps du travailleur devenu prolétaire qui fournit sa force de travail à la machine, c’est le corps du consommateur qui s’auto-consomme. »
Marx ne pouvait pas imaginer ce que serait une société consumériste. Il vivait à une époque où les prolétaires de Manchester croupissaient dans la misère absolue. Difficile pour lui d’entrevoir ces mêmes ouvriers au volant d’une voiture avec climatisation, GPS et smartphone à la main ! Ou d’imaginer qu’une voiture qui sort des chaînes américaines de General Motors puisse posséder plus de 500 capteurs à même de renseigner des algorithmes. Ni prévoir que de nouvelles technologies mises au point par l’entreprise Generali puissent mettre en place un contrat d’assurance demandant votre accord pour que les data de votre voiture leur soient transmises, afin de vous prescrire par la suite comment la conduire. C’est en cours au niveau des assurances ; c’est déjà le cas pour les assurances sociales. Vous allez vous engager à transmettre vos données et on va vous dire de manger moins de graisses, moins de sucre… Et vous allez devoir le respecter, sinon vous allez payer des primes. On est dans ce monde-là. C’est une réalité inimaginable pour Marx. Et pourtant, c’est la conséquence de ce qu’il écrit en 1857.
Serions-nous en train de devenir les acteurs passifs d’une société de contrôle entièrement régie par la technologie, un panoptique immense et total ?
C’est ce que j’appelle les sociétés d’hypercontrôle — qui confirment ce que Deleuze décrit en 1990, mais en l’accentuant incommensurablement. Dans les années 1990, Toni Negri l’avait interviewé pour la revue Futur Antérieur : il avait énoncé qu’il fallait aller un peu plus loin que la notion de société disciplinaire au sens de Foucault, parlant de société de contrôle à propos des médias de masse à l’ère des reality shows. On intériorise aujourd’hui l’hypercontrôle dans le corps, on réaménage celui-ci : il devient une sorte d’interface servant des réseaux — et Virilio voyait venir cela. Ce n’est plus simplement le corps du travailleur devenu prolétaire qui fournit sa force de travail à la machine, c’est le corps du consommateur qui s’auto-consomme. Nous en avons avec Ars Industrialis une vision pharmacologique, selon laquelle il faut toujours retourner le négatif, non pas simplement en positif — c’est la position hégélienne — mais en affirmatif, et au sens où il faut en devenir les quasi-causes, ce qui est plus nietzschéen. Si on lit sérieusement les textes de Marx, en les analysant terme à terme, on en arrive à la conclusion qu’il faut dépasser le point de vue marxiste classique, à savoir que c’est le prolétariat qui, comme force révolutionnaire, va renverser le capital. Force est de constater au regard de l’Histoire que c’était une erreur. Si nous voulons avancer, il faut en faire notre deuil une fois pour toutes : ce n’est pas le prolétariat qui changera quelque chose.

[Glitch art (1nd3x.com)]
Comme annoncé par l’OCDE ainsi que par l’Observatoire de l’emploi, il y a une baisse de l’emploi à prévoir, soit 10 % de chômage en plus dans les 10 années qui arrivent. Si on prend à la lettre ce que dit le MIT dans une étude réalisée il y a quelques années, c’est 47 % des emplois qui tendent à disparaître en Amérique du Nord (plus exactement : 47 % des emplois américains sont automatisables). Oxford dit que cela concerne 50 % des emplois en France. Tous ne vont pas être automatisés, mais si on considère les stratégies d’Amazon sur ses magasins sans employés, si on regarde cette banque qui met en service un système d’intelligence artificielle pour conseiller ses clients, ce sont des millions d’emplois qui vont disparaître dans tous les domaines. Et que cela soit 10, 20 ou 30 %, dans tous les cas, l’emploi est en train de baisser. Nos économies sont fondées sur la spéculation ; nous nous sommes structurellement imposés un endettement parfaitement insolvable. À un moment donné, il faudra payer la note, et cela va faire très mal — ce qui va probablement nous tomber dessus dans les prochaines années. Ici, les responsables ne sont pas les États, et encore moins les consommateurs, mais les fonds spéculatifs. Étant déjà aujourd’hui aux limites du supportable, 10 % de chômage supplémentaire deviendront totalement insoutenable ; ne parlons même pas de 20 ou 30 %… À partir de là, il y a une négociation à engager avec le capitalisme entrepreneurial. Il va falloir qu’il redistribue les gains de productivité. C’est indispensable pour lui, parce qu’il a besoin de gens qui achètent des marchandises pour continuer à vivre. Tous les capitalistes des grandes entreprises qui réfléchissent un peu le savent.
À qui pensez-vous ?
« Tous ne vont pas être automatisés, mais ce sont des millions d’emplois qui vont disparaître dans tous les domaines. »
Warren Buffet, par exemple. Cette redistribution doit se faire intelligemment, afin de créer de nouveaux types de valeurs qui permettront à l’Europe de sortir du modèle prédateur qui est en train de la détruire. Sans rien défendre de la Commission européenne et de l’Union européenne telles qu’elles l’ont imposé à travers le traité de Maastricht, il faut faire de l’Europe un projet nouveau : cette civilisation qui paraît épuisée a encore d’innombrables ressources, et demeure le marché le plus solvable du monde en ce qui concerne ses fondamentaux : éducation, santé, infrastructures, centres de recherche, etc. Dans la mesure où il s’agit désormais, toutes affaires cessantes, de sortir la planète de l’impasse où elle se trouve — impasse qui fait dire au GIEC que si dans 50 ans nous n’avons pas tout changé, tout est perdu… —, l’enjeu est d’engager un processus de déprolétarisation. Si les robots permettent de gagner du temps, que fait-on de ce temps ? Il faut le consacrer à la reconstruction des savoirs. On n’a plus de savoirs, on ne sait plus écrire ni compter, ni même élever ses enfants, on ne sait plus enterrer ses parents : on ne sait plus rien faire, en fait… « Apprenez l’orthographe en deux jours », proposent des spams : ça coûte 1 600 euros et c’est fait pour les cadres supérieurs qui ne savent plus écrire, parce que les correcteurs orthographiques désactivent leurs connexions synaptiques. Ils désapprennent tout, comme vous et moi. La future voiture autonome va nous désapprendre à conduire.
Mais tout le monde n’est pas aussi pessimiste que vous ! D’aucuns vous diront : par l’externalisation, le cerveau se décharge de tâches « subalternes » pour se concentrer sur d’autres choses, voire passe à une couche « supérieure » de réflexion. Tout comme l’écriture a permis de décharger une partie de l’espace de notre mémoire disponible pour se concentrer sur d’autres pans, tout aussi essentiels.
Ce serait vrai si l’on comprenait que la technologie est un pharmakon et que, sans prescriptions thérapeutiques formées par des institutions de savoirs nouvelles, le pharmakon est nécessairement empoisonnant. Mais pour produire ces nouvelles prescriptions, il faut les mettre au cœur d’une nouvelle façon de produire de la richesse économique luttant contre l’ère Anthropocène, et pour produire l’ère Néguanthropocène, laquelle suppose une nouvelle macro-économie valorisant ce que nous appelons l’économie contributive. Si la technologie redonne du temps, la question est de savoir à quoi est consacré ce temps. Ce temps doit devenir celui de la déprolétarisation et de la formation et l’acquisition de savoirs nouveaux — ce que sentaient André Gorz et Oscar Negt. Mais décharger la mémoire pour suivre Trump, c’est ce à quoi conduisent les sottises de Michel Serres et de sa « petite poucette ». Marianne Wolf, une neuroscientifique spécialiste de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, montre qu’il y a deux possibilités : soit vous êtes en rapport avec une technique dont vous ignorez tout du fonctionnement et vous y êtes asservi, c’est-à-dire « adapté », soit vous adoptez quasi causalement cette technologie en en prescrivant aussi bien les caractéristiques fonctionnelles que les pratiques sociales. Nous, nous disons qu’il faut reconstruire un rapport savant aux technologies largement distribué et en reprenant une part des analyses de Gilbert Simondon. Bientôt, on nous dira que cela ne sert plus à rien de lire ni d’écrire : avec les systèmes de reconnaissance vocale — Siri ou autres —, pourquoi investir tant d’argent dans l’éducation ? Mais, dans le même temps, les enfants des grands patrons de la Silicon Valley vont dans des écoles où il n’y a ni téléviseurs, ni aucun écran, pas de smartphones ni d’ordinateur. Laissons plutôt cela aux pauvres gens — et crétinisons-les en masse. Je ne dis pas que c’est calculé ni délibéré. En revanche, je soutiens que ce modèle, qui est insoutenable et insolvable, produit aussi les électeurs de Trump, de Salvini et de tant d’autres à venir.
Photographie de vignette : Cyrille Choupas
- Du 8 juillet au 5 août 1974, 89 mouvements collectifs de révoltes se déclenchent, dont 9 mutineries. 11 établissements pénitentiaires sont dévastés et 7 morts sont dénombrés.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Miguel Benasayag : « Il ne faut pas traiter les gens désengagés de cons », avril 2018
☰ Lire notre entretien avec Alain Damasio : « Nous sommes tracés la moitié de notre temps éveillé », octobre 2017
☰ Lire notre entretien avec Isabelle Garo : « Lire Foucault », février 2016
☰ Lire notre entretien avec Manuel Cervera-Marzal : « Travail manuel et réflexion vont de pair », mars 2016
☰ Lire le texte inédit de Daniel Bensaïd, « Du pouvoir et de l’État », avril 2015
