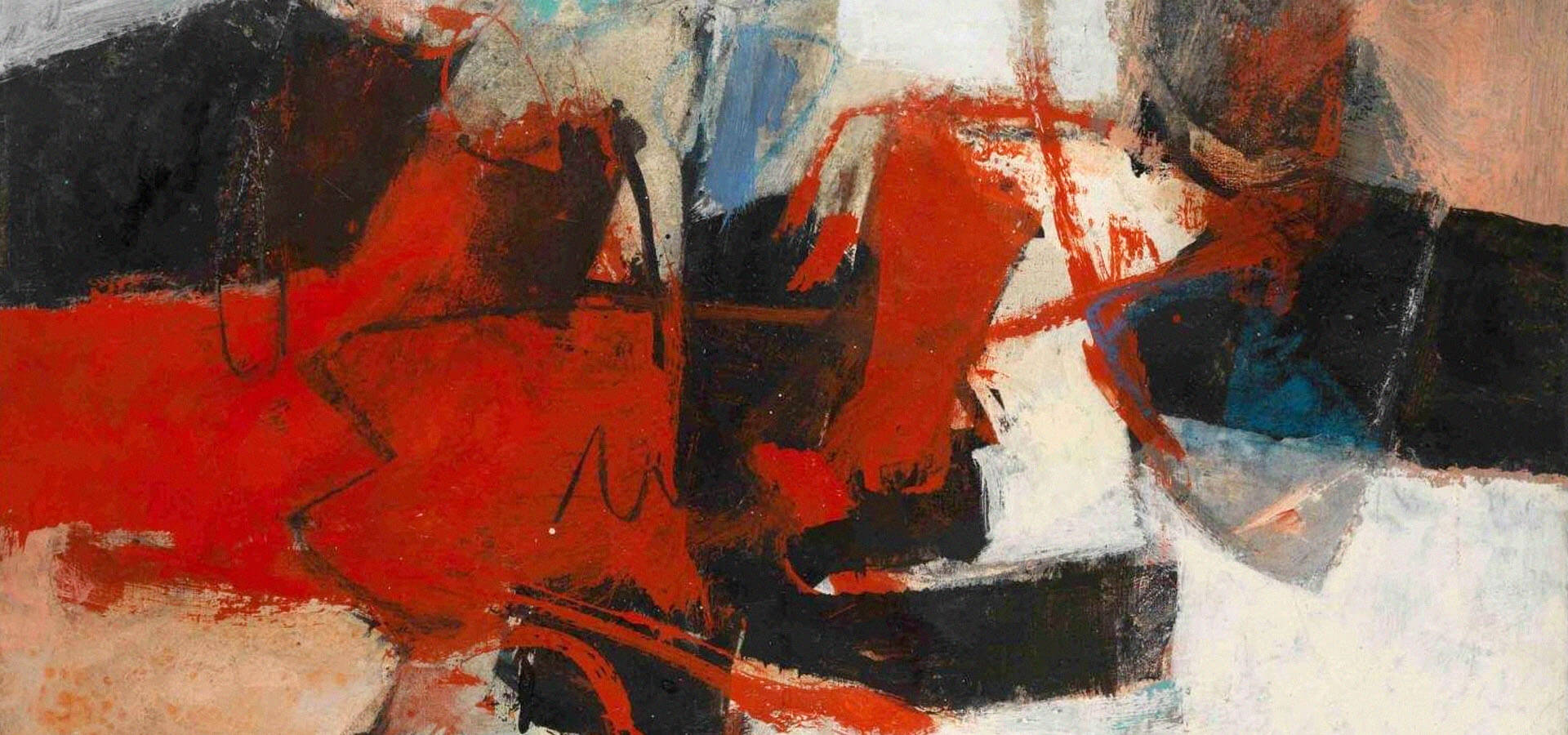Texte paru dans le n°3 de la revue papier Ballast (automne 2015)
« Anarchie et communisme, loin de hurler de se trouver ensemble, hurleraient de ne pas se trouver ensemble », lança Cafiero, cofondateur méconnu du communisme libertaire. Il y a deux siècles de cela, cet Italien s’était pris à rêver d’un monde de concorde et de fraternité, en harmonie avec la nature : il s’empara d’un fusil, garda des vaches, assista un photographe, fut docker, vulgarisa Marx, appela finalement à participer au système électoral et mourut dans un asile. Portrait. ☰ Par Émile Carme

« Non plus la promesse d’un Paradis sur terre, tombé d’on ne sait quelle grâce dialectique, mais la mise en œuvre hic et nunc des intuitions ou des programmes révolutionnaires. »
Carlo Cafiero et Errico Malatesta, moins de soixante ans à eux deux, avaient élaboré ce projet de concert. La région est connue pour ses soulèvements populaires, son brigandage et son hostilité à l’État unificateur du Padre della Patria, le roi Victor-Emmanuel II — un espace clé pour lancer un soulèvement révolutionnaire, d’autant que ses reliefs montagneux entraveront les forces militaro-étatiques dans la guérilla que leur opération ne manquera pas de déclencher. Les discours ne suffisent plus ; les analyses s’entassent sous les bonnes intentions ; les réunions et les livres végètent en vase clos : il faut agir, pensent-ils, incarner le socialisme, le matérialiser par une pratique insurrectionnelle. Non plus la promesse d’un Paradis sur terre, tombé d’on ne sait quelle grâce dialectique, mais la mise en œuvre hic et nunc des intuitions ou des programmes révolutionnaires. Les révolutionnaires annoncent aux paysans rassemblés qu’ils sont en train de libérer leur village de la tutelle monarchique : le socialisme s’apprête enfin à prendre ses quartiers ! « Vive l’Internationale ! Vive la République communiste de Letino ! » Les habitants, déroutés mais enthousiastes, les écoutent parler de l’abolition des impôts et de la conscription. Cafiero s’exprime en dialecte et promet une nouvelle société, sans militaires ni propriétaires, sans esclaves ni maîtres (tous ses autres compagnons, à l’exception de Malatesta, n’entendent goutte de la langue des locaux). Le communisme libertaire, en somme, auquel Cafiero œuvre depuis sa rupture avec les deux auteurs du Manifeste du parti communiste et sa rencontre avec l’anarchiste russe Bakounine.
On dit Cafiero juché sur une croix (ou, c’est selon, debout à la place de celle-ci, préalablement ôtée), un drapeau rouge et noir battant à ses côtés. Le registre des taxes et les cadastres partent en fumée sur la place. Le portrait du roi est décroché et déclaré déchu. « Nous, soussignés Carlo CAFIERO, Errico MALATESTA, Pietro Cesare CECCARELLI, déclarons avoir occupé la municipalité de Letino, à main armée, au nom de la révolution sociale », laissent-ils, par écrit, au secrétaire communal. Dans son ouvrage Gli Internazionalisti — La Banda del Matese, paru en 1958, le journaliste libertaire Pier Carlo Masini rapporte qu’ils hissèrent le drapeau bicolore sur la mairie. On dit aussi qu’une femme est venue demander à Cafiero s’ils pouvaient se charger de l’expropriation et de la redistribution des terres : l’intéressé répondit que les paysans devaient accomplir personnellement cette tâche et qu’il leur fallait, quant à eux, poursuivre leur chemin afin de libérer de nouveaux villages. L’accueil est chaleureux et le prêtre va jusqu’à déclarer que la parole du Christ est compatible avec le socialisme et que ces hommes s’avèrent, ni plus ni moins, dépositaires de la parole divine. Applaudissements. Sous la couverture d’un gentleman britannique, Cafiero s’était installé quelques jours auparavant dans une maison de la région, jouxtant un bois, en guise de base arrière (dans l’essai Italian Anarchism, Nunzio Pernicone fait savoir que la location avait été prise en charge par Malatesta3). Les armes y avaient été stockées et certains volontaires les avaient rejoints. Durant l’une de ces nuits, ils avaient fait face à quatre carabinieri ; des coups de feu étaient partis, deux policiers avaient été blessés et l’un était décédé des suites de l’infection de sa plaie. Les anarchistes s’étaient enfuis à la hâte, emportant ce qu’ils pouvaient, chargeant les armes sur trois mulets. Vingt-et-un fusils (des vieux modèles), huit revolvers et onze baïonnettes. D’autres camarades encore devaient les retrouver ; on parle de cent combattants initialement prévus dans le cadre de l’ensemble de l’opération — tant pis…

[Afro Basaldella]
Ils se rendent le lendemain à trois ou quatre kilomètres de là. Gallo, un petit village au bord d’un lac du même nom. Reconduisent l’opération. Les titres fonciers et un portrait du Père de la Patrie sont brûlés. Le feu entend en finir avec le vieux monde : la cendre couve de nouvelles perspectives. Un second prêtre rassure les habitants après avoir montré aux révolutionnaires qu’il est lui aussi, tout religieux qu’il soit, un exploité comme les autres — preuve en est la saleté de sa tunique. Les séditieux distribuent l’argent trouvé dans le bureau des taxes. L’insurrection, assurent Malatesta et Cafiero, est « le moyen de propagande le plus efficace et le seul qui, sans tromper ni corrompre les masses, puisse pénétrer les niveaux les plus profonds de la société4 ». Seraient-ils enfin en passe de l’emporter ? Le printemps manque à ses obligations et bride l’enthousiasme : une soudaine tempête de neige s’abat sur Gallo et contraint les insurgés à résister, plusieurs jours durant, au froid comme à la faim. Les troupes gouvernementales — qui n’ignoraient rien de leur action : leur guide, anarchiste, faisait office d’indicateur — les encerclent. Le ministre de l’Intérieur assumera sa stratégie : laisser les éléments séditieux élaborer, préparer, puis lancer leur action afin de les stopper in extremis pour asseoir le capital sympathie du pouvoir — protecteur, à l’évidence ; efficace, assurément — auprès de la population. Plus de dix mille hommes face à trente autres. Quelques échanges de tirs. Deux agents sont touchés (l’un deux perdra la vie des suites de sa blessure).
« Le ministre de l’Intérieur assumera sa stratégie : laisser les éléments séditieux élaborer, préparer puis lancer leur action afin de les stopper in extremis pour asseoir le capital sympathie du pouvoir. »
Le climat a rendu nombre de leurs armes inutilisables et, dans leur fuite, les insurgés n’ont pu emporter les baguettes nécessaires au rechargement des fusils… Épuisés, affaiblis, ils parviennent néanmoins à se réfugier dans une ferme en altitude. Un paysan les dénonce ; les troupes donnent l’assaut ; les révolutionnaires n’opposent aucune résistance, faute d’armes en état de marche. Un capitaine leur demande quel est l’objet de leur folle entreprise et les hommes de répondre : « La cause du peuple5 ». Un échec6. Un échec comme trois ans auparavant, en août 1874, lorsque Malatesta avait tenté, avec la complicité de Mikhaïl Bakounine, de déclencher une révolution sur la base d’un semblable soulèvement dans les Pouilles et à Bologne7. Cafiero avait acheté deux cent cinquante armes pour l’occasion mais n’avait pu en être : il lui avait fallu se rendre en Russie afin d’épouser une femme, Olympia Koutouzof8, qu’il avait rencontrée en Suisse dans le cercle d’amis de Bakounine et qui voyait ses mouvements limités par les autorités tsaristes — leur mariage allait permettre à Koutouzof d’obtenir la nationalité italienne et de rejoindre son vrai mari. Cafiero avait toutefois rédigé un texte afin d’expliciter leur geste : les paysans italiens allaient, enfin !, pouvoir s’affranchir de la tutelle tyrannique des maîtres. Leur action serait l’épicentre d’un vaste chambardement régional puis national. L’étincelle à même d’embraser la botte italienne tout entière ! Le papier joue parfois de drôles de tours à ceux qui y dessinent l’avenir : les paysans n’entendirent pas être libérés de la sorte ; ils livrèrent même leurs sauveurs aux forces de police.
Malatesta racontera : « Plusieurs centaines de conjurés avaient promis de se trouver à Castel del Monte. J’y arrive : mais là, de tous ceux qui avaient juré d’y être, nous nous trouvâmes six. Peu importe, on ouvre la caisse d’armes : elle est pleine de vieux fusils à piston ; cela ne fait rien, nous nous armons et déclarons la guerre à l’armée italienne. Nous battons la campagne pendant quelques jours, cherchant à entraîner les paysans, mais sans trouver d’écho9. » Encerclés, il réussit à s’enfuir, avant d’être arrêté en gare de Pesaro, cité portuaire à l’est de l’Italie. Après avoir songé au suicide, Bakounine s’échappa, grimé en prêtre, « appuyé sur une canne, un petit panier avec des œufs10 ». L’anarchiste russe avait soixante ans, de l’asthme, les dents saccagées et un corps inapte à pareille embardée — lui-même l’avait avoué à Cafiero : « L’état de ma santé, ma pesanteur, la maladie de mon cœur et la raideur de mes membres et de mes mouvements qui en sont la conséquence nécessaire, me rendaient désormais peu apte aux expéditions aventureuses11… » Il en fut pourtant, non sans avoir hésité. Celui qui comptait à son actif tant de faits d’armes révolutionnaires (1848 à Paris puis à Prague ; 1849 à Dresde ; 1870 à Lyon) se dit alors que ce soulèvement serait son dernier, même s’il ne croyait plus que l’Europe fût prête à accueillir le socialisme : il écrivit au militant libertaire James Guillaume, à qui l’on doit les précieux tomes de L’Internationale, qu’il n’en reviendrait pas.

[Afro Basaldella]
Mourir sur une barricade était l’ultime souhait de ce combattant fourbu et désespéré. Une vie de luttes dressant son bilan : « Je suis réellement fatigué et désillusionné. Les événements de France [la Commune de Paris] et d’Espagne avaient porté à toutes nos espérances, nos attentes, un coup terrible. Nous avions calculé sans les masses, qui n’ont pas voulu se passionner pour leur émancipation propre, et, faute de cette passion populaire, nous avions beau avoir théoriquement raison, nous étions impuissants12. » Une leçon plus qu’un bilan, d’ailleurs : l’histoire des mouvements avant-gardistes armés, champions de la minorité agissante, auraient appris de son expérience… Un second échec, disions-nous. Cafiero est jugé. Il passera, avec Malatesta et leurs camarades, seize mois derrière les barreaux. Fort peu, au regard des accusations retenues contre eux : conspiration contre l’État, destruction de propriété d’État, subversion armée, vol, crime. La mort des uns fait l’affaire des autres : le sacre du nouveau roi, Humbert Ier, entraîne une amnistie : les révolutionnaires sont libérés ; une foule d’environ deux mille personnes les attend pour les acclamer13. D’autres, socialistes compris, se montrent autrement plus sévères : de telles actions sont inconséquentes puisqu’elles renforcent l’appareil de répression d’État et jettent le discrédit sur l’ensemble du mouvement internationaliste. Cafiero a trente-deux ans et Malatesta ne tarde pas à prendre les chemins de l’exil, de l’Égypte à l’Argentine.
Un mouton noir de la noblesse
« Il chiffonna sa bonne étoile, choisissant l’aventure à l’avenir. Parjure à la fatalité et traître à sa généalogie. »
Quelques portraits demeurent. Deux ou trois photographies, autant de dessins. La barbe plus ou moins longue en fonction de l’âge qu’il avait lorsque l’image le fixa un jour et pour toujours. De beaux yeux fins, déliés et sombres. Paupières bombées, soulignées par l’ombre qui s’y glisse. La lèvre supérieure mangée par la moustache, et l’autre, plus volontaire et charnue. Le nez est long et les cheveux drus, semble-t-il. Il est dit qu’il mesurait un mètre soixante-dix-huit. Cafiero fut de ceux qui firent défaut à leur destin. Sa vie se plaça sous le sceau du contredit : la société aspire, forte de ses lois de reproduction, à ce qu’un fils de noble ou de bourgeois le demeure pour engendrer à son tour un noble ou un bourgeois. Cafiero préféra sectionner ses chaînes : génétiques et sociales14. Il chiffonna sa bonne étoile, choisissant l’aventure à l’avenir. Parjure à la fatalité et traître à sa généalogie : plutôt les ronces à la fine fleur, les fanions rouges et noirs au beau linge d’un monde de déjà-morts. Originaire des Pouilles, dans le sud-est de l’Italie, une région bordée des mers Adriatique et Ionienne, le jeune Cafiero n’avait que peu d’attrait pour sa terre natale ; il s’en alla étudier le droit à Naples.
Les informations sont rares, en langue française. Richard Drake, enseignant à l’Université du Montana, a publié en 2009 l’essai Apostles and Agitators:Italy’s Marxist Revolutionary Tradition : ceux qui fréquentaient Cafiero, apprend-on, le décrivaient comme « riche, élégant, beau15 ». Un autre témoignage fait savoir qu’il plaisait aux femmes16. Ses parents, des propriétaires terriens issus de la noblesse (son biographe italien, Pier Carlo Masini, écrira dans son ouvrage Cafiero, paru en 1974, que sa famille, certes aisée, était pourtant moins riche que la légende ne le prétend), avaient un temps songé à faire de leur progéniture un prêtre17. Le jeune Carlo fut envoyé en formation au séminaire de Mofletta, jusqu’à ses dix-huit ans, mais haït cette expérience (comme il haïra l’Église, véritable organe de répression à ses yeux). Il n’en restera pas moins fasciné par la religion, note Drake. Cafiero abandonna la diplomatie, s’intéressa aux langues orientales ainsi qu’à la civilisation islamique, et fit la connaissance du peintre Telemaco Signorini, artiste naturaliste dont l’œuvre attestait de ses préoccupations sociales. Une rencontre décisive puisqu’elle permit au nobliau de prendre le pouls du monde environnant, dans cette ville, Florence, de brassages cosmopolites et d’agitation intellectuelle et politique.

[Afro Basaldella]
Cafiero se rendit à Paris puis à Londres, durant près d’un an, de juillet 1870 à mai 1871. Un séjour au cours duquel la France et l’Allemagne guerroyèrent — prélude aux deux guerres mondiales que l’on sait : 139 000 Français et 45 000 Allemands y perdirent alors la vie. L’Hexagone capitula, Napoléon III fut capturé, Bismarck annexa l’Alsace-Lorraine, le Second Empire s’effondra et la Commune éclata dans ses pas — la suite, écrite à même le sang, est connue… Deux témoignages nous éclairent sur la personnalité de l’activiste révolutionnaire qu’il n’est pas encore, signés du peintre Giuseppe De Nittis et du poète Giacinto Stiavelli : Cafiero était « un homme d’une grâce incomparable, d’une agilité d’esprit incroyable18 » ; il était généreux de son argent et donnait l’impression — fausse — d’une certaine nonchalance ; il dégageait « une grande majesté » et fascinait ses interlocuteurs par ses « manières exquises19 ». Ses textes, parfois violents, trancheront avec les rares descriptions qu’il existe de lui, homme doux et aimable aux intonations de voix féminines.
« Il fit la connaissance de Marx et d’Engels, alors en exil. Une commotion plus qu’une rencontre : le premier l’éblouit par son intelligence et sa force d’esprit. »
En Angleterre, Carlo Cafiero assista à quelque meeting organisé par la Première Internationale, à Hyde Park, et vit de ses yeux les taudis, les gouges, la prostitution, la criminalité, l’alcoolisme, la misère et la crasse des petits, des damnés, des sans-grades. Sa décision fut prise : il allait consacrer son existence à combattre l’oppression sociale et économique. Il fit la connaissance de Marx et d’Engels, alors en exil. Une commotion plus qu’une rencontre. Le premier l’éblouit par son intelligence et sa force d’esprit — il était âgé d’une cinquantaine d’années et possédait une œuvre colossale, déjà tout entière derrière lui (Le Manifeste du parti communiste avait paru deux décennies plus tôt et le premier volume du Capital, sur lequel il avait œuvré durant pas moins de vingt années, trois ans auparavant). Le tandem allemand n’a pas manqué pas de le charger d’une mission : retourner en Italie afin de devenir leur correspondant et, surtout, d’étendre l’influence de la pensée « marxiste20 » et, par là même, de contrer celle, des plus prégnantes dans son pays natal, des mouvements anarchistes (fortement inspirés par Bakounine) et mazziniens (de Giuseppe Mazzini, révolutionnaire républicain italien et déiste). Cafiero quitta Londres le 12 mai 1871, bien résolu à honorer sa tâche de disciple et d’émissaire du socialisme matérialiste et scientifique.
La Première Internationale était alors rongée par les querelles intestines : proudhoniens, communistes, marxistes, trade-unionistes, blanquistes, bakouniniens et autres anarchistes s’écharpaient sur des questions éminemment stratégiques et idéologiques (l’athéisme, l’État, le Parti, la grève, le fédéralisme, le sous-prolétariat…). Les heurts entre Marx et Bakounine cristallisaient pour partie ces tensions : le premier régla la question en excluant le second de la Première Internationale un an plus tard… Dans son ouvrage L’Émancipation des travailleurs, l’historien Mathieu Léonard résume, en plus des divergences doctrinales, le fossé psychologique et idiosyncrasique qui séparait les deux chefs de file : « Tout distingue le premier [Marx], patient scrutateur de la maturation du mouvement prolétarien depuis son observatoire londonien, du second, l’homme d’action, plus intuitif qu’intellectuel et en perpétuelle recherche d’énergies révolutionnaires. Si Bakounine admire les analyses et les capacités intellectuelles de Marx, celui-ci a en horreur le révolutionnarisme et la dimension baroque de son rival21. » Cafiero s’échina à reconstituer la section italienne de l’Internationale (il passa seize jours en prison après avoir été interpellé lors d’une réunion politique) et ne tarda pas à devenir une figure incontournable de ces milieux. Une correspondance s’engagea entre Engels et lui : introuvable, sauf par fragments, en langue française22. Dans une lettre du 28 juin 1871, le jeune épigone décrivit à Engels l’« état de barbarie » dans lequel se trouvaient les masses italiennes. « Ne connaissant rien, pensant fermement qu’elles sont nées pour servir et souffrir sur cette terre », misant seulement sur « la miséricorde de Dieu au Paradis23 ».
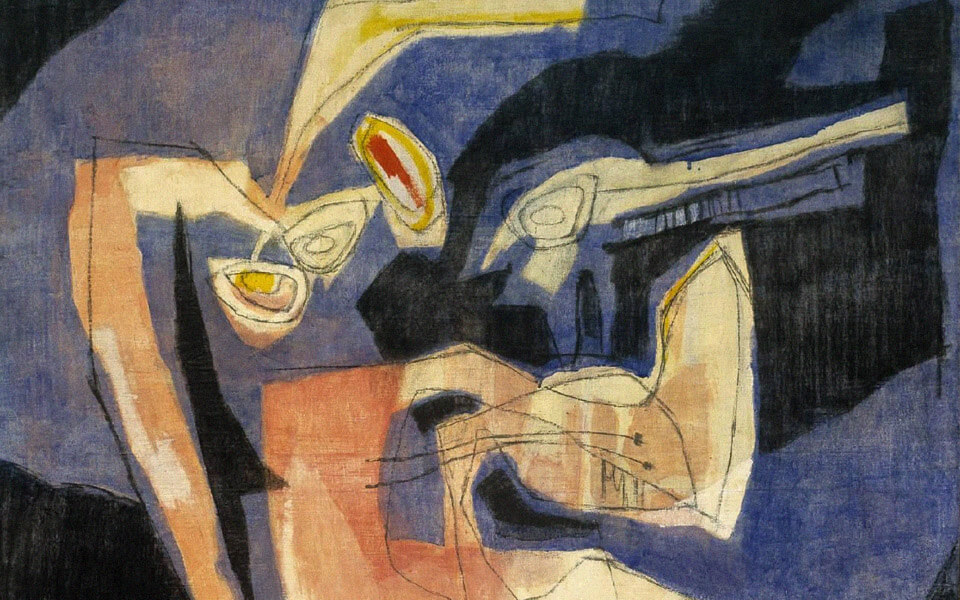
[Afro Basaldella]
L’idylle ne tarda pas à tourner court. Au grand dam d’Engels, Cafiero ne consentait pas à critiquer Bakounine, ni l’influence qu’il exerçait au sein des secteurs subversifs. Il lui écrivit même qu’il n’était nullement pensable d’imaginer un seul instant, contrairement aux accusations portées par les penseurs allemands, que Bakounine fût à la tête d’une secte ! L’Italien n’en démordit pas : il était plus de points communs que de divergences entre Bakounine et Marx ; Engels insista : il fallait œuvrer sans les bakouniniens et trouver d’autres points d’appui à Naples — l’anarchiste, ajoutait-il, incarnait un groupuscule qui, « seul24 », provoquait discorde et dissension au sein de la Première Internationale. Cafiero argua que le militant russe nourrissait pourtant force respect pour Marx25 mais l’alter ego de ce dernier ne daigna l’entendre ainsi. Dans sa correspondance, Engels écrivit à propos de leur apôtre indocile : « Cafiero est un brave garçon, un médiateur-né, et comme tel il est naturellement faible ; s’il ne se reprend pas prochainement, je l’abandonnerai lui aussi26. »).
« Le Russe avait fait la révolution que l’auteur du Capital avait seulement pensée. L’un avait l’odeur de la poudre sur les mains et l’autre celle de l’encre. L’un avait couru les barricades et l’autre les bibliothèques. »
L’Italie ne présentait pas les caractéristiques requises par Marx pour lancer une révolution : le pays, peuple agricole plus que prolétarien (notamment dans le sud), n’avait pas encore été bouleversé par le mode de production capitaliste — l’industrie n’y avait que dix ans d’existence. Mais, n’en déplaise aux calendriers communistes, Cafiero estimait que la révolution pouvait éclater à tout instant. Sans compter qu’il n’appréciait guère les velléités centralisatrices (londoniennes) de Marx : chaque pays, chaque région, obéit à ses rythmes propres (« Le poulpe doit être cuisiné dans son propre jus27 », rappelait-il). L’Italien en vint à rencontrer le tant craint Bakounine, en Suisse, le 20 mai 1872 : il fut soufflé par son charisme et sa puissance. Colosse de près de deux mètres, large d’épaules, édenté, cerné, malade du scorbut, vêtu à la hâte, la barbe et le cheveu sauvages, mangeant comme un bataillon et dormant tout habillé — Marx, railleur, le surnommait « Mahomet sans Coran ». Le Russe avait fait la révolution que l’auteur du Capital avait seulement pensée. L’un avait l’odeur de la poudre sur les mains et l’autre celle de l’encre. L’un avait couru les barricades et l’autre les bibliothèques. Bakounine était un mythe plus qu’un homme de chair et d’os : il avait rompu avec les siens — son père, aristocrate, possédait un domaine où travaillaient cinq cents serfs —, déserté l’armée russe, dévoré les textes d’Hegel, été déchu de ses titres nobiliaires, participé à plusieurs soulèvements dans toute l’Europe, passé six années derrière les barreaux, été déporté en Sibérie puis en cavale du Japon à New York… Un titan. De retour en Italie, Cafiero, vingt-six ans, n’eut d’autre choix que de l’avouer à Engels : « Après quelques instants de conversation, nous avons réalisé que nous étions [avec Bakounine] tous deux en complet accord quant aux principes28. » Puisque Cafiero n’était pas parvenu à réconcilier le communiste et l’anarchiste, il lui fallait choisir ; et il choisit : « Maintenant, mon cher ami, permettez-moi de vous parler avec franchise. Votre programme communiste est pour moi, dans le meilleur des cas, une grande absurdité réactionnaire29. » Cafiero avait fait lire certaines lettres d’Engels à son entourage ; elle servirent — avec ou sans l’aval du premier — à la rédaction d’un piquant article contre le compagnon de Marx. L’intéressé s’en offusqua, à raison, et lui reprocha sa trahison. Cafiero ne donna suite. La rupture était consommée.
Le grand souffle anarchiste
Adieu Marx, Engels et leur spectre communiste. Réactionnaire, le Manifeste ? Réactionnaire, le programme en dix points promu dans ses pages désormais célèbres sur la planète entière ? L’expropriation de la propriété foncière, l’impôt progressif sur le revenu, l’abolition de l’héritage, la centralisation d’une banque monopoliste d’État, le défrichement des terrains incultes, l’éducation gratuite et la fin du travail pour les enfants ? Non point. Bien que Cafiero n’ait pas formulé les choses ainsi (il écrivit peu, sa vie durant, avouant lui-même qu’il préférait les travailleurs manuels aux faiseurs de phrases), nous serions tenté de mettre en évidence trois axes de désaccords majeurs : l’État, la « linéarité » révolutionnaire et la paysannerie. L’affaire est connue ; rappelons-la seulement à grands traits : Marx et Engels estimaient qu’il fallait viser le dépérissement (ou, selon les textes, l’extinction, l’abolition, la destruction) de la structure étatique, mais qu’il n’était pas pensable, contrairement aux positions défendues par les anarchistes, de s’en débarrasser d’un coup d’un seul30. D’où la nécessité d’instituer une période transitoire : la dictature du prolétariat (dans sa correspondance, Marx consigna que ladite période conduirait à « l’abolition de toutes les classes » vers « une société sans classes31 »).
Cafiero, dans les pas de Bakounine, s’est inscrit en faux : l’État est et restera le porteur de bagages des dominants. Les transitions sont amenées à durer et le peuple victorieux aura tôt fait de voir son pouvoir accaparé dans les mains de ceux qui promettront d’agir pour son bien. L’idée même d’un État populaire ou ouvrier, avancée par certains socialistes, lui soulevait le cœur : un tel projet déboucherait inéluctablement, écrivit-il dans l’un de ses articles, sur « le plus parfait despotisme, car, ne l’oublions pas, le despotisme de l’État actuel augmenterait du despotisme économique de tous les capitaux qui passeraient aux mains de l’État, et le tout serait multiplié par toute la centralisation nécessaire à ce nouvel État32 ». L’URSS, de 1922 à 1991, se chargerait de confirmer ses dires. « Pas d’intermédiaires, pas de représentants qui finissent toujours par ne représenter qu’eux-mêmes ! », ajoutait-t-il. Pas d’élus payés pour porter des vestes retournées mais la démocratie directe, sans corps parasitaires. « Point d’entremetteurs, point de courtiers et d’obligeants serviteurs qui finissent toujours par devenir les vrais maîtres » — d’où sa volonté, après sa rupture avec le communisme « marxiste », de « combattre à outrance » ceux qu’il percevait comme des autoritaires33.
« Les transitions sont amenées à durer et le peuple victorieux aura tôt fait de voir son pouvoir accaparé dans les mains de ceux qui promettront d’agir pour son bien. »
Marx estimait que le communisme découlerait du capitalisme. De son œuvre émergea une sorte de « théorie des stades », fondée sur l’analyse historique des modes de production successifs, capable d’expliquer l’évolution inéluctable de l’humanité : 1) le communisme primitif (ou mode de production asiatique), 2) l’esclavage, 3) le féodalisme, 4) le capitalisme. La cinquième (et dernière ?) étape serait donc le communisme, elle-même découpée en deux temps : le socialisme, comme moment charnière, puis le communisme intégral, c’est-à-dire l’abolition définitive des classes et de l’exploitation de l’homme par l’homme. Lénine reprit cette gradation à son compte, des décennies plus tard, en la synthétisant dans son ouvrage L’État et la Révolution : « Le communisme procède du capitalisme, se développe historiquement à partir du capitalisme, résulte de l’action d’une force sociale engendrée par le capitalisme34 » (le leader bolchevik parlera également de « substituer l’État prolétarien à l’État bourgeois35 » avant de le briser puis de l’anéantir définitivement). Plus lapidairement encore, Mao écrira : « Le capitalisme mène au socialisme, le socialisme mène au communisme36. » La messe est dite. Ce schéma rigide, évolutionniste et linéaire — qui mériterait à l’évidence plus ample développement, d’autant que le dernier Marx, celui de la (brève) correspondance avec Vera Zassoulitch, se montra moins affirmatif37 — fut contesté du vivant de Marx et continua, bien sûr, de l’être après sa mort, en 1883, au cœur comme à l’extérieur des courants marxistes. Conséquence des plus concrètes : les pays qui n’avaient pas atteint le quatrième stade se voyaient inaptes à la révolution sociale : un éloge dialectique du capitalisme que l’écosocialiste Paul Ariès nomme la « première bévue38 » du marxisme. Si Bakounine avait été, comme Marx, nourri à la pensée hégélienne, il trouvait les propositions de son homologue prussien par trop mécanistes, fatalistes et déterministes. Cafiero n’entendait pas, quant à lui, que l’on pût repousser l’émancipation à demain : il n’est nul besoin de « rassembler les conditions » qui, inévitablement, conduiraient au socialisme (Marx évoqua « l’inéluctabilité d’un processus naturel39 » dans le premier volume du Capital).
La paysannerie, enfin. Dans son livre Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte, Marx fit savoir les raisons pour lesquelles il lui était impossible de se constituer en classe40 : le paysan est conservateur, ou réactionnaire, car enraciné dans sa terre — sa sédentarité lui vaut d’assentir à l’ordre dominant comme aux pesanteurs du vieux monde. L’attachement profond qu’il porte à son sol l’aliène, comme le premier bourgeois venu, aux vices de la propriété individuelle. « L’influence politique des paysans parcellaires trouve, par conséquent, son ultime expression dans la subordination de la société au pouvoir exécutif41. » S’élance, face au paysan potentiellement contre-révolutionnaire, l’ouvrier moderne, celui qui détient les armes qui « mettront à mort42 » la bourgeoisie. À l’instar, plus tard, des libertaires Emma Goldman ou Erich Mühsam et des populistes russes, Cafiero et Bakounine refusaient de faire de l’ouvrier urbanisé (le prolétaire) le moteur privilégié de l’émancipation : les secteurs agricoles et le sous-prolétariat des villes ont leur mot à faire dans la grande lutte libératrice. Ici et maintenant, donc. Avec les paysans et sans transition étatique, donc. La pensée découle de l’action, pensait-il, et non l’inverse. Son article « I tempi non sono maturi43 ! » (« Les temps ne sont pas mûrs ! ») rappela que les vrais ennemis n’étaient pas les despotes et les obscurantistes, mais les « faux libéraux » et les « modérés » : ceux qui ne cessent de répéter qu’il faut attendre, encore, que le peuple n’est pas prêt, pas encore. Cafiero, qui, pour des raisons de sécurité militante, se faisait également appeler Armando et Gregorio, s’insurgeait : ce discours arrange les immobiles, les pleutres et les repus. La révolution est celle que l’on décide de faire ; ni plus, ni moins44.

[Afro Basaldella]
La propagande par le fait (autrement dit l’insurrection continue, par tous les moyens extra-légaux possibles : attentats, tyrannicides, sabotages, soulèvements, etc.) constituait donc, à ses yeux comme à ceux de son entourage anarchiste, le moyen le plus sûr pour soulever le peuple au regard des échecs des dernières révolutions (1830, 1848) et de la répression extrêmement brutale de la Commune de Paris (Cafiero saluerait ainsi, en 1881, l’assassinat du tsar Alexandre II à Saint-Pétersbourg). Il est d’usage, dans les publications universitaires, historiques et militantes, d’attribuer une phrase, devenue fameusse, à l’anarchiste russe Kropotkine : « Notre action doit être la révolte permanente, par la parole, par l’écrit, par le poignard, le fusil, la dynamite, et même, parfois, par le bulletin de vote, lorsqu’il s’agit de voter pour Blanqui et Trinquet quand ils sont inéligibles. […] Tout ce qui n’est pas légal est bon, pour nous. » Publiée dans un article du périodique Le Révolté, en 1880, et tronquée plus souvent qu’à son tour (le passage sur le bulletin de vote disparaissant curieusement). Le texte est en réalité de Cafiero. Mais si l’Italien avait pris ses distances avec les schèmes marxistes, il n’en étalait pas moins quelque progressisme naïf et béat, confiant au futur le soin d’apporter le bonheur aux humains. Il hasardera ainsi dans l’un de ses textes : « On pourra bien laisser à chacun prendre à volonté ce dont il aura besoin, puisqu’il y en aura assez pour tous. On n’aura plus besoin de demander plus de travail que chacun n’en voudra donner, parce qu’il y aura toujours assez de produits pour le lendemain45. »
« Cafiero vécut quelque temps à la Baronata en ermite, s’occupant des vaches, du bois et du fumier, puis, sans un sou, abandonna la Suisse pour assister un photographe à Milan. »
L’avenir, sous sa plume, avait des allures de jardin d’Éden : un jour, « le travail perdra le caractère ignoble de l’asservissement, en lui laissant seulement le charme d’un besoin moral et physique, comme celui d’étudier, de vivre avec la nature46 » ; un jour, « les hommes pourront vivre dans la concorde et la fraternité47 »… Contrairement à certains courants socialistes technocritiques, Cafiero envisageait positivement le développement des machines (« ces puissants auxiliaires du travail29 »), à condition qu’elles pussent apaiser les travailleurs dans leur labeur. Il était enfant de son siècle, celui de tous les possibles. Le suivant, qu’il ne put connaître, se chargera, sans doute une fois pour toutes, de faire obstacle aux rêveries les plus généreuses.
Mesquinerie de l’ordinaire et du présent, pourtant : une maison sema le trouble dans une foudroyante amitié. Cafiero, fort de l’héritage familial, avait dépensé sans compter pour la cause et installé Bakounine dans une superbe demeure suisse au bord du Lac Majeur (également conçue pour devenir un espace international voué à la Révolution), dont il prenait l’intégralité des frais et des travaux à sa charge. James Guillaume fera le récit détaillé et chiffré de cette déconfiture dans le troisième tome de L’Internationale : « Bakounine et Cafiero, qui n’avaient pas la moindre expérience en matière de finance, se lancèrent dans des acquisitions successives, conséquences de la première, firent exécuter des travaux coûteux, se laissèrent tromper par des entrepreneurs, des intermédiaires et des intrigants sans scrupules, jetèrent sans compter l’argent par les fenêtres ; et l’affaire de la Baronata devait finir, au bout d’un an, par la ruine à peu près complète de Cafiero et une brouille momentanée entre lui et Bakounine48. »
Cafiero trouva rapidement Bakounine trop à ses aises et manquant, par son confort quotidien et sa légèreté de vivre somme toute assez bourgeois, à ses devoirs révolutionnaires (l’un des biographes italiens de Cafiero estimera que Bakounine trouvait, en retour, son ami trop intransigeant et trop puriste ; l’historien Max Nettlau rapportera quant à lui que Cafiero manifestait peu de tolérance pour qui ne pensait pas comme lui). Brouille, donc, et départ de Bakounine — il s’en alla, chagrin et suicidaire, rejoindre Malatesta pour le fiasco insurrectionnel italien que l’on sait… Cafiero vécut quelque temps à la Baronata en ermite, s’occupant des vaches, du bois et du fumier, puis, sans un sou, abandonna la Suisse pour assister un photographe à Milan. Le Russe revint sur leur rupture dans son Mémoire justificatif — il s’agit, bien sûr, de sa « version des faits » : un récit en clair-obscur où l’anarchiste assure ne rien entendre de la déception ou de l’amertume de son ami, tout en admettant, il est vrai, qu’il usa de sa fortune (moins colossale, précisa-t-il, que l’on a bien voulu le dire) pour la bonne raison qu’il lui fallait prendre soin de sa famille (une femme, trois enfants et un beau-père)… Il jura s’en vouloir, tout en ajoutant : « Ai-je besoin de dire que Carlo, dans toutes ces affaires, entreprises et promesses, a été inspiré du plus pur dévouement fraternel, et que ce fut précisément cette grandeur d’âme fraternelle qui me fit accepter aveuglément tout ce qu’il m’avait proposé ? » Quelques reproches plus personnels émaillent ce document. Cafiero en serait venu à considérer Bakounine « comme un vieux chiffon absolument inutile et bon à jeter à tous les vents » ; il faisait preuve d’« abstraction révolutionnaire » ; il n’était, du fait de son « obstination extraordinaire », jamais capable d’entendre une nouvelle idée « au prime abord ». Les deux complices se retrouveraient pourtant, passant outre les rancunes et les impairs. Le 10 octobre 1875, Cafiero confierait à son ami : « Je t’écrirai, Michel [Mikhaïl, en français], aussitôt arrivé là-bas. Je t’embrasse, Michel, je t’embrasse bien fortement, je t’embrasse encore46. »
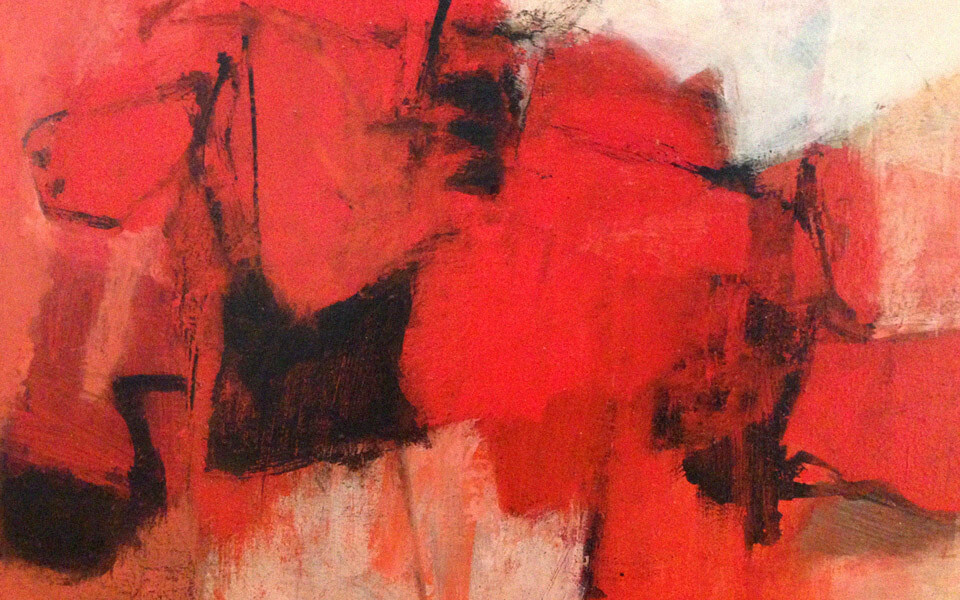
[Afro Basaldella]
L’égaliberté communiste libertaire
Cafiero, on l’a dit, sort de prison au lendemain de l’amnistie royale. Nous sommes en 1878 ; il a trente-deux ans, plus de père depuis longtemps, une fortune entièrement dilapidée, deux guérillas manquées au compteur et un compagnon-modèle mort en chemin — Bakounine disparut deux années auparavant, des suites d’une urémie. Il avait profité de son incarcération pour lire le Capital de Marx, dans une traduction française. Le texte, qu’il perçoit comme porteur d’une vérité nouvelle, l’éblouit à ce point qu’il voulut aussitôt le faire connaître au public italien. Non point aux lettrés (qui, de toute façon, savaient déjà le lire en allemand ou en français), mais aux travailleurs. Aux gens du commun. À ceux qui, les premiers, devraient avoir accès à ces textes théoriques afin d’affermir leur lutte. Le Capital, par trop savant et scientifique, n’est pas lisible par les Italiens les moins instruits : Cafiero rédigea en prison un abrégé, une synthèse en dix chapitres. Il le publia en 1879, un an après sa libération. Un souci pédagogique dont il avait déjà fait preuve en commandant un ouvrage didactique à son ami James Guillaume, qu’il traduisit ensuite en italien (le livre paraîtrait en français sous le titre Idées sur l’organisation sociale). Guillaume — avec, on l’imagine, l’appui de Cafiero — y rappelait que la révolution ne se commande pas et qu’elle échappe à tous les modèles et plans établis en amont ; elle doit prendre en compte la paysannerie, s’articuler sur la base de communes fédérées et procéder, par effet domino, de façon internationaliste. Cafiero rassemble également, avec d’autres, de l’argent pour les prisonniers politiques déportés en Nouvelle-Calédonie.
« Non plus rejeter le communisme — comme le faisaient Bakounine et Proudhon —, non plus mépriser l’anarchisme — comme le faisaient Marx et Engels —, mais réconcilier les frères ennemis. »
De France, il adresse son livre à Marx, en deux exemplaires, et joint un courrier des plus solennels, lui donnant du « très estimé Monsieur » et du « Votre très dévoué49 ». L’intéressé lui répond quelques jours plus tard : il le remercie pour la « grande supériorité50 » de son travail et se dit lui aussi son dévoué — leurs échanges s’arrêtent ici. Est-ce pour Cafiero un retour au marxisme, après avoir tué le père en ralliant son illustre rival ? Un abandon de l’anarchisme ? Une fusion, plutôt. Il publie en 1880 l’article « Anarchie et communisme » afin d’exposer son point de vue : il n’est de révolution possible sans l’alliance du rouge et du noir (rappelons que le « communisme libertaire » fut, pour la première fois, proclamé comme doctrine politique et philosophique en 1876, par la Fédération italienne de la Première Internationale, via, notamment, Cafiero et Malatesta). Non plus rejeter le communisme — comme le faisaient Bakounine et Proudhon —, non plus mépriser l’anarchisme — comme le faisaient Marx et Engels —, mais réconcilier les frères ennemis51 afin de combler les carences respectives tout en démultipliant les forces des deux courants. Cafiero n’en continue pas moins de croire que la lutte passe, d’abord, par le mouvement d’une minorité agissante (même dix personnes), capable d’allumer la mèche populaire. Aux communistes qui affirment que la liberté découle de l’égalité, Cafiero oppose la vie des communautés religieuses : chaque individu vaut son prochain mais nulle liberté ne circule. Le « despotisme », écrit-il, y règne même en maître. Cafiero parle de « vraie liberté », qu’il associe explicitement à l’anarchie (sans « isme », note-t-on). Il en existerait dès lors une « fausse » ? Le texte n’en dit mot mais il n’est pas difficile de lire entre les lignes : Cafiero dénonce en creux la liberté des libéraux, celle de la jungle, du plus fort, du renard libre d’être ce qu’il est au sein d’un poulailler. D’où l’impérieuse nécessité de les combiner ensemble : l’anarchie (la liberté) et le communisme (l’égalité). Cafiero ramasse sa pensée en une formule aussi brève qu’efficace : « Nous voulons la liberté, c’est-à-dire l’anarchie, et l’égalité, c’est-à-dire le communisme. » Son anarchie pourfend trois ennemis (l’autorité, le pouvoir et l’État) et son communisme entend s’emparer des richesses « au nom de l’humanité ».
En lieu et place du mode de production capitaliste (qu’il résume ainsi : « ta mort est ma vie »), Cafiero propose l’axiome qui suit : « Chacun pour tous et tous pour chacun. » Ni l’individu sacrifié sur l’autel du collectif, ni l’individu seul maître à bord. « On ne peut pas être anarchiste sans être communiste. […] L’anarchie et le communisme sont les deux termes nécessaires de la révolution. » Cette union lui permet ainsi de surmonter le dilemme vieux comme le monde qui n’attend que d’être changé, entre liberté et égalité. Empruntons ici au philosophe Étienne Balibar son terme d’« égaliberté », stipulant que « E = L52 », autrement dit : il n’est pas de priorité légitime, dans une perspective émancipatrice, entre les deux propositions. Cafiero chemine sur la crête pour maintenir la seule position valable qui soit : celle du funambule — ni l’individualisme, ni l’autoritarisme communiste. Il propose un dépassement dialogique en surmontant, par un travail de confrontation positif, deux notions a priori antagonistes, concurrentes mais, finalement, complémentaires.

[Afro Basaldella]
Le suicidé de la société
Carlo Cafiero se sépare d’un ancien camarade, Andrea Costa, lorsque ce dernier rallie les rangs du suffrage universel et obtient un poste de député. Il tonne et tranche : le réformisme est une impasse et le capitalisme demeure, du fait même de sa nature, impossible à amender — il faut l’abattre, sans autre forme de procès. Nulles rustines. Nuls accommodements. Seulement la lutte de fond en comble (dans un texte écrit le 27 juin 1881 et paru dans Il Grido del popolo, il évoque ainsi une guerre sans merci contre les oppresseurs). Il se rend à Marseille, travaille comme docker et cuisinier, est expulsé de France, part en Suisse puis à Londres. « Amis, déclare-t-il aux funérailles d’un frère de lutte qui a sombré, il nous faut hâter la révolution autant que faire se peut, car, voyez-vous, nos amis se laissent mourir, en prison, en exil, ou fous de trop de douleurs53 ». Mais la révolution — qu’il décrit dans son essai inachevé Rivoluzione comme « la loi inexorable de tout progrès humain47 » — ne vient pas et Cafiero commence à vaciller. Une fièvre féroce, d’abord. Le début d’une descente aux enfers. Il refuse de donner son adresse à quiconque de crainte d’être espionné. Il écrit vouloir se défaire de l’anarchisme mais non de l’anarchie et décide, en 1882 et à l’effroi ou la surprise générale, d’appuyer une campagne électorale en Italie : le succès du très récent Parti socialiste révolutionnaire italien, fondé par ce même Costa, et l’essor des formations sociales-démocrates en Allemagne le conduisent subitement à revoir ses positions. Il ne faut pas s’isoler des masses, estime-t-il : mieux vaut avancer d’un seul pas, aux côtés des gens, que de courir isolé dans la plus pure abstraction. Évolution stratégique ou signe de sa folie naissante ? Les avis demeurent partagés.
« Il ne faut pas s’isoler des masses, estime-t-il : mieux vaut avancer d’un seul pas, aux côtés des gens, que de courir isolé dans la plus pure abstraction. »
Il se fait arrêter (sans le moindre mobile) et, de sa cellule, s’ouvre les veines de la main gauche au moyen d’une bouteille brisée. Le suicide manque à ses fins. Libéré, il est contraint à l’exil et retourne en Suisse. Il tente de nouveau de mettre fin à ses jours, en s’ouvrant la gorge avec un verre à dents cassé (Nunzio Pernicone écrira dans Italian Anarchism : avec le verre de ses lunettes). Phases de violente dépression, crises délirantes, perte de poids… Marx meurt et Cafiero se méfie de son entourage. Il ne voit presque plus personne. Se met à chuchoter en public. Croit déceler partout des agents doubles et se persuade que le pouvoir italien l’écoute via les nouveaux réseaux téléphoniques. Il chasse ses hôtes de chez lui puis s’excuse, à grand renfort d’accolades, quelques jours plus tard en leur expliquant qu’il n’est plus fait pour la société des hommes et qu’il lui faut s’échapper. Partir loin, seul. À Florence, on le retrouve dans une grotte, transi de froid ; il erre de ville en ville, maigre corps blême à la dérive — on le croise courant nu dans un champ… Il est interné et, en 1886, déclaré fou, cliniquement fou. L’homme se sent perpétuellement persécuté — même s’il connaît aussi des périodes d’accalmie au cours desquelles sa folie feint la raison jusqu’à exploser de nouveau. Il fume beaucoup, demande à porter des habits de couleur rouge, tente de retenir les rayons du soleil en fermant les volets et refuse de manger de la viande. Un même motif paraît l’obséder : se trouver tout en haut d’une montagne, seul et nu. Il aimerait être rasé (cheveux, barbe, corps) pour que des plumes puissent pousser de son corps et qu’il s’envole ensuite. Un jour, il croise des paysans qui s’alimentent de pain rassis et s’en va aussitôt à la rencontre des propriétaires de la maison qui les emploient pour hurler qu’il est honteux qu’ils puissent, eux qui ne fichent rien, jouir du pain blanc et laisser les travailleurs manger ce dont même les bêtes ne voudraient pas. Le reste du temps, il est décrit comme silencieux, courtois et aimable.
À la même période, un certain Nietzsche — dont on a pu dire à tort qu’il était anarchiste — sombre lui aussi dans la démence, dans le pays natal de Cafiero. Comment expliquer pareille déchéance ? Kropotkine y verra les séquelles d’une déception amoureuse : la féministe communiste libertaire russe Anna Kuliscioff, vivant en Italie depuis 1878, l’aurait rejeté. Richard Drake et Pernicone estimeront que les incarcérations répétées, la répression policière, les défaites successives et l’amer constat de l’échec des luttes émancipatrices en Europe influeront sur son psychisme. L’historien socialiste Gianni Bosio écrira quant à lui : « Ce fut une folie engendrée par une société injuste et ingrate, une folie alimentée par la foi dans les hommes et le progrès. Ce fut une folie de l’avenir : une folie rouge54. » Carlo Cafiero meurt d’une tuberculose intestinale, le 17 juillet 1892, dans les murs de l’asile Nocera Inferiore, quelques jours après l’exécution, à Montbrison, de l’anarchiste Ravachol.

[Afro Basaldella]
Sa vie fut brève : quarante-cinq années. Corps de glaces et de particules fendant le ciel du XIXe, siècle de l’ampoule électrique, de la bicyclette et du code morse, comète disparue parmi les fous, peau bouffée par la maladie. Cafiero fut du temps des révolutions et de l’abolition de l’esclavage. La révolution n’était pas une hypothèse, seulement un horizon. Une unique question se posait : quand ? Impulsif et excessif, tour à tour tranchant et fort amène, implacable et doux, ce solitaire était hanté par le sort du collectif humain. Produit de la noblesse qui, comme tant d’autres avant et après lui, redoubla d’efforts et d’intransigeance pour s’en arracher et « sauver » les damnés qui n’étaient pas issus de sa classe. Carlo Cafiero cœur et tripes nous file parfois entre les doigts : le je se jouait alors au pluriel. Plusieurs biographes et commentateurs s’interrogeront : Cafiero connut-il une vie intime ? des amours ? Pier Carlo Masini écrira que, nonobstant le manque cruel d’informations en la matière, son seul grand amour fut la Révolution ; Richard Drake entérinera : Cafiero réservait l’intégralité de sa nature passionnée à la politique. Moine-soldat, âme ascète dont le cœur ne bat qu’en brèche. Notre homme est d’abord l’Histoire qu’il voulut prendre au cou. L’individu, dans l’intimité qui le tient, s’efface derrière la scène de son temps.
Des enfants ont été appelés Cafiero en mémoire du martyr et son existence écorchée a inspiré chansons, toiles et sonnets. La revue Critica sociale écrira qu’il fut un héros du socialisme, une âme sensible et bonne comme le furent jadis celles des apôtres ; l’économiste Arturo Labriola dira qu’il fut un Don Quichotte idéaliste, positiviste, chevalier déchu à la triste figure. Et Riccardo Bacchelli de transformer Cafiero en héros de roman, en 1927, avec Il diavolo al Pontelungo. Son ami et camarade Errico Malatesta jurera, oui, qu’il fut un grand homme — son sens du sacrifice, sa générosité et sa probité devraient l’ériger en « un si splendide exemple55 ». Laissons les saints à leurs textes sacrés et les statues à d’autres ; ne manquons jamais de regarder les « modèles » droit dans les yeux, étroites carcasses de songes trop grands : Cafiero ne laisse aucun manuel, aucune ligne à suivre, seulement quelques éclats libertaires-égalitaires indélébiles, une révolte viscérale et une douleur qui n’ont pas d’âge. Il n’est pas vain de se rappeler qu’un fil nous tient, fût-il ténu, tête en dehors de leurs eaux glacées.
- Karl Marx, La Commune de Paris, Le Temps des cerises, 2013, p. 42.[↩]
- Selon les sources, on compte vingt-six, vingt-sept ou trente personnes. Certaines se montrent plus approximatives — à l’instar de Daniel Guérin qui, dans Ni Dieu ni Maître, parle d’environ trente personnes. Dans La Fédération jurassienne (Canevas éditeur, p. 186.), Marianne Enckell évoque une « petite bande armée ».[↩]
- Nunzio Pernicone, Italian Anarchism, 1864–1892, Princeton University Press, 2014, p. 122.[↩]
- Traduit de l’italien par l’auteur — extrait du congrès « Di Berna dell’ Internazionale antiautoritaria », 1876.[↩]
- Pier Carlo Masini, Cafiero, Milano, 1974, p. 208.[↩]
- L’historien communiste Emilio Sereni dira, dans les pages de Il capitalismo nelle campagne, que leur action tenait de l’infantilisme : l’anarchisme n’était influent que dans certaines villes (contrairement à l’Espagne).[↩]
- Malatesta : « Au printemps de 1874, une très vive agitation s’était produite sur différents points de l’Italie par suite de la baisse des salaires et du renchérissement exorbitant des objets de consommation. Dans un grand nombre de localités, les magasins furent pris d’assaut et mis au pillage. » Cité par James Guillaume dans le tome III de son Internationale, documents et souvenirs, Société nouvelle de librairie et d’édition, P.-V. Stock, 1909, p. 189.[↩]
- Variante orthographique : Olimpia Kutusov.[↩]
- Cité par James Guillaume, L’Internationale, documents et souvenirs (1864–1878), tome III, chapitre VIII, op. cit.[↩]
- Hanns-Erich Kaminski, Michel Bakounine, la vie d’un révolutionnaire, Aubier, p. 331.[↩]
- Cité par James Guillaume, L’Internationale, documents et souvenirs (1864–1878), op. cit.[↩]
- Extrait du Mémoire justificatif de Bakounine, cité par James Guillaume, L’Internationale, documents et souvenirs (1864–1878), op. cit.[↩]
- Chiffre indiqué par R. Brosio dans son article « La banda del Matese — La guerriglia insurrezionale come “propaganda del fatto” nell’Italia del secolo scorso ».[↩]
- Dans son essai Rivoluzione (1881), il écrira, peut-être en lien avec son parcours propre, que la famille est « la première expression » de toute une série de pouvoirs aliénants.[↩]
- Richard Drake, Apostles and Agitators : Italy’s Marxist Revolutionary Tradition, Harvard University Press, 2009, p. 29.[↩]
- « Carlo Cafiero », Giampiero Galzerano, 1992.[↩]
- Pier Carlo Masini estimera, dans son Cafiero, qu’il est toutefois possible d’imaginer que le jeune Cafiero se fût porté volontaire.[↩]
- Cité par Pier Carlo Masini, Cafiero, op.cit. p. 20.[↩]
- Ibid., pp. 20–21.[↩]
- La chose est fameuse : Marx refusait lui-même ce qualificatif.[↩]
- Mathieu Léonard, L’Émancipation des travailleurs — Une histoire de la Première Internationale, La Fabrique, 2011, pp.177–178.[↩]
- L’ouvrage La corrispondenza di Marx e Engels con italiani, paru en 1964, s’est chargé de les rassembler.[↩]
- Richard Drake, op. cit., p. 30.[↩]
- Ibid., p. 32.[↩]
- Dans Étatisme et anarchie, Bakounine a dressé un portrait contrasté de Marx : « Nerveux, certains disent jusqu’à la couardise, il est extrêmement vaniteux et ambitieux, querelleur, intolérant et absolu comme Jéhovah, le Dieu de ses ancêtres, et comme lui vindicatif jusqu’à la démence. Il n’est pas de mensonge ou de calomnie qu’il ne soit capable d’inventer et de répandre contre ceux qui ont eu le malheur de susciter sa jalousie ou, ce qui revient au même, son animosité. […] Sous ce rapport, il est tout à fait l’homme politique. Telles sont ses qualités négatives. Mais il en a beaucoup de positives. Il est très intelligent et possède une culture extrêmement vaste. […] Il est rare de trouver un homme ayant tant de connaissances et lu autant, et aussi intelligemment, que M. Marx. » Tops / H. Trinquier, 2009, pp. 316–317.[↩]
- Cité par Mathieu Léonard, L’Émancipation des travailleurs — Une histoire de la Première Internationale, op. cit., p. 289.[↩]
- Cité par Mathieu Léonard dans l’avant-propos à Abrégé du Capital de Karl Marx, Le Chien rouge, 2013, p. 15.[↩]
- Lettre du 12 juin 1872, Richard Drake, op. cit., p. 33.[↩]
- Ibid.[↩][↩]
- Voir, notamment, les analyses d’Engels dans l’Anti-Dühring.[↩]
- Lettre à Jospeh Weydemeyer, 1852, tome IV des Œuvres complètes de Marx à la Pléiade, p. 1680.[↩]
- Carlo Cafiero, « Anarchie et communisme », Le Révolté, 1880.[↩]
- Mikhaïl Bakounine estimait pour sa part : « Le pseudo-État populaire ne sera rien d’autre que le gouvernement despotique des masses prolétaires par une nouvelle et très restreinte aristocratie de vrais ou de prétendus savants. Le peuple n’étant pas savant, il sera entièrement affranchi des soucis gouvernementaux et tout entier intégré dans le troupeau des gouvernés. Bel affranchissement ! » Étatisme et anarchie, Tops / H. Trinquier, 2009, p. 347.[↩]
- Lénine, L’État et la révolution, Gonthier, 1964, p. 96.[↩]
- Ibid., p. 26.[↩]
- Extrait de son discours de Chengdu, 20 mars 1958.[↩]
- Löwy met ainsi en évidence la notion de zeitwidrig (« contretemps ») chez Marx, qui entraverait cette rigidité déterministe (voir « Marx, l’aventure continue », Rouge, n° 1671, 8 février 1996). De même, Balibar estime que Marx n’avait pas « en vue » un tel évolutionnisme, en dépit du « schéma de causalité » qu’il a mis en place — ses dernières observations à propos de la situation russe (contradictoires, au regard d’anciens textes) permettent, estime-t-il, de remettre en question cette « ligne unique de développement de l’histoire universelle » (voir La Philosophie de Marx).[↩]
- Paul Ariès, La Simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance, La Découverte, 2011, p. 82.[↩]
- Karl Marx, Le Capital, chapitre XXIV, « Le Procès d’accumulation du capital », Quadrige/PUF, 1993, p. 856.[↩]
- « Les paysans parcellaires constituent une masse énorme dont les membres vivent tous dans la même situation, mais sans être unis les uns aux autres par des rapports variés. Leur mode de production les isole les uns des autres, au lieu de les amener à des relations réciproques. » Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, GF Flammarion, 2007, p. 190.[↩]
- K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, GF Flammarion, 2007, p. 191.[↩]
- K. Marx & F. Engels, Manifeste du parti communiste, Librio, 2007, p. 34.[↩]
- Carlo Cafiero, La Plebe, Milano, 26–27 novembre 1875.[↩]
- « Les temps sont mûrs lorsque l’injustice domine, lorsque le mal triomphe, lorsque la mesure est comble, lorsque la voix de l’humanité outragée se lève, terrible, en faisant geler le sang des traîtres et des parasites. Les temps sont mûrs parce qu’on entend dans l’air un bruit qui est comme la voix des milliers et milliers de cris de douleur et de rage, parce que l’écho se répercute, retentissant depuis les chaînes de montagnes d’Irlande jusqu’à celles de la Sicile ; parce qu’une grande pensée rapproche les ouvriers de toute la planète ; parce que tous les esclaves doivent être unis. Oui, le pollen est mûr et il est en train de tomber, c’est pourquoi l’ovaire se détend, impatiente, en implorant le baiser fécondateur. Préparons le terrain qu’on veut cultiver. Nous devons récupérer la plus grande partie de l’humanité, qui dépérit dépourvue d’une pensée, de la dignité, de la vie. » Carlo Cafiero, « I tempi non sono maturi ! », La Plebe, Milano, 26–27 novembre 1875 (traduction de Luis Dapelo, pour le présent article).[↩]
- Carlo Cafiero, « Anarchie et communisme », op. cit.[↩]
- Ibid.[↩][↩]
- Carlo Cafiero, Rivoluzione, essai inachevé.[↩][↩]
- James Guillaume, L’Internationale, documents et souvenirs (1864–1878), op. cit.,p. 97.[↩]
- Carlo Cafiero, lettre publiée dans Abrégé du Capital de Karl Marx, op.cit., p. 152.[↩]
- Ibid., p. 155.[↩]
- Nous empruntons ici la formule de Daniel Guérin, qui œuvra, à partir de la fin des années 1960, à une réconciliation définitive de l’anarchisme et du communisme marxiste.[↩]
- Étienne Balibar, La Proposition de l’égaliberté, PUF, 2012, p. 70.[↩]
- Cité par Pier Carlo Masini, Cafiero, op.cit, p. 189.[↩]
- Cité par Domenico Tarizzo, L’Anarchie : histoire des mouvements libertaires dans le monde, Seghers, 1978, p. 66.[↩]
- Cité par Pier Carlo Masini, Cafiero, op. cit., p. 370.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Piotr Archinov — devenir une force organisée », Winston, octobre 2017
☰ Lire notre article « Shûsui Kôtoku : appel au bonheur », Émile Carme, octobre 2017
☰ Lire notre article « Erich Mühsam — la liberté de chacun par la liberté de tous », Émile Carme, mars 2017
☰ Lire notre article « Le communisme libertaire : qu’est-ce donc ? », Émile Carme, novembre 2016
☰ Lire notre article « Mohamed Saïl, ni maître ni valet », Émile Carme, octobre 2016
☰ Lire notre article « Ngô Văn, éloge du double front », Émile Carme, mars 2016