☰ La Norme gynécologique — Ce que la médecine fait au corps des femmes, de Aurore Koechlin
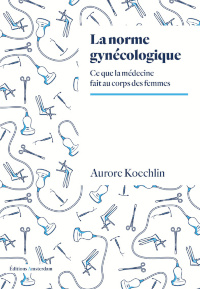
Amsterdam, 2022
☰ Les Jardiniers du bitume, de Roger Riffard
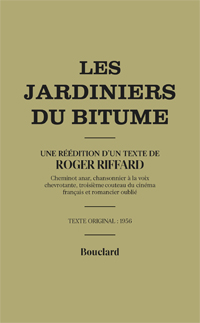
Bouclard, 2021
☰ Le Boxeur, de Reinhard Kleist
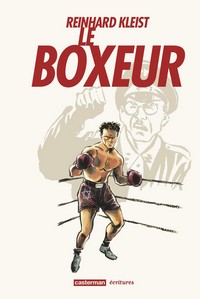
Casterman, 2013
☰ Exercices d’observation, de Nicolas Nova
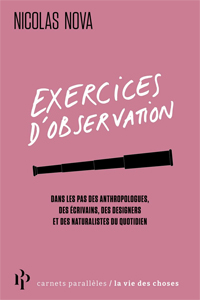
La pratique de l’enquête, pour l’écrivain comme pour le chercheur ou le journaliste — et plus encore pour les autodidactes —, est un sujet sur lequel il est parfois difficile de trouver des méthodes. « Dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien », le petit ouvrage de Nicolas Nova, anthropologue de métier, s’avère une ressource intéressante pour qui est venu à l’écriture et à l’enquête par la pratique, sans avoir usé ses fonds de pantalon sur les bancs de la fac. À travers dix-huit exercices d’observation, il se penche sur différentes façons d’aborder le travail d’enquête, à travers l’étude de personnes, de lieux, voire d’objets. Ainsi du parcours commenté qui consiste à cheminer avec un individu en lui faisant décrire le trajet effectué, dire ses émotions, raconter ses souvenirs, ce qu’il voit, parfois en y ajoutant un travail de cartographie. Jusque chez soi, où l’observation d’un simple objet peut devenir un exercice d’écriture, dès que l’on pense à tous les processus mis en œuvre pour sa fabrication, à ce qui l’a conduit jusque dans nos mains, à tout ce qu’il représente en terme de normes. Mais aussi à toutes les manières de le détourner de son usage initialement prévu, pour le transformer en autre chose. Chaque exercice est accompagné d’exemples pratiques et de propositions de variantes, mais aussi de précieuses références de lecture qui renvoient à des travaux illustrant l’utilisation des techniques exposées. Pour qui n’a pas suivi de formation en sciences sociales, cela permet d’accéder à des études originales et de découvrir des domaines de recherche insoupçonnés — comme la garbology, étude des déchets des sociétés humaines. Le format court se veut pratique, loin de longues dissertations. Le livre est également une invitation à rafraîchir son regard et à retrouver l’œil affûté du photographe. À saisir de nouveau ce que le quotidien dans sa répétition a fini par ranger dans l’armoire de la banalité. [L.]
Premier Parallèle, 2022
☰ Hôtel du Brésil, de Pierre Bergounioux

Curieuse idée que celle d’écrire un texte sur un sujet que l’on a manqué, évité, éludé. C’est pourtant bien l’objet d’Hôtel du Brésil et de son auteur, Pierre Bergounioux. On retrouve là ses principales obsessions — les structures économiques et sociales qui déterminent une vie, le destin de la paysannerie et des terres qui ont vu naître l’écrivain, l’étonnant dessillement que constitue l’enfance et la décevante cécité des adultes — reprises sous un jour nouveau, qu’un terme pourrait peut-être résumer : l’inconscient. Si ce thème a toqué à la porte de bien des intellectuel·les au début du XXe siècle et a ensuite inondé une partie des sciences sociales, pour Bergounioux, l’inconscient « résidait bien moins en nous, pour nous, pour d’autres, qu’à notre porte, dans les choses qui nous assiégeaient, leur dureté, leur mutisme ». L’inconscient à la porte, sur le seuil, voilà qui ferait un résumé bref mais exact de ce récit. Les choses dont parle sans cesse l’auteur, celles qui ont déterminé son parcours, ce sont avant tout les roches, les gravats, les couches géologiques fortement contrastées de la Corrèze où il a grandi. Pour lui, elles expliquent beaucoup. Ainsi se souvient-il d’une composition de français, au collège, où il insista sur « la contribution des roches au sentiment de l’existence selon qu’elles étaient bistre, granuleuses ou homogènes et claires ou dures et comme nocturnes », sans que le professeur ne sanctionne la pertinence ou non de son jugement. Bientôt les livres s’assurèrent de combler le silence des adultes et commença une « vie nouvelle, recluse, concentrée, contre nature » dont on trouve un écho régulier dans les Carnets de notes que l’auteur publie depuis une quinzaine d’années. À rebours des écrivain·es urbain·es, maladifs, tout entier tournés vers eux-mêmes qui ont été saisis par les débuts de la psychanalyse, Pierre Bergounioux, lui, expose un moteur bien différent de l’intériorité, consciente ou non, pour écrire : le mystère des choses muettes, d’un peuple qui leur ressemble, qu’il convient d’élucider. [R.B.]
Gallimard, 2019
☰ On ne va pas y aller avec des fleurs — Violence politique : des femmes témoignent, d’Alexandra Frénod et Caroline Guibet Lafaye
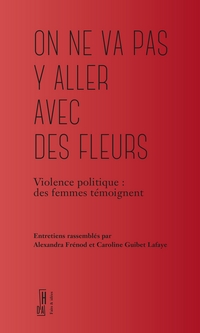
« Davantage que les hommes, les femmes qualifiées de terroristes passent, notamment dans les médias, pour des fanatiques, des figures manipulées, immatures, désespérées, à la dérive. » Terrorisme. Le terme, à force d’être utilisé à tort et à travers, a fini par se vider de son sens. Issu d’un travail universitaire, On ne va pas y aller avec des fleurs se donne pour objectif « de faire entendre aux lectrices et aux lecteurs des voix restées inaudibles, que semble porter […] un même fil : la quête d’un idéal humain ancré dans un monde meilleur ». Avec pour chacune une présentation générale du contexte de la lutte dans laquelle elle s’est inscrit, l’ouvrage donne à lire, un peu à la manière de Svetlana Alexievitch, la parole de femmes qui ont fait le choix de la lutte armée. Loin des clichés habituels, elles expliquent les raisons qui les y ont amenées, comment elles l’ont vécu, quel regard elles portent aujourd’hui sur leur engagement. Les entretiens choisis pour l’ouvrage brossent un tableau assez large, à la fois en termes d’époque, de la fin des années 1970 à aujourd’hui, et géographiquement : Colombie, Kurdistan, Pays Basque, Italie, France, Allemagne… Parfois inégaux en terme de densité, ils marquent pour la plupart par la force de leurs propos. Les questionnements sur la violence sont loin du virilisme parfois associé à la lutte armée. Suite à sa première action, l’exécution d’un informateur, Isée, militante de l’ETA, raconte : « C’était un choc que ce soit tellement facile d’enlever sa vie à quelqu’un… Je ne voulais pas lui faire de mal. Mais par contre je n’avais aucune empathie pour lui, alors là, non ! » « Pour moi, la violence est un moyen qu’une personne victime d’oppression peut utiliser pour s’en libérer », explique Yasemîn, combattante du PKK, avant de reprendre : « La violence susceptible d’être exercée par nous ne peut pas être qualifiée de bonne ou mauvaise : elle est notre façon de tenir face à une puissante volonté adverse. » [L.]
Hors d’atteinte, 2022
☰ CAFÉ (Collecte Aléatoire de Fragments Étrangers) n° 1 : Futurs

bon français
». L’enjeu, pour les traducteurs et traductrices, est donc de ne pas homogénéiser, de ne pas nier ce qui diffère. Avançant comme autant de « funambules prêts à bousculer la langue pour y faire entrer l’étranger », les voilà qui contribuent assurément à la délier. [Y.R.]
CAFÉ, 2019
☰ Les Veilleurs du vivant — Avec les naturalistes amateurs, de Vanessa Manceron
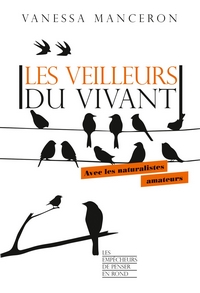
Que sait-on des naturalistes, ces volontaires de la nature ? Les profesionnel·les de la gestion des milieux les connaissent bien, le sont parfois eux-mêmes. Les militant·es écologistes, pour leur part, lorgnent sur leurs compétences et cherchent à les politiser. Les aménageurs, enfin, les sollicitent pour valider des projets destructeurs après qu’ils ont inventorié la future destruction. Les naturalistes, ce sont ces hommes et ces femmes qui passent des heures, des années, une vie à décrire les êtres vivants qui les entourent. L’ethnologue Vanessa Manceron en a suivi certain·es dans le sud de l’Angleterre afin de faire cas d’un « régime d’attention au vivant », à la fois « premier-né du rapport moderne à la nature et antidote », propre à ces amateurs et amatrices. Ils ne se contentent pas d’observer : ils transcrivent, prennent bonne note et constituent des listes, des inventaires, afin de compléter le grand tableau de la nature — un tableau en mouvement, qu’il serait vain de vouloir circonscrire totalement. La société anglaise décrite par l’autrice a cela de particulier qu’elle se représente son environnement comme un grand jardin, dans lequel il est familier de frayer avec les êtres vivants qui s’y trouvent. On constate ainsi, entre autres choses, que les buses variables ont une sociabilité complexe dont certain·es sont devenu·es spécialistes ou que la confection d’herbiers ne s’arrête pas avec l’enfance. Vanessa Manceron s’attache à décortiquer les raisons qui poussent les naturalistes à vivre au grand air, à labourer sans cesse de mêmes territoires pour, finalement, renseigner un irrémédiable déclin. Car ces « veilleurs du vivant » sont aux avant-postes pour observer les disparitions qui, intimement, les touchent. Pour l’autrice, point de désespoir, toutefois : « les naturalistes entendent bien résister aux sirènes de l’effondrement et faire valoir toute l’intelligence mutuelle à se re-lier et à reconnaître aux vivants leurs propres raisons d’exister en dehors d’eux-mêmes ». [R.B.]
La Découverte, 2022
☰ Vers les terres vagues — Approche de la Zone à défendre, de Virginie Gautier
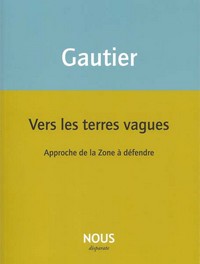
Ça ne fait pas de doute : « c’est un lieu déjà très écrit » dont il est question. Un lieu raconté par ses habitant·es, comme par une flopée de visiteurs et de visiteuses, lardé de documents de gestion et de textes réglementaires, un lieu, oui, qui a déjà conduit à de nombreuses synthèses. Pas de doute, cet endroit singulier qui s’est construit à Notre-Dame-des-Landes, connu désormais comme la première ZAD, a séduit les mains à plumes au point de commencer sceptique une nouvelle lecture à son sujet. Là où l’une de ses exégètes est partie du mot de « noue » pour déployer une réflexion poétique, Virginie Gautier, elle, « entre par le mot de lande ». Et ainsi par l’espace, qui est sa matière principale. Elle a en effet prévenu, quelques phrases plus tôt : « Embarquer corps, texte et paysage dans un même mouvement, il n’y a de vrai que cette tentative. » Cette tentative, quelle est-elle ? Une marche de 250 kilomètres, 13 jours sur les routes bretonnes puis ligériennes, pour gagner de biais une zone très connue. En route, ce sont « fragments de choses », « chutes de pensées » et autres « séquences », « repères » et « bornes » qui sont saisies dans le paysage. « Peut-être qu’on marche dans des brouillons de phrases » résume l’autrice. Du moins est-ce la pratique qu’elle a choisie de mettre en œuvre. Il est heureux, finalement, que le but du voyage n’ait pas occupé toute la place, tant il a été raconté. C’est la marche qui le précède, cette marche d’approche, en somme, qui répond à un appel initial, selon lequel « il serait temps de déterrer de vieilles nouvelles manières ». Le long d’un rivage, aux abords d’une agglomération de l’Ouest, on apprend ainsi que « le sol est un ciel qui bouge très lentement » et on se dit que l’obtention de ces simples mots suffisent à motiver ce voyage en terres vagues. [E.M.]
Nous, 2022
☰ Au bord du naufrage, de Yeyei Gomez

« Sexisme — guerre — société de contrôle — médias — réseaux sociaux — désinformation — argent — pouvoir — politiques — nantis — pauvreté — migrants — catastrophe écologique, bienvenue, vous êtes sur Terre. N’oubliez pas votre gilet de sauvetage. » C’est une société « au bord du naufrage » que croque d’un trait épuré la dessinatrice espagnole Yeyei Gomez. Réalisés au crayon, à l’acrylique et en sérigraphie, ses dessins de presse sont encore peu connus en France. Elle a pourtant collaboré avec des médias tels que le New York Times, The Tribune, le magazine étasunien Jacobin et le journal espagnol El Salto. Chaque dessin est accompagné d’une formule incisive, aussi acérée que son graphisme va à l’essentiel, aussi percutante que sa palette de couleurs. Yeyei Gomez détourne le langage néolibéral pour mieux le tourner en ridicule, comme dans cette scène où, assistant à une conférence dans un amphithéâtre, un auditeur glisse à son voisin : « Dans les séminaires à la sensibilisation à l’environnement, on nous apprend à vendre du vent. On dit que ça ne pollue pas. » Ou cette mère tenant son enfant qui dit : « Il a déjà appris à monologuer. » L’humour cède parfois au tragique : « Quand le travailleur a ouvert les yeux, il était déjà esclave. » Ou cette phrase à côté d’un caddie devenu cage : « On a oublié le pouvoir du mot liberté, elle se nomme désormais gratuité. » On doit la traduction de ce premier recueil à la jeune maison d’édition La Pieuvre Mimétique, nichée au pied des Pyrénées et qui fait partie des Éditions en Apnée, fondées par Pauline Vel. L’intéressée affiche son ambition : soigner la réalisation de ses ouvrages afin « qu’un livre se diffuse en douceur [plutôt] que d’adhérer à des mises en place rapides qui sacrifient la majorité des livres à de trop nombreux retours destinés à un système de pilonnage que l’on ne peut plus tolérer ». [L.]
La Pieuvre Mimétique, 2022
Photographie de bannière : Ueda Shoji
REBONDS
☰ Cartouches 80, octobre 2022
☰ Cartouches 79, septembre 2022
☰ Cartouches 78, juillet 2022
☰ Cartouches 77, juin 2022
☰ Cartouches 76, mai 2022

