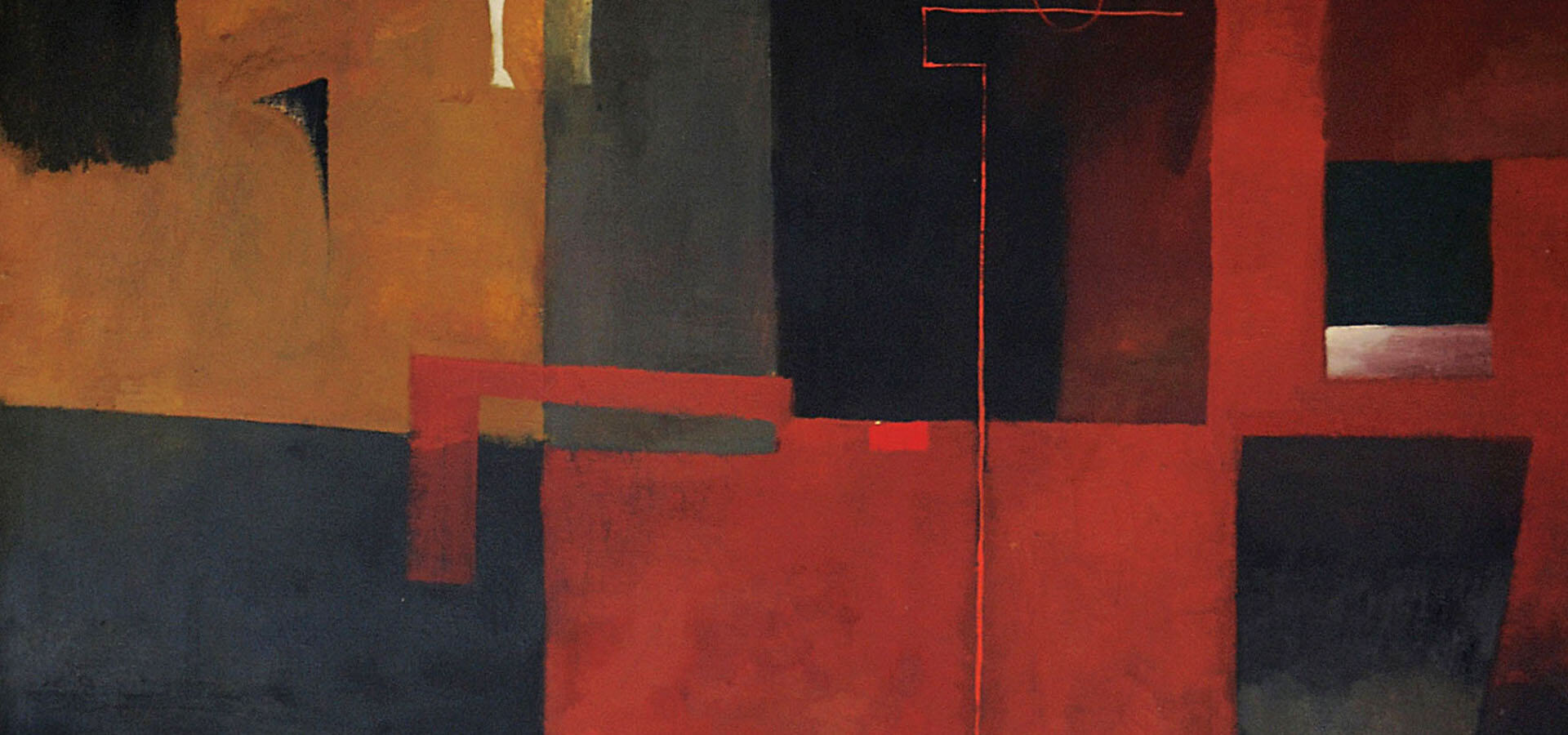Texte inédit pour le site de Ballast
On ne compte plus les identités d’Ignace Reiss, l’enfant de Galicie polonaise devenu espion pour le compte de l’Union soviétique avant d’être assassiné par le pouvoir stalinien, en 1937, suite à l’annonce publique de son ralliement au trotskysme. Son petit-fils retrace pour nous cette double histoire, politique et familiale. « Une histoire tissée d’incertitudes, où il faut se faire aux lacunes, aux zones d’ombre, à l’insuffisance », précise Alexis Bernaut. Une histoire du siècle dernier, entre Moscou, Berlin, Paris et New York.
« Vive ceux qui ont échoué, car ils deviennent le fleuve1. »
Martín Espada

« À 38 ans, c’est déjà un vétéran des services secrets de l’Armée rouge. Mais l’échec de la Révolution espagnole l’a finalement décidé à rompre avec le Parti. »
Le 17 juillet 1937, c’est un de ces hommes-là qui sort avec fracas du silence en écrivant une lettre par laquelle il aspire à se faire connaître au monde et rompre avec son passé. Il y dénonce les forfaitures de Staline, sur lesquelles il espère, en rendant sa déclaration publique, attirer l’attention de la classe ouvrière du monde entier. Il sait, ce faisant — même s’il escompte avoir le temps de se mettre à l’abri avec sa famille —, qu’il signe son arrêt de mort. Sa lettre de défection de la Troisième Internationale, dans laquelle il appelle à rejoindre les rangs de la Quatrième, est un véritable manifeste, un acte de dissidence sans précédent de la part d’un agent de son rang, que Trotsky lui-même saluera. Il signe cette lettre « Ludwig » — l’identité la plus connue, la plus emblématique de toutes celles qu’il aura endossées2. À 38 ans, c’est déjà un vétéran des services secrets de l’Armée rouge. Mais l’échec de la Révolution espagnole, sabotée par Staline, l’a finalement décidé à rompre avec le Parti. Quelque temps plus tôt, Roman, son jeune fils, s’était étonné de lui voir les cheveux soudainement et prématurément blanchis.
Une enfance entre deux mondes
Ludwig, dont la véritable identité restera incertaine — vraisemblablement Ignace Nathan Poretski3 (patronyme que sa femme Elizabeth, dite Elsa, choisira comme nom de plume une fois veuve4) — est officiellement né le 1er janvier 1899 à Podvolochisk5, en Galicie polonaise. La ville est séparée de sa voisine orientale Volochysk par la rivière Zbroutch, laquelle est également, depuis 1772, la frontière entre l’Empire austro-hongrois et celui du tsar. Ignace y naît dans une famille pauvre. Son père, polonais, se prénomme Mark, ou Saul, selon les sources ; sa mère, dont le prénom est peut-être Mina, est russe. Elle a, comme beaucoup d’autres, traversé la frontière pour prendre époux, signant de la sorte un déclassement social considérable. La famille est très probablement juive (80 % de la population de la ville l’est alors). Ignace est le petit dernier et le préféré de sa mère. L’un de ses frères combattra plus tard dans l’armée polonaise, et mourra pendant la guerre contre la jeune URSS ; ce sera utilisé contre Ignace le moment venu, pour le faire passer pour un agent double polonais quand il s’agira de justifier — inutilement d’ailleurs — sa traque puis son assassinat.

[Youla Chapoval, Sans titre, 1948]
En ce début de XXe siècle, Ignace joue avec ses amis, l’hiver, sur la rivière gelée qui sépare les deux mondes. En été, les enfants se retrouvent sur ses rives. Cette frontière naturelle, on peut le supposer, joue un rôle primordial dans l’imaginaire et le quotidien des enfants de Podvolochisk (notamment Ignace, dont la mère garde vive la nostalgie du pays natal), qui font régulièrement des expéditions à la gare, où l’écartement différent des rails de chaque côté de la frontière oblige les voyageurs à changer de train. C’est l’occasion de se faire quelques sous en portant leurs lourdes valises. En outre, un oukase impérial interdisant l’importation de fleurs en Russie, les voyageuses qui s’y rendent doivent abandonner leurs bouquets, à la joie des enfants de Podvolochisk qui les rapportent chez eux. Les camarades de jeu d’Ignace suivront tous des parcours semblables. Ils se nomment Willy, qui sera le premier officier de l’Armée rouge à planter le drapeau rouge sur l’Elbrouz ; Samuel Ginsberg, plus tard connu sous le nom de Walter Krivitski, agent du NKVD qui réussira à fuir aux États-Unis où il écrira J’étais l’agent de Staline, avant de mettre fin à ses jours en 1941 ; les frères Berthold ; Fedia, l’aîné de la bande, qui connaît la Russie et se rend souvent à Vienne ; et, surtout, Krusia, mentor des six adolescents, qui est la petite amie de Fedia. Les deux aînés entretiendront aux yeux des plus jeunes la mystique de la Russie, et contribueront largement à leur formation politique. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale, auquel Fedia — pas plus, du reste, que Lénine lui-même — ne croyait, est un choc pour le groupe. Pendant les combats, les envahisseurs russes et autrichiens se succèdent à Podvolochisk. Au cours de l’occupation russe, Ignace et Samuel trouvent à s’employer comme musiciens dans l’orchestre d’un bar. L’ordonnance d’un officier russe ayant réquisitionné la maison de la famille parle à la mère d’Ignace de son village natal. Elle sort de sa mélancolie, retrouve la parole, pleure beaucoup. Les Russes se conduisent bien — et paient services et nourriture, au contraire des Autrichiens qui leur succèderont.
« Sa chambre est toujours pleine de monde. Ignace y croise des soldats en permission, des déserteurs, des gens venus de partout. »
Fedia parti à la guerre, c’est Krusia qui maintient la cohésion du groupe. Pharmacienne de profession, elle travaille en dans une usine de produits chimiques, ce qui lui donne droit à une ration de travailleuse de force. Mais comme elle ne mange guère, il y a constamment des victuailles chez elle — opulence rare en ces temps de disette. Sa chambre est toujours pleine de monde. Ignace y croise des soldats en permission, des déserteurs, des gens venus de partout. D’une santé fragile, Krusia mourra en 1928, ayant alors tourné le dos à la plupart de ses idéaux de jeunesse. Les adolescents, futurs révolutionnaires, prendront dès leur passage dans la clandestinité l’habitude de signer de son nom ou de son initiale — K — leur correspondance, dès lors qu’ils voudront être sûrs de n’être identifiés par personne. Pris dans la tempête, Ignace voyage. À Vienne, à Leipzig, où il rencontre Gertrude Schildbach, jeune socialiste juive allemande qui deviendra une amie — avant de le livrer, bien des années plus tard, à ses assassins. Il revient à Podvolochisk travailler comme cheminot. Au moment où son grand frère se bat dans l’armée polonaise contre la jeune Russie soviétique, Ignace décide de rejoindre l’Internationale socialiste.
À la fin de la guerre et pour la première fois depuis 1795, la Pologne est indépendante. Le Parti communiste polonais naît presque aussitôt, en décembre 1918, de la fusion des différents groupes marxistes des trois empires. C’est un parti d’héritage luxemburgiste plus que léniniste6, très implanté dans le prolétariat industriel et qui, après avoir été progressivement assujetti à Moscou (et ses anciens membres — « luxemburgistes » — forcément considérés comme suspects), sera finalement dissout en 1938. Ludwig commence un travail de propagande, distribuant aux soldats des tracts imprimés à Vienne et acheminés en Pologne grâce aux cheminots tchèques. Ce sont les premières arrestations, passages à tabac, tortures. Les prisons polonaises, alors réputées pour leur exceptionnelle saleté, ont la particularité de séparer prisonniers politiques et droits communs. On s’échange des colis, des livres. On se parle. Des amitiés politiques durables s’y nouent entre militants de bords différents — ce qui serait impossible à l’extérieur, et s’avérera utile dans l’établissement de réseaux de renseignements. On s’en évade souvent.

[Youla Chapoval, Sans titre, 1948]
Un engagement à vie
De fait, Ludwig s’évade, et participe en 1919 au congrès du PC polonais en tant qu’observateur. Un mandat en lin, cousu dans la doublure de sa veste, vaut laisser-passer — en lin, car un mandat en papier crisserait, trahissant son porteur lors d’une fouille au corps (fréquentes). Ce sésame qui faisait sa fierté, Ludwig le renverra en 1937 avec sa lettre de défection et sa médaille de l’Ordre du Drapeau rouge. En 1920, le PC polonais reçoit l’ordre d’aider l’Armée rouge à combattre l’armée polonaise. Ludwig effectue un très dangereux travail d’infiltration, les « saboteurs » étant systématiquement fusillés. La guerre russo-polonaise représentera le dernier moment où Ludwig ne travaille que pour le Parti. Une fois la guerre terminée, le jeune militant communiste polonais sera envoyé à Vienne pour y commencer sa carrière dans les services de renseignement de l’Armée rouge. Cet engagement ne lui semble alors pas irrévocable. Mais la clandestinité exige des sacrifices immédiats et douloureux : il ne pourra plus participer comme militant à l’activité du Parti ; il devra aussi garder ses distances avec ses anciens camarades — lesquels en concluront qu’il a déserté. Tout le contraire, ô combien, mais le secret est notamment à ce prix.
« Ludwig s’évade une fois de plus. À Cracovie, il est bloqué par une grève de cheminots, la première au cours de laquelle l’armée refusera de tirer sur les grévistes. »
Dès 1922, Ludwig est renvoyé à Lvov, où il travaille à mettre en place ses premiers réseaux. Échecs, arrestations. Lors des procès, habituellement transformés par les militants arrêtés en tribunes pour agitprop, il lui faut à nouveau nier tout rapport avec l’URSS, prétexter le seul appât du gain. Ludwig s’évade une fois de plus. À Cracovie, il est bloqué par une grève de cheminots, la première au cours de laquelle l’armée refusera de tirer sur les grévistes. Il ne sait pas qu’il assiste là au dernier combat retentissant de la classe ouvrière polonaise — sans pouvoir y prendre part. Il ne sait pas non plus qu’il quitte la Pologne, son pays natal, pour ne plus jamais y revenir. En 1923, en Allemagne, Moscou a donné l’ordre de préparer les soulèvements populaires ; Ludwig est ainsi affecté au 4e bureau de l’État-major général (renseignements de l’Armée rouge), où il retrouve Fedia. Mais soulèvements et putschs sont morts-nés. La révolution en Europe échoue, la démoralisation gagne, et c’est le début des rivalités intestines entre services et bureaux. Fedia n’y croit déjà plus vraiment.
Après 1923, les services de renseignement russes sont transférés à Vienne, où la surveillance exercée par les rescapés des armées blanches7 est active. Comme les autorités soviétiques ne tuent pas encore ceux dont elles veulent se débarrasser, se contentant de les envoyer à l’étranger, on trouve à Vienne de nombreux dissidents. C’est l’occasion pour Ludwig de premiers contacts avec les communistes bulgares, sur fond de rivalités dans les Balkans. C’est aussi, dans un autre registre, cet ancien officier supérieur de l’état-major impérial autrichien qui, rencontrant Ludwig, s’attendant sans doute à rencontrer un moujik repoussant aux ongles noirs, s’étonne de le trouver impeccablement mis. Les débuts de sa mission sont faits de tâtonnements, de déceptions. Le matériel ne manque pas, au contraire, mais la plupart des documents sous lesquels croulent les services viennois sont des faux, établis par les organisations d’émigrés russes blancs ou le contre-espionnage polonais. Qu’ils soient authentiques ou faux, ils ont été achetés, photographiés, envoyés à Moscou, où l’on démasquera notamment un « traité » censé émaner de l’état-major général français portant sur une alliance franco-polonaise contre la Russie soviétique, rédigé en un français impossible, mais passé inaperçu à Vienne faute de francophones. Avec le temps et les succès incontestables remportés par ailleurs, on apprendra à s’accommoder de quelques échecs. Vienne est pour l’heure un havre relatif, où naîtra en 1925 Roman, le fils de Ludwig et de sa femme Elsa8.

[Youla Chapoval, titrée et datée « 1949-1950 »]
En 1928, Ludwig se rend brièvement à Moscou pour se voir remettre l’Ordre du Drapeau rouge, puis passe par Prague où il s’occupe du réseau de renseignements vers la Pologne. Pas pour longtemps. On lui confie en effet la même année une mission très délicate : prendre la responsabilité des réseaux d’espionnage soviétiques sur le territoire britannique, poste auquel il succède à Max Friedman. La charge est dangereuse, la tâche ardue. La réputation redoutable du contre-espionnage britannique n’est plus à faire. C’est donc d’Amsterdam que Ludwig pilotera ses activités. Il validera notamment le recrutement du célèbre agent double Kim Philby, et établira les premiers contacts de l’URSS avec le parti républicain irlandais Sinn Féin. C’est ce genre de succès, ainsi que l’acquisition par Krivitski du code japonais, par exemple, ou encore les faits d’armes de l’espion et journaliste révolutionnaire allemand Richard Sorge, qui finiront par établir la réputation des services soviétiques. À Amsterdam, Ludwig noue des liens avec le PC hollandais et retrouve son vieil ami Henk Sneevliet, député et dirigeant du syndicat des cheminots ; proche de Rosa Luxembourg, Sneevliet avait été envoyé par Lénine en Chine en tant que délégué du Komintern pour aider à la formation du Parti communiste chinois. En Hollande comme partout, Moscou attend de chacun de ses agents qu’il se trouve une couverture, ce qui prenait du temps et s’avérait souvent inutile. Après avoir repoussé l’idée d’une galerie d’art, Ludwig choisit une papeterie. (La couverture sera tellement efficace que l’affaire finira par être rentable…)
Moscou, Berlin, Paris
« L’opposition à Staline est durement écrasée. Les arrestations se multiplient. Les désillusions, le désespoir gagnent. »
Il passe l’hiver 1929, très rude, à Moscou, dans un logement communautaire froid et surpeuplé. Les ampoules électriques sont rares et souvent chapardées. Les blagues sur le « petit père des peuples », dont on attribue la paternité au dirigeant du Komintern Radek, circulent alors avec délices. Staline est impopulaire, voire détesté, mais on ne le craint pas trop encore. Cela changera bientôt. Au détour des rues de la capitale, on fait la queue sans savoir ce qui sera donné. Les seules phrases à savoir dire en russe, plaisantent alors les étrangers, sont : « Qui est le dernier ? » et « C’est mon tour ». Quand c’est possible, quand il y a suffisamment, on dîne chez les uns ou les autres pour garder le moral. Immanquablement, un samovar inutile trône au milieu de la table — par dérision : clin d’œil ironique au samovar de la famille Filipov, la famille soviétique typique et idéale vantée dans les documents de propagande de l’époque et destinés à l’étranger. Ludwig et Elsa côtoient régulièrement Richard Sorge, type même de l’espion brillant, extrêmement courageux, parfois jusqu’à l’inconscience, dévoué à Staline et qui, condamné à mort au Japon, croira jusqu’au bout qu’il serait secouru par Moscou. En 1932, la donne change. L’opposition à Staline est durement écrasée. Les arrestations se multiplient. Les désillusions, le désespoir gagnent. Et pourtant, Elsa racontera que ces années de souffrance auront créé entre ceux qui y auront survécu des liens plus solides que les années d’espoir qui avaient suivi la révolution.
En 1933, c’est Berlin. Le contraste est brutal entre l’opulence des uns et la misère des autres. Après l’incendie du Reichstag le 27 février 1933, le parti nazi, le NSDAP, procède à l’arrestation de tous les socialistes et communistes possibles. Elsa, qui vit avec Roman dans un appartement d’un immeuble occupé par des communistes, ne doit son salut qu’à l’humanité d’un simple fonctionnaire de police social-démocrate, qui fermera les yeux sur la littérature séditieuse (Lénine, Trotsky, Luxemburg) sur les étagères. Lors d’une autre fouille, menée cette fois par la Gestapo, des documents sensibles avaient été cachés au fond d’un carton contenant les rails métalliques du train électrique de Roman. C’est au tranchant du métal rangé à la va-vite, dissuadant les gestapistes soucieux de ne pas se blesser les mains, qu’ils devront la vie. Staline, qui d’abord en sous-estime gravement la force et la pérennité, finit par prendre la mesure du pouvoir hitlérien, et décide notamment de recruter le fils du Kaiser pour en faire le chef de file d’une opposition aristocratique. C’est ainsi que Ludwig est amené à prendre contact avec un membre de la famille Hohenlohe — un prince désargenté qu’il aide financièrement — dans l’espoir qu’il lui sera un jour utile. Las, l’aristocrate passe son temps à écrire des vers et travailler à son autobiographie. On demande également à Ludwig de se rapprocher de Putzi Hanfstaengel, personnalité nazie de premier plan, ancien confident d’Hitler et financier du NSDAP à ses débuts. Ludwig refusera d’instinct, le supposant en relation avec l’Intelligence Service britannique. La suite lui donnera raison. La liberté de jugement de l’agent commence à agacer, a fortiori lorsqu’il s’avère avoir vu juste.

[Youla Chapoval, Feu, 1950]
Étape suivante : Paris. En 1936, Ludwig est rappelé à Moscou — procédure de plus en plus habituelle, car toute participation à l’existence du Parti à l’étranger étant rigoureusement interdite aux agents clandestins, ceux-ci se retrouvaient de plus en plus isolés, et donc vulnérables. Ludwig, qui avait maintes fois différé son retour, est alors, et à plus forte raison, devenu suspect. Et déjà surveillé, notamment par des fonctionnaires zélés du NKVD en poste à Paris, dont la méfiance à l’égard des intellectuels et des vieux bolcheviks est typique de ces années de terreur. C’est Elsa qui se rendra à Moscou, où elle trouve une atmosphère de mort. Les liens d’humanité, même entre les amis les plus proches, sont brisés par la terreur. On lui fait comprendre qu’il est « inutile » de chercher à reprendre contact avec tel ami — « N’habite plus ici ». Tel autre ? « Malade, à l’hôpital. » Elsa aperçoit dans la rue Kroupskaïa, la veuve de Lénine, qui a dû mendier auprès de Staline la vie des seize condamnés du premier procès du 19 août 1936, vieux compagnons de route de son mari, pour se voir finalement contrainte de les accuser d’être des contre-révolutionnaires. Kroupskaïa, fantomatique. Et les cosaques, gardiens de la monarchie tsariste dont les privilèges ont été rétablis, qu’Elsa voit à nouveau dans la rue. Elle décide de voir quand même les amis qu’on lui a déconseillé de voir. « Au summum de la terreur, dit Elsa, le danger perd tout sens et les précautions deviennent absurdes. »
La rupture
« La mise en place de ces circuits est à la fois très complexe et extrêmement dangereuse : les armes ne peuvent pas passer par la France à cause de l’embargo franco-britannique. »
Ceux qui le peuvent mettent alors tous leurs espoirs dans une victoire des républicains dans la guerre d’Espagne. Ludwig, qui établit des circuits d’approvisionnement des républicains espagnols en armes, est aux premières loges pour assister au sabotage de leurs efforts par Staline, qui fait éliminer, au cœur même des combats, les opposants dont il veut se débarrasser. Ludwig fait parvenir à ces militants d’extrême gauche l’avertissement qui restera attaché à son nom : « La décision d’user de tous les moyens contre vous vient d’être prise. Entendez-moi : je dis tous les moyens9. » La mise en place de ces circuits est à la fois très complexe et extrêmement dangereuse : les armes ne peuvent pas passer par la France à cause de l’embargo franco-britannique. Hors de France, la surveillance nazie rend la mission hautement périlleuse. C’est alors que Ludwig prendra sans doute la décision de rompre ; il tente de convaincre son collègue Krivitski, qui tergiverse, d’en faire de même. Mais son vieil ami ne se décide pas. « Les hommes attendent un miracle qui remettrait demain la politique de la classe dirigeante sur ses anciens rails », dira Léon Trotsky. « Ils espèrent mais continuent à traîner leur boulet10. » Elsa reviendra de Moscou, qu’elle a quitté in extremis, avec pour Ludwig ce message de la part de ses plus anciens amis : « Ne reviens jamais. » Les suicides sont de plus en plus fréquents. Ludwig dira à ce propos : « Un revolver ne suffit pas pour se tuer. Il faut le temps. On sait, ou l’on croit savoir, comment se comporter face à un ennemi que l’on a combattu. Mais comment doit-on se conduire devant les siens, devant ceux pour qui l’on était prêt à perdre la vie et la liberté ? » Une considération qui fait lugubrement écho à la prémonition lancée quelques années plus tôt par Fedia : « Deux destinées attendent les gens comme nous : ou bien nos ennemis nous pendront, ou bien les nôtres nous fusilleront. »
Paris, en 1937, est devenue la plaque tournante de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas rentrer à Moscou. Elsa y fait la connaissance du dirigeant menchevik Raphaël Abramovitch, qui est à la recherche de son fils Mark Rein, porté disparu en Espagne. Dans sa nouvelle école à Romainville, l’institutrice communiste demande au jeune Roman le métier de son père. « Homme d’affaires. » Elle a une moue de dédain. Comment pourrait-elle se douter que le père de son élève, qu’elle prend pour un affreux capitaliste, risque sa vie pour la victoire des Républicains espagnols ? Gertrude Schildbach, la vieille amie de Ludwig rencontrée à Leipzig fait parvenir de Rome une lettre à Ludwig, laquelle passe, comme tout courrier, par les services du NKVD à Paris. Devenue avec le temps une amie intime du couple, très attachée à Roman, elle approche alors de la cinquantaine. Gertrude est unanimement considérée comme (très) laide, sujette à de fréquentes et vertigineuses baisses de moral, suicidaire. Ludwig lui a plusieurs fois sauvé la mise. La situation en URSS la trouble, écrit Gertrude, qui souhaiterait s’en ouvrir plus largement à Ludwig. Aubaine pour le NKVD, qui non seulement retrouve sa trace grâce à cette lettre, mais encore y trouve un excellent moyen de pression sur lui.
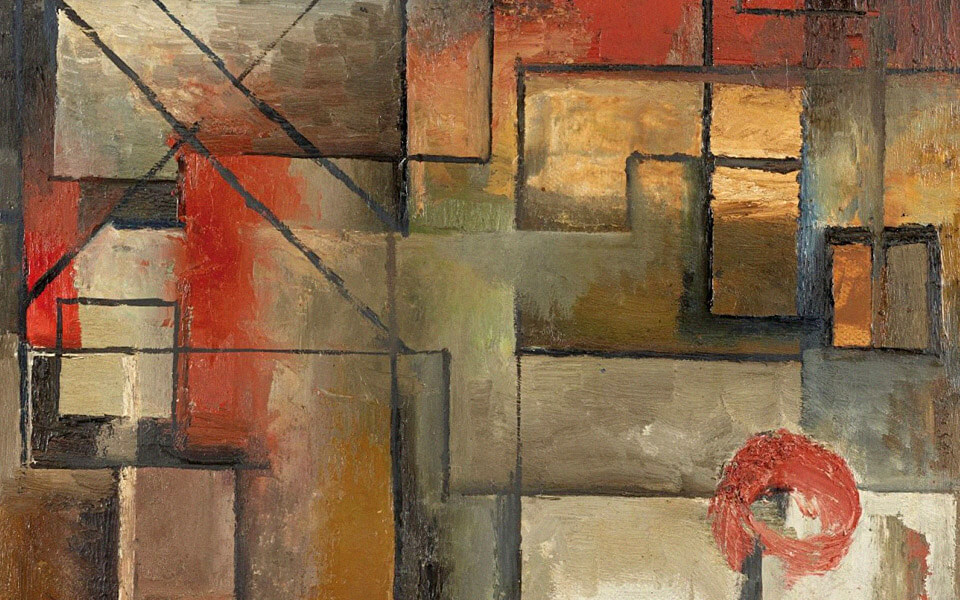
[Youla Chapoval, Sans titre, 1948]
Ludwig a mis femme et enfant en sécurité à Finhaut, dans les montagnes valaisannes, en Suisse. C’est là qu’il fait lire à Elsa la lettre par laquelle il espère atteindre les partis ouvriers du monde entier — non sans prévenir au préalable le Comité central du Parti communiste : un geste de loyauté qui lui coûtera la vie et que Trotsky qualifiera d’« attitude d’un chevaleresque extraordinaire », bien qu’« inutile11 ». La lettre, confiée à l’ambassade soviétique à Paris pour être acheminée à Nikolaï Iejov, chef suprême du NKVD à Moscou (ce qui est censé donner à Ludwig un délai d’une semaine supplémentaire pour préparer la suite), est ouverte à Paris sur ordre de Serguei Spiegelglass, fondé de pouvoir de Iejov, de passage dans la capitale française. Il y a déjà une cible sur le dos de Ludwig ; Speigelglass organise aussitôt la chasse à l’homme. Il fera pour cela notamment appel à Serge Efron, le mari de la poétesse Marina Tsvétaïeva, et à des hommes de son réseau.
« On retrouvera le corps de Ludwig criblé de balles, sa montre arrêtée à 10 heures moins 10. »
« Notre monde avait disparu à jamais. Nous n’avions plus ni passé ni futur », dira Elsa après avoir lu la lettre. De fait, dès lors, Ludwig commence à reconnaître ses amis disparus sous les traits du moindre passant. « Il est plus facile de mourir que de vivre », dit-il. Il part pour de longues marches dans les montagnes suisses, comme suspendu au-dessus du vide. Il a rendez-vous avec Sneevliet, début septembre 1937 à Reims, pour rendre sa lettre publique. Et avec le fils de Léon Trotsky, Léon Sedov qui, à Paris, représente son père vers qui Ludwig veut se tourner. Juste avant, Ludwig doit voir à Lausanne sa vieille amie Gertrude Schildbach. Lors d’une promenade à pied à Finhaut, la famille croise un groupe de promeneurs. Une jeune femme les salue amicalement ; c’est Renate Steiner, chargée depuis plusieurs mois par le NKVD de filer Ludwig. Elsa la reconnaîtra quelques jours plus tard sur des fichiers de police. La famille rencontre Gertrude Schildbach dans l’après-midi. Elle est apprêtée ; elle doit, dit-elle, épouser un industriel italien ; elle parle de son mariage prochain. Elle porte la robe, choisie par Elsa, que Ludwig lui a offerte pour son dernier anniversaire. Elle est nerveuse. Elle a posé une boîte de chocolats sur la table. Elsa tend la main. Gertrude reprend la boîte avec empressement. « Ce n’est pas pour vous. » C’était bien pour eux : la valise de Gertrude sera fouillée plus tard ; les chocolats étaient fourrés à la strychnine. Le NKVD avait prévu plusieurs scénarios pour s’assurer que personne, ni Ludwig, ni Elsa, ni Roman, n’en réchappe. Mais au dernier moment, prise de scrupules, ne supportant pas l’idée d’empoisonner le jeune Roman qu’elle a souvent gardé, Gertrude reprend son cadeau. Ludwig mettra ce comportement sur le compte de la nervosité habituelle de son amie. Puis Gertrude et Ludwig dîneront ensemble, sans Elsa ni Roman. Le lendemain, Ludwig a rendez-vous à la gare de Reims avec Sneevliet et Léon Sedov pour convenir des termes de la publication de sa rupture. Il y était aussi attendu par des tueurs, au cas où il aurait survécu à l’attentat dont Gertrude fut la pièce maîtresse. Si Ludwig était certes suspect aux yeux de Moscou depuis un certain temps, une telle connaissance des moindres détails de son emploi du temps signalaient sans doute possible l’existence d’une taupe, vraisemblablement dans l’entourage de Henk Sneevliet.
L’assassinat, et après…
On retrouvera le corps de Ludwig criblé de balles, sa montre arrêtée à 10 heures moins 10, une touffe des cheveux gris de Gertrude Schilbach au poing, abandonné au bord de la route de Chamblandes, près de Lausanne, le 4 septembre 1937. Sur lui, un passeport au nom d’Hermann Eberhardt ; c’est Elsa qui, alertée, ira reconnaître le corps de son époux. Léon Trotsky réagira à l’annonce de la mort « profondément tragique » de Ludwig en affirmant, dans un texte daté du 21 septembre 1937 : « Seules des convictions idéologiques profondes ont pu dicter à Reiss sa conduite et cela seul mérite de lui attirer le respect de tout ouvrier pensant. » Il regrettera par ailleurs la part de responsabilité de la Quatrième Internationale : « Il s’agit de nos fautes et de nos faiblesses communes. Nous n’avons pas établi aussitôt la liaison avec Reiss, nous n’avons pas su renverser les obstacles négligeables qui le séparaient de nous11. » Efron, qui était présent dans la voiture d’où les coups de feu ont été tirés, sera renvoyé en URSS avec sa famille. Le mari de Marina Tsvétaïéva faisait partie de ces Russes blancs « retournés » et payés par le NKVD, travaillant pour le renseignement soviétique par patriotisme et dans l’espoir de rentrer un jour au pays. Le billet retour d’Efron, après le fiasco de l’assassinat de Ludwig qui n’aurait dû laisser ni témoin, ni survivants, se soldera par sa mort et par un long enfer pour sa femme et ses enfants. À Paris, la poétesse disait : « Ici, je suis inutile, là-bas, je suis impossible. »
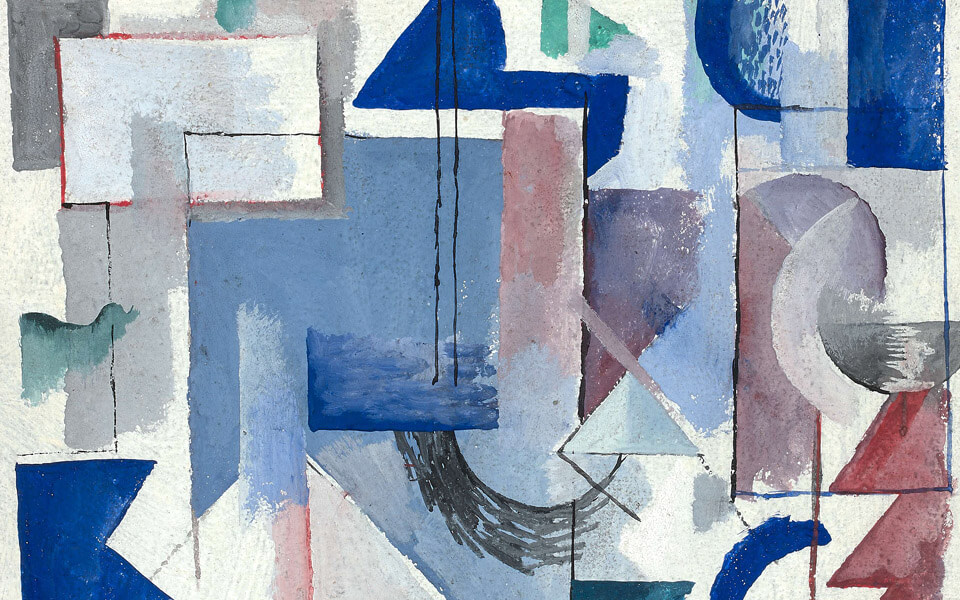
[Youla Chapoval, Sans titre, 1949]
Renate Steiner, chargée de filer Ludwig en Suisse, sera vite retrouvée et interrogée par la police. Elle aussi aura été appâtée par un séjour en URSS, où elle souhaite vivre depuis 1932. La jeune institutrice avait déjà été chargée de suivre Sedov en 1936 sans que cela ne conduise à son assassinat ; elle dut sans doute croire de bonne foi qu’il s’agissait là d’une filature similaire, sans conséquence tragique. Quant à Gertrude Schildbach, l’un des tueurs, lui aura préalablement joué la comédie de l’amour — son point faible. Les criminels seront arrêtés et relâchés — le gouvernement du Front populaire voulant éviter l’incident diplomatique avec l’URSS — mais tous seront éliminés après coup. On trouvera dans leurs bagages le plan du logis de Léon Trotsky à Mexico, ce qui fera dire que l’assassinat de Ludwig était une « répétition » de celui de Trotsky.
« On trouvera dans leurs bagages le plan du logis de Léon Trotsky à Mexico, ce qui fera dire que l’assassinat de Ludwig était une
répétitionde celui de Trotsky. »
Si Ludwig est mort, sa femme et son fils lui survivent. Peu après l’assassinat, Elsa a rendez-vous avec Sneevliet, à Paris, chez Gérard Rosenthal, l’avocat de Trotsky. Sedov, qui y est attendu, ne peut pas se déplacer. En revanche, Victor Serge, qui n’est pas invité, se joint à Sneevliet. Serge est accompagné d’un certain Étienne, alias Mark Zborowski, jeune secrétaire de Sedov, dont la plupart des trotskystes français de l’époque se méfient. Étienne et Victor Serge sont inséparables, le premier étant légitimement fasciné par le second, lequel, tout aussi légitimement heureux des marques d’estime du jeune homme, en fait son confident. Elsa se montre froide avec l’écrivain12, lequel se fera copieusement engueuler par Sneevliet pour avoir introduit un inconnu, tout secrétaire de Sedov qu’il soit, à une réunion aussi sensible. En 1938, Elsa et Roman sont chez Alfred et Marguerite Rosmer, des proches amis de Trotsky, à Périgny, au sud-est de Paris. Il y a aussi chez eux le petit-fils de Léon Trotsky, Sieva, qu’Alfred Rosmer emmènera rejoindre son grand-père au Mexique. Il y a Ira et Nora, les filles d’Andreu Nin, fondateur du POUM, exécuté en Espagne sur ordre de Staline, et leur mère Olga. Une photo parmi d’autres montre les quatre enfants, assis à une table. Bien des années plus tard, au début des années 2000, ce cliché donnera à un réalisateur français l’idée d’un documentaire réunissant les quatre protagonistes — documentaire qui, faute d’argent, ne verra jamais le jour. Chez les Rosmer, ils rencontrent également Daniel Martinet, et l’Arménien Tarov (plus connu sous le nom d’Armenak Manoukian), qui rejoindra le groupe Manouchian et finira exécuté avec ses camarades en 1942. Elsa fait la connaissance de Léon Sedov, le fils de Trotsky. De cette rencontre, elle dira qu’est née « un type d’amitié [qu’elle] ne croyait plus possible ». Hélas, Sedov mourra lui aussi, en février 1938, des suites d’une opération bénigne d’un ulcère à l’estomac. La thèse de l’accident est évidemment invraisemblable. Le coup est très dur.
Elsa et Roman réchappent à un attentat de plus, Gare du Nord à Paris. Trop de monde. Ils fuient vers Marseille, où le consul de Pologne s’assied sur ses principes et leur établit de vrais-faux papiers, les faisant naître à Barnaoul, en Sibérie. Ils comptent traverser l’Atlantique pour les États-Unis, où le NKVD ne pourra pas les atteindre. Or le quota des immigrants provenant d’Europe centrale étant atteint, seul un lieu de naissance en Russie les assure de franchir Ellis Island. Ils portent le nom de Bernhaut, nom de jeune fille d’Elsa, qui deviendra Bernaut à l’immigration américaine. Quelques années plus tard, le jeune Roman partira à la guerre. Un cafouillage l’aura fait naître officiellement en 1926 (à Barnaoul) plutôt qu’en 1925 (à Vienne). Mobilisé en 1944 plutôt qu’en 1943 dans l’armée américaine, cette heureuse fortune lui aura certainement sauvé la vie, même s’il échappera encore à la mort, hospitalisé, pendant que son unité, envoyée en Allemagne, est décimée. Si bien qu’affecté à Berlin en 1945, le sous-officier qui le reçoit, ne croyant pas si bien dire, l’accueille par ses mots : « What are you doing here ? You’re supposed to be dead. » En effet, et à plus d’un titre. Ses supérieurs s’avisent qu’il parle plusieurs langues, dont un anglais impeccable — « This one is unusual, sir : he speaks English. » Habitués aux « interprètes » écorchant plusieurs idiomes et trop contents de l’aubaine, ils nomment le jeune GI interprète pour les services de contre-espionnage. Ce qui l’amènera notamment, ironie de l’Histoire, à être en contact avec le NKVD en zone russe.

[Youla Chapoval, Sans titre, 1949]
Aux États-Unis, d’étranges retrouvailles
Roman sera démobilisé en 1946 et renvoyé aux États-Unis. Il étudiera à l’université de Columbia à New York où il croisera brièvement la route du futur poète Allen Ginsberg. Elsa deviendra docteure de philologie et de littérature slave dans la même université. Elle s’y liera d’amitié avec la célèbre anthropologue Margaret Mead, dont l’un des jeunes collègues n’est autre qu’un certain Mark Zborowski, alias Étienne, l’ancien secrétaire de Léon Sedov et proche de Victor Serge. Peu après, Zborowski se retrouve dans le collimateur du FBI dans le cadre de l’affaire Rosenberg : il doit comparaître pour parjure. C’est alors d’abord à Elsa qu’il admettra avoir toujours été la taupe du NKVD que certains trotskystes français soupçonnaient — impliqué dans l’assassinat de Ludwig, dans celui de Léon Sedov et, plus tard, celui de Rudolf Klement : « Je ne dois d’explications à personne, lui dira-t-il, sauf à toi. » Fin 1955, lors de son procès, le juge décidera de s’en tenir à l’accusation de parjure (sur la foi du témoignage d’un condamné pour espionnage sur le territoire américain, qu’Étienne niera toujours avoir rencontré), négligeant de nombreux témoignages allant dans le sens des activités politiques d’Étienne. Zborowski fut reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison. Tout au long du procès, ses collègues anthropologues prendront fait et cause pour lui. « Ils ignoraient tout des agents et de la police secrète, racontera Elsa, et ne savaient rien des questions politiques soviétiques ; pour eux, un agent soviétique et un parjure ne pouvait être qu’une victime innocente de persécutions politiques. » « Nous nous refusons », lui déclarera l’une des collègues de Zborowski, « à voir organiser des sacrifices humains dans notre pays ».
« C’est une histoire tissée d’incertitudes, où il faut se faire aux lacunes, aux zones d’ombre, à l’insuffisance. »
Elsa et Roman vivront à New York, puis à Londres, brièvement, et à Paris. Elsa y mourra en octobre 1978, un an et demi après avoir connu la joie de voir naître son petit-fils, joie qu’elle n’aurait jamais cru possible. Roman passera sa retraite avec son épouse française, dans un village de six cents âmes du sud de la Seine-et-Marne. Extraordinaire hasard de l’histoire, il s’y découvrira voisin de la fille de Raphael Abramovitch, la sœur de Mark Rein, dont il fut question plus haut. À son quatre-vingt-dixième anniversaire, il se dira plutôt étonné, somme toute, d’en être arrivé là. Ayant sans doute résolu qu’il était temps de partir, Roman s’éteindra tranquillement quelques mois plus tard, en septembre 2015. Il ne parlait que rarement, et avec réserve, de cette histoire, arguant qu’il valait mieux ne pas se prononcer sur ce dont on n’était pas absolument certain. En quelque sorte, il faisait sien cet aphorisme presque michaldien : « Même si c’est vrai, c’est (probablement) faux13. » Ce n’est qu’en 1989 que mon père a commencé à lever le voile sur l’histoire familiale, à m’en livrer des bribes ; alors, sans doute, on ne risquait plus rien.
Des militants, des journalistes, des historiens sérieux (comme par exemple les Suisses Peter Huber et Daniel Kuenzi, ou le Hollandais Igor Cornelissen) et d’autres parfois moins rigoureux, ont travaillé sur cette histoire. Des passionnés ont écumé ce qui restait des archives (que Loïc Damilaville soit ici remercié). Certains lecteurs et les spécialistes de Tsvétaïéva en connaissent une partie. La vie de Ludwig, son combat, ont été mis en images ou en mots, ont inspiré des œuvres diverses. Citons notamment Berlin-Moscou, de Tariq Ali14, qui imagine notamment Roman (appelé Felix) retrouvant Gertrude Schildbach à Berlin en 1945 ; Le dernier jour de l’espion Reiss d’Eberhart Raetz, ou le film français Disparus, de Gilles Bourdos, sorti en 1998, qui prend certaines libertés avec la vérité historique. Costa-Gavras envisagera même d’adapter Les Nôtres au cinéma dans les années 1970, ce qui ne se fera pas.

[Youla Chapoval, Sans titre, 1949]
Ceci n’est pas travail d’historien ; j’ai tâché de raconter un peu de cette histoire qui est celle de ma famille. C’est une histoire tissée d’incertitudes, où il faut se faire aux lacunes, aux zones d’ombre, à l’insuffisance. On s’habitue à voir des tiers en savoir davantage que soi sur ses propres aïeux. Le récit développé ici, loin d’être exhaustif, repose donc pour l’essentiel sur Les Nôtres, parce que c’est la source la plus rigoureuse et certainement la plus vive (Jorge Semprún, dans sa préface à la deuxième édition du livre, évoque « la mémoire fertile, inusable » d’Elsa), parce que la vérité est, sans emphase excessive, l’un des devoirs des vivants aux défunts. Et parce qu’enfin cette histoire d’espion et de révolutionnaire, pris dans la tourmente d’un siècle et mort pour ce en quoi il croyait, est aussi, comme la plupart des histoires, une histoire de famille et, comme la plupart des histoires de famille au fond, peu banale et essentiellement inconnaissable.
« Vive ceux qui ont échoué
et ceux dont les vaisseaux ont sombré dans la mer !
et ceux-là qui eux-mêmes ont sombré dans la mer !
et tous les généraux qui ont perdu leurs combats, et tous les héros défaits !
et tous les innombrables héros inconnus, égaux dans la gloire aux plus grands des héros15 ! »
Walt Whitman
Illustration de bannière : Youla Chapoval, Calme Nuit, 1949
Photographie de vignette : Ignace, Roman et Elsa © Alexis Bernaut
- « Vivas to those who have failed : for they become the river. »[↩]
- L’autre identité par laquelle on le connaît le mieux est Ignace Reiss. Ce nom, inconnu de Moscou, lui fut donné après sa mort et permettra, un temps, de brouiller les pistes.[↩]
- On l’appellera ici Ignace jusqu’à son entrée au PC polonais. Puis, Ludwig.[↩]
- D’abord parus en anglais sous le nom d’Our Own People, Oxford University Press, 1969, puis en France (Les Nôtres) chez Denoël, avec en guise d’avant-propos un article de Léon Trotsky écrit après l’assassinat. Les éditions ultérieures du livre furent préfacées par Jorge Semprún. Sauf mention contraire, toutes les citations entre guillemets de l’article en sont issues.[↩]
- Aujourd’hui Pidvolotchysk, en Ukraine.[↩]
- Lénine mettait l’accent sur le Parti comme avant-garde de la classe ouvrière plus que sur le prolétariat lui-même ; pour Rosa Luxemburg, au contraire, le Parti était l’organisation politique de la classe ouvrière et non l’instrument de la direction politique destiné à prendre le pouvoir. C’est, selon Rosa Luxemburg, la classe ouvrière qui, le moment venu, orienterait le Parti dans le sens nécessaire à la prise du pouvoir.[↩]
- Nom donné aux diverses formations militaires qui ont combattu le pouvoir bolchevik 1918 à 1922.[↩]
- Née à Kolomya (à l’époque en Pologne, aujourd’hui en Ukraine) en 1898, elle est passée par la faculté de médecine.[↩]
- Cité par Victor Serge dans « L’assassinat d’Ignace Reiss », Victor Serge, Maurice Wullens, Alfred Rosmer, L’Assassinat politique en URSS, 1938.[↩]
- Léon Trotsky, « Une leçon tragique », publié comme avant-propos de l’édition des Nôtres de 1969, Denoël.[↩]
- Léon Trotsky, Ibid.[↩][↩]
- Sedov et Elsa avaient en commun de se méfier, malgré son prestige incontestable, de Victor Serge. Le premier trouvait suspecte sa libération d’URSS en 1936 et soupçonnait le NKVD de le filer parmi les groupes trotskystes et d’opposition qu’il fréquentait à Paris — position partagée du reste et par Ludwig et par Krivitsky ; quant à Elsa, compte tenu de ces éléments, elle le trouvait trop bavard et pas assez prudent. Victor Serge écrira en 1938 un texte élogieux à la mémoire d’Ignace Reiss.[↩]
- « Même si c’est vrai, c’est faux. » Henri Michaux, « Tranches de savoir » in Face aux Verrous, Gallimard, 1954.[↩]
- Dont le titre original est Fear of Mirrors, paru en 1998, traduit une première fois sous le titre La Peur des Miroirs (Syllepse) et réédité chez Sabine Wespieser sous le titre Berlin-Moscou. À l’occasion de la parution de son roman, Tariq Ali avait interrogé Roman pour The Guardian (en anglais).[↩]
- « Vivas to those who have fail’d !
And to those whose war-vessels sank in the sea !
And to those themselves who sank in the sea !
And to all generals that lost engagements, and all overcome heroes !
And the numberless unknown heroes equal to the greatest heroes known ! »[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Le feu et l’oubli : Bruno Jasieński, poète révolutionnaire », Thomas Misiaszek, octobre 2017
☰ Lire notre article « Piotr Archinov — devenir une force organisée », Winston, octobre 2017
☰ Lire notre article « Margarete Buber-Neumann — survivre au siècle des barbelés », Adeline Baldacchino, mars 2017
☰ Lire notre article « Souvenirs sur Solano », Edgar Morin, septembre 2016
☰ Lire notre article « Iaroslavskaïa, l’insurgée », Adeline Baldacchino, juillet 2016
☰ Lire notre article « Jaroslav Hašek, éthanol et drapeau noir », Guillaume Renouard, janvier 2016