Entretien | Ballast
Depuis des années, Christian Laval questionne, bien souvent aux cotés du philosophe Pierre Dardot, le néolibéralisme depuis une perspective post-marxiste. Ils ont publié en 2009 un travail sur la mutation néolibérale de notre représentation de l’individu abstrait et rationnel, La Nouvelle raison du monde, et, cinq ans plus tard, un essai qui revisite la notion de révolution à la lumière du concept de « commun ». Dans le brouhaha de la cafétéria de la Bibliothèque nationale, à Paris, il revient pour nous sur la genèse de leurs réflexions et sur leurs filiations intellectuelles, comme sur le sens plus global de son travail en cours sur la socialisation de la propriété : l’occasion de rappeler l’importance de « l’auto-institution » de la société, c’est-à-dire du cadre que se donne — et se construit — un peuple pour organiser son affranchissement.

La publication de La Naissance de la biopolitique de Foucault a été pour Pierre Dardot et moi-même un livre déclencheur : nous étions depuis longtemps insatisfaits de la façon dont la gauche alternative ou radicale interprétait le néolibéralisme en termes de marchandisation généralisée. On avait, nous aussi — un peu comme tout le monde, il faut l’avouer —, été tentés par l’interprétation facile d’un État encerclé, qui se défait, qui est démantelé par les politiques néolibérales… Or ce schéma, celui d’Attac ou de Bourdieu à certains égards, ne nous satisfaisait plus. En 2003, la parution du livre de Foucault constitue donc pour nous un choc, une forme de révélation après coup, puisque le cours de Foucault datait de 1979. C’est seulement vingt-cinq ans plus tard qu’on découvre son interprétation ; elle nous semble particulièrement pertinente en termes de logique normative et de rationalité politique d’ensemble — et pas seulement pour ce qui concerne les politiques économiques, d’ailleurs. C’est de là que nous allons repartir. Nous avions aussi formé un groupe de recherche, « Questions Marx », qui entendait questionner Marx et, plus largement, renouveler la pensée critique en faisant valoir certaines de ses thèses, écrits ou analyses qui nous semblaient oubliés ou négligés. Nous avons fait un premier travail sur les formes de marxisme qui nous paraissaient les plus percutantes, pertinentes, créatrices. Nous avons été amenés à critiquer notamment Hardt et Negri, dans notre Sauver Marx ? Et c’est dans la foulée de ce travail que nous avons commencé à lire vraiment Foucault, moins pour en faire une exégèse que comme un point d’appui et d’analyse du néolibéralisme le plus contemporain.
En quoi vos travaux antérieurs ont-ils nourri cette démarche ?
« En 2003, la parution du livre de Foucault Naissance de la biopolitique constitue pour nous un choc, une forme de révélation après coup. »
De deux façons, comme un nœud qui se constituerait : sur le terrain sociologique, j’avais travaillé sur l’école et l’université. Très vite, il m’était apparu que c’était une transformation très profonde des systèmes éducatifs qui s’était jouée, rendant les analyses classiques de Bourdieu un peu dépassées : je soulignais que les modes de reproduction des systèmes éducatifs ne passaient plus seulement par les inégalités culturelles mais qu’intervenaient désormais des facteurs économiques, de plus en plus massivement. Les systèmes éducatifs avaient tendance à se brancher beaucoup plus directement que ne le prétendait Bourdieu sur le système économique, alors que toute la thèse de Bourdieu et Passeron consistait à avancer que la reproduction scolaire supposait l’autonomie du système scolaire pour légitimer des inégalités sociales passées par le filtre des résultats scolaires. Cette analyse était probablement valable pour un état plus ancien du système éducatif, qui s’était déjà transformé tout en reprenant des critiques bourdieusiennes (par exemple, l’idée que le système était trop éloigné de la vraie vie productive, etc.) Donc il me fallait revoir cette analyse, moins « contre » Bourdieu que pour l’infléchir. Avant ma lecture de Foucault, déjà, je travaillais donc sur l’idée que le néolibéralisme ne concerne pas que l’économie mais touche toutes les institutions, et en particulier les institutions scolaires : d’où une analyse du néolibéralisme scolaire, de l’école néolibérale ou de l’université néolibérale dès les années 1990. Mais j’ai tiré un deuxième fil pour aboutir à La Nouvelle raison du monde : celui des travaux sur l’utilitarisme anglo-saxon et sur Bentham en particulier. Là, c’est une toute autre source, qui venait plutôt de la psychanalyse. J’avais fait des études d’économie et de psychanalyse en parallèle ; j’ai très vite essayé de les mettre en rapport, ce que de plus en plus de chercheurs tentent de faire aujourd’hui.
C’est à partir de là que j’ai réalisé que Lacan ou Freud s’étaient intéressés au modèle économique. Chez Freud, il y a un modèle économique du psychisme et des métaphores économiques très prégnantes dans sa psychologie ; chez Lacan, l’intérêt pour la sociologie et Marx, et surtout pour Bentham, l’amène aussi à s’intéresser à l’économie ! J’ai réalisé alors que les lacaniens n’avaient pas attaché d’importance suffisante à tout ce qu’indique Lacan comme point d’inflexion historique ou intellectuel : l’idée que Bentham impose un virage utilitariste à l’éthique et plus largement aux rapports humains. Ceci a déclenché chez moi, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, un intérêt qui demeure aujourd’hui une idée quasi obsessionnelle, car je crois qu’il y a là quelque chose de fondamental. J’ai croisé sur ma route ensuite le MAUSS, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, Alain Caillé — avec qui j’ai fait une thèse sur la sociologie en tant qu’anti-utilitarisme ; mais, en fait, j’avais entamé ma réflexion bien plus tôt. Voilà les sources indirectes de toute notre réflexion : une série de zigzags orientés dans une direction unique, qui m’a finalement mené à la création d’un centre de recherches sur Bentham avec Jean-Pierre Cléro et de jeunes chercheurs. On a essayé, à Nanterre, de faire cristalliser ce travail pour rassembler des travaux jusque-là dispersés en économie, droit, psychologie, philosophie, etc.

Extrait de Composition bleue, jaune et grise de Serge Poliakoff (1958)
Bentham serait donc pour vous le premier théoricien du néolibéralisme ?
Non, en fait on essaie plutôt de montrer que le néolibéralisme est un nouveau libéralisme qui s’est opposé à beaucoup d’égards au naturalisme du libéralisme classique, celui d’Adam Smith par exemple. Le libéralisme classique n’est déjà pas un bloc homogène puisqu’il y a une tension très forte, dès le départ, au sein même du mouvement. Certains insistent très tôt sur le rôle du gouvernement, du droit, de la vie économique comme supposant un cadre institutionnel (des « dispositifs » de discipline ou de morale, dirait Foucault), et sont donc très loin du mythe de l’auto-régulation du marché. Bentham, qui garde des aspects naturalistes, montre déjà qu’il n’y a pas de « monde capitaliste » sans État ni maillage institutionnel, au point qu’il indique que le capitalisme suppose une langue nouvelle, une réformation de l’ensemble du langage car les vieux mots trahiraient le juste calcul que chacun devrait pouvoir faire ! Chez lui, ça va jusqu’à repenser de fond en comble l’État. D’une certaine façon, c’est un vrai technicien de l’État bureaucratique social : il invente toutes sortes de ministères (de l’éducation, de la santé, etc.), il pense un État qui prendrait en charge la totalité de la vie des individus, capable de calculer les peines et les plaisirs pour permettre d’atteindre le plus grand bonheur du plus grand nombre. On n’est pas là dans le néolibéralisme qui, lui, se dressera contre l’État social, interventionniste, régulateur ; et qui concevra le marché comme une construction. Mais il m’a semblé que c’est parce que Foucault avait beaucoup appris de Bentham qu’il a identifié ces mêmes aspects constructivistes du néolibéralisme contemporain — d’où mon article « Ce que Bentham a appris à Foucault ». Foucault avait cette qualité, de se laisser imprégner par ses lectures.
À tel point qu’on a pu dire de Foucault qu’il ouvrirait la voie au néolibéralisme… ?
« Les altermondialistes et les bourdieusiens, quelles que soient leurs immenses qualités d’alerte, n’ont pas fait le travail de connaître l’adversaire, d’aller voir en détail ce qu’il disait. »
C’est à la fois une connerie et une calomnie ! Foucault le dit très bien : quand on étudie sérieusement, quand on est un lecteur sérieux, ce qu’on étudie nous transforme, non par adhésion mais en nous aidant à comprendre le monde, la situation, l’époque. Ce que les lecteurs superficiels n’expérimentent pas assez ! Quand on s’intéresse à Bentham, on se laisse transformer parce qu’on a cette intuition qu’il y a là quelque chose d’essentiel. La théorie du pouvoir de Foucault est liée en partie à sa connaissance de Bentham, mêlée à d’autres lectures — comme celle de Canguilhem, sur les normes. Foucault ne peut être compris que par le travail des nœuds qui se font entre des fils différents.
Comment voyez-vous alors la naissance du néolibéralisme : rupture ou continuation logique par rapport au libéralisme ?
Ce qu’on a généralement vu dans le néolibéralisme, cette idée que nous critiquons avec Pierre Dardot, c’est que ce serait un « archéolibéralisme » : un retour en arrière — c’est la pente de Bourdieu, de l’altermondialisme de la fin des années 1990. Ils voient le néolibéralisme comme un retour à Adam Smith. Et donc, comme Marx ou Polanyi ont déjà fait la critique du marché autorégulateur, il n’y aurait plus grand-chose à en dire, peut-être même pas besoin de les lire ! Et c’est bien ce qui s’est passé : les altermondialistes et les bourdieusiens, quelles que soient leurs immenses qualités d’alerte, n’ont pas fait le travail de connaître l’adversaire, d’aller voir en détail ce qu’il disait. Du coup, ils n’avaient en face d’eux qu’un épouvantail. Et croyaient pouvoir s’en débarrasser à bon compte. Ils interprétaient le néolibéralisme comme un ultralibéralisme : une version radicalisée du libéralisme classique, qui ne viserait que l’extinction de l’État et la généralisation du marché. On a confondu le néolibéralisme avec le libertarianisme au sens américain ! On s’est donné un ennemi caricatural et on a, ce faisant, conforté les mythes, notamment celui de la social-démocratie, selon laquelle l’Europe serait un rempart contre l’ultralibéralisme anglo-saxon. Les socialistes ont beaucoup donné dans ce panneau, comme on sait, en faisant une interprétation délirante et falsifiée de l’économie sociale de marché. Notre préoccupation était de montrer que le néolibéralisme était très largement un constructivisme : qu’il visait à construire institutionnellement, juridiquement, politiquement, des marchés, et que l’Union européenne en était le parfait laboratoire (pas un rempart !). Cela ne peut pas être compris si on s’en tient à l’ultralibéralisme anti-institutionnel, ou si on le déchiffre comme un retour à Adam Smith qui n’a rien à voir avec le marché commun.
On a voulu montrer la double logique du néolibéralisme : on ne peut l’extraire d’un seul courant. Ce n’est pas une doctrine ni un ensemble de doctrines comme le pensent ceux qui font de l’histoire des idées. C’est une rationalité politique, sociale, culturelle qui conçoit les rapports humains comme des rapports de concurrence qui doivent être établis et construits. D’une part, les acteurs et agents qui doivent fonctionner dans ces marchés doivent eux-mêmes être constitués par le droit, l’école, des dispositifs managériaux qui leur permettent de fonctionner dans ce cadre : c’est la subjectivation, par où il faut penser à la fois la création de situations, comme diraient les situationnistes (le néolibéralisme est une sorte de situationnisme — enfin, je vais m’attirer leur colère s’il en reste… [rires]), c’est-à-dire un art de créer des situations par où les gens sont pris dans des logiques de concurrence. Mais d’autre part, il suppose d’agir sur les individus en les supposant sensibles aux variables de situation, capables de réagir sous une forme rationnelle en fonctionnant « à la compétition », comme du « capital humain ». Le côté intrigant, énigmatique, de la thèse de Foucault, c’est qu’il ne cherche pas à comparer l’ordolibéralisme allemand — cette version très constructiviste — et le néolibéralisme austro-américain représenté par Hayek ou Friedman, il ne recherche pas leurs différences. Il veut plutôt montrer que la gouvernementalité néolibérale, la façon de gouverner les individus, s’appuie sur deux piliers : la création des marchés avec les ordolibéraux et la redéfinition de l’homme économique comme capital humain ou entreprise de soi-même. Il montre alors, sans être tout à fait explicite — c’est pourquoi il faut le lire sérieusement pour le voir —, que la création du marché va supposer le nouvel homme économique, entrepreneur de lui-même, qui fonctionne « à la concurrence ». En fait, Foucault accole, articule les deux grands courants du néolibéralisme en faisant l’hypothèse de la gouvernementalité, ce qui lui permet de dire autre chose que « il y a plusieurs néolibéralismes », ce qu’on sait : c’est l’essence de cette nouvelle gouvernementalité, qui s’installe à la fin des années 1970, qui l’intéresse.

Extrait de Sans titre de Serge Poliakoff (1951)
Vous montrez bien que les logiques privées du marché viennent contaminer l’État lui-même, que désormais les deux marchent main dans la main. Que penser alors de ceux qui, à gauche, se réclament à nouveau d’un « État républicain », voué au bien commun, qui ferait reculer la logique du marché ? Y croyez-vous ?
Il faut d’abord prendre au sérieux l’idée de la transformation profonde de l’État dans un sens néolibéral. Il est nécessaire de réaliser qu’il ne suffit pas de quelques lois ou décrets interventionnistes pour balayer les transformations qui se jouent depuis 40 ans. Il est sans doute trop tard pour recréer l’Europe sur d’autres bases, d’où l’idée de certains selon laquelle il faudrait se recentrer sur l’État national en se débarrassant des contraintes européennes qui sont celles du marché. On reviendrait à un monde d’États-nations… Mais c’est sous-estimer la profondeur des transformations accomplies dans le sens de l’État entrepreneurial et managérial : comment, dans les services publics, révolutionner les rapports avec les agents, les usagers, etc. ? On ne peut pas revenir en arrière, on doit tout changer ! Or, comment procéder ? Il ne suffit pas de clamer qu’on veut revenir à l’État républicain !
C’est là qu’intervient votre notion de commun ?
« Il nous faut en effet une perspective révolutionnaire qui n’abolit pas l’État mais le transforme en profondeur selon un nouveau principe politique. »
Il nous faut en effet une perspective révolutionnaire qui n’abolit pas l’État, mais le transforme en profondeur selon un nouveau principe politique. Pas de retour pur et simple mais une transformation radicale. Où en est-il, l’État ? Il pose problème. Beaucoup pensent que l’État est éternel et font fi de 150 ans de réflexion critique, voire des analyses de Bourdieu sur la violence symbolique et physique intrinsèque de l’État — même les plus cultivés font comme si les sciences sociales et l’histoire n’avaient rien dit sur cette violence ! Quelles conséquences politiques en tirer ? On ne peut pas les ignorer et revenir au mythe d’un État neutre. Bref, c’est la grande question qui nous occupe : quelles conséquences tirer d’une critique conséquente de l’État ? Il faut revenir à la genèse de l’État moderne, à son lien avec la guerre, l’économie, le capitalisme, le marché et la propriété. Ce qui nous intéresse, c’est la naissance jumelle, concomitante, de la propriété privée (dominium) et de la souveraineté de l’État (imperium). On ne comprend rien en opposant simplement l’État et le marché. C’est une réflexion qui est encore en cours, et on ne peut pas se substituer aux historiens ou aux juristes. Notre rôle est de puiser dans les derniers travaux qui font autorité pour essayer de comprendre et d’analyser ceux qui vont plus loin dans le sens qui est le nôtre ! Il faut voir d’où nous sommes partis. Marx, Bourdieu, Foucault, etc. nous ont formés : nous avons avec eux un rapport étroit et libre, sans être pour autant leurs « disciples ». On ne les considère pas comme des boîtes à outils : on doit comprendre comment leurs pensées se sont constituées mais il faut s’appuyer sur elles pour aller au-delà de leur système conceptuel en se servant de tout ce que la recherche contemporaine a pu apporter de neuf — en allant chez Durkheim, chez Duguit. Le rapport imperium/dominium, il est présent chez Léon Duguit, mais on aurait sans doute pu le trouver chez Proudhon ! Dans son travail quasi illisible sur la justice ou dans sa théorie de la propriété, il y a des intuitions sublimes. Il faut ensuite en faire des hypothèses de travail, et avancer…
Justement, quelle est votre hypothèse sur un dépassement possible de l’impasse néolibérale en suivant la piste du commun ? Qu’entendez-vous réhabiliter en parlant des communs ?
Deux choses. Au singulier, le commun pourra être entendu comme un principe, celui de la démocratie radicale : c’est le principe qui veut que toutes les activités soient organisées, instituées en fonction de l’auto-gouvernement, donc ne soient pas closes ni fermées, mais avec une destination sociale. C’est une activité consistant à produire des ressources ou des biens qui sont destinés à un ensemble, une communauté d’usage, elle-même de format variable selon ses objets. Mais le commun, c’est aussi une institution culturelle, politique ou économique, régie par le principe des communs. Ce n’est pas nous qui avons inventé ce concept ou l’avons fait revivre : ce qui est très intéressant, c’est que son lexique est apparu en relation d’opposition directe avec le néolibéralisme, et qu’il s’agissait, avec Elinor Ostrom par exemple, de créer des relations nouvelles entre les gens pour en faire un mode de création et de production, pas seulement d’opposition. Par analogie, on peut concevoir le mouvement des communs comme la naissance du socialisme et de l’association au début du XXe siècle, émergeant à travers toute une série de courants dispersés. Il s’agit pour nous aussi d’inventer un nouveau monde dont l’essence paraît disparate au départ, et de prendre au sérieux politiquement la recomposition d’une pensée alternative proliférante mais cohérente, pas seulement constituée, localement ou sectoriellement, d’isolats.
On a d’abord compris les biens communs comme biens naturels, puis on a élargi la notion à l’Internet. Mais vous allez plus loin, en ajoutant des étages « politiques » à cette question de la gestion de biens particuliers…
On a en effet voulu montrer que, même si les acteurs ne pensent pas leur action comme politique, parce qu’ils ont une vision négative de la politique, leur activité, en ce qu’elle se réfère au commun, est forcément politique dès lors qu’ils essaient de mettre en place des fonctionnements démocratiques radicaux, rejoignant une aspiration plus ancienne qui est celle même du socialisme. Quand ils veulent que leur activité ait une signification sociale et dépasse la recherche de l’intérêt privé, de la maximisation des gains individuels et donc finalement la logique du capital, ils sont déjà dans le politique, même sans le savoir.
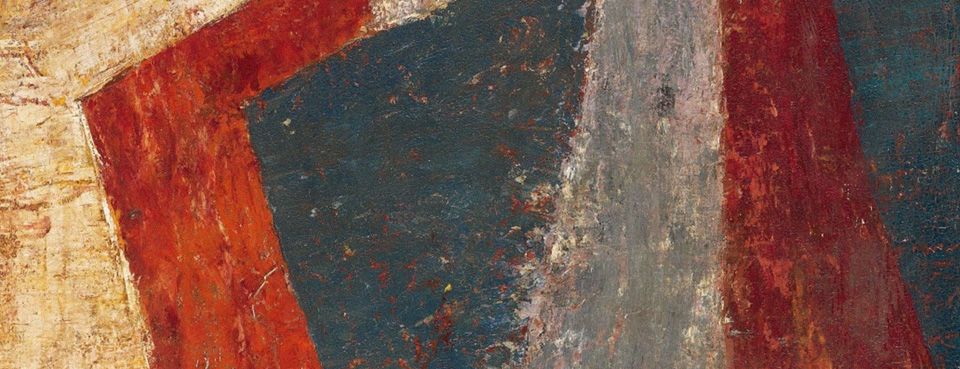
Extrait de Composition Rouge orange gris bleu de Serge Poliakoff (1952)
Vous avez beaucoup réfléchi à la question de la propriété, qui pourrait n’être détenue ni par l’État, ni par des individus : la socialisation de la propriété des biens communs. Que voulez-vous dire par là ?
Certes, beaucoup de communs s’appuient sur des formes juridiques qui renvoient à la propriété commune ou collective. Mais la logique même du commun, c’est de composer de façon variée avec un droit qui excède le droit de propriété : le droit d’usage. Ce droit a une dimension cruciale qui est sa dimension d’inappropriabilité : lorsqu’on veut qu’une ressource soit d’usage collectif, on lui accorde immédiatement cette qualité. Évidemment, ça ne signifie pas que tout le monde peut en user comme il veut, mais ce qui importe, ce sont les règles d’usage, nécessairement limitatives. Il y a là une évidence contemporaine qui répond aux besoins nouveaux : ce sont des dimensions protectrices de la nature, de la ressource, du bien, en incluant la question de la durée, de la transmission. Car on baigne aujourd’hui dans une rhétorique sur les « générations futures » ; mais raisonner sérieusement sur le sujet, c’est forcément revoir les logiques de propriété privée ou publique, qui ne concernent que la propriété actuelle, dont on peut faire ce que l’on veut ! Les notions de pérennité et de perpétuation amènent forcément à dépasser la conception de la propriété classique. Ce qui est en germe, c’est la naissance d’un nouveau droit et de nouvelles institutions ; donc au fond d’une nouvelle civilisation, si l’on entend que « le civil » inclut toujours une dimension juridique.
Mais comment voyez-vous cette transition possible vers le commun ? Sera-t-elle graduelle et sans violence ou marquée par des ruptures révolutionnaires ? Vos réflexions sur la Révolution russe permettent-elles de tirer des leçons encore valables ?
« Nous pensons que le gouvernement est une dimension incontournable du social, que la politique ne peut se dissoudre, que l’auto-gouvernement est encore gouvernement. »
On pense en termes de politique : la politique implique de l’affrontement et ne peut congédier l’idée de rupture, voire de conflit violent. Un changement de principe social aussi majeur que celui qui se prépare, dont sont porteurs les mouvements sociaux, ne se fera pas simplement. Rien n’est exclu : on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner, mais on sait déjà qu’elles peuvent mal tourner. [rires] La Révolution russe permet surtout de comprendre qu’on ne peut pas opposer le moyen et la fin : vouloir créer une société émancipée de la hiérarchie, du pouvoir et de la domination en utilisant tous les moyens de la verticalité, du centralisme, etc., c’est impossible et on ne peut plus se tromper là-dessus. Y compris les acteurs et praticiens du commun qui en ont pris conscience, car ils ne veulent surtout plus de parti politique dirigeant les masses en ayant la prétention de détenir un savoir surplombant sur la société. On a affaire là à des gens qui ne séparent plus moyen et fin, organisation actuelle et société future. On sait que l’action politique est en échec dès qu’on trahit aujourd’hui la société à venir. L’inégalité dans l’organisation de l’action met par avance en échec la société future. Réinventer l’action collective imposera donc de repenser les mécanismes de la délégation et du fétichisme politique. On voit aujourd’hui comme il est difficile de se passer d’un dirigeant, d’un chef : comme si un homme pouvait encore être l’incarnation du peuple, thèse proprement populiste et délirante ! Les tensions entre le démocratisme nécessaire et le verticalisme du désir de chef sont toujours présentes. Nous n’excluons pas la révolution, mais il faut la repenser : une révolution au XXIe siècle ne prendra pas la même forme qu’au XXe. C’est là qu’il faut saluer Proudhon, au moins pour son titre : L’Idée générale de la révolution au XIXe siècle ! C’est lui qui nous a inspiré le sur-titre Commun, pour notre livre Essai sur la révolution au XXe siècle. On pense qu’il y a eu une certaine « idée de la révolution » de Marx et d’Engels, ou une certaine « idée de la révolution » d’Octobre, mythifiée. Désormais va surgir une nouvelle « idée de la révolution » qui peut retrouver des traits du XIXe et travailler sur cette mémoire de la pensée révolutionnaire tout en inventant de nouveaux chemins.
Ne seriez-vous pas en train de devenir anarchiste ? Negri avait dit de votre livre qu’il s’agissait d’un « manifeste proudhonien » — avec dédain certes, mais ne l’assumeriez-vous finalement pas ?
Nous reprochions simplement à Negri d’avoir une conception du communisme très proche de l’idée d’une force collective spontanée. Ce n’était pas une insulte pour nous ! Nous avons d’ailleurs une très grande estime pour un certain génie de Proudhon, même si nous n’ignorons pas tous ses défauts. Même Marx l’avait reconnu : il a d’ailleurs fait un usage parfois anonyme de ses idées. Nous avons critiqué l’idée d’un commun spontané, exploité de l’extérieur par la propriété — ce que Marx a fait, c’est nous montrer que le capitalisme, par la grande entreprise, mettait en musique une certaine coopération, à son profit, de manière organisée. Commun est-il pour autant un manifeste anarchiste ? Pas du tout, même si nous reconnaissons tout ce que le mouvement anarchiste a pu porter en termes d’exigence d’auto-organisation, d’autonomie, de critique de la bureaucratie, des partis, etc. Nous sommes évidemment redevables au courant libertaire en général d’avoir soutenu que ce qui est en jeu dans la lutte anticapitaliste est avant tout la liberté individuelle et collective. Pour autant, nous ne pensons pas du tout que le but serait la disparition de l’État ou une dissolution du politique dans l’économique. L’anarchisme hérite de Saint-Simon : le social contiendrait de façon immanente son principe d’auto-organisation, ce qui lui permettrait, à maturité, de pouvoir se débarrasser des institutions qui constituent la société. Pour faire court, à terme, l’atelier remplacerait le gouvernement. Or nous ne le croyons pas du tout : nous pensons que le gouvernement est une dimension incontournable du social, que la politique ne peut se dissoudre, que l’auto-gouvernement est encore gouvernement. Croire qu’on peut se passer de gouvernement, c’est croire à des logiques immanentes au social qui suffiraient à l’organisation de la société : plus besoin de droit, de délégation, ni de rien, car le social se suffirait à lui-même. Cette idée est un décalque de la pensée économique libérale, en réalité ! Saint-Simon est le personnage clef de cette récupération : l’industrie contiendrait en elle-même des forces (une « puissance », en termes spinoziens), comme le marché pour les libéraux. C’était un grand lecteur d’Adam Smith et de Jean-Baptiste Say, mais il les contestait pour dire : ce n’est pas l’anarchie du marché mais l’organisation de l’industrie qui est le principe de la société. Et les anarchistes vont dans le même sens quand ils croient à la seule reprise en main du social par lui-même, par ses propres forces, une fois débarrassé du patronat et de l’autorité.
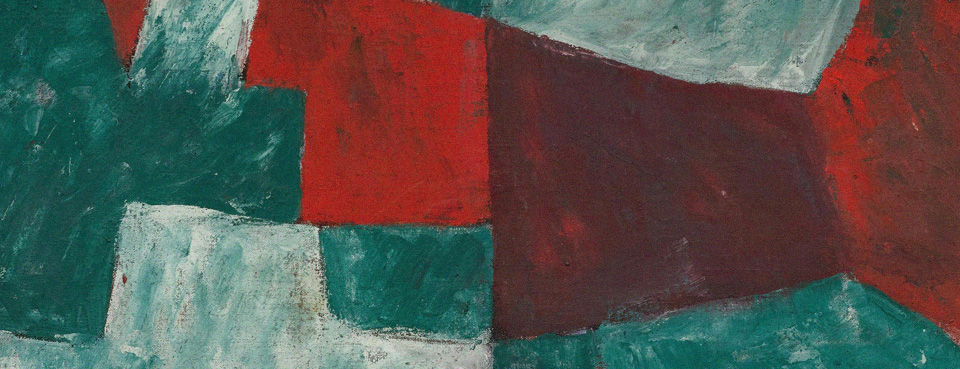
Extrait de Composition abstraite de Serge Poliakoff (1965)
Tous les anarchistes n’ont pas oublié le politique ! La révolution anarchiste espagnole de 1936 n’est-elle pas précisément le meilleur exemple de mise en œuvre historique de votre principe du commun ?
Oui, mais la Révolution espagnole n’a pas la philosophie de sa pratique ! En pratique, les anarchistes espagnols ont en effet pensé en termes politiques : la coordination des collectivités territoriales et des activités économiques a été fondamentale pour eux. Pourtant, leur doctrine, comme chez Marx, reposait encore sur un postulat selon lequel la société pourrait au final se dissoudre dans l’économique. Chez les penseurs du conseillisme, on retrouve ce phénomène : la société est un maillage de Conseils ouvriers ; chez le premier Castoriadis on voit cela, un mythe actif né du saint-simonisme qui conçoit la société comme un domaine productif organisé par les producteurs, et finalement comme une association de producteurs. Or nous croyons avec Pierre [Dardot] qu’il faut penser le politique. Les communards qui ont lu le dernier Proudhon vont, eux, concevoir leur action politique dans un schéma fédéraliste et communaliste. Même Marx va, de bonne foi je crois, reconnaître dans la Commune ce qu’il appelle « la forme politique enfin trouvée de l’émancipation économique » ! Là se situe un virage qui nous semble fondamental. Il fallait peut-être attendre cette expérimentation historique extraordinaire pour y deviner une avancée considérable dans la manière de penser la société future. Ce que Marx continuera d’ignorer, c’est quand même que les communards ont inventé cette « formule » grâce à des penseurs comme Proudhon — l’ennemi idéologique de Marx —, qui avaient imaginé la transformation sociale sur le mode de la communauté de communes. Quant à nous, nous n’abandonnons ni Proudhon ni Marx car, sur des partitions différentes, ils permettent de comprendre les révolutionnaires du XIXe siècle en tant qu’ils ont inventé des formes institutionnelles nouvelles. Pour nous il y a un continuum des penseurs, de Marx et Proudhon à Castoriadis et Gurvitch en passant par Merleau-Ponty, des Conseils et des Soviets à Mai 68 et au Chiapas, qui permettent, sur une même ligne alors qu’ils semblent ennemis, de penser la révolution, non comme prise de pouvoir par un parti mais comme réinvention, ré-institution profonde de la société.
REBONDS
☰ Lire notre abécédaire de Cornelius Castoriadis, février 2018
☰ Lire notre entretien avec Renaud Beauchard : « Se dégager du marché mondial unique », décembre 2017
☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais » (Memento), juin 2017
☰ Lire notre abécédaire de Pierre Bourdieu, janvier 2017
☰ Lire notre article : « L’émancipation comme projet politique », Julien Chanet, novembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Isabelle Garo : « Lire Foucault », février 2016
☰ Lire notre entretien avec Razmig Keucheyan : « C’est à partir du sens commun qu’on fait de la politique », janvier 2016
☰ Lire notre article : « Bookchin : écologie radicale et municipalisme libertaire », Adeline Baldacchino, octobre 2015
☰ Lire le texte inédit de Daniel Bensaïd, « Du pouvoir et de l’État », avril 2015
☰ Lire notre entretien avec Daniel Zamora : « Peut-on critiquer Foucault ? », décembre 2014


