Entretien paru dans le n° 2 de la revue Ballast (printemps 2015)
Nous publions en ligne notre dossier consacré au tirage au sort. Outil foncièrement démocratique (meilleure représentation du corps social, éviction des professionnels de la politique, compression du désir de pouvoir) ou règne de l’arbitraire et fin de la responsabilité individuelle et collective ? Ce premier volet donne la parole à Clément Sénéchal, militant écologiste et auteur antilibéral de l’essai Médias contre médias : en contempteur résolu du tirage au sort, il plaide pour la représentation comme garante d’une authentique démocratie sociale. Il va de soi — c’est même tout l’objet de notre rubrique « Agora », jamais avare d’un franc débat autour des questions qui agitent le camp de l’émancipation — qu’il conviendra de lire le second volet, aux côtés de la militante et metteuse en scène Judith Bernard, afin d’entendre le présent dossier.

D’abord, attention à ne pas confondre représentant et « maître », qui sont deux termes qui renvoient à des choses très différentes, tant du point de vue conceptuel — les deux figures n’expriment pas le même lien de subordination, notamment parce que l’idée de légitimité est absente du second, qui semble soutenir sa position uniquement par l’antériorité d’une force — que par les champs sémantiques et politiques auxquels ils appartiennent. « Maître » est un terme extrêmement pauvre — il dit peu de choses sur le rapport de pouvoir qu’il prétend décrire — et signale bien souvent une pensée simpliste, schématique et allusive. Que je sache, Edwy Plenel, en tant que directeur de la publication, représente Mediapart — il ne cesse d’ailleurs de parler en son nom dans les médias. Rancière lui-même, puisque vous le citez, doit bien représenter quelque chose également, sans doute un courant de pensée, une manière de concevoir politique et démocratie. Dans l’absolu, c’est précisément la faculté de représenter — par une langue, un discours, des œuvres d’art ou des concepts — qui donne à l’homme son humanité, sa capacité à faire société, et le distingue encore un peu des animaux. Politiquement, la représentation se caractérise par le jeu de médiations qui permettent d’ordonner pacifiquement la pluralité et la différentialité humaine : elle est l’enjeu nécessaire de l’intersubjectivité, de la mise en commun, de l’association. Je ne vois donc pas bien en quoi le principe de la représentation, qui suppose la mise en ordre et la perpétuation d’intérêts collectifs au niveau politique, peut être le contraire de la démocratie.
« Si le peuple en entier reste assemblé constamment, alors plus personne n’œuvre à la reproduction matérielle de la société. Il faut donc des instances de médiation : des institutions. »
D’ailleurs, je ne crois pas qu’il soit bon de replier le politique entièrement sur le social, de couper la respiration qui peut exister entre l’un et l’autre ; car elle permet à l’individu de s’aménager des marges de manœuvre sans être écrasé sous le poids d’une totalité, c’est-à-dire de s’accomplir dans un jeu d’adhésions et de résistances, de participations et de retraits. Le décalage de la scène représentative permet de mettre au jour une zone de controverses et d’hétérogénéités (des luttes, des temporalités…) indispensables à la démocratie. Que reste-t-il d’autonomie du sujet dans le contrat social de Rousseau, où chacun « se donnant à tous ne se donne à personne », devenant « partie indivisible du tout » ? Bien peu de choses. D’ailleurs, en faisant in fine appel à des guides et à une religion civile, Rousseau lui-même ne cache pas le caractère insoluble de son contrat social. D’après lui, un système politique dépourvu de représentation ne peut se réaliser que dans une démocratie idéale et sans histoire, car seul « un peuple de dieux » — incorruptibles — pourrait s’en satisfaire. Enfin, des arguments pragmatiques en faveur de la représentation : si tout le monde parle en même temps, c’est la saturation cognitive, et finalement le néant. Si chacun n’arbitre que d’après sa propre volonté, c’est la guerre de tous contre tous et le chaos. Et si le peuple en entier reste assemblé constamment, alors plus personne n’œuvre à la reproduction matérielle de la société. Il faut donc des instances de médiation : des institutions.
Mais le tirage au sort (dit TAS) soulève une question plus large encore, celle du pouvoir. Ses partisans estiment qu’il éliminera ainsi tous les prétendants aux honneurs. Entendez-vous, comme la tradition anarchiste ou le philosophe Alain le pensent, que la nature même du pouvoir est de corrompre quiconque s’en saisit ?
Si la nature du pouvoir est de corrompre tous ceux qui s’en saisissent, alors peu importent les intentions de celui qui s’en trouve pourvu. Ce genre de postulat ne mène pas loin — à la paralysie, tout au plus. Il est bien évident que le pouvoir, dans la mesure où il fonde une position d’excédent, couvre toujours l’abus de pouvoir. Il faut donc que « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir », comme le soutient Montesquieu. Qu’il s’agisse de pouvoirs en extériorité (le judiciaire face à l’exécutif, par exemple) ou en intériorité (les mandataires sur leurs mandants). Mais, pour autant, il ne s’agit nullement d’empêcher toute expression du pouvoir. Souvenons-nous que sans pouvoir, nous sommes condamnés à l’impuissance, c’est-à-dire dans l’incapacité d’habiter collectivement ce monde. La faculté de décider est sans doute la chose la plus précieuse de l’être humain — il serait bon de s’en souvenir de temps en temps. Dans un climat d’apathie générale, prenons garde à ne pas amplifier constamment une acception négative du pouvoir, en diabolisant a priori la volonté de pouvoir et ceux qui s’en réclament. Essayons plutôt de parvenir à ce que chacun revendique de participer au mouvement du pouvoir, c’est-à-dire œuvrer à l’instauration d’une véritable démocratie d’action : une démocratie protagonique, c’est-à-dire un régime qui incite chaque citoyen à s’impliquer dans la gestion des politiques publiques.
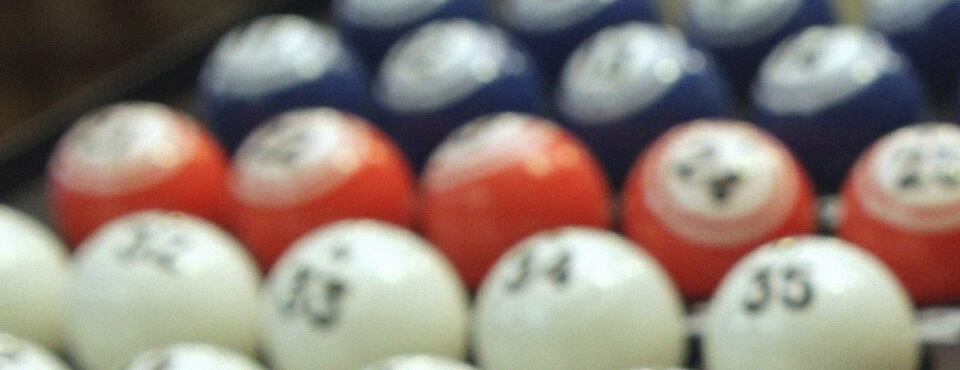
(DR)
Vous êtes un défenseur des partis comme cadre d’organisation de la confrontation politique. L’abstention massive et les rassemblements grandissants qui se constituent à l’écart de ces formations (du mouvement du 15‑M à Occupy Wall Street) ne donnent-ils pas à douter de la pérennité des partis ?
Attention : je ne pense pas que les partis soient le seul cadre de la confrontation politique. Les luttes syndicales, par exemple, sont également décisives et le syndicalisme révolutionnaire, dans les deux siècles derniers, a obtenu des modifications substantielles de l’état de la lutte des classes. Cependant, je pense comme Lénine ou Gramsci que le champ politique présente des spécificités stratégiques et nécessite des acteurs qui lui soient propres, à même de transcender l’action syndicale nichée au cœur même du procès de production, à savoir les partis politiques — sans quoi nous en resterions au niveau d’une démocratie corporative. De même, le monde associatif mène aujourd’hui de nombreuses luttes pour l’émancipation absolument indispensables : mais seuls les partis sont à même d’opérer le travail de synthèse thématique qui permet de porter une vision du monde et de lui imprimer une direction historique. Tous ces éléments doivent donc se tenir dans une division organique du travail politique à même de fonder une contre-hégémonie opposable à l’ordre capitaliste, plutôt que de se diluer dans le factionnalisme. Enfin, de façon plus prosaïque, je ne vois pas comment, dans un avenir proche, une force politique pourrait s’imposer en France sans s’être d’abord constituée en parti. Pour autant, personne ne peut nier là simplement le caractère autoritaire du néolibéralisme, présagé par Poulantzas dès les années 1970, c’est-à-dire celui d’un bloc historique qui appuie sa domination sur un exécutif coupé du peuple et une bureaucratie inaccessible aux parlements, mettant à distance toutes les procédures de la démocratie classique. Et Poulantzas de rappeler : « Les fascismes, les dictatures militaires, ou les bonapartismes n’ont pas simplement supprimé les seuls partis ouvriers ou révolutionnaires, mais l’ensemble des partis démocratiques traditionnels, bourgeois et petits-bourgeois compris, dans la mesure où ceux-ci, parallèlement à leurs fonctions de classe, exprimaient la présence en leur sein de certaines revendications des masses populaires dont il fallait bien tenir compte. » Quant aux Indignados espagnols ou aux manifestants grecs, leurs condensations politiques s’appellent Podemos et Syriza.
Mais les reniements — pour ne pas dire « trahisons » — de Syriza ne confortent-elles pas les positions de ceux qui contestent toute capacité de changement radical par les voies institutionnelles, pour ne pas dire légales ?
« Qui peut croire aujourd’hui que des activistes puissent défier la violence d’État et le pouvoir répressif du capital — qui a les moyens de financer des mercenaires et des armées privées ? »
Vous en connaissez d’autres ? Prendre les armes ? Qui peut croire aujourd’hui que des activistes puissent défier la violence d’État et le pouvoir répressif du capital — qui a les moyens de financer des mercenaires et des armées privées ? C’est une lubie romantique. De même, ne pas comprendre que Syriza est arrivé au pouvoir dans un environnement encombré par les décisions passées et surdéterminé par des considérations géopolitiques relève de la naïveté. D’abord, il ne suffit pas de prendre le pouvoir pour l’exercer : il faut d’abord recomposer les rapports de force qui traversent l’appareil étatique, lui-même hétérogène. Ensuite, il faut se confronter aux mouvements des adversaires politiques — la CDU allemande, par exemple. Enfin, la concentration institutionnelle d’un pouvoir de classe dans les traités européens et ses institutions réduit les marges de manœuvre. Autrement dit, il n’y a que dans la chanson que l’on peut faire table rase du passé, et la première tâche d’un pouvoir révolutionnaire est de réorganiser sa souveraineté. En gagnant les élections, Syriza ne s’est pas retrouvé face à une feuille blanche où imprimer tranquillement son programme et ses lois, mais face à un plan de bataille sur lequel gagner habilement des positions. Mais l’important était de briser le carcan de la subalternité intériorisée par la gauche radicale depuis des années en Europe, et d’ouvrir ainsi l’espoir d’un espoir, ou « la possibilité d’un possible », comme dit Badiou. Et pour ça, il faut des victoires électorales.
Le sociologue Yves Sintomer estime que le TAS serait souhaitable, au regard de l’abstention massive dont nous parlions et de l’incapacité grandissante des partis à porter les aspirations populaires. Le TAS pourrait redonner, juge-t-il, du « souffle » à la vie politique. Pourquoi serait-il donc, comme vous l’avez écrit, « antipolitique » ?
Je ne vois pas en quoi s’en remettre au hasard pourrait redonner du « souffle » à quoi que ce soit, si ce n’est à la superstition. Je rappelle que le TAS a des origines religieuses. Pour les Grecs, le hasard n’existait pas ; ils y voyaient la volonté des dieux. La démocratie, c’est au contraire fonder la politique sur elle-même : immanence contre transcendance. Dès lors, il n’y a pas d’autre solution que de s’en remettre à l’action volontaire des hommes dans tous les moments de l’existence, y compris et surtout dans l’instance de sélection des gouvernants. Le TAS est antipolitique parce qu’il enjambe le travail de conviction par lequel le langage et la raison se trouvent sommés de devenir politiques, c’est-à-dire à la fois mis en partage et transformés en force matérielle. (« Une idée devient une force lorsqu’elle s’empare des masses », écrit Marx.) Il l’est également parce qu’il neutralise la délibération comme foyer de propositions différentes, de programmes opposés et de projets à accomplir, soumis au choix pluriel du grand nombre et dans lesquels la lutte des classes trouve son expression politique — et éventuellement son renversement ou son abolition. Sans représentation, la politique se trouve simplement engloutie par le social : elle disparaît.

(DR)
Le TAS, déclarez-vous, renforcerait l’individualisation de la société ; ses défenseurs estiment au contraire qu’il pousserait chaque citoyen, enfin concerné (ou potentiellement) directement par la chose publique, à s’affirmer comme acteur politique. Pourquoi cette hypothèse ne vous semble-t-elle pas crédible ni cohérente ?
Cette idée d’après laquelle la perspective d’être un jour tiré au sort inciterait les citoyens à s’intéresser à la chose publique n’est pas sérieuse. Sur les 45 millions d’électeurs français, pour une assemblée de 2 000 personnes renouvelées tous les ans, la chance de participer une fois aux affaires dans sa vie est par exemple d’environ 0,004 %. Ridicule. D’ailleurs, je ne constate pas que la perspective d’être un jour appelé à participer à un jury d’assises excite une quelconque passion pour le droit. Par contre, si les campagnes, les bulletins de vote, les partis et le lien de loyauté entre l’élu et l’électeur disparaissent, alors le citoyen se trouvera littéralement démantelé, subissant le jour improbable où enfin il sera tiré au sort — et pour quoi faire ? Il n’en aura plus la moindre idée.
Un ouvrier vous avait pris à partie dans Mediapart : il vous a reproché de nourrir une vision élitiste de l’émancipation politique, de ne pas faire confiance aux masses pour s’administrer elles-mêmes et de perpétuer cette vieille idée d’avant-garde…
« Le tirage au sort exclut toute conflictualité au profit d’une vue simplement gestionnaire, ignorant totalement la dimension disciplinaire qu’elle implique toujours. »
C’est exactement l’inverse ! Comme on constate un essoufflement du mouvement ouvrier, il faudrait dissoudre ses organes et fronts de résistance vacillants plutôt que de les renforcer. Les ouvriers se défendent mal ? Tirons-les aux dés ! C’est justement la doctrine du TAS qui dénie aux classes populaires la faculté de s’organiser pour la conquête du pouvoir. De quelle façon, d’un point de vue théorique, articulez-vous votre critique du TAS avec le néolibéralisme ? C’est très simple. Sur le plan socioéconomique, le néolibéralisme fonctionne autour de la figure ultra-individualiste du winner, atome versatile, somme d’énergies toujours en déplacement, ne s’opposant jamais à rien ni ne s’engageant durablement, sous peine de perdre son employabilité. Sur le plan politique, le néolibéralisme privilégie l’étanchéité de l’administration bureaucratique à l’aléa démocratique, au principe d’incertitude. L’État doit gérer les besoins et contradictions intrinsèques du capitalisme, sans jamais le mettre en cause : c’est la théorie de la fin de l’Histoire de Fukuyama et le « There is no alternative » (TINA) de Thatcher. Les postulats du TAS sont les mêmes. D’une part, toute organisation collective est suspecte, tout mouvement vers le pouvoir signale une attention malsaine, tout militant se trouve en conflit d’intérêts. D’un mot, le TAS sanctifie le désengagement. D’autre part, il affirme que la tâche politique se réduit à résoudre des problèmes concrets de façon pragmatique et consensuelle, au sein d’une assemblée tirée au sort, dépourvue de coloration politique. Autrement dit, le TAS exclut toute conflictualité au profit d’une vue simplement gestionnaire, ignorant totalement la dimension disciplinaire qu’elle implique toujours. Enfin, il peut se trouver une alliance objective entre le capital et le TAS dans le fait qu’une somme d’individus désorganisés et inexpérimentés se manipule ou s’achète bien plus facilement que des militants aguerris et responsables devant des électeurs. D’autant que l’idéologie capitaliste irrigue et enrobe l’ensemble des rapports de production quotidiens : elle est inscrite au plus profond du tissu social et nous sommes tous, spontanément, capitalistes (conditionnés par ses catégories). La vieille rhétorique antipartis (qu’on pense au quant-à-soi « apartidaire » de Simone Weil, théorisé dans sa Note sur la suppression générale des partis politiques en 1940) nourrie par le TAS s’accompagne d’une apologie des formes affinitaires, fluides et en réseaux, qui mène à l’instauration d’une société liquide, dont seule profite l’hyperclasse capitaliste.
Mais David Van Reybrouck, l’auteur de Contre les élections, ne vise-t-il pas juste lorsqu’il dénonce l’obsession des scrutins à venir et l’hypocrisie qu’ils induisent : séduire, mentir, jouer sur le temps, conserver ses places et, au fond, ne rien changer à la donne ?
L’intrigue et la brigue sont constitutives de l’être humain et il est vain de prétendre pouvoir sonder a priori les reins et les cœurs, sauf à restreindre un grand nombre de libertés fondamentales. Il faut plutôt penser un système politique qui convienne à « un peuple de démons », selon le mot de Kant. Un univers où les gens ont intérêt à l’universel — ce qui définit la république de Machiavel. Or, la république est indissociable du principe de publicité, lequel caractérise aussi les candidats aux charges politiques. Quelles contraintes pourraient bien peser sur un anonyme tiré au sort qui, à l’inverse d’un élu, n’a pas d’image à défendre ? Sorti de la toile d’interdépendances tissée par l’élection, il en serait d’autant plus corruptible. Ce sont donc les règles de l’élection qu’il faut resserrer : instauration du référendum révocatoire, stricte égalité des temps de parole dans les médias, stricte égalité des financements publics pour chaque formation politique, renforcement du contrôle opéré sur les dépenses de campagne, même plafond pour tous (ce qui implique de mettre un contrôleur dans chaque équipe de campagne), etc.

(DR)
Vous évoquez un « risque » totalitaire si le TAS était appliqué au sens strict, mais vous n’êtes pas, en revanche, opposé à certaines formes de démocratie directe, et donc à certains changements : lesquels ?
La confusion entre représentativité sociologique et représentation politique, dans la mesure où elle transforme un état de fait en devoir être, comporte effectivement un risque totalitaire. Si le TAS donne un reflet exact de la société et que cela devient un motif de légitimité indiscutable, quelle place alors pour une opposition politique et l’expression de voix dissidentes ? C’est une aggravation de la « tyrannie de la majorité ». Que fait-on par exemple si la majorité sociologique est raciste, ou misogyne ? Jamais les minorités ne pourraient sortir du cercle vicieux de leur oppression. Car pour qu’un intérêt minoritaire en fait devienne majoritaire en droit, il faut qu’il soit reçu puis porté par quelqu’un d’autre, dans un rapport dialectique de médiation-représentation. Tuez les partis, vous aurez l’ordre établi. Concernant la démocratie directe, je pense que les partis peuvent très certainement revoir leurs pratiques — rester connecté en permanence avec la base militante, même pendant l’exercice du pouvoir, par exemple. Que les collectifs de production (les entreprises) doivent évoluer vers des coopératives autogérées. Et qu’il est temps d’instaurer en France une vraie culture du référendum d’initiative populaire.
Portrait de Clément Sénéchal : © Benjamin Boccas
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Jacques Rancière : « Le peuple est une construction », mai 2017
☰ Lire la tribune d’Iñigo Errejón « Podemos à mi-chemin », (traduction), mai 2016
☰ Lire notre entretien avec Manuel Cervera-Marzal : « Travail manuel et réflexion vont de pair », mars 2016
☰ Lire notre entretien avec Emmanuel Daniel : « L’émancipation ne doit pas être réservée à ceux qui lisent », janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec Razmig Keucheyan : « C’est à partir du sens commun qu’on fait de la politique », janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec Stathis Kouvélakis : « Le non n’est pas vaincu, nous continuons », juillet 2015
☰ Lire le texte inédit de Daniel Bensaïd « Du pouvoir et de l’État », avril 2015
☰ Lire notre entretien avec Alain Badiou : « L’émancipation, c’est celle de l’humanité tout entière », avril 2015


