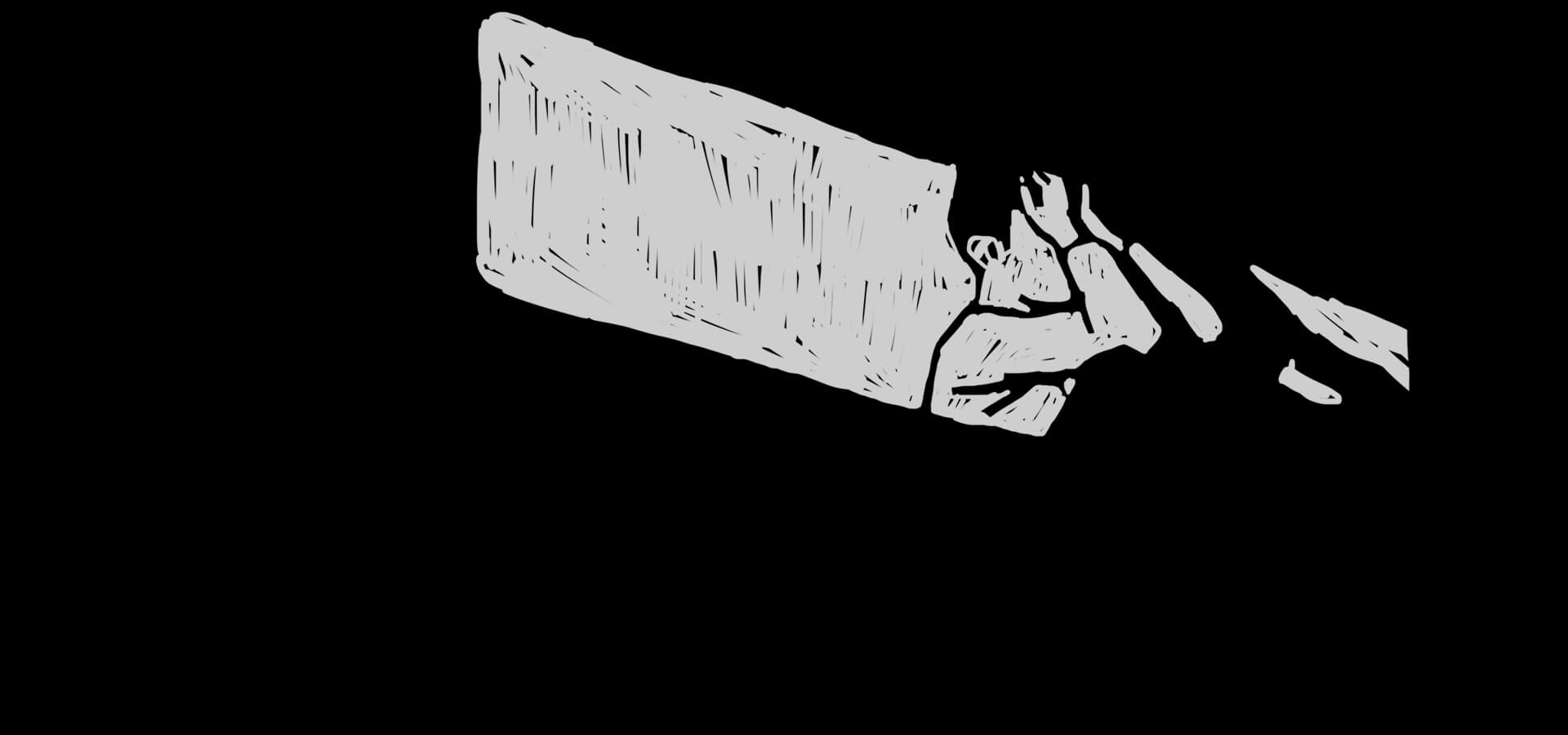Texte inédit pour le site de Ballast
Bruxelles. Nous rencontrons un homme qui connaît depuis 10 ans l’errance, l’invisibilisation et l’oppression propres à la clandestinité imposée. Autour d’une table, il fait le récit — sous couvert de l’anonymat auquel il est contraint — de ce qui se vit derrière les murs des centres fermés de Belgique (équivalents des centres de rétention administrative en France), où sont détenues des personnes en irrégularité administrative de séjour. En 2016, le réseau Migreurop réactualisait une carte des camps d’enfermement d’exilés en Europe : une capacité totale connue de 47 000 places. Une voix comme l’écho de tant d’autres.

« Tu as vraiment l’impression d’être un fugitif ; c’est comme si tu avais commis un crime et que tu fuyais la prison : tu dois vivre en cachette. »
Quand on t’attrape comme ça, même si tu as un recours1 en cours, c’est comme si tout s’annulait parce qu’on te donne un « ordre de quitter le territoire ». On te demande de signer et on t’embarque en centre fermé. Moi, j’avais refusé de signer. On m’a emmené avec trois flics, qui m’avaient demandé sur la route ce que j’avais fait. Quand j’ai répondu « Rien », il y en a un qui avait semblé étonné. Il n’avait rien dit et il me regardait, je crois que c’était bizarre pour lui. Cette première fois, on m’avait libéré rapidement, du monde m’avait soutenu dehors, mon avocat aussi. Mais c’est très dur, c’est pas possible de comprendre ce qui se passe pour quelqu’un à ce moment-là si tu n’as pas subi ça. Imaginez : vous êtes à la maison, ils viennent vous chercher, ils vous menottent et ils vous mettent en prison, alors que vous n’avez rien fait. C’est trop dur, surtout quand tu crois que tu es dans un pays où tous les droits humains sont respectés. Tu comprends alors que quand tu es un réfugié, tu n’as aucun droit. Ils viennent et ils t’attrapent quand ils veulent. Ils peuvent débarquer tôt le matin, à 4 ou 5 heures, alors que tu dors. Ils cognent fort à la porte, tu ouvres et ils te menottent. Ils t’embarquent. Il y a du monde autour de toi et les flics te parlent mal quand ils viennent te prendre. Ils te disent que de toute façon tu vas rentrer chez toi, que tu n’as « rien à foutre ici ». Direct. Je me rappelle la première fois que les flics sont venus, ils sont entrés en me disant « On est venus te chercher ». Je leur avais demandé de me laisser juste le temps de m’habiller et d’éteindre la télé. J’éteins mon ordinateur aussi, je débranche tout et je commence à m’habiller. L’autre, il était déjà furieux. J’étais en train de mettre ma ceinture quand il tire dessus, me la prend de force et la jette à côté. Il me crie « Mets tes mains derrière, nous on n’a pas le temps ! ». J’ai vu qu’il commençait à être violent, je suis parti sans mettre ma ceinture. Ils m’ont embarqué comme ça au commissariat, où ils ont pris mes empreintes, fait des photos, tout, tout de suite. J’ai demandé à appeler un avocat et ils ont refusé. Ils ne te laissent appeler personne.
Quand tu arrives en centre fermé, si ton téléphone a une caméra, on te le retire. Seuls les téléphones sans caméra peuvent entrer, ils ne veulent pas que tu filmes dedans. Si c’est ton cas, alors ils te remettent juste ta puce, et comme ça tu cherches dedans que quelqu’un te prête son téléphone, pour appeler tes proches ou ton avocat. Et ça peut prendre des jours avant que tu puisses le faire. Ce n’est pas eux qui te permettent d’appeler ton avocat, c’est à toi de te débrouiller. Sinon, ils ont des téléphones à vendre dedans, sans caméra ; tu peux leur en acheter un si tu veux et si tu as de l’argent, ça te coûte environ 35 euros. Moi, je ne leur en ai jamais acheté, c’est toujours quelqu’un de dehors qui m’en a apporté un. Quand on peut et qu’on a quelqu’un dehors qui nous aide, on fait comme ça. Mais si tu n’as personne et que tu n’as pas d’argent, ils te disent que tu peux travailler pour eux dedans. Ça peut prendre deux semaines pour réunir les 35 euros. Ils te font nettoyer les toilettes, les chambres, la cuisine. Il y a des professionnels qui viennent pour ça, mais pas assez. Tu nettoies les couloirs, la cour où tu ramasses les mégots de cigarettes, etc. Moi, j’ai refusé de travailler pour eux. Ils te payent avec des tickets, et une fois que t’as beaucoup de tickets, tu peux aller les voir et ils te donnent de l’argent. Comme je n’ai jamais voulu, je ne sais pas combien ils payent, mais je crois que ça doit être autour de 50 centimes de l’heure. Les gens qui fument beaucoup font ça pour avoir des cigarettes.

Illustration : Hélène Aldeguer
La deuxième fois, ils m’ont embarqué à Liège, ils m’ont gardé deux semaines. On était quatre dans la chambre, sur des lits superposés. J’étais avec un Mauritanien, un Sénégalais et un Congolais. La dernière fois où ils m’ont enfermé, on était 20 par chambre, dans des dortoirs, comme une caserne militaire. Il y avait 10 lits superposés, une seule toilette et pas de douche. Là où j’étais, tu pouvais te doucher deux fois par semaine, à 7 heures du matin. Ou sinon, tu allais à la salle de sport parce qu’après le sport, on te laisse te doucher. Tous les matins, à 7 heures, ils allument la lumière, avec des lampes fortes. Tu entends un bruit, « PAM ! », tellement fort que ça te réveille tout de suite, que tu le veuilles ou non. Ils entrent, et avec des bâtons, ils tapent sur les lits, en criant « Levez-vous, levez-vous, levez-vous ! ». T’es obligé de te lever. T’es ensuite obligé d’aller au réfectoire. Même si tu ne manges pas, tu dois rester avec eux là-bas. Après, tu sors dans la cour pour trente minutes ou une heure. Puis on te met dans une salle, tout le groupe, pour toute la journée et tu n’as plus le droit de sortir. Tout est organisé par groupe, avec les 20 personnes d’une chambre. Les gens des autres groupes, tu ne les vois jamais, tu peux juste les entendre. Mais tu sens qu’il y a beaucoup, beaucoup de groupes ; des groupes de femmes qui sont à part, aussi. Mais on ne peut pas se voir. Chaque groupe passe à tour de rôle dans la cour pour la récréation. Nous, on était dans une pièce au deuxième étage, on voyait les autres groupes par la fenêtre, passer en bas dans la cour. C’est pareil pour le passage en cuisine, c’est un groupe après l’autre, on ne peut jamais croiser les autres. Ils font tout pour qu’on ne se rencontre pas. Ils ne veulent pas nous regrouper, pour que ça ne pète pas. Les gens, s’ils sont nombreux, ils pourraient se jeter sur les gardiens. Si on est 100 ou 200 ensemble, on pourrait faire quelque chose. Et puis il y a aussi des bagarres entre les gens, parce qu’il y a des personnes agressives, des gens qui ont déjà fait de la prison. C’est dur d’être mélangé avec des criminels, si on nous met tous ensemble, c’est qu’ils nous considèrent tous pareils.
« C’est pareil pour le passage en cuisine, c’est un groupe après l’autre, on ne peut jamais croiser les autres. Ils font tout pour qu’on ne se rencontre pas. Ils ne veulent pas nous regrouper, pour que ça ne pète pas. »
Quand des gens se bagarrent, ils sont sanctionnés. On les isole. On m’a mis en cellule d’isolement une fois, c’était terrible. J’ai fait des cauchemars toute la nuit, je ne voulais plus dormir là-bas. La première chose qui m’avait choqué, c’est qu’il y avait la toilette, pleine, qui puait, juste à côté du lit. Là-bas aussi, il faut les appeler pour tirer la chasse, et ils le font s’ils le veulent. Il n’y a pas de fenêtre ; quand ils éteignent la lumière, il fait un noir total. La veille de ton jugement en justice, tu es emmené en isolement, à chaque fois, et c’est pareil pour tous. Ils ne te laissent pas dormir avec les autres détenus. Pareil les veilles d’expulsion. C’est leur tactique, ils te séparent du groupe. Puis ils viennent tôt le matin, vers 5 heures, ils te réveillent et ils te menottent pour t’emmener soit au tribunal, soit à l’aéroport. J’ai beaucoup réfléchi à ça, à me demander pourquoi ils font ça. Je me suis dit que c’est peut-être pour ne pas déranger l’esprit des autres détenus, pour qu’ils ne se révoltent pas. J’ai encore un ami dedans, ça fait un mois qu’il y est. Son avocat lui demande toujours de l’argent. Il paye, il paye, il paye. Il prend des crédits avec des gens pour payer son avocat. Je lui ai dit que ça n’allait pas, que ce n’était pas normal qu’il lui demande autant d’argent. Son avocat sait qu’il ne travaille pas, qu’il n’a aucun revenu. Récemment, il m’a demandé d’aller le voir, justement, j’y suis allé et il m’a dit : « Faut encore payer ». J’ai dit : « Payer quoi ? », il m’a dit : « Dis-lui de payer encore. – Il n’a pas les moyens, comment il va payer encore ? – Il a des amis. ». Il disait que pour passer encore un jugement, il fallait donner de l’argent. C’est de l’arnaque, ça : à chaque procédure il lui demande 500 euros. J’en ai entendu d’autres, des cas comme ça, même avec des gens qui ont des avocats en pro deo2, mais qui leur demandent quand même de l’argent. La nuit que j’avais passée en isolement, c’était si terrible que j’avais demandé à voir le psychologue. Je lui avais dit que je ne pouvais pas rester dedans, sinon j’allais me suicider. J’avais eu tellement peur la nuit, je m’étais réveillé après un cauchemar terrible et j’étais resté comme ça, tétanisé dans le noir jusqu’à ce qu’ils allument la lumière le matin. Tu sais pas quelle heure il est quand tu es dedans, on te prend ta montre aussi à ton arrivée. On m’avait mis en isolement parce que je m’étais plaint de la chambre où j’étais, parce qu’il y avait trop de monde et que certains fumaient — mon lit était juste à côté des toilettes, où les gens allaient fumer la nuit. J’ai expliqué que je ne supportais pas la fumée, ni les cris des gens toute la nuit. Alors un jour, ils m’ont dit qu’il y avait une chambre où je pouvais dormir tout seul. J’étais content, mais quand j’ai vu ce que c’était, je ne l’étais plus. C’était bizarre… (silence)
Au centre fermé, tu as un numéro. On ne t’appelle pas par ton nom, ça m’a choqué ! On est au temps des nazis ou quoi, où on appelait les gens par des numéros ? On était au réfectoire, ils étaient venus contrôler qu’on était tous là. Le gardien vient avec sa feuille et il appelle les gens par un numéro. Celui qu’on m’avait donné, c’était A12, « A » étant le nom donné au compartiment où on était, et moi j’étais le 12. Il crie « A1, A2, A3… » et les gens répondent « Présent ». Arrive A12, et moi je ne l’ai même pas regardé, j’étais furieux. Il répète « A12 ! ». Il savait bien que c’était moi ; il s’arrête juste devant moi, il me regarde et il crie « A12 ! ». Je ne réponds rien. Mon collègue à côté de moi me tape dans le dos et me dit : « Hé, c’est toi qu’on appelle ! » Je lui dis : « Non, je ne m’appelle pas A12. Qu’il m’appelle par mon nom ». Et là, le gardien me dit : « Monsieur, ce n’est pas vous ? – Non, ce n’est pas moi. – Ah bon, A12 ce n’est pas vous ?? » Je lui ai dit : « Regarde le nom qui est écrit devant A12, ça c’est mon nom. Si tu ne m’appelles pas par mon nom, je ne réponds pas. » Alors il a menacé de me sanctionner si je ne répondais pas. J’ai tenu bon. Puis ses collègues sont venus et lui ont dit de me laisser. Il s’est éloigné, mais il a continué de me fixer longtemps. Quand nos regards se sont croisés, il m’a fait le signe du couteau sous la gorge. Ils ont continué de m’appeler « A12 » à chaque fois, j’en revenais pas. C’est bizarre, ils ont des tactiques qui ne changent jamais. Ils ont ton nom écrit sous les yeux, mais ils vont t’appeler par un numéro. Même quand ils viennent chercher quelqu’un dans la cellule, ils l’appellent par un numéro. J’avais un ami avec qui j’avais été enfermé — lui a été expulsé ; un jour, il m’a appelé pour me donner des nouvelles. Quand j’ai décroché, il m’a appelé par mon numéro. Sans doute pour me rappeler ces événements passés, mais moi, tout ce que je voulais, c’était oublier. Ça m’a fait mal.

Illustration : Hélène Aldeguer
J’étais surpris de voir le nombre de personnes qui y travaillent. Tout ce monde pour garder des gens qui n’ont rien fait. Les salaires de tous ces gens, ça vient d’où ? Pour aller manger, il y a deux hommes à la porte qui vous comptent après vous avoir mis en rang. Les gardiens disaient souvent « Rentrez chez vous, vous n’avez rien à foutre ici ! ». Un jour, une gardienne a dit ça et un homme, albanais je crois, ne comprenait pas ; il lui a demandé « Why do you say that3 ? ». Elle était jeune, elle devait avoir entre 25 et 30 ans. On se demande pourquoi ils sont si nombreux à avoir cet esprit raciste. C’est comme s’ils avaient tous eu un lavage de cerveau et qu’ils suivaient le pas. Je ne comprends pas qu’on appelle ça des « centres ». C’est quoi un lieu où on t’enferme, à 20 par chambre, où on te réveille le matin à 7 heures, où on te surveille littéralement à chaque instant, et où tu n’as le droit de sortir prendre l’air que pendant une heure par jour, ce regard toujours sur toi ? Ce sont des prisons. Les gardiens, on se dit que ce sont des flics qui ont été formés à être gardiens. T’en vois pas mal qui sont âgés. Ils ne te laissent pas filmer dedans, c’est difficile aussi d’y entrer… Ils ne veulent pas que la population sache ce qu’il s’y passe. Pour les visites, les gens se manifestent à l’accueil en s’étant enregistrés à l’avance. De l’intérieur on appelle ton numéro, après il y a un gardien qui te conduit dans le réfectoire — c’est là que se font les visites. Après chaque visite, ils te fouillent, jusqu’à l’intérieur de tes chaussures, avant de te ramener dans ta cellule. Ils retirent leur téléphone aux visiteurs aussi. Et eux ne peuvent voir que la cuisine, tous les autres espaces leur sont interdits, même à ton avocat. Personne ne voit le reste de la prison. Il y aurait tellement de choses à raconter. Elles me reviennent en mémoire petit à petit. (silence) J’ai vu dedans des gens qui finissent complètement dérangés, qui hurlent, qui se cognent la tête contre les murs. Des femmes beaucoup, c’est difficile surtout pour elles, encore plus quand c’est la première fois que ça leur arrive. Tu les entends crier fort, depuis leur cellule d’isolement. La nourriture aussi c’est dur, c’est souvent des genres de tartines de beurre et de fromage, matin et soir.
« C’est quoi un lieu où on t’enferme, à 20 par chambre, où on te réveille le matin à 7 heures, où on te surveille littéralement à chaque instant, et où tu n’as le droit de sortir prendre l’air que pendant une heure par jour ? »
La chose la plus difficile en Europe, c’est pas tant d’être en centre fermé, c’est d’être sans-papiers. C’est terrifiant. Tu ne marches jamais tranquille dans la rue. On ne peut pas vivre avec la peur pendant 10 ans ou plus. C’est le plus difficile, la peur au ventre pendant des années. Même si t’as mangé quelque chose, c’est comme si t’avais le ventre vide, un trou de peur. Ça fait mal à la tête aussi. C’est pas tout le monde qui peut supporter ça. Tu fuis des problèmes et tu en trouves d’autres ici, parfois plus difficiles à supporter. Parce que ça dure longtemps, que tu ne sais pas quand ça va s’arrêter. T’es comme dans une prison tout le temps. Un réfugié qui marche sans papiers, il est dans une prison. Il est traqué tout le temps. Tu sais, ils ne vont jamais fermer les centres fermés. Dès que ça se vide, ils les remplissent avec d’autres personnes. Trop de gens y travaillent, ils feraient quoi, ils gagneraient comment leur vie s’il n’y avait plus de réfugiés à enfermer ? (rires) Alors ils te traquent. Parfois, ils t’interpellent, mais comme le centre fermé est saturé et qu’il n’y a plus de places, ils te laissent (ça, c’est les jours de chance). S’il y a une place, t’es cuit. Tout ça, c’est politique. Ils ont des budgets avec leur politique d’immigration, alors il faut bien qu’ils montrent qu’ils font quelque chose avec cet argent, qu’ils travaillent. Les expulsions coûtent vraiment beaucoup d’argent : les billets, les gardiens qui doivent t’encadrer, les centres fermés. Je pense que c’est pas la solution de dépenser tout cet argent-là. Ils ne finiront jamais d’expulser les gens. On dirait qu’ils n’ont pas de cerveau ! Ils se disent qu’en expulsant des gens, ils vont décourager les autres qui voudraient arriver, mais ça ne marche pas. Ils font semblant de travailler, ils se créent du boulot. Un centre fermé ne peut pas travailler à vide : ils feraient quoi tous ces médecins, ces assistants, ces éducateurs, s’il n’y a pas de réfugiés ? L’éducateur veut éduquer qui là-bas ? Quand j’y étais, on me disait que je pouvais voir l’éducateur, mais je ne voyais pas pourquoi. On a le même âge, et il vient me proposer de jouer. (rires) Ça sert à rien. Il venait nous proposer des jeux dans la salle en nous disant que celui qui gagnerait aurait un verre de coca. Non mais ils blaguent avec les gens ! (rires) C’est n’importe quoi, c’est pas normal, ça…
Même ceux qui travaillent là-bas sont frustrés, tu sens qu’ils ne sont pas à l’aise de travailler dans un tel lieu. Tu le vois dans leur regard. Comment tu peux avoir du bonheur quand tu travailles avec des misérables ? Le bonheur, tu l’as quand c’est partagé. Je ne pense pas que tu puisses te sentir bien dans ta peau, dans ta vie, dans ton foyer quand tu fais ce genre de travail. Mais ils sont sans doute obligés de le faire pour trouver des sous, pour pouvoir vivre. Je me dis que s’ils pouvaient trouver un autre travail, ils n’accepteraient pas celui-ci. J’avais remarqué qu’en cuisine c’étaient que des étrangers qui y travaillaient, je pense que les autres n’ont pas accepté. C’est pareil avec les équipes de nettoyage. C’est difficile pour les étrangers de trouver du boulot, alors ils prennent ce qu’ils trouvent. Et puis, tu vois qu’ils s’en foutent de ce qui t’arrive là-bas. Ils font leur boulot et ils s’écartent. Moi je ne pourrais jamais travailler là, je ne supporterais pas de voir ce qu’ils font aux gens. Je préférerais rester sans travail que faire celui-ci. En prison, je peux comprendre, là au moins tu peux te dire que les gens ont commis une faute grave. Alors que dans le centre fermé, tu es innocent, tu n’as rien fait, à personne. C’est ce qui fait le plus mal. Je préférerais faire 10 ans de prison pour une faute que j’aurais commise ! Je supporterais 10 ans d’enfermement, je purgerais ma peine consciencieusement. Quand tu sais que tu as fait du mal à quelqu’un, tu assumes. Alors que là, même une journée, c’est insupportable. Plus que l’enfermement, c’est l’injustice que tu ressens qui est le plus dur. C’est comme ceux qui se font accuser à tort du crime d’un autre, que le juge ne veut rien savoir et qu’il te condamne à de la prison. Ça fait mal. La dernière fois qu’ils sont venus me prendre chez moi, j’ai dit au flic : « Écoute, ça fait des années qu’on se connaît, qu’on se croise dans le même quartier. Tu sais que je n’ai rien fait, pourquoi tu fais ça ? » Il m’a répondu : « Je fais mon boulot. » Je lui ai dit : « Ouais, fais ton boulot mais fais-le bien. Va arrêter ceux qui dealent là-bas, tu les connais, tu sais ce qu’ils font et tu passes à côté tous les jours, sans rien faire. » Et il vient m’arrêter moi, chez moi, à l’aube. Je ne comprends pas.

Illustration : Hélène Aldeguer
Toutes les illustrations sont de Hélène Aldeguer pour Ballast.
- En référence à toute procédure juridique d’appel à une décision administrative ayant refusé de délivrer un titre de séjour.[↩]
- Équivalent en Belgique de l’aide juridictionnelle.[↩]
- « Pourquoi dites-vous ça ? »[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec le Gisti : « Droit d’asile : ça se durcit d’année en années », novembre 2017
☰ Lire notre article « Patrick Communal — Le droit au service des laissés-pour-compte », décembre 2016
☰ Lire notre témoignage « Ne pas laisser de traces — récit d’exil », Soufyan Heutte, juillet 2016
☰ Lire notre article « Réfugiés : au cœur de la solidarité », Yanna Oiseau, mai 2016
☰ Lire notre article « Crise des réfugiés : ce n’est pas une crise humanitaire », Yanna Oiseau, mai 2016
☰ Lire notre témoignage « Hosni, banlieusard », février 2015