Traduction d’un article de ROAR pour Ballast
L’écologie est anticapitaliste ou elle n’a rien d’écologique : la chose commence à se savoir. Entre 1990 et 2015, les 10 % les plus riches de la population mondiale ont ainsi été responsables de 52 % des émissions de CO2 cumulées. Cent entreprises sont quant à elles responsables de 70 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Jaskiran Dhillon, militante, enseignante en anthropologie et autrice de Prairie Rising: Indigenous Youth, Decolonization, and the Politics of Intervention, a grandi en territoire autochtone cree, au Canada. « Nous ne pouvons pas améliorer la situation en promouvant de meilleurs choix de consommation qui privilégient le changement de comportement individuel », rappelle-t-elle dans ce texte, que nous traduisons. Elle invite à l’élargissement de la compréhension du péril climatique et à la formation d’alliances et de coalitions anticapitalistes, anti-impérialistes, antiracistes et féministes. Autrement dit, à réfléchir aux possibilités d’une transformation globale et populaire.

Les températures les plus élevées jamais enregistrées dans le nord-ouest des États-Unis et dans l’extrême sud-ouest du Canada sont apparues au cours de l’été 2021 avec la force d’un siège invisible, avançant au ralenti. Les météorologues qui suivaient la montée silencieuse de cette vague de chaleur ont diffusé des cartes peintes en nuances cramoisies, alertant le public endormi d’un été devenu rouge flamboyant. […] Créé par un système de haute pression qui fait que l’atmosphère piège l’air très chaud — et précipité, en partie, par la chaleur émergeant d’océans se réchauffant de plus en plus —, un dôme de chaleur produit des températures extrêmes au niveau du sol, lesquelles peuvent persister durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
« Mais ce type de chaleur n’est pas seulement perceptible dans l’air que nous respirons : elle enveloppe tout ce qu’elle touche. »
En Colombie-Britannique, au Canada, les thermomètres ont enregistré une température alarmante de 49,6 °C, avec des pics similaires dans les États de Washington et de l’Oregon, immédiatement au sud de la frontière, exposant les résidents étasuniens et canadiens au genre de phénomènes météorologiques extrêmes que les pays du Sud connaissent depuis des années. Mais ce type de chaleur n’est pas seulement perceptible dans l’air que nous respirons : elle enveloppe tout ce qu’elle touche, laissant une traînée de mort et de destruction. Et des questions urgentes sur l’avenir.
Pour les climatologues qui ont étudié l’intensification des vagues de chaleur au cours de la dernière décennie, les conséquences du dôme de chaleur ont été, comme prévu, dévastatrices. Le British Columbia Coroners Service a recensé 569 décès liés à la chaleur entre le 20 juin et le 29 juillet 2021, dont 445 sont survenus pendant le dôme. Un corps humain exposé à une chaleur intense et incessante est un corps sous contrainte, un corps qui fait des heures supplémentaires : lorsqu’il est soumis à une élévation de la température de l’air, notre corps attire davantage de sang vers la peau pour dissiper la chaleur — un système de refroidissement naturel développé pour maintenir une température corporelle optimale. La consommation d’oxygène et le métabolisme s’intensifient, entraînant une accélération du rythme cardiaque et une respiration rapide. Au-delà de 42 °C, la production d’enzymes et d’énergie est mise en échec et le corps risque de développer une réponse inflammatoire systémique. Jusqu’à une possible défaillance de plusieurs organes. Les humains ne sont pas les seuls êtres à avoir été affectés. Selon un article publié dans The Atlantic en juillet 2021, des milliards de moules, de palourdes, d’huîtres, de bernaches, d’étoiles de mer et d’autres espèces intertidales sont également mortes. Un certain nombre d’espèces terrestres ont également souffert, se repliant sur elles-mêmes dans l’air étouffant et suffocant : le récit dystopique d’une « faune désespérée et mourante ». […]
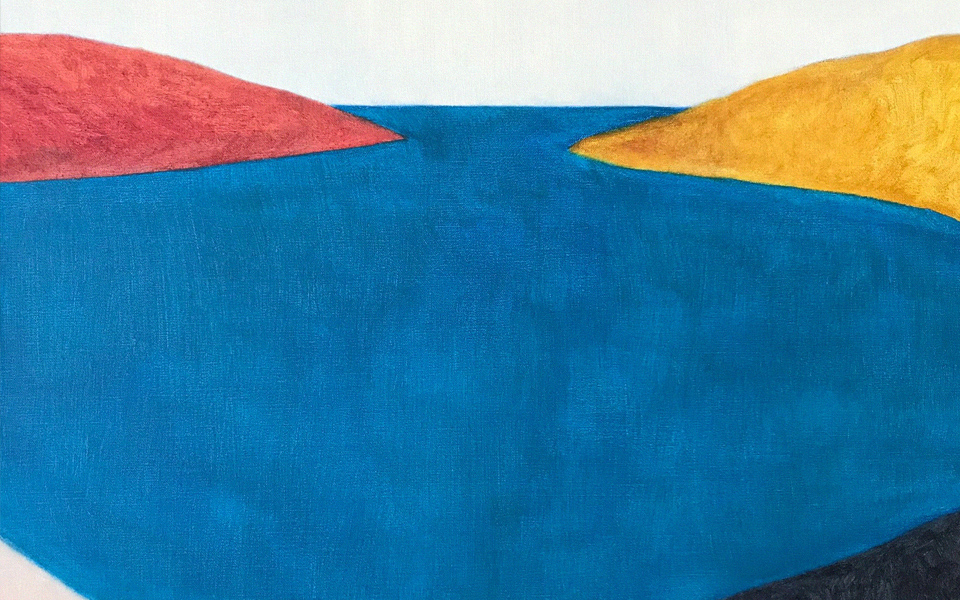
[Guim Tió Zarraluki]
Un profond déséquilibre du pouvoir
Comment en sommes-nous arrivés là ? Une première analyse de ce dôme de chaleur menée par une équipe mondiale de scientifiques a révélé que l’apparition de ce type de vague de chaleur était quasiment impossible sans changement climatique d’origine humaine. Leurs résultats étaient accompagnés d’un avertissement clair : « Le réchauffement rapide de notre climat nous entraîne sur un terrain inconnu avec des conséquences majeures pour la santé, le bien-être et les moyens de subsistance. S’adapter et poser des limites est nécessaire de toute urgence pour préparer les sociétés à un avenir très différent. » La situation semble devoir s’aggraver — trois milliards de personnes pourraient vivre dans des endroits aussi chauds que le Sahara d’ici 2070, à moins que nous ne nous attaquions au changement climatique par des mesures radicales. Et que nous le fassions maintenant. Le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), publié en août 2021, brosse un tableau tout aussi grave de notre réalité climatique actuelle et des prévisions pour l’avenir. Dans une démarche courageuse, et en opposition avec les gouvernements nationaux qui se sont chargés par le passé de rendre public les conclusions de ces évaluations, un groupe de scientifiques a divulgué la troisième partie du rapport qui révèle, en termes non équivoques, comment les industries fossiles soutenues par de nombreux gouvernements sont parmi les plus grands responsables de notre état environnemental actuel. Elles exposent également ce qui doit être fait afin de changer de cap.
« Trois milliards de personnes pourraient vivre dans des endroits aussi chauds que le Sahara d’ici 2070, à moins que nous ne nous attaquions au changement climatique par des mesures radicales. »
Le rapport rappelle que les activités humaines ont conduit au réchauffement du climat à un rythme sans précédent depuis au moins deux millénaires, et qu’il existe une relation quasi linéaire entre les émissions cumulées de CO2 d’origine anthropique et le réchauffement planétaire qu’elles provoquent. Cela signifie que nous n’attendons plus l’arrivée du changement climatique : il est là. Il vit dans l’air chaud et étouffant que nous respirons pendant les vagues de chaleur imprévues. C’est la raison pour laquelle les sécheresses sont de plus en plus graves et que, dans le même temps, les inondations plongent des millions de personnes dans le chaos, la précarité et les contraignent à se déplacer. Cela explique pourquoi la glace de l’Arctique a atteint son niveau le plus bas depuis au moins 1850. L’acidification des océans trouve là aussi son origine. Et c’est le moteur de conditions environnementales qui devraient entraîner l’apparition de 200 millions de migrants climatiques au cours des trente prochaines années. Nous n’avons pas besoin de plus de preuves. La science ne pourrait être plus claire.
La réponse à la question de savoir comment nous en sommes arrivés là ne peut cependant pas être réduite à un scénario homogène du type « tout le monde est à blâmer » — lequel ne ferait guère la différence entre la façon dont des pays comme les États-Unis et d’autres nations occidentales ont produit la grande majorité des émissions de carbone qui ont conduit à ce désastreux changement planétaire. Les États-Unis ont davantage contribué au problème de l’excès de dioxyde de carbone que n’importe quel autre pays de la planète. L’empreinte carbone la plus importante est bien celle des classes aisées : plus le revenu du ménage est élevé, plus les émissions sont importantes. De fait, un article de Scientific American explique que les États-Unis, avec moins de 5 % de la population mondiale, utilisent environ un quart des ressources mondiales en combustibles fossiles — brûlant près de 23 % du charbon, 25 % du pétrole, et consommant environ 27 % de l’aluminium et 19 % du cuivre.

[Guim Tió Zarraluki]
Un récent rapport d’Oxfam, intitulé Confronting Carbon Inequality, fournit des révélations stupéfiantes sur la façon dont les corrélations entre la richesse et les émissions de carbone s’étendent au contexte mondial : les 1 % les plus riches de la planète sont responsables d’émissions équivalant à plus du double de celles de la moitié la plus pauvre de l’humanité, et les 10 % les plus riches du monde sont responsables de plus de la moitié de toutes les émissions. […] [L]es entreprises mondiales qui se consacrent au développement et à l’expansion des infrastructures énergétiques à base de combustibles fossiles constituent également une part importante, si ce n’est la plus importante, du problème. Si l’on va encore plus loin, il apparaît que la relation entre le capitalisme racial, le colonialisme et le changement climatique se trouve au cœur d’une compréhension critique de l’Anthropocène : ce sont le colonialisme et le capitalisme qui ont jeté les bases du développement d’économies à forte intensité d’émissions de carbone, donnant la priorité à l’accumulation capitaliste (sous toutes ses formes destructrices) au détriment de tout le reste.
« Les dirigeants indigènes du monde entier tirent la sonnette d’alarme sur l’écocide imminent résultant du cycle sans fin de l’extraction et de la consommation. »
Comme l’explique le philosophe potawatomi Kyle Whyte, à propos de l’expérience spécifique des peuples indigènes de l’île de la Tortue, « l’invasion coloniale qui a commencé il y a des siècles a provoqué des changements environnementaux anthropogéniques qui ont rapidement perturbé de nombreux peuples indigènes — notamment la déforestation, la pollution, la modification des cycles hydrologiques et l’amplification de l’utilisation du sol et de la terraformation pour des types particuliers d’agriculture, de pâturage, de transport et d’infrastructures résidentielles, commerciales et gouvernementales ». Ces critiques ne sont pas nouvelles : les dirigeants indigènes du monde entier tirent la sonnette d’alarme sur l’écocide imminent résultant du cycle sans fin de l’extraction et de la consommation depuis aussi longtemps que des colonies de peuplement comme les États-Unis existent. Ils nous ont également rappelé que d’autres types de mondes sont possibles : des mondes construits sur le soin, la réciprocité, l’interdépendance et la coexistence, par opposition à la violence structurelle, la dépossession et la domination.
Il n’est donc pas surprenant qu’une structuration sociale, politique et économique de notre monde ancrée dans le colonialisme et l’impérialisme ait entraîné des disparités massives avec des conséquences disproportionnées — la race, la classe et le genre sont profondément liés à l’expérience et à la violence de la catastrophe climatique. Dans le Sud global, la crise a produit des événements climatiques mortels dans de nombreux pays depuis plus d’une décennie, précédant de plusieurs années l’arrivée notable du dôme de chaleur aux États-Unis et au Canada au cours de l’été 2021. Au Soudan, par exemple, les températures ne cessent d’augmenter, l’eau se raréfie et les sécheresses sévères sont devenues monnaie courante, produisant des problèmes majeurs quant à la fertilité des sols et à l’agriculture. L’Afrique australe se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète : la seule année 2019 a vu 1 200 décès liés au climat. Le Bangladesh, souvent qualifié de « point zéro du changement climatique » alors qu’il n’a contribué qu’à hauteur de 0,09 % aux émissions mondiales cumulées de CO2, a connu une forte augmentation des inondations qui ont entraîné la destruction de millions de maisons, créé de nombreux obstacles à la production agricole et provoqué une escalade alarmante de l’insécurité alimentaire. […]

[Guim Tió Zarraluki]
Un cadre de travail internationaliste
Face à des projections aussi sombres et dévastatrices, le piège du désespoir semble être l’issue la plus facile. Des millions de personnes à travers le monde n’ont pourtant pas la possibilité du refuge ou du déni — et si nous pensons à long terme, aucun d’entre nous ne l’aura. Comment ceux d’entre nous qui sont déterminés à agir sur le changement climatique pensent-ils au renouvellement de la solidarité mondiale et des mobilisations de masse dans ce moment historique où tout est en jeu ? Quelles sont les lignes directrices politiques qui devraient être au cœur de l’activisme climatique ? Nos mobilisations autour du changement climatique et de la justice environnementale doivent être guidées par un cadre internationaliste à la fois anticolonial et anticapitaliste.
« Nos mobilisations autour du changement climatique et de la justice environnementale doivent être guidées par un cadre internationaliste à la fois anticolonial et anticapitaliste. »
[…] À cet égard, nous pouvons nous inspirer des mobilisations de la jeunesse pour le climat. À Philadelphie, par exemple, les activistes de Youth Climate Strike ont manifesté dans les rues tout en se référant à l’internationalisme — en reliant les luttes pour la justice environnementale dans les quartiers où ils vivent avec les dévastations occasionnées par la crise climatique dans le Sud global. L’organisation transcende les frontières géographiques : considérant que la catastrophe climatique est, en grande partie, produite aux États-Unis, Youth Climate Strike exige que, dans le Nord global, nous ouvrions les yeux et prenions nos responsabilités au niveau local, dans nos communautés, ainsi qu’à l’égard du reste du monde. Cependant, un cadre internationaliste doit également mettre en avant une analyse critique de la façon dont le capitalisme racial continue à faire des ravages sur la planète. Des pays comme les États-Unis font en effet partie d’une constellation beaucoup plus large de projets impérialistes produisant d’importantes souffrances, provoquant des morts catastrophiques et remodelant les écologies et les modes de relation afin de faciliter le mouvement du capital. Les zapatistes le savaient en 1994, lorsqu’ils ont fait leur « Première déclaration de la jungle lacandone ». Les Sioux de Standing Rock s’y sont opposés lorsqu’ils ont lancé leur bataille épique contre le Dakota Access Pipeline en 2016. Et les communautés de Guyane s’y opposent en s’organisant en réponse à l’expansion de l’extraction pétrolière d’Exxon qui prévoit d’envoyer plus de deux milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
Alors que l’on s’organise pour le climat, une autre raison concourt à rendre ce cadre internationaliste et anticolonial si vital : l’impérialisme va de pair avec la destruction environnementale. En d’autres termes, les projets impérialistes tels que l’occupation coloniale de l’Afghanistan par les États-Unis pendant vingt ans ont non seulement laissé d’innombrables citoyens afghans dans une situation d’immense danger et de précarité depuis le retour des Talibans, mais ont également laissé le pays dans un état de délabrement environnemental. Cette destruction est particulièrement visible dans la déforestation rampante, qui a proliféré dans les turbulences d’une si longue guerre, et dans l’augmentation des polluants atmosphériques toxiques qui ont été libérés par les forces armées américaines en brûlant des déchets — et d’autres activités militaires — et qui rendent les Afghans chroniquement malades, en augmentant le risque de cancer et d’autres maladies. Les bases militaires désaffectées doivent également faire l’objet d’un assainissement environnemental avant que les terres puissent être utilisées pour donner la vie au lieu de la prendre.

[Guim Tió Zarraluki]
Un récent rapport du projet « The Cost of War » de l’université Brown confirme que les États-Unis dépensent plus pour l’armée que n’importe quel autre pays du monde — nettement plus que les dépenses militaires combinées de la Russie et de la Chine. L’utilisation de la force militaire nécessite une grande quantité d’énergie, dont la majeure partie sous forme de combustibles fossiles. En raison de cet engagement monstrueux en faveur de la militarisation, la machine de guerre américaine est l’un des plus grands pollueurs de la planète, et ces dégâts cataclysmiques s’étendent aux autres projets coloniaux soutenus par l’argent des contribuables américains. Le réseau de financement de la guerre lie les États-Unis et le Canada à l’Afrique, au Moyen-Orient, à l’Amérique du Sud, à l’Asie, bref, à tous les endroits où se déplace le capital financier international. Les milliards de dollars qui ont servi à soutenir l’armée israélienne, par exemple, ont causé une importante destruction de l’environnement en Palestine. Les bombes et autres armes mortelles sont destinées à détruire, pas à construire. Et les séquelles de cette destruction continuent d’avoir un impact sur l’air, la terre, l’eau, les plantes, les animaux et les personnes qui ont vécu dans des conditions de guerre pendant des années, même lorsqu’une guerre prend ostensiblement fin ou qu’une force d’occupation se « retire ». Cela signifie qu’un mouvement de justice climatique solide doit nécessairement inclure la démilitarisation pour qu’un programme internationaliste de justice écologique et de durabilité puisse être réalisé.
Construire des coalitions féministes multiraciales et anticoloniales
« Les milliards de dollars qui ont servi à soutenir l’armée israélienne, par exemple, ont causé une importante destruction de l’environnement en Palestine. »
Cependant, pour que l’internationalisme se concrétise dans les espaces et les lieux de l’activisme autour de la question climatique, les coalitions doivent également faire partie de la réponse. Ceux d’entre nous qui sont les plus privilégiés ont la responsabilité de mener le travail difficile de construction des coalitions féministes multiraciales et anticoloniales entre différents mouvements sociaux collaborant au-delà des frontières politiques et géographiques — des coalitions qui abordent conjointement ces différentes questions, favorisent la réflexivité et nous permettent de mieux nous comprendre, de déchiffrer les façons dont nos mondes se sont coconstitués à travers une série d’expériences vécues et de relations matérielles historiques. Le capitalisme racial, tel qu’il est alimenté par les projets coloniaux et impérialistes, s’immisce en chacun de nous. Il s’enracine même dans les pratiques sociales et les manières d’être les plus anodines en apparence ; il façonne nos mémoires collectives et individuelles qui nous définissent. Essentiellement, il joue avec ce que signifie être humain — comment nous développons des relations les uns avec les autres et avec le monde qui nous entoure, comment nous mangeons, respirons et aimons.
[…] Un aspect crucial du mouvement pour la justice climatique devrait dès lors consister à créer des plateformes où les gens peuvent s’engager dans des débats et des dialogues sur le pouvoir et l’histoire dans leurs efforts de mobilisation quotidiens. Grâce à ces interactions, les gens peuvent relier leurs positions sociales et leurs expériences d’oppression, de marginalisation et de résistance tout en étant attentifs aux spécificités des luttes particulières. Cela fait écho à l’appel de l’universitaire et militante afro-caribéenne Jacqui Alexander aux féministes de couleur à « se familiariser avec l’histoire des autres », et à celui d’Angela Davis, féministe radicale noire, en faveur des « coalitions improbables ». […] Nous pouvons ainsi commencer à appréhender des liens entre les questions sociales et les communautés du monde entier, souvent considérées comme séparées et éloignées les unes des autres, et inciter ceux du Nord global à ajuster leurs efforts d’organisation, de mise en réseau et de construction de plateformes de manière à aborder ces inégalités de façon pratique pour commencer à changer la dynamique du pouvoir.

[Guim Tió Zarraluki]
Peu importe où ces coalitions voient le jour, les dirigeants autochtones doivent y jouer un rôle fondamental, compte tenu de l’histoire mondiale de la dépossession des terres et des occupations coloniales en cours, et parce qu’ils offrent des conseils essentiels et ouvrent des perspectives anticolonialistes. […] Ce que nous gagnerons peut-être de ces coalitions féministes, multiraciales et anticoloniales, c’est une architecture de la décolonisation et une pratique de la solidarité qui produiront de nouvelles écologies politiques reflétant ce moment historique. Cette architecture, en retour, pourrait mettre en lumière les points d’alignement et d’intersection, permettant ainsi l’identification d’objectifs politiques communs et ouvrant la voie à une unification globale à travers des géographies sociales et historiques distinctes. […]
Un plan d’action révolutionnaire
« Nous avons besoin d’un plan d’action révolutionnaire qui soit généré par un mouvement populaire mondial. »
[…] [N]ous devons être honnêtes avec nous-mêmes quant aux responsabilités que nous portons et être prêts à modifier la compréhension que nous avons des problèmes auxquels nous sommes confrontés ; en retour, nous devons être prêts à modifier nos idées sur les « solutions » qui seront les plus efficaces dans le contexte d’un calendrier qui se réduit rapidement. Nous devons à la fois exploiter et abandonner une partie de notre pouvoir. La science seule ne nous sauvera pas, pas plus que la politique gouvernementale, les réunions de l’ONU ou les sommets sur le climat où nous attendons des « leaders mondiaux » qu’ils se lèvent et s’unissent autour des changements dont nous avons si désespérément besoin. Nous ne pouvons pas améliorer la situation en promouvant de meilleurs choix de consommation qui privilégient le changement de comportement individuel ou en soutenant les entreprises qui vendent des « produits durables ». Il n’y a pas de technologie magique qui permettra au cours des choses de revenir à la « normale » ; les milliardaires verts n’ont pas les réponses ; il n’y a pas d’île imaginaire vers laquelle nous pouvons nager et qui offrira une restauration du climat.
Nous avons besoin d’un plan d’action révolutionnaire qui soit généré par un mouvement populaire mondial et guidé par un ensemble d’engagements politiques partagés et de modes de relation les uns avec les autres qui puissent contrecarrer l’immense incertitude du moment, un plan qui soit ancré dans une dynamique ici et maintenant, engagé dans un avenir juste libéré des chaînes de l’apocalypse climatique. Le chemin à parcourir n’est pas facile. Mais prendre la décision de s’y engager est peut-être la chose qui compte le plus en ce moment : cela témoigne d’un attachement à l’idée que quelque chose d’autre est possible, que nous n’avons pas cédé ou abandonné, que nous sommes prêts à continuer d’essayer. En fin de compte, notre capacité à rester unis est l’une des plus grandes armes d’espoir et de résistance que nous ayons.
Traduit de l’anglais par la rédaction de Ballast | Jaskiran Dhillon, « Building anti-colonial féminist coalitions against climate change », ROAR, n° 11. Une version de cet article sera incluse dans le dernier livre de Jaskiran Dhillon, Notes on Becoming a Comrade : Solidarity, Relationality, and Future-Making, à paraître en 2022 chez Common Notions Press.
Illustrations de bannière et de vignette : Guim Tió Zarraluki
REBONDS
☰ Lire notre discussion avec Paul Guillibert : vers un « communisme du vivant » ?, mars 2022
☰ Lire notre reportage « Casamance : résister au sel et attendre la pluie », Camille Marie et Prosper Champion, décembre 2021
☰ Lire notre entretien avec Animata Traoré : « Le capitalisme détruit les sociétés, les économies locales et les écosystèmes », décembre 2021
☰ Lire notre reportage « Kurdistan Nord : une ferme écologique en résistance », Loez, novembre 2021
☰ Lire notre entretien avec Andreas Malm : « L’urgence climatique rend caduc le réformisme », juin 2021
☰ Lire notre traduction de l’entretien « Hugo Blanco, l’écosocialiste péruvien », janvier 2021


