Entretien inédit | Ballast
Ne nous leurrons pas : les milieux de gauche et d’extrême gauche ne sont pas imperméables. Ils sont, eux aussi, pétris d’oppressions, de dominations et sujets à la violence. Comment les prendre en charge sans recourir à des institutions qui participent à leur perpétuation ? En un mot, peut-on véritablement bâtir « des communautés avec espoir et sans police » depuis lesquels lutter plus sereinement ? Et quels outils sont à notre portée ? C’est ce qu’interroge la militante Elsa Deck-Marsault dans Faire justice, publié aux éditions La Fabrique. Elle s’appuie pour ça sur son expérience au sein du collectif féministe et queer Fracas, qui propose une aide à la gestion des conflits interpersonnels, des violences et des agressions au sein de groupes. L’autrice avance une critique de ce qu’elle appelle le « moralisme progressiste », ainsi que de l’usage de pratiques punitives au sein des milieux militants. « Nous sommes anarchistes, nous ne croyons pas en la punition comme outil de rétribution ou de réhabilitation » trouve-t-on ainsi sur le site du collectif Fracas. Que faire, alors ? Elsa Deck-Marsault plaide pour des alternatives qui intègrent pleinement le rôle du collectif dans les leviers à mobiliser, en s’inscrivant dans la lignée de la justice transformatrice. Nous en discutons.

Cet aspect m’a initialement beaucoup freinée dans l’écriture. Je me demandais si je n’étais pas en train de donner des billes à nos ennemis politiques, que ce soit la droite, l’extrême droite, mais aussi les personnes qui auraient commis des violences et voudraient récupérer ce discours pour se laver les mains. J’ai fini par arriver à m’en défaire car il est très important que, dans les milieux de gauche et d’extrême gauche, on apprenne justement à faire des critiques qui soient publiques. On touche alors plus de gens, y compris dans nos propres espaces, qu’en gardant ces critiques privées. On est toujours en train de se demander ce qu’on va faire si on est récupéré politiquement, or ça repousse la ligne de réflexion, ça nous empêche de voir nos propres dysfonctionnements internes. C’est une façon de déplacer le discours. Et puis, toujours penser par rapport à nos ennemis c’est aussi s’accorder sur leurs agendas politiques, là où on doit mener le nôtre et le porter. On a assez de choses à faire dans nos propres milieux avant de s’interroger sur les façons dont on pourrait être récupéré et de penser à comment y faire face. On a assez de choses à faire dans nos propres milieux, pour ne pas s’attarder outre-mesure sur les diverses manières dont on pourrait être récupéré.
Vous critiquez finement une forme d’individualisation qui a imprégné les luttes. « Centrer nos luttes sur l’unique prise de conscience de nos privilèges ou, au contraire, de leurs répercussions négatives sur notre vie ne saurait proposer un horizon politique satisfaisant. » dites-vous, en reprenant l’expression d’« épistémopolitique de la vulnérabilité ». Pouvez-vous expliquer ?
Cette expression est tirée d’un article de Chi-Chi Shi intitulé « La souffrance individuelle (et collective) est-elle un critère politique ? », qui m’a beaucoup inspirée. L’autrice part du constat que le ressenti et la souffrance individuels sont aujourd’hui présentés comme le point de départ de nos luttes, c’est-à-dire l’endroit d’où on va pouvoir se rassembler. Politiquement, est-ce que ça nous permet de faire des liens entre les différents ressentis et souffrances que chacun et chacune peut avoir et exprimer ? On s’est retrouvé à centrer nos combats autour des individus et ça rend la construction de ponts impossible. On voit nos luttes davantage en termes de camps centrés autour de souffrances et de ressentis communs qu’en termes de front qu’il faut faire avancer face à un ennemi commun.
« On centre le problème sur des personnes plutôt que sur un système plus global. Résultat : on n’est plus capable de lutter et de militer ensemble. »
Lorsqu’on pense en termes de camps, qui fait partie du « nous » politique et du « eux » ? On s’est focalisé sur la traque des traîtres potentiels qui seraient dans le « nous » pour les exclure de nos espaces, faire en sorte que ces derniers soient de plus en plus safe, en partie pour qu’un confort individuel soit assuré au sein de nos luttes. Cette limite entre le « eux » et le « nous » me sert de point de départ pour parler de moralisme progressiste, c’est-à-dire la recherche exclusive de la perfection morale et la façon dont elle va s’incarner dans le fait d’assainir nos propres camps. On essaye de se retrouver entre bon·nes militant⋅es qui auraient tous les codes symboliques de la parole, sociaux, etc., en rejetant ce qu’on estime être des mauvais⋅es militant⋅es. On traque les gens qui feraient des erreurs discursives, des fautes dans leur comportement. On centre le problème sur des personnes, individuellement, plutôt que sur un système plus global. Résultat : on n’est plus capable de lutter et de militer ensemble. On en est venu à confondre nos « identités politiques » avec nos opinions et on a du mal à faire du lien entre nos conflits, à confronter nos points de vue contradictoires.
La question qui irrigue tout votre livre n’est-elle pas celle de la violence (et de sa légitimité ou non) ? Il faudrait selon vous éviter de remplacer une violence institutionnelle par une violence communautaire et militante…
C’est un peu le constat que je fais au début de mon livre, oui. Face au contexte socio-économique, écologique, social qui s’aggrave, on se sent si démuni qu’on essaye de rétablir notre puissance en pratiquant la punition à tout va. La punition donne l’impression que nos actions ont des conséquences concrètes, là où elles sont plus lointaines quand on se bat contre Total ou le système patriarcal… On essaye de contrebalancer la violence qu’on subit de la part de l’État et des structures sociales contre des personnes qui, dans nos espaces, seraient des « traîtres ». Mais je ne vise pas du tout un monde sans violence : ça n’est pas possible. Il faut plutôt s’organiser collectivement pour la rediriger vers ceux qui en sont à l’origine.

[James Brooks]
Vous insistez en effet sur la façon dont le « tournant libéral » a influencé nos luttes (de « source de contestation », elles se sont rapprochées de « thèmes intégrationnistes »). La lutte contre les discriminations a‑t-elle supplanté la recherche d’une émancipation collective ?
Je ne sais pas si je peux l’affirmer de manière générale, mais pour ce qui est de la prise en charge des violences sexuelles, on peut en attester, oui. Dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS), on a eu tendance à être dans une politique plutôt passive et attentiste vis-à-vis des institutions pénales-carcérales. Il y a eu un tournant depuis les années 1975, quand les luttes féministes se sont positionnées pour un durcissement des peines et une prise en charge élargie de l’État. Aujourd’hui, d’un côté l’État surfe sur des thématiques féministes pour porter des lois racistes et, de l’autre, on attend de l’État et des institutions pénales-carcérales qu’elles apportent la solution au problème des VSS. Deux agendas ont concordé et c’est une impasse totale, puisqu’on a vu que ça ne fonctionnait pas. Avec MeToo, on a fait lire et entendre nos récits à ces institutions, mais rien n’a changé structurellement. Je m’étonne donc que les féministes continuent d’inviter les victimes de violences à déposer plainte, alors même que la prise en charge ne suit pas et qu’il n’y a aucune remise en question structurelle du patriarcat qui produit ces violences.
Les incitations à porter plainte se retournent en effet parfois contre les victimes.
Oui, on a incité beaucoup de femmes à porter plainte. Résultat : les personnes auteures de violences n’ont pas été condamnées mais les victimes se sont retrouvées avec des plaintes pour diffamation. On devrait s’interroger : en pensant que ces incitations participeront à changer la structure dans laquelle on est, vers quoi pousse-t-on finalement les personnes impliquées ? On a du mal à passer à un autre fonctionnement, qui consisterait à nous charger, nous-mêmes, d’apporter les réponses à ces problèmes-là. Je parle de position attentiste : les milieux féministes ont été — et sont toujours — une grosse force pour dénoncer ces violences. Mais pour proposer et devenir porteurs d’alternatives solides, le bât blesse toujours.
Vous parlez d’un « véritable système punitif qui [s’est] développé au sein des milieux militants ». Si les groupes militants ne prennent pas bien ou peu en charge la gestion des conflits et des agressions, n’est-ce pas tout simplement parce que ça demande beaucoup de temps ?
« Les pratiques punitives nous enseignent qu’on est toujours sur la sellette. »
Il faut effectivement prendre en compte l’épuisement militant. Pour autant, la manière dont ces milieux fonctionnent nous prend énormément d’énergie. La manière dont on traite les conflits et les agressions actuellement nous traumatise, nous heurte beaucoup : c’est épuisant. Changer notre vision de la violence et du conflit, en passant par la critique et l’auto-critique, comprendre que ces mécanismes ne sont pas nécessaires — puisque répondre à la violence par la violence ne marche pas — pour trouver quelque chose de plus efficace sur le long terme finira par nous prendre moins d’énergie qu’actuellement. On ne pourra qu’y gagner dans la manière de mener nos luttes. Il y aura de l’inconnu, mais la situation dont on hérite n’est pas confortable pour autant. Les pratiques punitives, telles que le call out (la dénonciation publique ou en ligne), nous demandent beaucoup d’énergie collective. À chaque fois qu’un nouveau call out sort, ça nous mobilise, on se demande si on va le repartager, qu’est-ce que la personne a fait, etc. Si on arrête d’utiliser cet outil, ça nous laissera pas mal d’autres options et, surtout, si on invente autre chose, ce sera plus efficient collectivement. Après, le processus de prise en charge des faits de violence et de conflits nécessite effectivement du temps, de la formation, de l’investissement, de l’énergie…
Ce système punitif a aussi des conséquences sur l’implication des individus au sein d’un collectif.
Les pratiques punitives nous enseignent qu’on est toujours sur la sellette. Quand on milite depuis dix ans dans un milieu et qu’on sait qu’on peut en être exclu d’une minute à l’autre parce qu’on aura fait ou dit telle chose, qui serait considérée comme inacceptable de la part de nos pairs, ça nous pousse à nous investir à demi — un pied dedans et un pied dehors. Et si on passe notre temps à mettre des gens à la porte de nos milieux, c’est encore de l’énergie gaspillée. Déjà qu’on est peu, si on continue à faire ça, on va finir par être trois !
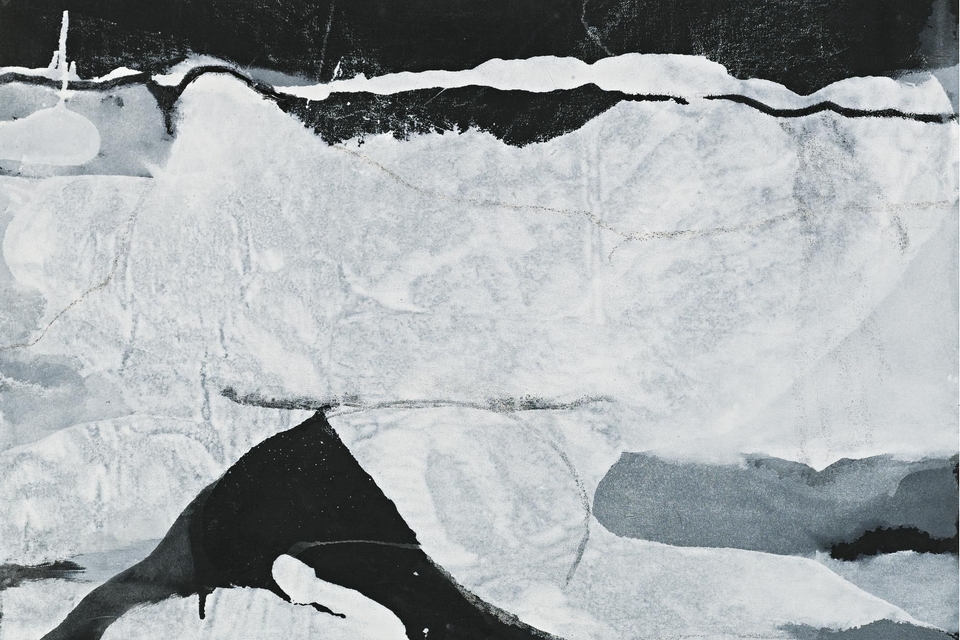
[James Brooks]
Les mécanismes de call out ou d’exclusion ne sont-ils pas parfois la conséquence d’une forme de pression pour que le collectif réagisse vite ?
À la suite de MeToo et à l’ère des réseaux sociaux, les informations circulent très vite. Beaucoup de gens réagissent davantage par peur d’être vus comme mauvais⋅es allié⋅es ou militant⋅es que parce qu’ils sont vraiment d’accord avec la position prise. On en vient à se demander « comment faire pour montrer que moi, personnellement, je suis du bon côté de la barrière ? » Alors que les questions devraient être « qu’est-il juste de faire ? avec quoi je suis en accord politiquement et éthiquement ? » C’est une sorte de performativité qui utilise chaque nouvelle histoire pour montrer qu’on est le bon ou la bonne militant⋅e, qu’on a bien pris position. D’où ma référence au moralisme, qui invite à montrer qu’on a la bonne morale, qu’on est sur la bonne voie. Alors qu’au fond, c’est vide de sens.
Les prises de position immédiates par rapport à une affaire sont donc moins motivées par la potentielle résolution de ces dernières que par le fait d’afficher en soi une réaction ?
Exactement. Ça se voit nettement avec les partis politiques, à propos desquels il y a beaucoup d’histoires de viols et d’agressions sexuelles qui sortent. Les partis politiques cherchent soit à étouffer ces histoires car ils savent que ça ne sera pas bon pour eux si ça sort, soit à s’écarter le plus possible des auteurs de violence, soit à essayer de laver leur nom si l’affaire est divulguée. Dans tous les cas ils sont susceptibles d’être accusés par l’opinion publique. Le problème, c’est qu’alors que ces gens sont occupés à produire des textes pour laver leur réputation, leurs prises de position n’entraînent aucune remise en question profonde et structurelle des mécanismes menant à ces violences. Mais qu’est-ce qu’on fait des victimes ? de la structure qui produit ces violences ?
Faire justice résulte notamment de votre expérience avec le collectif Fracas que vous avez cofondé. Quel approche porte-t-il ?
« On voit beaucoup d’associations exploser en plein vol au bout de deux ans à cause de conflits qu’elles n’ont pas réussi à surmonter. »
Dès la création il y a quatre ans, on avait plusieurs angles d’attaques. Le premier, c’était de pouvoir accompagner des individus et des collectifs en situation de conflit, ou qui étaient confrontés à des violences et qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas passer par la police pour y faire face. Deuxièmement, il y avait une volonté de transmission : partager à nos milieux ce sur quoi on se formait, les outils utilisés dans le domaine du soin, du droit, etc. — des outils peu connus et universitaires, qu’on voulait rendre plus accessibles à nos communautés. On voit beaucoup d’associations exploser en plein vol au bout de deux ans à cause de conflits qu’elles n’ont pas réussi à surmonter. On voulait donc à la fois accompagner des personnes mais aussi travailler plus largement sur le contexte de nos espaces et lieux militants — pour nous des milieux féministes et queers, mais ça s’est élargi au fur et à mesure. Comment allait-on changer nos communautés à travers des histoires individuelles et particulières ? L’approche transformatrice est arrivée ensuite.
Vous faites référence à la justice transformatrice ?
Oui. Le terme est né dans les années 19901, il est arrivé en France assez récemment. Dans la justice transformatrice, la violence et le conflit sont perçus comme les symptômes plus larges d’une société qui a des problèmes structurels, systémiques. Le conflit et le fait de violence sont appréhendés comme des opportunités pour transformer à la fois les individus, mais surtout la société, afin d’aller vers plus de justice et d’égalité. Il s’agit d’accompagner aussi bien les auteurs de violence, les victimes et la communauté qui est autour, ou la société. C’est une justice qui vise moins à identifier et punir un coupable pour ses actes, qu’à comprendre pourquoi ça s’est passé comme ça, qu’est-ce qui s’est passé, et se demande comment faire en sorte, collectivement, que ça ne se reproduise pas. Cette justice n’est pas portée par l’État ou les institutions, mais par les proches, les personnes qui connaissent le mieux celles qui sont touchées. Ils et elles ont la meilleure connaissance de ce qui s’est passé, des enjeux pour les personnes impliquées, de l’accompagnement dont elles ont besoin pour aller mieux. C’est une approche foncièrement abolitionniste : on estime que les tribunaux, la police, tout le système pénal-carcéral ne fonctionnent pas, ne peuvent pas être réformés, qu’il faudrait les mettre à bas. En parallèle, on essaye de travailler avec des relais, notamment institutionnels. On a des liens avec le monde associatif, car parfois on estime qu’on n’est pas à même de pouvoir répondre aux problèmes de quelqu’un. On est un maillon d’une grande chaîne qu’il faudrait pouvoir nourrir et faire grandir.

[James Brooks]
Comment mettre en pratique cette prise en charge des conflits et des violences dans les milieux militants et y faire adhérer le collectif, sans justement polariser ses membres sur des positions antagonistes ?
On dit dès le début qu’on n’est pas des professionnels du soin ni du droit. Pour nous, la responsabilité d’une violence est portée à hauteur égale par l’auteur et par les gens qui sont autour. On ne parle pas d’individus isolés qui commettent des violences sexistes et sexuelles, mais bien d’un fait systémique qui inclut l’auteur, son groupe d’ami⋅es, sa communauté, les collectivités, la société, etc. Les violences sexistes et sexuelles existent car il y a tout un système qui les permet. Quand on travaille avec des collectifs, le plus important est de faire comprendre qu’au-delà d’identifier un coupable, on veut analyser le contexte dans lequel a pu être émis le fait de violence et comment le collectif y a participé, ce qui a pu faire émerger le fait de violence (que ce soit la banalisation ou minimisation d’un acte, le fait d’avoir poussé à une attitude prédatrice, incité à la consommation d’alcool, etc.).
Vous parlez du rôle central de la communauté, notamment des proches, de l’entourage, qui parfois choisissent de ne rien faire en cas d’agression. Quelle responsabilité pour l’entourage dans ce cas ? On semble être à la frontière entre la responsabilité individuelle et collective…
Pour moi, l’entourage fait partie de la société au même titre que n’importe qui. Dans le système pénal-carcéral, on ne compte pas du tout sur l’entourage pour prendre en charge des faits de violence. On identifie une personne qui a commis une faute et on se concentre sur elle. Dans la justice transformatrice, on essaye au contraire de collectiviser. Ça permet de mettre en place certains outils. Par exemple, si un auteur de violence et une victime côtoient un même lieu, l’entourage peut, si nécessaire, organiser un planning pour partager l’espace. Aussi, l’impact que les faits de violences ont sur l’entourage ne peut pas être minimisé. Or, dans le système pénal, l’entourage n’est absolument pas considéré. Il convient de le faire parce que ça peut être traumatisant de voir son proche être victime ou auteur d’un acte de violence. L’entourage est donc une cellule à revaloriser et à mieux accompagner : c’est un tremplin essentiel dans la prise en charge communautaire d’un acte de violence pour aller vers une justice adaptée à la personne et à son contexte social.
Mais dans certains cas, l’entourage intervient pour soutenir les agresseurs. Il est courant que des proches disent « je le connais, c’est un mec bien », pour appuyer un certain récit sur les faits.
« Je suis profondément abolitionniste : il faut qu’on abandonne le cadre pénal-carcéral pour transformer notre rapport à la justice. »
Ce point est intéressant et m’a pas mal travaillée : comment se fait-il que des personnes, notamment témoins de ces violences, soutiennent les agresseurs ? Si on évoque Stéphane Plaza, ses proches étaient forcément au courant de ce qu’il mettait en place au sein de son foyer. Concernant Denis Baupin, un bon nombre de personnes savaient ce qui se passait, et ont même dû par la suite le soutenir, essayer de laver son nom dans le procès. Des logiques de loyauté envers les ami·es sont en jeu. Dans les boys club, lorsqu’un mec agresse une meuf, il est courant que sa bande de potes ne le balance pas : la loyauté est perçue comme une forme d’amitié valorisée. Alors qu’être un⋅e bon⋅ne ami⋅e ou camarade, ce n’est pas forcément soutenir sans conditions, mais confronter la personne quand il ou elle n’a pas un comportement en accord avec ses valeurs. Ça parait être le b.a‑ba mais ça ne l’est pas en pratique.
En parallèle, on se retrouve souvent dans des systèmes où le mec est soutenu par tous ses proches et protégé par eux. Imaginons : si le cadre pénal-carcéral tel qu’il existe aujourd’hui n’existait plus et qu’avouer sa faute ne nous mettrait pas face à une peine de prison, cela changerait considérablement notre manière de traiter ces agressions. Aujourd’hui, avouer c’est faire face à du harcèlement potentiel, à la perte de son emploi, de sa famille. Forcément, les personnes sont plus occupées à laver leur nom et leur réputation plutôt qu’à se remettre en question. Ce système est complètement contre productif et ne nous pousse pas à être honnête devant les juges. Je suis donc profondément abolitionniste : il faut qu’on abandonne le cadre pénal-carcéral pour transformer notre rapport à la justice.

[James Brooks]
Vous vous positionnez aussi contre la professionnalisation des personnes qui gèrent les conflits. Vous écrivez : « Les raisons de se passer des professionnel⋅les du conflit sont nombreuses, mais la principale réside dans l’idée que nous avons la créativité et les ressources pour le faire (en mieux). » Mais il semble qu’il y ait aussi de bonnes raisons d’avoir des professionnel⋅les : si les gens ne sont pas formés, ils risquent de faire n’importe quoi, et on a besoin d’être reconnu comme légitime pour intervenir dans la résolution d’un conflit…
Des personnes lambdas peuvent-elles prendre en charge des conflits alors même qu’elles ne seraient pas formées ? Ça m’a beaucoup interrogée. Au-delà de la formation, qui est un aspect important, comment établir une éthique dans la gestion du conflit ? et comment la transmettre ? Je n’ai pas toutes les réponses. Ce qui est important, c’est qu’on met déjà en place des choses qui marchent — même si on fait aussi des erreurs. Il faudrait faire des archives pour garder trace de ces tentatives de prises en charge autonomes, afin de créer une mémoire collective à laquelle se référer lorsqu’on serait confronté à une situation similaire. On peut ensuite élaborer des choses à partir des erreurs ou des victoires. C’est principalement ce qui manque ; la formation est importante, mais elle ne suffit pas à elle seule. Si on est sur le terrain avec les mains dans la pratique, on apprend tout autant. Il faut conjointement mener pratique et réflexion sur celle-ci : l’analyse de pratiques est essentielle pour avancer et plus puissante que n’importe quelle formation.
Derrière le mot « professionnalisation », il faut donc comprendre celui d’étatisation ou institutionnalisation ?
Non, derrière ce terme j’entends l’accumulation de formations, pour spéculer et capitaliser sur le conflit. Faire des formations pour intervenir dans ses propres espaces ou ceux similaires au nôtre est bénéfique ; mais quand ça devient hors-sol et sans connaissance du terrain où on intervient, alors c’est un problème. Passer par une forme d’institutionnalisation ne me dérange pas. Il faut certes mettre à bas les institutions dans lesquelles on se trouve car elles ne fonctionnent pas. Mais il faut créer quelque chose derrière pour ne pas tomber dans le chaos.
Se pose tout de même une question d’échelle. Quand on parle d’un conflit de voisinage, on visualise assez bien ce qui peut être mobilisé par les personnes concernées. Mais quand on parle d’un crime raciste et de sa résolution, c’est plus compliqué d’arriver à imaginer quelles personnes seraient mobilisées.
« Il faut revenir à un niveau local, et généraliser à partir de lui notre manière de prendre en charge les violences. »
Des dispositifs ont déjà été mis en place pour traiter des cas graves, notamment quand on parle de communautés où il y a de l’inceste et de la pédophilie. Des dispositifs transformatifs existent et marchent mieux que la justice pénale à cet endroit-là. Des tribunaux populaires ont également pu être créés à l’échelle de quartiers entiers. Ils permettent de gérer les conflits de voisinage mais aussi la sécurité des habitants sur plusieurs années. Il faut pousser la réflexion collective sur ces sujets. Je suis convaincue que si la communauté était conçue comme une cellule en laquelle on a confiance et qui se structure par une approche critique de ses propres pratiques, alors on pourrait agrandir le maillage actuel. Le lien communautaire gérerait les conflits en son sein, mais la communauté pourrait aussi se déplacer pour prendre autre chose en charge. Il faut revenir à un niveau local, et généraliser à partir de lui notre manière de prendre en charge les violences. Mais dans la pratique, au sein de Fracas, j’ai constaté plusieurs obstacles à cette démarche.
Par exemple ?
Lorsque deux personnes ne se connaissent pas du tout et n’ont aucune communauté en commun. Si je prends l’exemple du harcèlement sur Internet, on ne sait pas qui est l’auteur : donc le collectif Fracas ne peut pas la contacter pour mettre quelque chose en place avec elle et sa communauté. On ne détient pas une force de coercition comme la police et force est de constater que certains endroits ne sont pas accessibles.

[James Brooks]
Il y a parfois des histoires d’agressions passées qui ressortent plusieurs années après. Il peut sembler plus simple de traiter le cas lorsque cela s’est produit récemment. Quelle temporalité doit être prise en compte dans la réponse collective à apporter ?
Je ne pense pas que ce soit plus facile si l’événement vient de se produire. Une personne qui vient de vivre des violences n’en a pas la même vision le jour où ça s’est produit et cinq ans plus tard. L’accompagnement qu’il faut déployer n’est pas du tout pareil selon qu’une violence vient de survenir ou qu’elle est survenue il y a plusieurs années. Par exemple, si une personne nous dit qu’elle a vécu une violence hier, le collectif Fracas ne pourra pas intervenir tout de suite. On n’est pas des psychologues, on ne pourra pas apporter un soin à cette personne, soin dont elle a besoin. On aura tendance à la rediriger vers des personnes qui pourront gérer l’urgence de la situation. Le déploiement d’outils pour résoudre une situation prend du temps. Il faut s’adapter à la situation, et j’ose espérer qu’il n’y a pas de prescription dans les milieux militants : on détermine, avec chaque personne qui nous contacte, ses besoins et comment on va pouvoir l’accompagner.
Vous affirmez qu’un collectif se connaît et qu’à condition d’être accompagné, il est le mieux à même de pouvoir prendre en charge les conflits, les agressions. Mais ce postulat ne met-il pas de côté les oppressions systémiques qui traversent les collectifs, sont incarnées, intériorisées, et dont les collectifs ne peuvent pas forcément se rendre compte ?
Si une violence est liée à des rapports d’oppression systémiques, le conflit ou le fait de violence fait justement ressortir ces rapports-là. C’est le moment où on peut les travailler : analyser tous les dysfonctionnements latents, tous les rapports de pouvoir, les rapports de force. Si le collectif souhaite prendre ça en charge correctement et regarder ce qui vient de se passer, il ne pourra pas fermer les yeux sur les rapports d’oppression. À mon avis, le collectif a les clés pour faire en sorte que ces rapports puissent s’apaiser, à condition de bien analyser comment les rapports de pouvoir ont influencé les rapports de force qui ont rendu possible les faits de violence. Mais on peut retourner la question : qui serait plus à même que les collectifs de réfléchir sur les rapports d’oppression même s’ils sont cachés ?
Cela ne dépend-il pas des milieux en question ?
C’est sûr que mon propos concerne les milieux militants de gauche et d’extrême gauche : je n’aurais pas écrit le même livre si je m’étais concentrée sur le monde de l’entreprise, les écoles d’ingénieurs, etc. Des gens sont venus me voir, me disant qu’ils avaient essayé de parler de sexisme dans leur entreprise mais que ça ne parle à personne, que tout le monde s’en fout. Là, je n’ai pas de réponse… Mais ça rejoint la question de l’éthique : parler de tout ça nécessite un socle commun minimal en accord avec des droits fondamentaux alloués à tout le monde, qui repose sur l’idée qu’on peut apprendre à bien se traiter. Si on fait déjà ça dans nos milieux, qu’on arrive à créer cette « hygiène du conflit » et à prendre en charge les violences, on peut être une sorte de laboratoire d’inventivité sociale. Peut-être qu’à terme, on arrivera à toucher d’autres sphères. Si on se passe d’un système punitif, on ouvrira de nouvelles fenêtres dans la tête des gens.
Illustration de bannière : James Brooks
Photographie de vignette : Hors-Série
- L’expression a été « forgée au début des années 1990 par la militante anti-carcérale canadienne Ruth Morris », Multitudes, vol. 88, n° 3, « Abolition, justice, transformation », Emma Bigé, Yves Citton, Camille Noûs.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec les grévistes du Planning familial, avril 2023
☰ Lire notre traduction « Pour une lutte de classes intersectionnelle », octobre 2021
☰ Lire notre entretien avec Aurore Koechlin : « Aucune révolution féministe sans renversement des classes », février 2021
☰ Lire notre article « Marlène Schiappa, le fémonationalisme et nous », de Kaouthar Harchi, août 2020
☰ Lire notre article « Checker les privilèges ou renverser l’ordre », de Kaouthar Harchi, juin 2020
☰ Lire notre article « À l’assaut des murs », de C.M., mars 2020


