Entretien inédit pour le site de Ballast
Second et dernier volet de notre débat entre le sociologue Daniel Zamora et le politologue Jean-Yves Pranchère.
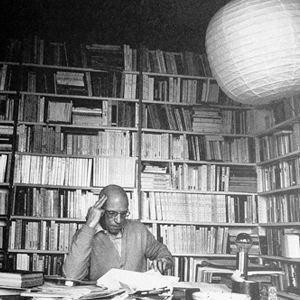
Jean-Yves Pranchère : Même si Foucault était capable d’une désinvolture qui aurait fortement déplu à Weber, une forme d’esprit wébérien — à savoir la dissociation entre l’impersonnalité de l’œuvre et l’engagement politique assumé en propre par l’auteur — se retrouve dans ce qu’on peut nommer la « tripartition » de l’œuvre de Foucault. Il y a d’abord des livres qui présentent les résultats d’enquêtes historiques sur une généalogie qui apparente les sociétés industrielles à une « cage de fer ». Surveiller et punir et L’Histoire de la sexualité, à cet égard, sont des ouvrages de même statut théorique que L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme. La forme désengagée de ces livres explique la diversité de leur réception et de leurs usages : Surveiller et punir a pu être lu comme un livre antimoderne ou conservateur aussi bien par Philippe Ariès que par Jürgen Habermas. Parmi les héritiers de Weber, nous trouvons à la fois Georg Lukacs, Carl Schmitt et Raymond Boudon ; parmi les héritiers de Foucault, nous trouvons aussi bien Didier Eribon que François Ewald, passé un temps au MEDEF, Blandine Kriegel, républicaine revendiquée, ou Robert Castel, l’auteur des Métamorphoses de la question sociale. On pourrait dire que cela tient à ce que les travaux de Foucault étaient, comme il l’a dit lui-même, des « boîtes à outils ». Mais cette caractérisation me semble moins exacte que celle qu’il a donnée ailleurs en disant qu’il avait proposé des « fragments philosophiques dans des chantiers historiques ». Ces fragments sont ambigus et les chantiers restent ouverts.
« Foucault montre que le néolibéralisme n’est pas un retrait de l’État mais un gouvernement par le marché. [J.-Y.P.] »
Il y a ensuite les cours, qui sont de véritables laboratoires de pensée où sont testées des hypothèses de recherche liées à des enjeux contemporains. On peut être tenté de souscrire à la thèse soutenue par Frédéric Gros, celle de la « supériorité des cours » sur les livres. De fait, on trouve dans les cours nombre d’analyses qui manquent aux livres. Le cours de 1976 « Il faut défendre la société » explore jusqu’au bout l’hypothèse que le droit et la politique pourraient n’être que des formes de la guerre pour constater finalement que l’hypothèse est intenable, ce qui conduira à l’introduction de la notion de « gouvernementalité ». Le cours de 1979 est pour une part très critique : Foucault montre que le néolibéralisme n’est pas un retrait de l’État mais un gouvernement par le marché. Il récuse la thèse de Hayek selon laquelle le régime totalitaire soviétique serait une hypertrophie de l’État social1… Mais c’est un cours qui manifeste aussi une évidente sympathie pour les aspects « anti-normalisateurs » du néolibéralisme. C’est très sensible lorsque Gary Becker y entre en scène et que disparaît le contrepoint critique qui avait jusque là accompagné l’exposé.
Et la troisième catégorie ?
Jean-Yves Pranchère : Les interventions politiques. Celles-ci sont le plus souvent « stratégiques » : Foucault vise à produire des effets susceptibles de transformer un champ de force. Il ajuste parfois son discours à ce que son public est capable d’entendre, en produisant des énoncés instables, dont le sens est contextuel, qui « tordent » le langage dominant de façon à servir de levier pour renverser les convictions d’une certaine audience. Certaines de ses interventions virulentes contre l’humanisme dans les années 1960 sont difficilement intelligibles si on ne se souvient pas que « l’humanisme » était alors incarné par Roger Garaudy, qui était un penseur officiel du PCF (et qui a fini depuis dans les eaux du négationnisme). On sait que Foucault ne voulait pas être un « intellectuel universel » (à l’image de Sartre, défenseur d’une vision totalisante du monde), mais un « intellectuel spécifique », intervenant à partir de ses recherches sur des enjeux locaux et déterminés. Il reste que l’intellectuel, en tant que tel, se risque au-delà de ce qu’il sait strictement pour prendre position dans les conflits du présent. Ce risque est nécessaire : il est constitutif de la politique, ce pourquoi Aristote pensait que celle-ci était le domaine de la phronèsis, de la « prudence » comme discernement. S’il manque de phronèsis, l’intellectuel spécifique n’est pas mieux protégé que l’intellectuel général contre de lourdes erreurs de jugement : Foucault l’apprit à ses dépens lors de la révolution iranienne2. Du moins se rétracta-t-il, tandis que Weber ne renia jamais les atroces positions nationalistes qu’il adopta lors de la guerre de 1914–18.

[Jean-Yves Pranchère (Laurent Gilson | Ballast)]
Daniel, certains de vos critiques pointent justement le fait que vous donnez un statut plus ou moins égal à tous les textes…
Daniel Zamora : Oui, on m’a beaucoup reproché la diversité des sources. Qu’il aurait fallu traiter les entretiens, les cours ou les livres différemment… Mais je ne suis pas totalement convaincu de cela. Ils ont bien entendu des statuts particuliers, mais c’est, en un sens, le cas de n’importe quel texte. Chaque texte, peu importe ses modalités, se réfère à des contextes, des impératifs et des contraintes différentes qu’on se doit de reconstruire sous peine de passer à côté de la spécificité de l’intervention. Par ailleurs, il me semble que ces formats divers s’éclairent l’un l’autre, offrant différents éléments sur les problématiques que Foucault choisit afin d’interroger son présent. Ce n’est qu’en juxtaposant ses cours, ses conférences et interviews aux livres qu’on peut saisir que la volonté de réinventer la subjectivité moderne traverse toute son Histoire de la sexualité. Foucault veut faire de l’antiquité un laboratoire pour trouver, voire pour expérimenter, des alternatives à l’herméneutique de soi. Et cela est plus visible dans certaines conférences ou interviews, où il fait le lien avec son présent de manière plus explicite. Il n’y a pas chez Foucault d’un côté des ouvrages qui seraient purement « académiques », motivés par une simple libido sciendi [désir de connaître, ndlr] et, de l’autre, des expérimentations plus « libres ». Ses livres sont d’emblée autant d’outils pour, dit-il, « dynamiter » son présent. Raison pour laquelle il admettra régulièrement qu’il n’est pas un historien et qu’il « sélectionne » ce qui l’intéresse dans le passé dans le but de provoquer « une interférence entre notre réalité et ce que nous savons de notre histoire passée ». De mobiliser le passé afin de transformer le présent. En ce sens, il y a un lien évident entre l’intérêt que Foucault porte à l’Antiquité, sa volonté de réinventer la subjectivité au lendemain de Mai 68 et le regard qu’il portera sur la gouvernementalité néolibérale. Tous trois offrent des outils pour élargir les espaces où l’on peut faire proliférer des expérimentations autonomes.
« Il n’y a donc pas, pour Foucault, d’opposition entre la stylisation de l’existence et le néolibéralisme mais, au contraire, des affinités évidentes. [D.Z.] »
Jean-Yves Pranchère : Je suis d’accord ! Mais cela ne supprime pas la différence entre les cours, qui ont un caractère expérimental, et les livres, qui sont beaucoup plus calculés. Quand Foucault rédige le résumé de son cours de 1979 au Collège de France, celui-ci apparaît comme beaucoup moins favorable au néolibéralisme que le cours lui-même. Cela pose la question de savoir à quel point il assumait la tentation néolibérale qui apparaît dans le cours prononcé.
Daniel Zamora : Je n’ai, de fait, pas d’avis définitif sur la question. D’ailleurs, nous n’avons jamais dit que Foucault était devenu néolibéral au sens d’une « conversion ». Foucault n’a bien entendu jamais procédé ainsi ; il a été, au sens propre, un « expérimentateur ». Mais il mobilise l’Antiquité pour démontrer qu’il a existé des alternatives à l’herméneutique de soi, et le néolibéralisme semble pouvoir ouvrir des espaces d’autonomie pour le sujet, lesquels pourraient être investis par d’autres subjectivités. L’émergence du néolibéralisme paraît d’ailleurs coïncider avec le déclin de l’herméneutique de soi qui dominait dans la France d’après-guerre. Celle d’un système où la morale est insérée dans un système juridique, où elle est l’objet de législation. Mais avec Giscard, toutes ces lois façonnant notre rapport à nous (avortement, censures, relations conjugales…) semblent, dans un premier temps, disparaître. Il n’y a donc pas, pour Foucault, d’opposition entre la stylisation de l’existence et le néolibéralisme mais, au contraire, des affinités évidentes. Il est toujours utile de se rappeler cette archive d’André Gorz, qui illustre parfaitement cette attitude : Gorz écrivait au milieu des années 1970 que les espaces libérés par l’État grâce au néolibéralisme sont des espaces que l’on peut investir pour expérimenter. Il a bien entendu été d’un optimisme démesuré, dans la mesure où les espaces « libérés » du « social-étatisme » ont été majoritairement colonisés par la rationalité du marché. Mais c’est bien là l’un des grands points aveugles de cette génération — n’avoir pas été assez lucides sur les impasses de leur anti-étatisme. Et sur le type d’espace démocratique qui pourrait se déployer en dehors du cadre étatique. Dans les faits, c’est le consommateur souverain qui a fini par s’imposer face au citoyen et le système impersonnel des prix face à la délibération collective.

[Daniel Zamora (Laurent Gilson | Ballast)]
Cette délibération collective, qu’on pourrait également nommer « autonomie », ne nécessite pourtant pas de passer par la critique de l’État ?
Daniel Zamora : Tout dépend de ce qu’on entend par « État » et « autonomie ». En ce qui concerne l’État, l’originalité de Foucault tient notamment en ce qu’il a tenté de le reconceptualiser en dehors du modèle de la souveraineté. Il a cherché à montrer de quelle manière l’État repose également sur toute une série de dispositifs plus ou moins occultes, dont Foucault aimait à dire qu’il fallait en faire « jaillir la violence ». À ses yeux, il faut déplacer, dans la théorie politique, la focalisation sur le souverain, pour saisir ce qui se passe « en deçà » de celui-ci. L’État apparaît comme un appareil qui repose sur des micro-pouvoirs préexistants, sur toute une série de relations qui agissent au niveau plus personnel, dans nos rapports à la famille, dans la science, les relations sexuelles, etc. L’État ne représente alors plus « que », ce que Foucault appelle « l’armature », la « garantie » d’un réseau de pouvoir beaucoup plus large. « Je pense que », dira-t-il en 1978, « sans aller jusqu’à dire que le pouvoir d’État dérive des autres formes du pouvoir, il est au moins fondé sur elles, et ce sont elles qui permettent au pouvoir d’État d’exister. » Dès lors, ajoute-t-il, « si l’on veut changer le pouvoir d’État, il faut changer les divers rapports du pouvoir qui fonctionnent dans la société ». L’idée sous-jacente, ici, est qu’on pourrait défaire l’État de l’intérieur, en minant toutes ces relations qui agissent dans la vie quotidienne, en faisant proliférer des subjectivités alternatives, on pourrait saper l’État de l’intérieur. C’est la fameuse révolution « moléculaire » qui va déplacer le centre de gravité de la politique, le faisant passer de la figure du souverain vers les sujets eux-mêmes. Sa théorie de la résistance et du changement va progressivement se concentrer sur le sujet. Cette analyse, devenue implicitement très populaire dans une gauche qui aime promouvoir les styles de vie alternatifs, s’est révélée totalement fausse. Loin d’échapper au contrôle, le capitalisme a fait de tous ces modes de vie alternatifs autant de marchés à conquérir, et l’État s’est parfaitement accommodé de ces territoires désormais gouvernés par la rationalité de l’entreprise. La dénonciation de la normativité que l’État imposait dans les recoins les plus intimes de notre existence a été remplacé par celle, plus diffuse bien entendu, produite par la compétition économique. N’y a‑t-il pas plus grand triomphe pour le néolibéralisme que d’avoir convaincu ses opposants que la transformation sociale s’opère par l’agrégation de choix de vie individuels ou de consommation ?
Et en matière d’autonomie ?
« La question n’est jamais de savoir comment se défaire de la normativité mais de définir comment la société va démocratiquement définir les normes à même de la gouverner. [D.Z.] »
Daniel Zamora : Chez Foucault, elle renvoie essentiellement à la question de la normativité. L’autonomie est celle du sujet dans la manière dont il peut se constituer comme tel. Je n’y perçois aucune notion d’autonomie en un sens collectif ou politique — du moins, pas comme collectif volontairement constitué. Des collectifs peuvent émerger de manière immanente au travers de contre-cultures, par exemple, mais il ne s’agit pas d’un collectif qui aurait une autonomie politique organisée. Il n’y a ici aucun élément pour penser la question démocratique et la manière dont une société peut être à même de se gouverner. Par ailleurs, cette perspective des « révoltes de conduite » contre la normalisation n’échappe en réalité pas à celle-ci. Le problème avec cette perspective, c’est qu’on ne peut se défaire de la normativité. Une société qui serait « moins normative » est seulement normative d’une manière différente. La question n’est jamais de savoir comment se défaire de la normativité — tout ordre social est par définition normatif — mais de définir comment la société va démocratiquement définir les normes à même de la gouverner, et de quel pouvoir les individus jouissent pour contester ces normes. La question est de savoir ce qui impose des normes : est-ce les signaux impersonnels du marché, répondant avant tout aux désirs des factions « solvables » de la société, ou la délibération collective dans un espace politique ? Foucault a créé une fausse dichotomie entre des institutions, dans laquelle la normalisation serait beaucoup plus forte et le marché, dans laquelle elle serait plus élusive ou plus facile à subvertir. C’est bien cette opposition qu’il nous faut désormais déconstruire.
Pourrait-on aller jusqu’à dire que les écrits du dernier Foucault mèneraient à une sorte de manuel de « développement personnel » philosophique ?
Jean-Yves Pranchère : S’il est vrai que Foucault ne nous donne pas les moyens de penser une « autonomie collective » (qui ne devrait en aucun cas s’opposer à l’autonomie individuelle), je ne suis pas certain qu’il soit aussi aveugle que cela au risque d’une normalisation par le marché, qui pourrait procéder de l’intériorisation par l’individu de l’ethos concurrentiel de l’homo œconomicus. On pourrait soutenir que c’est bien parce qu’il est sensible à ce risque qu’il ne publie pas ses analyses du néolibéralisme et qu’il préfère donner en exemple, dans les tomes 2 et 3 de son Histoire de la sexualité, des formes du « souci de soi » qui ne relèvent pas de l’exploitation de soi-même comme un capital. J’aurais presque envie de dire qu’il y a une certaine tension entre la conclusion maximaliste de ta critique de Foucault, Daniel, et le point de départ que tu as pris en renvoyant à Gorz.

[Laurent Gilson | Ballast]
Que voulez-vous dire exactement ?
Jean-Yves Pranchère : Que si Foucault appartient à une thématique d’époque qu’on retrouve chez Gorz, il devient difficile de l’opposer à des penseurs socialistes qui proviennent exactement du même espace — que ce soit Gorz ou Robert Castel, ce dernier s’engageant alors dans ce qui deviendra un travail magistral sur la question sociale. Foucault n’a pas trouvé d’issue entre un néolibéralisme de style giscardien et le jacobinisme incohérent de l’Union de la gauche. Personne à l’époque n’a trouvé d’issue. Mais cela ne signifie pas qu’on puisse passer du constat : « Dans cette situation d’impasse, les points d’accroche proposés par Foucault pour une transformation sociale se sont limités à la question du gouvernement des sujets » à une accusation qui serait « Foucault s’est converti à l’ordre établi et nous a proposé une version intellectuelle des éthiques du développement personnel ». Ce qui ferait de Foucault une sorte d’équivalent philosophique de la Jane Fonda des mêmes années, passée de l’engagement anti-impérialiste au body workout [entraînement corporel, sportif, ndlr]. Si on rapproche Foucault de Gorz, dont les textes tardifs, à la fin des années 1980, sont des propositons de transformation sociale radicale sur la base de l’écologie, alors Foucault devient un des éléments d’une constellation dont le rapport au nouvel ordre capitaliste restait critique. Et on peut ainsi analyser sans polémique ni euphémisation, comme l’a fait le sociologue Goulven Boudic3, le « rendez-vous » manqué des analyses de Foucault avec la social-démocratie (et le poids en elle du syndicalisme ouvrier). Je suis tout à fait d’accord avec toi, Daniel, pour regretter que Foucault ne se soit pas intéressé à la question de l’égalité : c’est une vraie limite. Mais il nous laisse l’importante question de l’émancipation individuelle. Or cette question ne se laisse pas réduire à celle de l’autonomie collective, ne serait-ce que parce que nous ne pouvons ni ne devons effacer ce que Claude Lefort nommait « l’hétérogénéité du social ».
Daniel Zamora : D’accord, mais penser autonomie individuelle et collective présuppose de penser des institutions et des formes collectives de transformation sociale. Et c’est là quelque chose qui manque chez Foucault. Et ce n’est pas rien ! Toute sa critique de la normalisation, des dispositifs d’assujettissement, se focalise sur les institutions au sens large. C’est de la diffusion dans les institutions modernes de gouvernement des techniques du pastorat chrétien dont il est question. Le néolibéralisme et sa promotion active du marché semble ici rompre avec cette tradition, cette forme d’assujettissement des individus. En ce sens, Foucault ne nous offre que peu d’instruments pour penser la normativité du marché. En partie car il échappe à la règle majoritaire qui domine la politique. Milton Friedman disait que « l’urne de vote produit la conformité sans l’unanimité » et « le marché l’unanimité sans conformité ». Si Foucault n’allait pas aussi loin, il m’apparaît qu’il partage parfois une vision naïve du marché, qui serait en quelque sorte moins contraignant vis-à-vis de la diversité des préférences individuelles.
« Je suis tout à fait d’accord avec toi pour regretter que Foucault ne se soit pas intéressé à la question de l’égalité : c’est une vraie limite. Mais il nous laisse l’importante question de l’émancipation individuelle. [J.-Y. P.] »
Jean-Yves Pranchère : Il me semble tout de même qu’il apprend du néolibéralisme que le marché est une institution qui, pour fonctionner, doit produire des individus structurés selon la subjectivité de l’entrepreneur de soi…
Daniel Zamora : Ah, ça ne me semble pas aussi clair !
Jean-Yves Pranchère : Nous n’allons pas reprendre notre discussion précédente, mais je maintiens que « l’entrepreneur de soi » exigé par la forme néolibérale du marché est un type de subjectivation. C’est en tout cas ce qui m’a frappé, et vraiment éclairé, quand j’ai lu le cours de 1979 à sa sortie en 2004.
Daniel Zamora : Oui, mais il fait une grande différence entre des « règles du jeu » et la liberté qu’ont ces joueurs dans ces règles du jeu. Pour illustrer ses idées, Hayek aimait prendre comme exemple l’idée de la circulation routière. Une économie planifiée signifierait pour lui un État central, dictant tous les déplacements de l’ensemble des individus. Le laisser-faire générerait un chaos sur les routes et le néolibéralisme viserait dès lors à établir un « code de la route ». Bien entendu ces règles sont établies par l’État mais elles ne visent qu’à créer le « cadre » dans lequel des individus opèrent sans pour autant édicter leur conduite. Ainsi, Foucault, qui reprend à son compte cette vision un peu abstraite du rapport entre État et marché dans le néolibéralisme, y voit une gouvernementalité qui repose beaucoup moins sur les dispositifs d’assujettissement dominants dans le « social-étatisme » de l’après-guerre. Il y voit une gouvernementalité qui offre des marges de liberté plus importantes, qui ne repose pas, écrit-il, sur « l’assujettissement interne des individus ». Il écrit tout de même dans son cours qu’il s’agit d’un « recul massif par rapport au système normatif-disciplinaire » ! C’est là tout le sens d’une gouvernementalité qu’il qualifiera « d’environnementale ». Si elle entretient bien entendu un rapport étroit avec le sujet, il est cependant très différent de celui produit par le pastorat chrétien et l’aveu, par exemple. Dispositif qui, aux yeux de Foucault, s’était largement diffusé dans des institutions telles que la justice ou la psychiatrie. On ne demandera plus au criminel de se reconnaître dans une subjectivité criminelle, mais simplement d’assumer le « coût » de l’illégalité de son action. Ce n’est pas un hasard si c’est précisément durant la période de déploiement du néolibéralisme que Foucault écrira que « l’idée d’une morale comme obéissance à un code de règles est en train, maintenant, de disparaître, a déjà disparu ». C’est une forme de subjectivation radicalement différente.

[Laurent Gilson | Ballast]
Jean-Yves Pranchère : Mais c’est bien parce que la gouvernementalité en reste une que Foucault s’intéresse à la question des modes de subjectivation. Et cet intérêt corrige le thème de la « mort de l’auteur », que tu as évoqué au début de notre échange. Que l’individu ne soit pas le créateur de sa pensée et de son action, qui sont d’abord les effets des dispositifs où il est pris, n’empêche pas qu’il doive en être le sujet, au sens où il doit assumer une fonction de responsabilité et de vigilance dans son rapport à soi4 Et il est nécessaire de penser les modalités de la subjectivation, dans la mesure où la liberté ne peut avoir lieu en dehors d’elle. Les critiques adressées par Foucault au caractère liberticide des « subjectivités révolutionnaires » portées par les partis communistes sont simplement irrécusables. Il est certain que Foucault voit dans le néolibéralisme un progrès par rapport aux institutions disciplinaires. Mais, en même temps, il a bien conscience que le marché est une institution et c’est pourquoi il me semble qu’il y a chez lui des éléments de subversion du néolibéralisme. Aucun néolibéral n’aurait pu écrire ce qu’il déclare en 1981 : « Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde un droit absolu à se lever et à s’adresser à ceux qui détiennent le pouvoir. »
Soyons plus précis encore : quels seraient selon vous, Jean-Yves, les contours de cette subversion ?
« Il est certain que Foucault voit dans le néolibéralisme un progrès par rapport aux institutions disciplinaires. Mais, en même temps, il a bien conscience que le marché est une institution. [J.-Y. P.] »
Jean-Yves Pranchère : Elle accentue une sorte de moment utopique du néolibéralisme, qui n’est jamais pleinement assumé par le néolibéralisme et qui, quand il est revendiqué, le subvertit. Pensons ici à l’allocation universelle : il est remarquable que cette proposition faite par le néolibéralisme ne soit jamais réalisée par lui — en tout cas jamais sous les formes où Foucault en parle, tout au plus sous la forme d’une prime à l’exclusion et jamais sous la forme d’un revenu qui révolutionnerait le marché, qui le rendrait réellement libre et non faussé, en donnant à l’individu le moyen de ne pas travailler s’il le souhaite et de refuser tout salaire qui lui semblerait inadéquat au travail fourni. Il y a un passage extraordinaire dans le tome III de Droit, Législation, et Liberté de Hayek : il y dit à la fois que l’allocation universelle est légitime (car les perdants du marché, s’ils n’ont plus les moyens de vivre, sont fondés à combattre par la violence l’ordre marchand qui les élimine) et que l’accepter revient à instituer le socialisme à travers une forme de propriété collective. L’allocation universelle apparaît donc à la fois comme une sorte de clé de voûte du néolibéralisme et comme une impossibilité « socialiste ». Cette contradiction n’est pas chez Foucault, qui défend une version maximaliste de l’allocation universelle dont je doute que le néolibéralisme puisse l’accepter dans la réalité. Par là, il échappe au néolibéralisme au moment même où il le suit, même s’il a sans doute le tort de ne pas voir tout ce qui, dans le discours néolibéral, relève non d’une gouvernementalité effective, mais bien d’une idéologie qui donne une image illusoire des pratiques qu’elle légitime.
Daniel Zamora : Foucault décide sciemment de traiter le néolibéralisme abstraitement, moins comme pratique que comme manière de penser la politique. Mais il fait ce choix, à mon sens, afin de répondre à ce qu’il perçoit comme la « crise du socialisme ». Le néolibéralisme, dans sa forme abstraite, offre alors des pistes pour inventer cette fameuse « gouvernementalité de gauche » qui lui semblait faire défaut. C’est pour cette raison que l’historien américain Colin Gordon, bien qu’il reviendra partiellement sur ses propos, verra dans ce projet une sorte de premier pas vers la problématique de la « troisième voie » de Blair et Clinton. Sur l’allocation universelle, j’aurais tendance à déplacer la focale du montant (version maximaliste vs minimaliste) vers le type d’horizon politique que cette mesure implique. Le point de départ de l’idée remonte aux grands débats de l’entre-deux-guerres sur la possibilité économique du socialisme et l’importance du système des prix dans l’allocation des ressources. C’est à ce moment qu’Hayek redéfinit de manière déterminante le capitalisme non plus par le bout de la propriété privée mais par celui de l’usage de l’information. Hayek pense qu’aucun système centralisé — et donc planifié — n’est à même de saisir la vaste dispersion de l’information dans la société (ou pour le dire autrement de la grande diversité des préférences individuelles) et donc d’allouer optimalement les ressources d’une société. Très rapidement l’horizon égalitaire sera partagé en deux : d’une part ceux qui le pensent collectivement, par le biais d’institutions socialisées soumises à la délibération publique (sécurité sociale, services publics, institutions culturelles publiques, etc.) et, d’autre part, ceux qui le restreignent à sa dimension monétaire, privilégiant le marché et le système des prix dans l’organisation de l’ordre social. C’est à ce moment, dès les années 1940, que non seulement Friedman, mais également des économistes socialistes, commencent à privilégier les transferts monétaires en matière de redistribution plutôt que les grandes politiques sociales et interventions macroéconomiques. Par là même, cette gauche, ce « socialisme de marché », a vidé de tout contenu politique collectif la notion d’égalité. Elle se pose au sein de l’espace de marché et non en opposition à celui-ci. L’espace démocratique se trouve disjoint de la sphère économique.

[Laurent Gilson | Ballast]
Cette question de l’allocation universelle semble un point d’entrée pour comprendre ce que Foucault entend par l’autonomie du sujet, et la limite de l’usage qu’on peut en faire dans une perspective socialiste…
Daniel Zamora : Je pense effectivement que si l’on peut imaginer qu’une version « maximaliste » de l’allocation universelle puisse augmenter l’autonomie du sujet — pour peu qu’elle soit à même de voir le jour, ce dont je doute —, il n’en reste pas moins qu’elle n’envisage aucune forme d’espace politique collectif. Reprenons l’exemple de la division du travail. Aujourd’hui, celle-ci est extrêmement inégale : elle permet à certains de jouir d’un travail épanouissant et bien rémunéré, et à d’autres d’être cantonnés à des emplois parfois socialement très utiles mais aux conditions éprouvantes. Cette situation est ce qui rend l’allocation universelle intéressante : elle semble attractive pour tous ceux qui sont les perdants de la compétition sur le marché du travail. Cependant, admettons que l’on puisse octroyer à tous un montant d’argent qui lui permette de choisir ce qu’il veut faire dans la vie. La question qui se pose immédiatement est de savoir si l’agrégation des désirs individuels mènera à une division effective du travail. À ce que tous les créneaux (tâches, fonctions, occupations…) nécessaires au fonctionnement d’une société complexe soient remplis. Généralement, on s’accorde pour dire : « Probablement pas. » Certaines positions risquent d’être désertées et d’autres surpeuplées. Bien entendu, le capitalisme ne produit pas non plus une division optimale du travail, il produit néanmoins une division qui fonctionne sous un certain angle, mais à l’aide de dispositifs très coercitifs. Des pans entiers de la société vont être relégués dans certains emplois et d’autres pas… Cette relégation ne se fait pas par consentement mais par contrainte, notamment pécuniaire. En ce sens, l’autonomie du sujet n’est pas grand-chose si elle ne s’accompagne pas d’une réflexion sur les mécanismes politiques et collectifs qui peuvent démocratiser des questions telles que celle de la division du travail. Qui permettent de penser, et non de fuir, le problème de la contrainte et de la normalisation. On ne peut, aussi regrettable que ce soit, produire un ordre social juste par la simple agrégation de nos volontés individuelles.
Il y a une formule éculée, consensuelle et donc facile : « penser avec et contre Foucault ». Doit-on conclure de cet échange qu’elle reste malgré tout indépassable ?
« L’autonomie du sujet n’est pas grand-chose si elle ne s’accompagne pas d’une réflexion sur les mécanismes politiques, telle que celle de la division du travail. [D.Z.] »
Daniel Zamora : Le plus précieux chez Foucault, c’est sa fascinante capacité à penser contre lui-même. Ce qu’il nous apprend, c’est précisément à nous déprendre de nos réflexes intellectuels, de constamment penser contre soi. Il nous invite à se frotter réellement à d’autres pensées, concepts, à les prendre au sérieux et à expérimenter en leur sein. C’est admirable. Beaucoup d’intellectuels ont à apprendre de cela. Comme « attitude » intellectuelle, il m’est précieux : il n’y a rien de plus stérilisant pour la pensée que notre tendance spontanée à ne lire que ce qui confirme nos idées précédentes. En ce sens, la démarche de Foucault ne nous a peut-être jamais été aussi précieuse aujourd’hui, à un moment où nous avons un besoin pressant d’innovation. Mais sa fameuse « boite à outils », elle, s’avère beaucoup moins en phase avec les problèmes auxquels nous avons à faire face. Elle est prisonnière d’un contexte désormais très éloigné du nôtre.
Jean-Yves Pranchère : Je pense que Foucault est une ressource sans qu’on ait besoin d’être foucaldien. Oui, il n’y a pas chez Foucault une théorie du socialisme, de l’autonomie collective. Mais ne nous cachons pas qu’un « dépassement du capitalisme » qui ne répète pas les monstruosités totalitaires des régimes marxistes-léninistes est une chose hautement difficile à penser. On ne reviendra pas en arrière de la critique du marxisme menée par Foucault : il est bien vrai, comme il le disait, qu’il y a deux Marx — un Marx historien, intelligent et lucide, et un Marx prophétique dont les prophéties « étaient presque toutes fausses ». Il est bien vrai que ce qu’on a appelé « marxisme » s’est organisé autour des prophéties les plus vagues de Marx (une « révolution » au contenu indéterminé, purement négatif : disparition de l’État et du marché) pour fonder en elles le principe délétère de la toute-puissance d’un Parti conçu comme seule existence possible du « prolétariat en tant qu’unique sujet individuel5 ». La question est donc : devons-nous reprocher à Foucault, dans un contexte où l’urgence était la lutte antitotalitaire, de ne pas avoir parlé de ce dont il n’a effectivement pas parlé, et devons-nous en conséquence accuser ses manques, ou devons-nous nous poser à nous-mêmes la question de savoir comment les combler ?

[Laurent Gilson | Ballast]
Reste cette iconisation de Foucault…
Jean-Yves Pranchère : Il est certain qu’il y a eu « iconisation ». Elle n’est pas bonne, et elle produit des contre-attaques réactionnaires qui ne sont pas bonnes non plus. Mais sortir de ce cercle ne nous demande pas tant d’abandonner Foucault que de le réinscrire dans une configuration intellectuelle plus large où figurent en contrepoids des penseurs de l’autonomie sociale. Si notre tâche est de penser les moyens d’un renouveau du projet de démocratie sociale, Foucault a du moins le mérite de nous avoir rendus attentifs aux processus de normalisation inapparents, ce qui permet à ses héritiers contemporains de poser la question de la normativité du marché, par exemple sous la forme de la « gouvernementalité algorithmique ». Dans un livre récent, Myriam Revault d’Allonnes a proposé une reformulation de la notion foucaldienne de « régime de vérité »6 pour proposer une analyse et une critique opératoire de ce qu’on appelle aujourd’hui la « post-vérité ». On peut donc inscrire Foucault, malgré tout, dans l’horizon de la modernité au sens des Lumières et de Kant. Cela doit être souligné, même si on ne le suit pas dans son diagnostic sur le présent.
- D’où la lecture trop unilatérale qu’en donnent Christian Laval et Pierre Dardot dans La Nouvelle raison du monde, lecture que Serge Audier (Penser le « néolibéralisme » — Le moment néolibéral, Foucault, et la crise du socialisme) a critiquée avec de bons arguments que prolongent les travaux de Daniel Zamora [nda].[↩]
- Voir Janet Afary and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution — Gender and the Seductions of Islamism, University of Chicago Press, 2005. Olivier Roy a tenté de défendre Foucault dans « L’énigme du soulèvement. Foucault et l’Iran », Vacarme 29/2004 [nda].[↩]
- Voir Goulven Boudic, « Michel Foucault et la social-démocratie : retour sur un rendez-vous manqué », L’Aventure démocratique. Cheminements en compagnie de Jean Baudouin, Presses universitaires de Rennes, 2017.[↩]
- Il faut rappeler le poids qu’a eu sur Foucault la pensée de Georges Canguilhem. Dans une conférence de 1980 (« Le Cerveau et la Pensée », G. Canguilhem, philosophe, historien des sciences), Canguilhem soulignait que la notion de « sujet » avait deux sens très différents : d’une part, comme chez Descartes, l’intériorité d’une conscience ou d’une subjectivité créatrice, source de son monde ; d’autre part, comme chez Spinoza, la vigilance d’un rapport critique au monde et d’une fonction de « sur-veillance » [nda].[↩]
- Voir Michel Foucault, « La méthodologie pour la connaissance du monde : comment se débarrasser du marxisme » (1978), Dits et Ecrits, texte n°235 [nda].[↩]
- La Faiblesse du vrai — Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, Seuil, 2018. Myriam Revault d’Allonnes note qu’une des faiblesses de Foucault est paradoxalement d’être resté trop rivé au partage platonicien entre vérité et opinion. La morale du « dire-vrai » (ou parrêsia) fait selon elle obstacle à la pensée d’une véritable politique de la vérité, qui suppose qu’on accepte de chercher avec Aristote et Arendt les voies de la rationalité propre au sens commun [nda].[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Christian Laval : « Penser la révolution », mars 2018
☰ Lire notre entretien avec Arnaud Tomès et Philippe Caumières : « Castoriadis — La démocratie ne se limite pas au dépôt d’un bulletin dans une urne », janvier 2018
☰ Lire notre article « Lire Foucault », Isabelle Garo, février 2016
☰ Lire notre entretien avec Daniel Zamora : « Peut-on critiquer Foucault ? », décembre 2014


