Entretien inédit sur le site de Ballast
L’estime que Frédéric Lordon porte à Pierre Bourdieu est connue. Et il ne fait pas l’ombre d’un doute que le premier reprendrait à son compte les mots du second, malmenant dans l’un de ses livres « l’illusion biographique », la psychologie et le genre autobiographique. On l’entend très bien. Mais on entend aussi que l’analyse sociologique n’épuise pas tout et qu’il y a, quand même, matière à discuter la chair et l’os. C’est donc, dans le cadre de ce dernier volet (et toujours dans l’arrière-salle d’un café), que nous avons tenté d’y voir plus clair : comment celui que tout destinait à devenir consultant financier s’est-il retrouvé à être l’une des voix contemporaines du communisme ? Lordon rechigne à parler de lui autrement que du bout des lèvres ; « tenter » est le bon mot.

Un événement administratif. J’ai changé de section au CNRS : j’étais chez les économistes, jusqu’en 2012. À force, ils voulaient me foutre dehors, je voulais partir, on devait finir par s’entendre. J’exagère un peu avec la réduction à l’événement administratif, qu’on lira plus adéquatement comme un scrupule de ma part à endosser sans autre forme de procès la qualité de philosophe, pour laquelle j’ai un grand respect et que, n’ayant pas suivi son cursus propre, je ne me permettrais pas d’usurper. Et puis tout de même : ça faisait un moment que le spinozisme prenait de plus en plus de place dans mes travaux — il y avait quand même une logique intellectuelle à ce déplacement institutionnel. Ma chance tient à ce que les philosophes, finalement, aient la définition la plus souple de leur propre discipline, et continuent d’une certaine manière de se tenir à ce magnifique adage de Canguilhem pour lequel « il n’y a pas de matière étrangère pour la philosophie ». J’apportais « ma » matière, prise dans l’économie politique et les sciences sociales, et ce que j’en faisais à l’aide de ma lecture de Spinoza a paru pouvoir se couler dans l’idée que les philosophes du CNRS se font de leur travail. Et puis il y a aussi que les philosophes sont les derniers à valoriser comme ils le font l’écriture de livres, et pas seulement les articles de quinze pages — formidable respiration. Il reste, quant au fond, que je continue de me situer dans un entre-deux un peu indistinct, qui n’est plus tout à fait des sciences sociales mais pas encore complètement de la philosophie — mais la condition a‑topique1 ne m’a jamais déplu.
Fidèle au Bourdieu de l’Esquisse pour une auto-analyse, vous refusez de céder du terrain à l’autobiographie, à la figure de l’auteur, à la narration individuelle. Mais tout le monde n’appelle pas, un jour, à « bloquer » la société au nom de « l’insoumission » et de « l’affranchissement » lors d’une occupation de place ! Pas d’individu-roi, soit, mais demeure tout de même ce que vous appelez vous-même l’ingenium2, les dispositions singulières et psychiques, affectives ! Pourquoi serait-ce déplacé de chercher à comprendre comment, tout « socialement disposé à atterrir chez les dominants » que vous étiez, le train a déraillé ?
« Je continue de me situer dans un entre-deux un peu indistinct, qui n’est plus tout à fait des sciences sociales mais pas encore complètement de la philosophie. »
C’est une enquête qui n’aurait assurément rien de déplacé. Tout et tous sont offerts à la reconstitution de leurs déterminations. Pour ce qui me concerne, ce qu’il y aurait à reconstituer est de l’ordre d’une bifurcation, car, en effet, c’est une histoire de déraillement. La question est de comprendre comment un fils de la bourgeoisie, qui n’a jamais connu qu’une vie de bourgeois, a été épargné de toute difficulté matérielle, a suivi le cursus honorum auquel le prédéterminait sa classe (Les Ponts, le MBA d’HEC), qui du reste se voyait lui-même dans ces années-là — 1986 — appelé à une carrière de winner, la question est de savoir comment cet individu, par glissements successifs, se retrouve d’abord chercheur plutôt que consultant chez McKinsey (je me souviens d’avoir envoyé le montant de ma bourse doctorale à l’enquête « salaires » d’HEC exprès pour tirer la moyenne vers le bas), économiste hétérodoxe, symboliquement pouilleux, plutôt qu’orthodoxe, philosophe (donc au fond de l’inutilité), et pour finir debout sur des palettes place de la République. Soit une trajectoire qui contredit en tout ce qu’une sociologie (trop) simple aurait fait dire à mes conditions initiales. Précisément parce que la sociologie n’est plus suffisante, je ne peux pas répondre à votre question. Et ceci parce que, cette histoire convoquant des déterminations tout à fait idiosyncratiques3, sans doute pour partie de l’ordre de l’inconscient, d’abord il n’est pas dit que j’en aie moi-même le fin mot, ensuite parce que même si je l’avais, je ne vous le donnerais pas.
Ici, cependant, je m’avoue à moi-même d’une incohérence indéfendable : car, sans doute projectivement, j’ai une passion particulière pour les histoires de bifurcations individuelles, les histoires de déraillement, les naissances tardives (à la politique, à l’intellectualité), et qu’il n’y a pas plus fascinant, et plus approprié à l’enquête spinoziste, que ces « bascules » — ici, par excellence, le concept d’ingenium montre sa supériorité sur celui d’habitus, en l’occurrence son plus grand pouvoir de résolution, comme on dit en optique. L’incohérence, en tout cas, c’est que là où pour ma part je renâcle à parler davantage, j’ai terriblement envie d’en faire parler d’autres. Et, là où Chantal Jaquet s’est intéressée à la bifurcation proprement sociologique des transclasses, rien ne m’intéresserait plus que de faire une enquête sur les bascules politiques, les bascules de la croyance. Il se trouve que je reçois assez régulièrement des mails de personnes qui me racontent des histoires de tangentes très impressionnantes. Et puis je pense à Nicolas Fensch qui a raconté lui-même sa propre diagonale, du gaullisme au cortège de tête, en passant par le Quai de Valmy et la prison. Ce sont des histoires extraordinaires, fascinantes, qui incidemment, au-delà de leurs cas, disent une période de crise, c’est-à-dire une période où des degrés de liberté s’ouvrent, et où l’on voit s’opérer des déplacements normalement inconcevables.

[Stéphane Burlot | Ballast]
En 1988, vous votez pour qui ?
Juquin au premier tour, le communiste réformateur. Deux ans avant, je votais RPR aux législatives : conscience politique de bulot, mimétisme parental de classe, c’est vous dire si je reviens de loin ! (rires) Le tout sur fond d’inculture crasse en tout. Car jusqu’à un âge avancé je ne m’intéresse qu’à la physique et à la littérature alpine, vous voyez le tableau. J’ai toujours été très impressionné par des personnes, il est vrai généralement passées par la khâgne, qui avaient lu les Méditations métaphysiques ou la Recherche du temps perdu à 15 ans. Moi à 15 ans, je lis Montagnes Magazine… (rires) Et puis un jour de décembre, j’avais 22 ans, pensant expédier avec un livre quelconque un cadeau de Noël, je suis entré dans une librairie — La Hune. Et là d’un coup, sans crier gare, ça m’est tombé dessus : la Pentecôte ! Claudel et son pilier4. D’abord, cerné par tous ces livres, le scandale de ma propre ignorance. Ensuite la certitude absolue que j’avais trouvé mon lieu. Spinoza a vraiment raison : nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Et il n’y a pas plus belle lecture de cette phrase énigmatique que celle qu’en fait Deleuze : même le dernier des abrutis, un jour il comprend un petit quelque chose — ne serait-ce, comme moi ce jour-là, qu’il y a quelque chose à comprendre. Et c’est ça l’éternité au présent de l’indicatif.
Et la rencontre avec le marxisme se produit à quel moment ?
« Je n’ai pas cessé de rectifier mon agenda de pensée à la lumière des événements de l’époque — et elle n’en a pas été avare. »
Très vite, et par l’économie. L’économie, c’est ma solution synthétique de bifurcation : les maths (les Ponts), les « choses de l’économie » (HEC), le tout arrimé à l’intuition qu’un bon moyen, peut-être le meilleur, de tenir un point de vue critique sur la société contemporaine suppose de l’attraper « par l’économie ». Je vais au séminaire de DEA de Robert Boyer : il enseigne la théorie de la régulation, d’inspiration marxienne. J’ai lu le descriptif du séminaire, je n’ai à peu près rien compris, mais lorsque je l’entends parler je sais instantanément que c’est ça que je veux faire. J’avais urgemment besoin d’une éducation intellectuelle : l’hétérodoxie régulationniste me l’a donnée, marxisme compris.
Votre premier ouvrage est paru en 1997 : dans quelle mesure l’époque, et ses événements mondiaux, a‑t-elle pesé sur le développement de votre sensibilité idéologique ?
Dans une mesure qui n’a pas cessé de se confirmer — et d’illustrer une vérité très générale : on pense dans une conjoncture. Ce premier livre était marqué par la découverte des marchés financiers comme instance normative surveillant et déterminant les politiques économiques. Ici se diagnostiquait la migration de la souveraineté : abandonnant les corps politiques, captée par le capital financier. Depuis, je n’ai pas cessé de rectifier mon agenda de pensée à la lumière des événements de l’époque — et elle n’en a pas été avare : montée du pouvoir actionnarial, récurrence des crises financières. Mais la grande percussion, comme pour beaucoup, c’est la crise de 2008 : éveillé à l’intellectualité dans la deuxième moitié des années 1980, en plein libéralisme triomphant, c’est-à-dire en pleine éradication du marxisme, je réalise en 2008 combien sans m’en rendre compte j’en ai pris le pli, et que je ne me suis jamais posé à moi-même la question anticapitaliste à proprement parler. Je réalise à quel point même des économistes hétérodoxes se disant marxistes comme ceux de la régulation avaient évacué cette question de leur paysage de pensée. Je me souviens de l’avoir écrit dans la Revue de la régulation en 2009, en rappelant la conclusion de l’un des ouvrages fondateurs de la théorie de la régulation5, qui appelait à penser la résolution de la crise du fordisme pas seulement dans les coordonnées d’une transition d’un régime d’accumulation à un autre, donc dans le capitalisme, mais éventuellement dans celles de la sortie du mode de production capitaliste lui-même. C’était en 1978 — derniers feux. Et il n’en a plus jamais été question pour trente ans. C’était quand même un fameux loupé collectif, et j’en avais été partie.
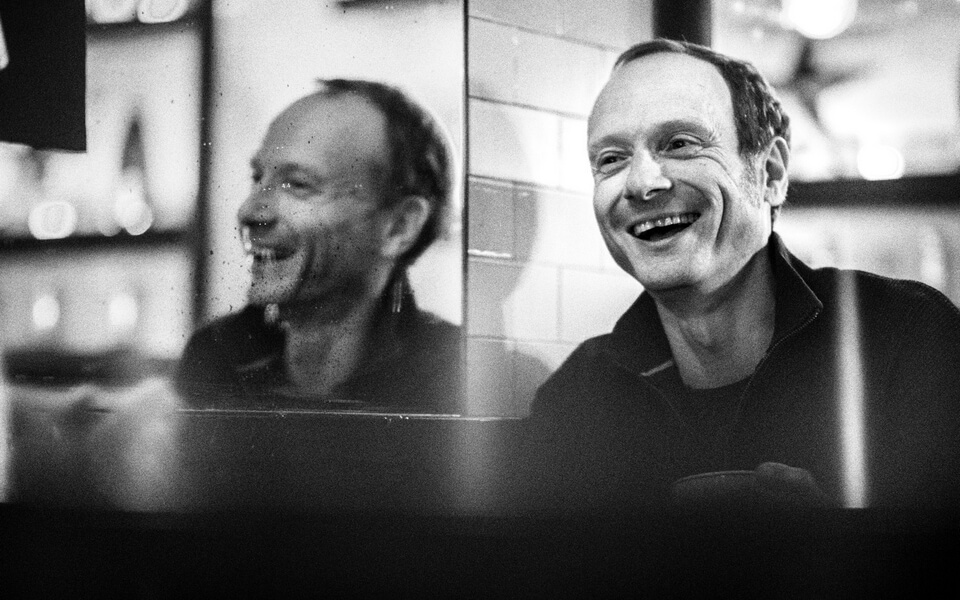
[Stéphane Burlot | Ballast]
« Je suis venu à l’idée communiste
par inadvertance », avez-vous dit un jour.
Voilà, tout est dit. C’est un aveu, cette « inadvertance ». Quand je relis cet entretien, je prends la mesure des déplacements. Je me fais un peu honte aussi.
Votre adhésion au communisme s’est faite via la res communa, la « récommune », bref, la chose commune. Mais le communisme n’est pas qu’une idée : c’est aussi une pratique, une histoire et même une mythologie, avec ses récits, ses moments épiques et ses martyrs. Quel rapport entretenez-vous avec tout ça ?
Un rapport de constitution tardive, mais puissamment moteur — comme l’est un imaginaire politique, cette chose mentale collective qu’on fabrique avec de la réalité historique. De constitution tardive et continuée, où n’en finissent pas de venir s’intégrer de nouvelles histoires. Par exemple, celle de l’Autonomie italienne qui, à part les « survivants » réfugiés en France, n’existerait pas (ou si peu) dans les têtes sans les transmissions de La Fabrique, de Marcello Tari à Tiqqun, des éditions de l’éclat qui traduisent La Horde d’or ou de la revue Période. C’est fou comme ça tient à peu de choses, et à peu de gens, que le fil d’une mémoire de lutte ne se brise pas complètement. Mais ce qui est encore plus fou, c’est que celui-ci ait failli se briser quand il s’agit sans doute de l’un des événements politiques les plus considérables de l’histoire européenne contemporaine. Si l’Autonomie italienne n’entre pas dans nos imaginaires politiques, mais alors qu’est-ce qui a droit d’y entrer ?
Vous aviez avancé que, sans tomber dans le fétichisme, le marxisme était la « meilleure éducation intellectuelle possible ». Vous semblez avoir tout de même pris une certaine distance. Inversons donc : sur quel point n’êtes-vous pas, mais alors pas du tout, marxiste ?
« Si l’Autonomie italienne n’entre pas dans nos imaginaires politiques, mais alors qu’est-ce qui a droit d’y entrer ? »
La théorie de la valeur, la philosophie de l’Histoire, la politique du dépérissement de l’État — trois fois rien… À ce compte-là, évidemment, la question se renverse : me reste-t-il quoi que ce soit de marxiste dans ces conditions ? Ma réponse est oui, et l’essentiel : le matérialisme comme réalisme des forces sociales, et notamment comme démoralisation positive de la politique, et puis la création du concept structuraliste de « capitalisme ». Le capitalisme, dont Marx crée le concept, comme configuration de rapports sociaux contradictoires, par-là essentiellement conflictuels. Eh bien ça, oui, ça fait une éducation intellectuelle, et une méthode.
Vous assumez le statut d’« intellectuel engagé ». Et, en compagnie de Charles Piaget [ancien syndicaliste de Lip, ndlr] et des travailleurs Ecopla, avez dit en 2016 vous tenir « à [leurs] côtés ». Sartre a employé la même formule et précise qu’il s’est « rangé » aux côtés de la classe ouvrière et paysanne pour « tenter de résoudre [s]a contradiction », en tant qu’intellectuel bourgeois. Est-ce une « tension », c’est là aussi son mot, qui trouve quelque écho en vous ?
Aucunement. Sous ce rapport, je ne me sens aucune tension à résoudre — et encore moins aucune culpabilité à expier. Mes origines de classe sont ce qu’elles sont. Elles ne m’inspirent aucune fierté et aucune honte. Je les prends comme un fait purement positif6, offert à ma propre réflexivité et à l’objectivation par qui voudra — mais je viens d’indiquer que ceux qui le voudraient manqueraient en fait de tout pour y procéder. Je ne peux pas m’empêcher de voir toute la trajectoire de Rancière, depuis La Leçon d’Althusser, comme un long rachat de la « mauvaise » position de classe, la position bourgeoise-professorale. Qu’on pense les effets sur soi de sa propre position sociale, c’est assurément une exigence élémentaire de réflexivité. Mais qu’on en souffre quand c’est celle-là — il y a quand même des positions de classe plus douloureuses… —, et qu’on la laisse produire ce type d’effet, je ne l’ai jamais bien compris (mais l’intéressé me démentirait peut-être aussitôt et me dirait que je fabule tout à fait). C’est sans doute là l’effet d’un pli des années 1960 et 70, où volaient bas les bruyants procès sur le thème « Comment peut-il parler de la classe ouvrière sans être ouvrier ? », et les tentatives de culpabilisation, d’ailleurs résurgentes, qui ont toujours rappelé quelle part de flic, de procureur et de curé il y avait chez certains gauchistes — du reste incapables de saisir la différence pourtant élémentaire entre « parler de » et « parler au nom de ». Parler « au nom de », pour le coup, c’est la chose qu’il ne me viendrait à aucun moment à l’idée de faire — il faudrait avoir perdu la boule. C’est d’ailleurs pourquoi, si je peux parfaitement endosser la catégorie d’intellectuel engagé, en aucun cas je ne revendiquerais celle d’intellectuel militant. Être militant, j’ai une petite idée de ce que ça suppose de servitudes — se lever aux aurores pour tracter à l’embauche, être physiquement sur les lieux où l’on lutte, passer des mauvaises nuits d’occupation, bref agir autrement qu’en mots. Et je sais que ça n’est pas ce que je fais, je sais quelle est ma place dans la division du travail politique — seconde.

[Stéphane Burlot | Ballast]
La condition de l’intellectuel critique, dites-vous, est de critiquer les pouvoirs et de se tenir à distance des partis. Daniel Bensaïd avait moqué, dans Une lente impatience, l’intellectuel « franc-tireur », le « compagnon de route » qui tient à préserver sa petite liberté. Comprenez-vous cette critique ?
J’étais tenté de répondre spontanément oui, mais en fait non. Je pense que c’est une critique qui procède d’un mouvement d’universalisation de sa propre position, ce qui est toujours une opération sujette à caution. En matière d’intervention intellectuelle, je ne crois absolument pas qu’il y ait une one best way, et, puisque je viens d’employer le mot, la chose à laquelle je crois le plus en cette matière, c’est la division du travail : la diversité de ses segments, ses complémentarités. Par exemple, je m’entends souvent reprocher ma position d’abstention, tout de même relative, disons de rareté, vis-à-vis des médias. Ne faut-il pas au contraire y aller autant qu’on peut, ne pas abandonner le terrain, cogner pour faire exister d’autres discours, etc. ? Les deux positions ne sont contradictoires que si on les universalise, or je pense que la division du travail leur donne une place à chacune. En tout cas, il ne me viendrait pas un instant à l’esprit d’universaliser la mienne. Et de même dans le rapport aux institutions et aux organisations de pouvoir. Je pense, là aussi, qu’il y a une place « au-dehors », que cette place a du sens, et qu’elle complète avantageusement celle du « dedans », qu’elles se régulent l’une l’autre. Cependant, je continue de croire, en général, que les institutions sont plus fortes que les individus et qu’elles les mangent, qu’elles les digèrent, sans même qu’ils s’en rendent compte. Quoique théorisant la nécessité du fait institutionnel, je pense que la vie dans les institutions est, presque aussi nécessairement, une sorte de désastre, une colonisation, une obturation, parfois même une mortification.
« J’aurais du mal à renoncer à la possibilité de côtoyer des groupes ou des tendances de la gauche réputées irréconciliables. »
Alors oui, je connais aussi des exceptions. D’abord parce qu’il y a quelques institutions moins pires que les autres, et parce qu’il y a aussi quelques individus plus forts que les autres, plus capables de résister à la phagocytose, de maintenir, envers et contre l’institution, des nuques raides. Que Daniel Bensaïd ait été fait de ce métal, c’est l’un des motifs d’admirer sa personne. Si je pense qu’il y a une contradiction essentielle dans l’expression « intellectuel militant » (je me rends compte qu’il y aurait énormément à dire pour soutenir convenablement cette assertion lapidaire), je vois aussi que Bensaïd aura déjoué l’oxymore. Il était capable aussi bien de la hauteur de vue théorique que de la pensée stratégique la plus pénétrante. Et d’être par-dessus le marché un homme d’organisation, conjonction des plus rares en un seul homme de dispositions aussi hétérogènes, peut-être même contradictoires. Deux personnes nous manquent beaucoup ces temps-ci, chacune dans leur genre d’ailleurs : Bourdieu et lui. Cependant, comme les exceptions ne font pas des lois générales, je peux à la fois admirer Bensaïd et continuer d’entretenir la plus grande méfiance vis-à-vis des appartenances organisationnelles, non pas en soi bien sûr, mais du point de vue qui est le mien, celui d’un chercheur ou d’un intellectuel, s’il est engagé. Je ne peux pas me défaire de l’idée que les institutions, les organisations, imposent des formes, le plus souvent très insidieuses, de rétrécissement. Quoi qu’elles en aient, les organisations produisent des ostracismes. Or j’aurais du mal à renoncer à la possibilité de côtoyer des groupes ou des tendances de la gauche réputées irréconciliables.
De la France insoumise à lundimatin, média lié au Comité invisible.
Oui. C’est peut-être une tournure bizarre, mais je trouve à penser avec égal intérêt dans des positions politiques ordinairement données pour incompatibles, et je n’ai aucune envie d’appartenir exclusivement à une seule. Ce qui ne signifie évidemment pas que la synthèse que j’en fais fasse parts égales à toutes ses composantes.
C’est là votre disposition personnelle aux « bords ».
J’ai une détestation pour le milieu et les milieux. Et une hantise pour l’homogène, ou le monoidéïsme. Alors oui : plutôt les bords, les bordures et les interfaces, avoir plus d’une idée, fréquenter plus d’un milieu.
Mais vous ne pourriez pas mettre ces gens à la même table…
« Sérieusement, vous m’imaginez en deal maker ? De toute manière, je suis bien certain que je serais l’homme politique le plus navrant de l’univers. »
Sérieusement, vous m’imaginez en deal maker ? (rires) De toute manière, je suis bien certain que je serais l’homme politique le plus navrant de l’univers : c’est le genre de chose qui n’entre pas dans ma complexion. Dans la série des projections sauvages, je me souviens de ce que j’ai lu me concernant pendant Nuit Debout : que j’étais en train de faire main basse sur le mouvement, que j’en tirais les ficelles dans l’ombre, et même que je préparais ma candidature présidentielle. Il n’y a guère d’intensificateur de délire comme l’exposition publique, surface projective offerte à toutes les fabrications. Mais j’ai répondu un peu de travers : on peut se retrouver à une même table pour autre chose que passer des deals : pour se rencontrer. Chose intéressante, si elle est de petite échelle, il y a cette nouvelle commensalité politique : des amis-hôtes qui ont su organiser des rencontres improbables. Il en est même sorti une ou deux choses.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Vous revendiquez vouloir « produire des effets politiques » sans toutefois être un homme politique. Entre nous, et sans modestie : pensez-vous, au terme de deux décennies de publications et d’interventions dans l’espace public, être parvenu à imprégner le champ politique critique français ?
Je n’en ai pas la moindre idée. En fait je suis incapable de répondre à une question pareille. Je vais sembler donner une raison tout à fait idiote mais c’est la vérité : je n’habite pas dans Paris mais en banlieue, j’ai un bureau à l’EHESS que je n’occupe pas et laisse d’autres utiliser, je travaille chez moi dans une condition d’isolement assez prononcée. Certes, j’ai un ordinateur et une connexion. Et cependant cet éloignement physique minimal suffit à ce que tout ce qui me concerne m’arrive très étouffé, amorti. C’est là qu’on aperçoit combien la réception de certaines informations suppose la socialisation physique : dans les lieux de la circulation. Or je ne bois pas des coups dans les bistrots du XXe ; je hais la mondanité intellectuelle dînatoire, lieu par excellence de macération des rumeurs et des jugements. Donc quant à mesurer les effets politiques qu’auraient mes interventions, vous voyez comme il m’en manque. La seule manière d’en apercevoir quelque chose, c’est quand je reçois des mails de personnes que je ne connais pas, pour le coup des « basculés », des « bifurquants », et ça c’est toujours très émouvant, ça rachète de tout.
Vraiment, vous ne cherchez pas à connaître les répercussions de vos écrits ?
« La multitude peut propulser des gens au firmament et les déchiqueter aussitôt après. »
En exagérant un tout petit peu, je pourrais dire que je cherche plutôt à ne pas les connaître. N’étant pas fait d’une autre étoffe que quiconque, et aussi parce que ce sont des choses qui entrent dans le champ de mes réflexions théoriques, je vois le désastre possible de l’asservissement à la notoriété. Quand elle est de petite échelle, c’est très agréable, et gratifiant : se faire alpaguer dans une manif et discuter, ou recevoir de temps en temps ces mails dont je vous parlais, c’est une joie. Mais dès que ça passe un cap, c’est terrible. Et c’est assez simple à comprendre : la notoriété, c’est un affect commun d’amour, or le conatus, spontanément, ne cherche rien d’autre que la reconduction, voire l’extension, de ses joies. Le risque, c’est, sans même s’en rendre compte, de ne se mettre plus à écrire et à parler qu’en vue de cette reconduction, à retenir ce qui pourrait l’entamer, ce qui pourrait aliéner de l’amour. C’est ça le désastre. Mais pas seulement. Dans la nuit du 31 mars 2016, j’ai quitté la place de la République vers 4 heures du matin pour rentrer chez moi dans un état d’angoisse indescriptible : je me suis vu saisi par la multitude — Dieu sait qu’elle n’était pas bien grande. Sauf pour les gens qui sont mus par ce désir incoercible, c’est un sentiment très perturbant, un sentiment de dépossession, de ne plus s’appartenir à soi-même, de devenir la chose de la multitude.
Quelques mois après Nuit Debout, des journalistes, persuadés de la réponse qu’ils comptaient obtenir, m’ont demandé si cette expérience avait modifié mes conceptions de philosophie politique. Grande déception de s’entendre dire qu’au contraire elle les avait toutes confirmées. C’est que « ce que peut la multitude » est au centre de mes réflexions depuis quinze ans, j’ai donc eu longuement le temps d’y penser. Et, en effet, même si ça n’était que sur le papier, je savais de quoi elle est capable : de propulser des gens au firmament et de les déchiqueter aussitôt après. Si je peux m’autoriser un moment promotionnel, il y a dans La Condition anarchique plusieurs passages sur ce sujet, notamment sur les notoriétés de réseaux sociaux, ainsi qu’une théorie du miracle et de la malédiction, toutes choses dont la multitude a le pouvoir. Sauf à être totalement inconscient, on ne se laisse pas emparer comme ça par ce genre de forces. Et puis même : on n’en connaît que trop des gens que la notoriété a fait tourner du caillou. Moralité : je me tiens à distance de ses échos pour retarder autant que possible le moment où je viendrais à passer le 38e parallèle.

[Stéphane Burlot | Ballast]
À défaut de vous pencher sur la réception présente, l’idée de « faire œuvre », de penser une cohérence, un bloc théorique et pratique à long terme, vous traverse-t-elle ?
Ça, oui. En tout cas pour ce qui est du bloc théorique. Oui, cette idée, elle a été présente du moment où j’ai négocié ma bifurcation spinoziste, où j’ai acquis en très peu de temps la plupart des idées sur lesquelles je vis encore, où j’ai vu que cette affaire allait me tenir pour un moment, et que je voulais au bout du compte la conduire à un point de consistance qui la rendrait en quelque sorte considérable — littéralement : qui ne peut pas ne pas être considérée (après, ce qu’on en fait, c’est une autre histoire). C’était en 2001–2002 et je me souviens m’être explicitement dit que je me donnais vingt ans sous le découpage suivant : pendant cinq ans je vais passer pour fou dans mon milieu (les milieux…) — et ça n’a pas loupé ; au bout de dix ans il faut que les gens voient qu’« il y a quelque chose » ; au bout de vingt que ça ait produit des intéressés. C’est à la fois peu et beaucoup comme ambition. C’est une ambition d’inscription. Mais celle-là, je la revendique.
En 2016, vous lanciez : « C’est que tout craque dans la société présente, et que le point de rupture pourrait n’être plus si loin. » Deux ans plus tard : « C’est en train de décrocher partout, dans plein de secteurs de la société française ». Dans quelle mesure l’agitateur, disons même le tribun, cherche-t-il à entraîner le chercheur au long cours et au sang froid ?
« Il se pourrait que j’entretienne le personnage de l’intervention pour ne pas laisser celui de la recherche couler à pic dans la dépression politique… »
Ce sont deux personnages qui cohabitent de manière parfois burlesque dans la même enveloppe. En tout cas qui savent et acceptent de ne pas composer une unité parfaite. Comment le pourraient-ils d’ailleurs ? Les jeux de langage de l’intervention et de la théorie sont trop hétérogènes pour coïncider parfaitement. Par exemple, je soutiens des énoncés sur le plan de la théorie qui deviennent de telles enclumes dans celui de l’intervention que je n’essaie même pas de les y accommoder — alors je glisse. Inversement, il entre dans le registre de l’intervention politique de jouer du performatif, c’est-à-dire de produire des énoncés délibérément en excès de ce que l’analyse positive pourrait soutenir, aux fins de faire éventuellement précipiter ce qui n’existe pas encore. Des deux personnages, ça n’est donc pas que l’un cherche à entraîner l’autre, mais que chacun vit sa vie. L’un joue le jeu des affects politiques, l’autre est régulé différemment.
« Vient fatalement un moment où les têtes se redressent », avez-vous averti un micro à la main. La pensée déterministe que vous faites vôtre pose, à rebours d’une critique régulièrement adressée au déterminisme, une issue de secours, une rupture. Mais cette rupture prend ici encore l’allure de la fatalité ! Pourquoi sommes-nous condamnés à nous révolter ?
Cas d’illustration parfait. Ce « fatalement », c’est typiquement l’excès du performatif. En réalité, si je me tenais rigoureusement au registre analytique-positif, je crois que je sombrerais dans un pessimisme noir. En définitive, il se pourrait que j’entretienne le personnage de l’intervention pour ne pas laisser celui de la recherche couler à pic dans la dépression politique… Quant à votre question, et d’un point de vue théorique, il n’est pas question de laisser revenir par la fenêtre le fatalisme qu’on a chassé par la porte : comment nous sommes déterminés et par quoi, c’est une affaire… contingente du point de vue de notre entendement fini. Nous ne sommes donc ni condamnés ni « fatalisés » à la révolte. Pas plus qu’à l’oppression. Ce à quoi nous aurons été déterminés, nous ne le saurons que post festum7. Donc on verra bien jusqu’où nos désirs nous auront portés.
- Sans lieu ni endroit précis.[↩]
- Disposition naturelle, tempérament, humeur.[↩]
- Caractères propres au comportement d’un individu particulier, personnalité psychique individuelle.[↩]
- Paul Caudel s’est converti au catholicisme à l’âge de 18 ans, à la Noël 1886, alors qu’il se tenait à côté de la statue de la Vierge du Pilier de Notre-Dame de Paris.[↩]
- Accumulation, inflation, crises, de Robert Boyer et Jacques Mistral, PUF, 1978.[↩]
- Qui peut être posé, qui est de la nature du fait ou se fonde sur les faits.[↩]
- Après coup, trop tard.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Miguel Benasayag : « Il ne faut pas traiter les gens désengagés de cons », avril 2018
☰ Lire notre entretien avec Alternative libertaire : « La sortie du capitalisme est indissociable de l’abolition du salariat », décembre 2017
☰ Lire notre abécédaire de Pierre Bourdieu, janvier 2017
☰ Lire notre entretien avec Jacques Rancière : « Le peuple est une construction », mai 2017
☰ Lire notre abécédaire de Daniel Bensaïd, mai 2015
☰ Lire notre entretien avec Alain Bihr : « Étatistes et libertaires doivent créer un espace de coopération », mai 2015
☰ Lire le texte inédit de Daniel Bensaïd, « Du pouvoir et de l’État », avril 2015


