Texte inédit | Ballast | Série « La Commune a 150 ans »
La Commune détient 74 otages. Elle propose au gouvernement de les lui restituer en échange du seul Auguste Blanqui, alors incarcéré. C’est que l’homme a déjà tout du « mythe » : bientôt trois décennies derrière les barreaux et une opposition inlassable aux pouvoirs en place. Adolphe Thiers refuse — libérer Blanqui, c’est risquer de décupler les forces de l’insurrection. Gaston Da Costa, 20 ans, compte parmi les disciples de ce stratège de l’avant-garde révolutionnaire. Condamné aux travaux forcés à perpétuité après l’écrasement de la Commune de Paris, Da Costa, substitut du procureur durant les événements, reviendra, 30 ans après, sur ces semaines de « drame » avec son livre La Commune vécue. Portrait de l’auteur et fresque d’un courant atypique du socialisme français, le blanquisme, désavoué, depuis, par la plupart des courants marxistes et libertaires. ☰ Par Tristan Bonnier
[lire le quatrième volet de notre série « La Commune a 150 ans »]

« La Commune, après cinq mois de siège, de famine et de honte, c’est le moment de joie. »
Après la guerre extérieure vient la guerre civile en plein Paris, suivie d’émeutes à Lyon, à Toulouse, et ailleurs — le bruit des canons qui tonnent sur les collines de la capitale, le 18 mars, retentit à la Guillotière, au Capitole ; la province se soulève et la France fait parler d’elle dans le monde entier3. C’est la fameuse « Année terrible » : le roi de Prusse, mitraillant la France, vise la couronne impériale et l’obtient à Versailles ; à son tour, Adolphe Thiers, fusillant Paris, vise la présidence et l’obtient au même endroit — de janvier à août 1871, voilà deux appétits satisfaits, au milieu des dégâts matériels de la guerre franco-prussienne. Entretemps, la Commune de Paris bat son plein : en mars, c’est sa proclamation, à coup de brochures, place de l’Hôtel de Ville ; en mai, c’est l’effusion de sang, à coups de baïonnettes, dans le cimetière du Père-Lachaise. On connaît le bilan : environ 20 000 fusillés4, presque autant de mises en procès ; des exécutions pour quelques condamnés ; pour les autres, par milliers : la prison, la déportation, les travaux forcés.
Itinéraire d’un bagnard
Parmi les 270 condamnés à mort de 1872, on trouve un dénommé Gaston Da Costa. Le 3e conseil de guerre lui impute l’incendie du Palais de justice. Son nom apparaît dans une biographie satirique, Le Pilori des Communeux, composée par le plumitif antisocialiste Henry Morel : « Ses amis l’appellent communément Coco. N’étant pas nous-mêmes de ses intimes, nous ignorons l’étymologie de ce surnom, mais nous supposons qu’il fut donné à Da Costa parce que celui-ci était l’alter ego et l’imitateur de Raoul. — Coco, jacquot, perroquet. Da Costa a longtemps promené au quartier Latin ses longs cheveux blonds et ses petites lunettes, qu’il ne quittait jamais, comme s’il eût craint que l’on ne lût dans ses yeux ce qui bouillonnait dans son cerveau ambitieux. Quand il était étudiant, Da Costa, alors âgé de vingt-trois ans à peine, prononça, au congrès de Liège, un discours tendant à démontrer que Dieu n’existait pas, qu’il n’avait jamais existé et qu’il n’existerait jamais. Le catéchisme renversé, quoi ! Cette petite plaisanterie fit renvoyer Coco de l’École de droit par M. Duruy, ministre de l’instruction publique. Mais Da Costa avait organisé, en vue de son expulsion, une émeute en règle qui ne manqua pas d’éclater en effet et que l’on dut réprimer par la force5. » Da Costa à l’école de droit, déclenchant une émeute — voilà un destin tout tracé.

[Umberto Boccioni]
De ce bachelier, de cet insurgé, on sait que c’est le fils d’un quarante-huitard ; qu’il est né à Paris en 1850, ce qui lui donne tout juste 20 ans en mars 1871 ; on sait qu’il logeait rue Thénard, chez son ami et futur procureur de la Commune Raoul Rigault, et qu’il écrivait dans des revues socialistes. Pendant l’insurrection, il soutient le groupe des blanquistes, ces professionnels de l’émeute et de la conspiration qui reprennent les mots d’ordre du grand révolutionnaire Auguste Blanqui, alors en prison6. Son parcours biographique peut être retracé en quelques dates : en 1867, il fait quinze jours de prison après avoir manifesté, place de l’Hôtel de Ville, au passage de l’Empereur Napoléon III ; en 1870, il s’engage comme officier dans le 118e bataillon de la Garde nationale ; condamné à mort en juin 1872, il voit sa peine commuée six mois après en travaux forcés à perpétuité, qu’il va passer au bagne de Nouvelle-Calédonie ; après l’amnistie de 1881, il gagnera sa vie comme répétiteur, écrivant des manuels de pédagogie et collaborant à la revue blanquiste Ni Dieu ni Maître.
« Certains faits divers sont devenus sous la plume des écrivains bourgeois et aristocrates de l’époque des récits sensationnels, des délires carnavalesques sortis de leur contexte insurrectionnel. »
Comme des milliers de condamnés, il a connu le bagne de Toulon et la Nouvelle-Calédonie. Là-bas, il y avait ceux de l’île des Pins, assignés à résidence, et ceux de l’île de Nou, condamnés aux travaux forcés — Da Costa appartient aux seconds. Pendant son voyage de trois mois à bord du « Rhin », 60 communards comme lui sont mêlés à 420 criminels de droit commun. Il faut supporter la déportation en train et en bateau, les repas au pain et à l’eau, les nuits dans les cases et les demi-journées de travaux forcés — terrasses, routes, mines, etc. —, mais aussi l’angoisse de la guillotine, les lettres d’adieu à sa mère, les maladies et les punitions — le martinet à lanières de cuir, qui fait gicler le sang après le troisième coup. Le voyage donne le scorbut, la cellule entretient la phtisie ; sur place, au pénitencier, on risque d’être dénoncés par les codétenus si la rumeur court qu’on cache de l’argent ou des provisions ; il arrive aussi qu’on soit inspecté par le garde-chiourme, c’est-à-dire déshabillé et bastonné par un officier de la marine. Voilà ce qui se passe pendant la décennie où Paris, vidée de sa population ouvrière, se réarme et, si l’on peut dire, se réembourgeoise.
C’est pendant ses années de détention que Da Costa commence de rédiger sa Commune vécue ; elle ne paraîtra qu’en 1903. Le premier tome s’ouvre sur « Le drame de la rue des Rosiers » et le dernier se clôt sur « La Semaine sanglante ». Du 18 mars au 28 mai, les épisodes défilent un à un, dans l’ordre chronologique. Abstraction faite des chapitres sur le bagne et la « Confession » finale, l’auteur ne donne que des impressions rapides de sa propre vie. Il se moque d’ailleurs des autres communards qui, en publiant leurs Mémoires, se sont donnés en spectacle, cherchant avant tout à « intéresser le lecteur à leur seule personnalité7 ». Son objectif consiste plutôt à rétablir la vérité des faits dont il a été témoin et qui ont fait l’objet, dans les décennies qui ont suivi, de déformations honteuses. Car certains faits divers sont devenus sous la plume des écrivains bourgeois et aristocrates de l’époque des récits sensationnels, des délires carnavalesques sortis de leur contexte insurrectionnel. Ainsi de l’arrestation du général Chanzy par des insurgés du 13e arrondissement, ou de l’attaque de la maison de Thiers — ces actes ayant servi de prétexte pour assimiler les communards à des sauvages.

[Umberto Boccioni]
Les mensonges de Maxime Du Camp
Da Costa revient d’abord sur quelques légendes et procédés typiques de la réaction, dont les écrivains ont complaisamment usé, et notamment Maxime Du Camp, l’ami de Flaubert et l’auteur des Convulsions de Paris. Cet ouvrage en quatre volumes est le plus violent réquisitoire écrit contre la Commune. Dès 1872, ironise Da Costa, on battait déjà des records littéraires : beaucoup de « sycophantes » ont souillé la mémoire des communards à force d’opuscules et d’articles à charge, semblables à des vautours planant au-dessus du charnier des vaincus. L’auteur de La Commune vécue relève les invraisemblances et les injures que Du Camp, le plus tenace de ces charognards, assène dans ses écrits. Ce « mouchard de lettres », comme le rebaptise Da Costa, n’hésite pas à réhabiliter un agent secret de la police impériale, à inventer une cour martiale permanente à la mairie du XIe arrondissement, à grossir le nombre des victimes versaillaises, à faire passer les fédérés pour des insensés. Selon Du Camp, Flaubert avait raison : ce qui domine dans la Commune, « c’est la bêtise, au sens originel du mot8 » — le communard, c’est la bête humaine. L’écrivain prend, à l’opposé, la défense du gouvernement de Versailles et fait l’apologie de Thiers, symbole de la civilisation qui se défend contre une attaque à main armée, ou encore de la Banque de France et de l’Église de Rome, autres victimes de la révolte. La fusillade à la Grande-Roquette, l’incendie du palais des Tuileries — tel est à ses yeux le dernier mot de la Commune. Le reste n’est que pillage de tonneaux d’eau-de-vie chez les cavistes et de bonbonnes d’éther chez les pharmaciens.
« Voilà donc ce que sont les communards aux yeux des écrivains réactionnaires : des
aliénés, des cas psychiatriques. »
Le récit de Du Camp ressemble à une collection de faits, tous présentés comme des actes arbitraires, odieux, barbares, du moment qu’ils sont commis par les fédérés. Les prétendus « crimes » de Versailles, ajoute-t-il, sont de la légitime défense. Pour Da Costa, une telle effronterie ne pouvait pas rester sans réponse : « Tels furent constamment les procédés de ce calomniateur d’élite qui, pendant notre exil, empoisonnait l’opinion publique. La plume vengeresse me tombe des mains quand, au moment de réfuter toutes ces ignominies, je lis dans la préface des Convulsions de Paris : “Je n’ai rien avancé qui ne fût démontré, par pièces authentiques (!) Malgré l’indignation qui m’a souvent débordé, j’ai été impartial ; la plus simple loyauté m’en imposait le devoir”. Quand la délation s’accompagne de pareille hypocrisie, on a vraiment honte d’être contraint de la réfuter à la barre du tribunal de l’Histoire9. »
Da Costa, en somme, fait œuvre d’historien. Il se veut réellement impartial dans sa méthode : malgré les redites et les saillies, ses souvenirs personnels se fondent dans une masse de documents et témoignages. À l’opposé, que trouve-t-on dans Les Convulsions de Paris ? Des clichés sur la ville et ses habitants : la Garde nationale dépeinte comme une population d’ivrognes et de fainéants, s’armant d’un chassepot pour toucher les indemnités, fréquentant les cabarets pour s’adonner à la parlotte comme dans les clubs ; des francs-tireurs démoralisés, au lendemain de la défaite, errant dans les rues de Paris, le long de l’avenue d’Italie, les mains dans les poches, le fusil en bandoulière. Des jugements de valeur foisonnent à chaque page, qu’on pourrait relever au hasard. Les Communards ? Des « fabricants de conspiration permanente », des « orateurs de cabaret », des « politiciens de carrefour », des « illettrés », des « envieux alcoolisés ». Le peuple du 18 mars ? Une « bande d’énergumènes », « 6 000 personnes, femmes, enfants, ouvriers, gardes fédérés, hurlant, gesticulant ». La Commune ? Des « transes perpétuelles », 3 600 incarcérations10. De chapitre en chapitre, de tome en tome, Du Camp peint de sombres bacchanales : lors d’un tir d’obus, écrit-il, deux individus, pour donner le signal, se mettent à danser ; aussitôt, « toute la bande entre en branle » ; on voit des hommes et des femmes aux vêtements débraillés, à la poitrine presque nue, hurlant : « à boire ! » C’est le début des incendies : « cette troupe d’aliénés » chante, vocifère, multiplie les gestes obscènes, à la lueur des maisons qui brûlent11. Voilà donc ce que sont les communards aux yeux des écrivains réactionnaires : des « aliénés », des cas psychiatriques.

[Umberto Boccioni]
L’agitation dans le quartier latin
Dans cette danse macabre de la Commune, le groupe des blanquistes auquel appartient Da Costa se voit affublé des traits psychopathologiques les plus graves12, tandis que les modérés font figure d’« aliéné[s] tranquille[s] » et de « maniaque[s] » inoffensifs. Écrire l’histoire de 1871, pour les écrivains réactionnaires de l’époque, c’est descendre dans un bourbier grouillant d’êtres à demi hallucinés, pour y trouver des jeunes à la tête farcie d’utopies, dévorant des traités d’économie sans les comprendre, admirant des œuvres romantiques sans les juger, des livres d’histoire ou des romans invraisemblables — l’imagination sans l’instruction, voilà le délire assuré ! Ces polémistes et historiens croient fermement que derrière chaque révolutionnaire se trouve un philosophe pour lui souffler à l’oreille ses idées fausses. Les communards passent pour l’incarnation des théories de Proudhon, et leurs atteintes à la propriété privée réveillent chez leurs ennemis des visions d’horreur.
« Les communards passent pour l’incarnation des théories de Proudhon, et leurs atteintes à la propriété privée réveillent chez leurs ennemis des visions d’horreur. »
Chez les contemporains, déjà, et dans la grande presse de l’époque, on appelle au coup de force, on prie la préfecture de police de nous débarrasser de cette bande de scélérats. Au témoignage de la poétesse Malvina Blanchecotte, la seule évocation de « Paris » épouvantait tout le monde. La ville était en quarantaine : « C’était un grand malade, pris de fièvre ; il fallait éviter la contagion13 ». Pourquoi une telle crainte ? 1789, 1830, 1848 avaient pourtant habitué la France au renversement de la royauté. Mais 1871 a surpris tout le monde. La bataille de Sedan avait certes écœuré l’opinion publique, qui ne voulait plus ni de l’Empire ni de la monarchie, mais elle ne s’attendait pas à un tel cri de guerre contre l’État, l’armée, le clergé, la finance. Les bourgeois de Paris n’avaient qu’une explication plausible : les quarante-huitards s’étaient endormis, depuis leur exil, à l’ombre du mancenillier révolutionnaire… et venaient de se réveiller, au lendemain de la guerre, empoisonnés pour toujours par la doctrine fédéraliste.
C’est que les communards étaient en porte-à-faux sur deux générations. D’un côté, ceux qui avaient connu la révolution de 1848 (sexagénaires en 1871) ; de l’autre, ceux qui, étant nés sous la monarchie de Juillet, avaient alors la trentaine. La différence de sensibilité est grande. Contrairement à la précédente, la nouvelle génération à laquelle appartient Da Costa a lu et apprécié les auteurs matérialistes du XIXe siècle : les Feuerbach, les Büchner, les athées d’outre-Rhin ; mais aussi, outre-Manche, le grand Darwin, traduit en français par la féministe Clémence Royer. Durant les années qui précèdent la Commune, les futurs Gavroches de 1871, étudiants de droit et de médecine, se cachent dans l’arrière-salle des cafés parisiens, discutant des articles de la revue Candide, fondée par Blanqui. C’est l’ébullition intellectuelle.
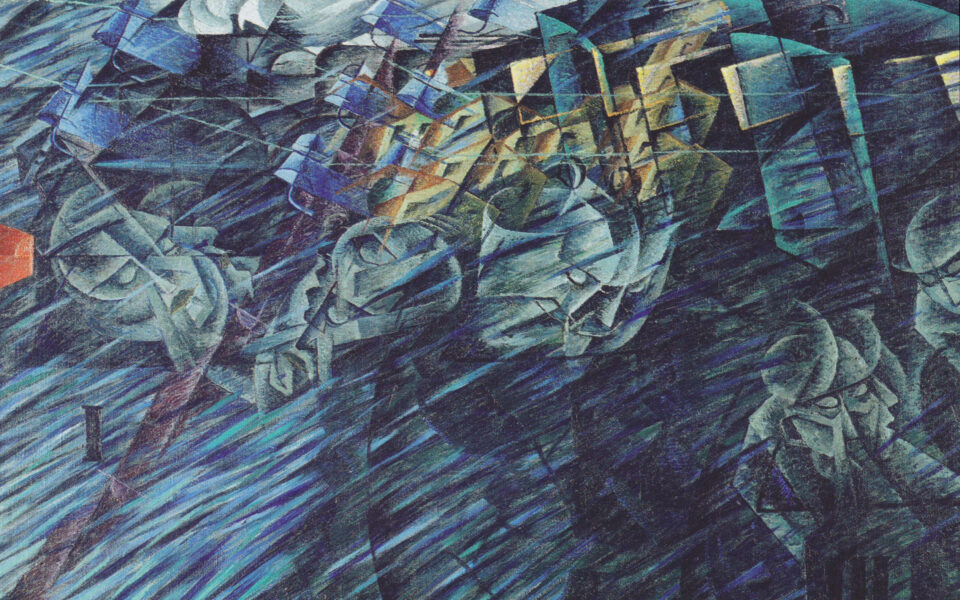
[Umberto Boccioni]
Puis vient le Congrès de Liège. Les 29, 30 et 31 octobre 1865, les plus farouches opposants au régime impérial, des disciples de Marx, de Proudhon et de Blanqui, se rejoignent en Belgique, espérant sceller l’alliance entre étudiants et ouvriers. Da Costa est l’un d’eux, et le plus jeune de cette nouvelle intelligentsia socialiste et révolutionnaire, qui allait s’engager dans la Commune de 1871. Hugo et Littré déclinent l’invitation ; les cadets se passeront donc de leurs aînés. Pendant ces trois journées, on vit des défilés, on écouta des professions de foi. Les jeunes déclamaient contre le césarisme, contre l’obscurantisme, contre le capitalisme. La propagande souterraine se montrait au grand jour. Blanqui, que ses disciples appelaient « le Vieux », cet héroïque conspirateur de 1830 et de 1848, finissant de purger sa peine de prison, allait susciter des énergies nouvelles dans le Quartier latin. Bientôt, la libre pensée allait gagner les faubourgs. Et le Sénat s’affola : le ministre Duruy prit des mesures disciplinaires à l’encontre des trouble-fête — c’est là que Da Costa fut renvoyé de l’École de droit.
Les blanquistes devant 1793
« L’hébertisme est la lutte acharnée contre le vieux monde ; c’est la soif enfiévrée de justice de celui qui se dresse en face du despotisme et crie :
l’égalité ou la mort !»
Mais Da Costa et les étudiants de 1865 se sont surtout fait remarquer pour la radicalité de leurs idées politiques. Dévorant les livres des historiens de la Révolution française, ils réhabilitent les noms de Hébert et de Chaumette, jusque-là recouverts par un amas d’injures. Jacques Hébert, à lui seul, incarne dans les histoires de la Révolution française du XIXe siècle l’idée de radicalisation : membre du Club des cordeliers de 1791 (an II), il est accusé par le camp de Robespierre d’avilir la Convention, d’exciter la haine entre campagnards et citadins, de porter atteinte au droit de propriété. Dans son journal, Le Père Duchesne, ce jeune révolutionnaire tourne en dérision la scélératesse des prêtres, les tartufferies de la cour de Versailles, ainsi que Louis XVI et Marie-Antoinette. Hébert est connu pour le langage de charretier dont il use volontiers ; ses phrases sont ponctuées de « foutre ! », comme dans cette déclaration, qu’il écrit en octobre 1793, se plaignant que les traîtres n’aient pas peur de la guillotine : « Je ne suis pas sanguinaire, foutre, mais je voudrais qu’on rétablît les gibets et la question pour des monstres, qui, de sang froid, ont fait égorger des milliers d’hommes14. » Les blanquistes de 1865 perçoivent chez Hébert des choses qui font écho à leur temps : Hébert déplore que la France ait si peur de faire tomber sur l’échafaud une tête couronnée, à cause du précédent anglais de 1649 ; de même, au temps de Blanqui, la France a peur de prendre les armes, à cause de 1793. Là où les Jacobins adoptaient une posture démagogique — « la poule au pot pour tout le monde ! » —, les Hébertistes rétorquaient : « Défiez-vous des endormeurs et soyez toujours l’avant-garde courageuse ! » Les blanquistes avaient choisi leur ligne d’action.
C’est donc une bataille historiographique qui précède, sur le plan des idées, la Commune de 1871 : quels sont les éléments réellement socialistes dans la Révolution française, quels sont les vrais efforts pour affranchir les peuples ? Dans la pensée blanquiste telle qu’exposée par l’un de ses partisans, Gustave Tridon, l’hébertisme est la lutte acharnée contre le vieux monde, dont le symbole est Torquemada, l’inquisiteur sadique ; c’est la soif enfiévrée de justice de celui qui se dresse en face du despotisme et crie : « l’égalité ou la mort ! » : « La terreur catholique et royale était un principe, la terreur révolutionnaire fut une nécessité. L’une procède de la négation de la justice, l’autre de sa revendication. La première torture, la seconde supprime15. » Les vrais révolutionnaires sont violents parce qu’ils ont vu de près l’Inquisiteur. Ainsi, la réhabilitation de Hébert est une réponse sarcastique à l’« hébertophobie » des socialistes de 1848, qui rechignaient à l’action violente. On peut d’ailleurs suivre la marche de l’esprit public aux jugements des historiens sur la Constituante et la Commune de 1793 : Thiers, dans les 10 tomes de son Histoire de 1827, admire Mirabeau, mais ne va pas au-delà ; Lamartine, en 1847, va jusqu’aux Girondins ; Louis Blanc, dans les 12 volumes de son Histoire de 1862, consacre Robespierre… Après lui, il faut tirer l’échelle ! L’hébertisme est donc le fruit d’une surenchère idéologique. C’est aussi le résultat d’un profond sentiment d’insatisfaction : depuis un demi-siècle, la Révolution est devenue, dans le discours des hommes de lettres, une sorte de théâtre à phrases, avec ses déclamations oratoires et ses épisodes tragiques — les conventionnels sont surfaits ! Qu’on cesse donc de chanter la Fédération et le Jeu de Paume, les pseudos principes de 89, et qu’on descende à la Commune du 10 août, qu’on aborde 93 ! — voilà ce que les blanquistes réclament.

[Umberto Boccioni]
Dans les milieux cléricaux, on peut prendre la mesure des réactions outrées, en lisant par exemple Monseigneur Dupanloup. Au lendemain de la Commune, cet évêque d’Orléans lance un cri d’effroi en citant une brochure des étudiants du congrès de Liège, lui remettant en mémoire quelque mauvais pressentiment : « Ce congrès […] se termina par ces cris : “Guerre à Dieu ! Le progrès est là. — La révolution c’est le triomphe de l’homme sur Dieu ! — Il faut crever la voûte du ciel comme un plafond de papier ! — Il y a une puissance qui a l’avenir, c’est l’humanité !” Ceci, c’était du positivisme. Le socialisme répondait : “Haine à la bourgeoisie ! haine au capital ! Si cent mille têtes font obstacle, qu’elles tombent !” Lorsque je signalai cette explosion de matérialisme et de socialisme, comme une chose grave, un journal lettré me répondit : “Tout cela est sans conséquence. Ce sont des enfants ! C’est une effervescence que l’âge calmera”. Je répondis à mon tour : “Dans dix ans, ces enfants peut-être seront les maîtres de la France. Vous avez là les Hébert, les Chaumette des révolutions à venir”. Dix ans ! Je demandais trop16. » Quatre ans plus tard, en effet, les blanquistes allaient exécuter des prêtres — ainsi qu’un journaliste proudhonien, Gustave Chaudey, victime de sinistres représailles —, entachant à jamais la mémoire des communards. C’est cet épisode que Da Costa a placé au cœur de sa Commune vécue.
La tragédie des otages
« Le 23 mai 1871, sur ordre de Rigault, on exécute Georges Darboy, l’archevêque de Paris, et cinq autres otages. La Commune perd sa crédibilité. »
Entre les mois d’avril et mai, la Commune change d’allure. Début avril, c’est la démocratie participative : on vote les mandats révocables, les salaires plafonnés, la rémunération des femmes, la laïcisation de l’assistance publique, de l’école et des hôpitaux, les moratoires sur les loyers, les échéances, les dépôts d’objet ; on lutte contre le chômage, la bureaucratie, le patronat, le clergé et la censure. En l’espace d’un seul mois, on crée des commissions, des chambres ouvrières, des syndicats ; on signe des pétitions ; on décrète la séparation de l’Église et de l’État. Les artistes, autour de Courbet et Vallès, s’affranchissent de la tutelle des marchands d’art ; les femmes, autour de Dmitrieff et Lemel, s’unissent pour le soin des blessés. Mais la tension devient extrême à cause des bombardements ; les désaccords se creusent entre les délégués, les décisions perdent leur efficacité. Début mai, c’est le Comité de salut public, les barricades, les représailles. En trois semaines, la capitale est prise par les portes de Saint-Cloud et de Versailles, d’Asnières et de Vanves ; les troupes versaillaises gagnent le Champ-de-Mars, la place de l’Étoile, la gare Saint-Lazare, fusillant les fédérés sur leur chemin. Les boulevards de Paris sont jonchés de cadavres.
Cette période, dans la tête de ses opposants, c’est aussi la « chasse à la soutane ». Des pillages à Notre-Dame-de-Lorette, des vitres cassées à Saint-Sulpice — partout des victimes de la cruauté du peuple !, s’écrie-t-on. Mais pour Da Costa, les historiens cléricaux ont, là encore, noirci le tableau. Les blanquistes ont bel et bien orchestré des perquisitions : on a arrêté quelques ignorantins, parmi ceux qui n’avaient pas fui leur presbytère ; on a fait saisir quelques ornements d’église, parmi ceux qui n’avaient pas été mis à l’abri17. Et puis, il y a eu la prise d’otage de Georges Darboy, l’archevêque de Paris. L’affaire a mal tourné : le 23 mai 1871, sur ordre de Rigault, on exécute Darboy et cinq autres otages. La Commune perd sa crédibilité.

[Umberto Boccioni]
Da Costa revient longuement sur cet épisode sinistre, dans lequel il a joué un petit rôle. Au moment où elle a lieu, deux mois plus tôt, l’arrestation de l’archevêque passe inaperçue. Da Costa, alors secrétaire du Comité de sûreté générale, participe à l’application du décret du 2 avril : la séparation de l’Église et de l’État. On supprime le budget des cultes et les biens de mainmorte, appartenant aux congrégations religieuses, deviennent propriété nationale. Aussitôt, les rapports de police signalent une agitation dans Paris : on observe des allées et venues entre l’archevêché et les paroisses ; c’est le départ de dizaines de prêtres pour Versailles. S’ensuit une altercation entre un commissaire du Ve arrondissement et un père jésuite de la rue Lhomond, suscitant la colère de Rigault. C’est alors que Darboy est arrêté et conduit à la préfecture. Mais au laisser-faire des premiers temps succède la panique — face à l’horreur de la situation. L’assassinat de deux leaders de la Commune, Gustave Flourens et Émile-Victor Duval, et la mort de centaines d’autres fédérés, sabrés ou fusillés à Gennevillers, suscite l’exaspération générale. Les choses se précipitent : on entend soudain dans les faubourgs des cris de rage et de vengeance contre les ennemis de la Commune, retranchés à Versailles.
« Blanqui était rendu a priori responsable de tous les actes révolutionnaires qui se déroulaient pourtant en dehors de son autorité. »
Quand Da Costa décide de prendre la plume, des années plus tard, personne ne connaît vraiment les circonstances de ce qui, en cette époque fébrile, avait finalement conduit au meurtre de ces prêtres arrêtés, devenus otages. Des rumeurs circulent sur des caisses emportées dans des voitures par des curés déguisés en gardes nationaux ; la commission exécutive de la Commune veut y voir les indices d’un complot et décide d’interroger Darboy. Da Costa raconte cette scène d’à peine un quart d’heure, devenue légendaire. L’interrogatoire se déroule dans le cabinet de Rigault, en présence des blanquistes Jean-Baptiste Chardon, Théophile Ferré et lui. Darboy, en entrant dans la pièce, ouvre les bras et s’exclame : « Mes enfants !... » Et Rigault de l’interrompre sèchement : « Il n’y a pas d’enfants ici, mais des citoyens et des magistrats de la Commune18. » L’archevêque, après un silence, cherche tant bien que mal à se défendre des accusations qu’on lui porte — quelle part de responsabilité a‑t-il, en tant que prélat, dans les exécutions sommaires commise par Versailles les 2, 3 et 4 avril ? Rigault l’interrompt à nouveau : « C’est bon, voilà dix-huit siècles que vous nous la faites, celle-là ; elle ne prend plus. » Et Darboy est transféré à la prison de Mazas. Da Costa, le 6 avril, est chargé de lui rendre visite et d’obtenir de sa main une « protestation écrite » contre Versailles, et de convaincre Thiers de l’échanger contre Blanqui.
L’attitude de l’archevêque, note Da Costa, est remarquable. Dans ces deux missives, il ne laisse entendre à aucun moment qu’il tient à sauver sa peau. La première lettre insiste sur la gravité des « actes barbares » et les « atroces excès » commis par les troupes versaillaises. La réponse de Thiers est laconique : « Les faits sur lesquels vous appelez mon attention sont ABSOLUMENT FAUX […]. Jamais l’armée n’a commis ni ne commettra les crimes odieux que lui imputent des hommes, ou volontairement calomniateurs, ou égarés par le mensonge au sein duquel on les fait vivre19. » Darboy envoie une seconde lettre, à laquelle Thiers ne prend pas la peine de répondre : il le prévient des risques de représailles, signalant combien la situation à Paris est délicate ; enfin, il en appelle à l’humanité du président, demandant la grâce de Blanqui — en vain. Blanqui était rendu a priori responsable de tous les actes révolutionnaires qui se déroulaient pourtant en dehors de son autorité. La Commune ne devait, à aucun prix, retrouver son chef… Ainsi, le 24 mai 1871, à 7 heures du soir, six otages sont conduits, en silence. Puis on ordonne la fusillade. C’est ce qui s’appelle, dans le langage des hommes d’action, frapper un grand coup — mais un coup de trop.

[Umberto Boccioni]
Confessions d’un révolutionnaire
Da Costa n’a jamais renié la doctrine blanquiste, comme le prouve cette profession de foi : « La Force ! elle ne prime pas nécessairement le Droit, mais elle en est l’inéluctable auxiliaire20. » Pas de conquête sociale au nom de la seule raison, en somme. Le phénomène de l’évolution, qui change le droit en devoir, se subordonne nécessairement au phénomène de la révolution, qui affirme le droit par la force ; chaque chose vient en son temps. C’est pour cela que Da Costa choisit de réhabiliter Rigault et Ferré dans son entreprise historiographique. Malgré leur caractère fanatique, ces deux-là ont servi la cause révolutionnaire. Mais c’est toujours la victoire qui décide, en dernier lieu, si tel acte de protestation est un acte de désordre. Comme Hébert après la Révolution française, les blanquistes après la Commune sont ces hommes d’action qui ont abandonné leur postérité à la calomnie : « Il semble qu’elles aient été écrites pour les défendre, ces lignes superbement douloureuses que le souvenir de Saint-Just inspirait à Louis Blanc : “Le nom des vaincus, qui l’ignore ?, est exposé à la souillure de bien des mensonges, quand ce sont les vainqueurs qui règnent, qui ont la parole ou qui tiennent la plume. Malheur à qui succombe après avoir fait tout trembler ! […]”. La réaction triomphante et impitoyable nous a laissé de ces deux hommes, Ferré et Rigault, nombre de biographies fantaisistes et haineuses21. » L’épisode de la « tragédie des otages » constitue une illustration parfaite de cette manière édulcorée d’écrire l’Histoire : pour Da Costa, l’erreur de Rigault et Ferré, c’est avant tout d’avoir fait des martyrs dans le camp des Versaillais — c’est-à-dire des vainqueurs — et d’avoir endossé à leur tour la réputation de tortionnaires22.
« Le blanquisme est mort avec l’aventure boulangiste, dans laquelle trop de gens — y compris Da Costa — se sont fourvoyés. »
Certes, la Commune ne se réduit pas à son Comité de salut public, à ceux qui ont voté l’exécution des prêtres. Les disciples de Blanqui, dépeints comme des excentriques sortis des clubs révolutionnaires pour jeter bas tous les principes de la bourgeoisie, sont une minorité. En fait, l’assemblée révolutionnaire compte, parmi ses élus, bourgeois et prolétaires confondus, toutes les sensibilités de la gauche : modérés, radicaux, démocrates-socialistes, internationalistes — tous ces militants n’ont pas le même âge et ont une conception différente de l’action politique. Les aînés reprochent notamment à leurs cadets leur tendance aux récriminations violentes. De là des dissensions internes. De là, aussi, aux yeux de Da Costa, l’échec de la Commune. Le problème de l’insurrection de mars, selon lui, c’est qu’elle a voulu être parlementaire ; elle a pris des « allures de Constituante » pour faire contrepoids avec Versailles. Or, pour vaincre Thiers, il fallait plus qu’un « pouvoir pseudo-exécutif », plus que des « phraseurs de l’Internationale23 ». L’auteur de La Commune vécue se montre sévère pour ses anciens camarades de lutte : quels que soient leurs mérites, ils n’ont eu qu’un tempérament de bourgeois déclassés.
C’est pourquoi l’ouvrage se clôt sur l’évocation des noms de Victor Hugo, de Louise Michel et d’Élisée Reclus. Il salue le poète qui, dans sa lettre ouverte du 26 mai, a offert le droit d’asile dans sa maison aux 1 500 réfugiés de Belgique ; honorant la bravoure de l’institutrice, il la défend contre les accusations qu’on lui impute d’avoir excité les passions de la foule et provoqué la mort des otages ; il dit enfin son admiration pour le grand géographe. Néanmoins, il se montre moins optimiste que ces trois-là ; il doute que la fin des privilèges de titre, de caste ou d’argent, soit compatible, un beau jour, avec la possibilité d’abolir les frontières. En cette fin de siècle, le socialisme n’est déjà plus qu’un parlementarisme. Le blanquisme est mort avec l’aventure boulangiste24, dans laquelle trop de gens — y compris Da Costa — se sont fourvoyés. Les derniers révolutionnaires se sont repliés dans l’anarchisme, désirant faire sauter la Chambre plutôt que d’y être élu. En fin de compte, les ex-bagnards se consolent d’une victoire platonique. La République du 18 mars a sombré ; les hommes et les femmes de 1871 n’ont laissé derrière eux que l’exemple de leur courage. Il reste encore à accomplir l’idée de la Révolution.
Illustration de bannière : Umberto Boccioni
- Victorine Brocher, Souvenirs d’une morte vivante (1909), Paris, Libertalia, 2017, p. 161.[↩]
- On a pu comparer les manifestations publiques des communards à une forme de communion politique — au sens d’un arrachement à la monotonie du quotidien. Cf. Henri Lefebvre, La Proclamation de la Commune. 26 mars 1871, Paris, La Fabrique, 2018.[↩]
- Certains éditorialistes de New York ont parlé d’un « french Ku Klux Klan », craignant que les revendications communardes ne viennent discréditer, de l’autre côté de l’Atlantique, l’idée suprême de démocratie libérale. Cf. Q. Deluermoz, Commune(s) 1870–1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2020, p. 88.[↩]
- La bataille des chiffres a longtemps fait rage. La mathématicienne Michèle Audin a mené en 2021 une étude approfondie aux éditions Libertalia : les « évaluations plus hautes, autour de 15 000 ou 20 000 morts, ne sont pas exagérées », assure-t-elle.[↩]
- Henry Morel, Le Pilori des Communeux. Biographie des membres de la Commune (1871), p. 8–9.[↩]
- Blanqui s’est illustré lors de l’insurrection de mai 1839 aux côtés de Barbès, à la suite de quoi il est emprisonné au Mont-Saint-Michel. On le retrouve lors de la révolution de février 1848 : il diffuse alors ses idées dans les conférences du fameux « club Blanqui », auxquelles assistent philosophes et poètes parisiens. Il disparaît de nouveau de la scène politique après le coup d’État de Napoléon III : le régime impérial le fait emprisonner à Sainte-Pélagie en 1861. C’est alors qu’il exerce une influence sur de jeunes étudiants, qui admirent la radicalité de son action politique et qui s’adonnent à des activités subversives (enterrements civils ou bagarres avec la police). Pendant 50 ans, Blanqui a finalement alterné entre l’affiliation à des sociétés secrètes et la condamnation à perpétuité.[↩]
- Da Costa, La Commune vécue, IIII, VIII, IV, p. 282.[↩]
- Maxime Du Camp, Les Convulsions de Paris, III, II, VI, p. 159.[↩]
- Da Costa, La Commune vécue, II, IV, VIII, p. 71–72.[↩]
- Maxime Du Camp, Les Convulsions de Paris, II, VII, I, p. 340.[↩]
- Maxime Du Camp, Les Convulsions de Paris, III, I, IX, p. 87.[↩]
- Dans un vocabulaire emprunté aux psychiatres du XIXe siècle, Du Camp taxe Rigault, Ferré, Ranvier et Urbain de « monomanie homicide », Pindy de « pyromanie », Eudes de « cleptomanie », Delescluze de « monomanie du pouvoir », Vallès de « monomanie des grandeurs », Léo Meillet de « monomanie raisonnante », Millière de « monomanie dénonciatrice », Félix Pyat de « lycanthropie féroce compliquée de lâcheté », Vermeersch de « scatologie furieuse » ou encore Babick de « théomanie » (M. Du Camp, Les Convulsions de Paris, II, VII, I, p. 340–341).[↩]
- Malvina Blanchecotte, Tablettes d’une femme pendant la Commune (1872), p. 12–13.[↩]
- Cité par M. Biard, « Des
bons avis
aux critiques assassines. La radicalisation d’Hébert mise en scène au fil des visites royales du Père Duchesne », Annales historiques de la Révolution française, n° 357, 2009, p. 47–66, note 3, p. 49.[↩] - Gustave Tridon, Les Hébertistes, plainte contre une calomnie de l’Histoire (1864), p. 9.[↩]
- F. Dupanloup, L’élection de M. Littré à l’Académie française (1872), p. 13.[↩]
- Il ne faut pas exagérer les perquisitions : les prêtres de Saint-Eugène et de Saint-Médard ont officié sans heurt jusqu’à la dernière semaine de mai, et ceux de Montrouge jusqu’à fin avril ; l’église de Saint-Joseph n’a été transformée en club révolutionnaire que le 13 mai ; le frère Calixte et les quelques Jésuites, arrêtés comme espions par les miliciens, ont été relâchés ; l’aumônier du château de Vincennes n’a pas été dérangé ; les couvents n’ont pas été menacé et dans les hospices, la persécution des religieuses se réduisait à l’appellation de « citoyennes » par les blessés fédérés.[↩]
- Da Costa, La Commune vécue, I, IV, I, p. 394.[↩]
- Cité par Da Costa, La Commune vécue, I, IV, II, p. 417.[↩]
- Da Costa, La Commune vécue, III, VI, III, p. 32.[↩]
- Da Costa, La Commune vécue, II, IV, XI, p. 121–122.[↩]
- Ironie de l’histoire : c’est justement Rigault et Ferré qui avaient dissuadé Louise Michel d’aller au bout de son intention d’assassiner Adolphe Thiers. Cf. : « Pressentant l’œuvre de ce bourgeois au cœur de tigre, je pensais qu’en allant tuer M. Thiers, à l’Assemblée, la terreur qui en résulterait arrêterait la réaction. Combien je me suis reproché aux jours de la défaite d’avoir demandé conseil, nos deux vies eussent évité l’égorgement de Paris. Je confiai mon projet à Ferré qui me rappela combien la mort de Lecomte et Clément-Thomas avait en province et même à Paris servi de prétexte d’épouvante, presque même à un désaveu de la foule ; peut-être, dit-il, celle-là arrêterait le mouvement. Je ne le croyais pas et peu m’importait le désaveu si c’était utile à la Révolution, mais cependant il pouvait avoir raison. Rigault fut de son avis. — D’ailleurs, ajoutèrent-ils, vous ne parviendriez pas à Versailles. J’eus la faiblesse de croire qu’ils pouvaient être dans le vrai quant à ce monstre » (Louise Michel, La Commune (1898), Paris, La Découverte, 2015, p. 196–197).[↩]
- Da Costa, La Commune vécue, III, VI, IV, p. 33.[↩]
- Le boulangisme est un mouvement politique antiparlementaire réunissant des « patriotes » d’extrême droite comme d’extrême gauche, organisés autour du général Georges Boulanger, qui projetèrent un coup d’État sous le mandat du président Sadi Carnot.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien « Michèle Audin raconte Eugène Varlin », avril 2019
☰ Lire notre article « Zola contre la Commune », Émile Carme, mars 2019
☰ Lire notre article « Élisée Reclus, vivre entre égaux », Roméo Bondon, septembre 2017
☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais », juin 2017
☰ Lire notre abécédaire de Louise Michel, mars 2017
☰ Lire notre article « Blanqui et Bensaïd : l’Histoire ouverte », Émile Carme, mai 2015


