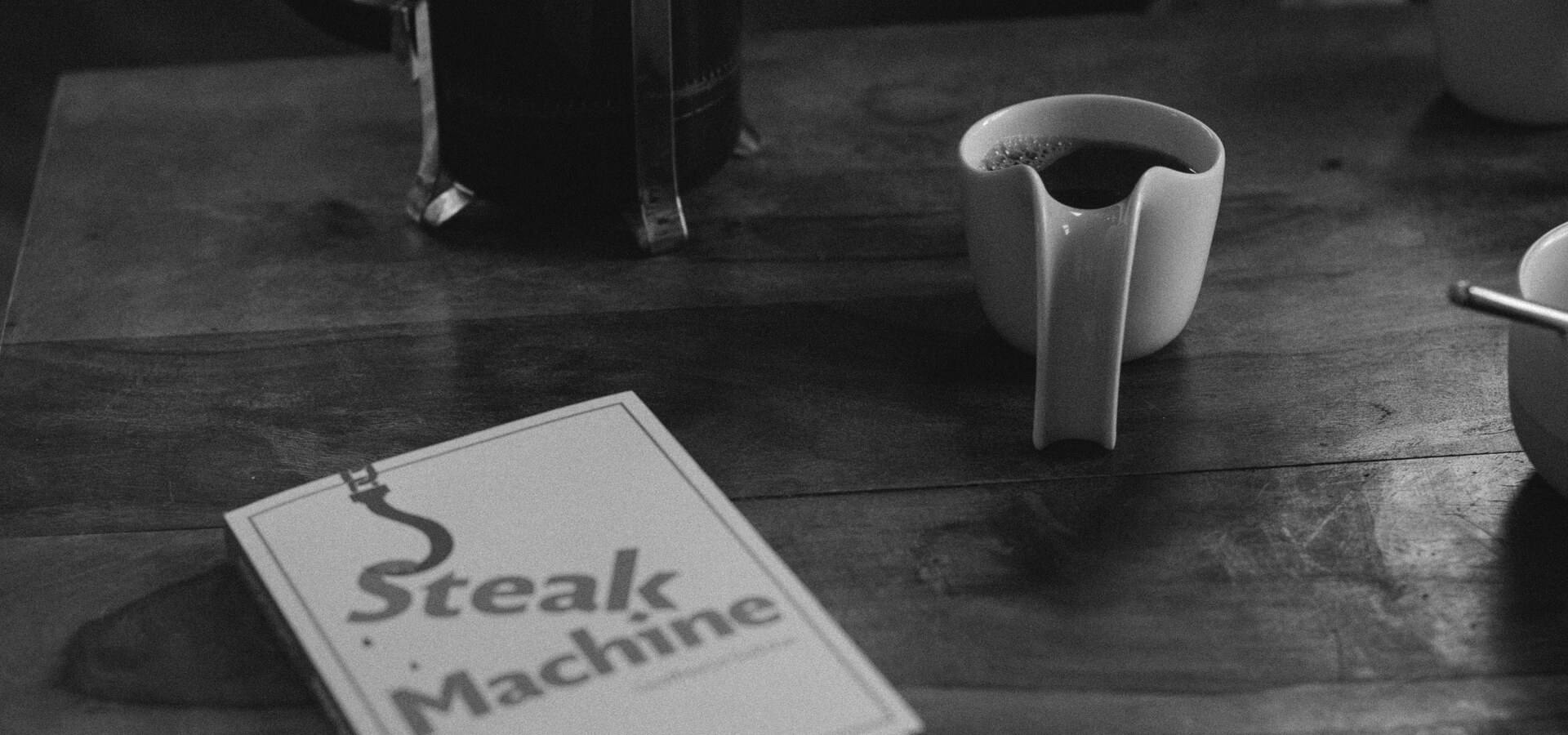Entretien inédit pour le site de Ballast
Le journaliste Geoffrey Le Guilcher, également cofondateur des éditions Goutte d’Or, s’est infiltré, sous une fausse identité, dans un abattoir breton afin de savoir ce que ces murs ont à cacher. Il n’était pas végétarien, pas militant, il tenait seulement à comprendre, en immersion, « ce dieu fou de l’abattoir ». Et surtout à saisir le quotidien de tous ces ouvriers qui le font tourner. « On fait du 63 vaches à l’heure quand on est au taquet », lui confie l’un d’eux ; « Si tu bois pas, que tu fumes pas, que tu te drogues pas […], tu craques », lâche un autre. Un double aveuglement : la misère des plus humbles côtoie la mise à mort des autres — cette « classe de travailleurs oubliés », disait autrefois Charles Gide en parlant des animaux, dans La Revue socialiste. Le Guilcher en fait le récit dans une enquête à la première personne : Steak Machine.

C’est parti d’une double démarche. Je voyais se propager la nouvelle mode des hamburgers dans toutes les brasseries : ils ont remplacé, presque partout, le plat de base — la cuisse de canard confite ou le tartare. Et les snacks low cost se mettaient à faire des « suppléments », trois ou quatre viandes différentes en plus de ton kebab ! Ça devient absurde : tu ne sais même plus combien il y a d’animaux dans ce que tu manges. Dans le même temps, je voulais savoir comment marchaient les abattoirs. M’interroger sur mes habitudes alimentaires, d’une part, et comprendre — suite au débat que l’association L214 avait fait émerger — ce qu’il se passait de l’autre côté du décor. Je voulais faire un récit à la première personne d’un des ces lieux sortis du néant, un lieu oublié, qu’on ignorait, un lieu tabou. L214 a tiré un premier fil : la souffrance des animaux dans ces abattoirs, où le minimum légal n’est absolument pas respecté. J’ai voulu savoir qui bossait là-dedans, comprendre ce qu’il s’y faisait.
Votre connaissance initiale est donc celle du grand public ?
« Quelle est la première cause du réchauffement climatique ? L’élevage. »
Oui. Mais, très vite, quand me vient cette envie, je me documente. Je rencontre L214. Je leur dis que j’aimerais infiltrer un grand abattoir industriel — ils m’ont aidé à le trouver. Je lis des livres, des rapports institutionnels, des articles. J’affine. Je découvre qu’on tue un milliard d’animaux par an, en France. Qu’il existe des grands et des petits abattoirs, municipaux. Je voulais voir un « monstre », celui qui fait que tout le monde bouffe de la viande — si on peut encore appeler ça ainsi — n’importe comment. Je suis d’origine bretonne, je suis donc allé là-bas. J’ai ensuite pris des conseils auprès de grands maîtres de l’infiltration.
Vous n’avez pas nommé l’abattoir en question : crainte d’éventuelles représailles juridiques ?
Au départ, je pensais le faire. Mais j’ai relu Le Quai de Ouistreham, de Florence Aubenas : j’aimais le fait qu’elle raconte son expérience autant que l’intimité des gens qu’elle croise — avec tout ce que ça peut comprendre de « compromettant » pour eux. Au fond, on s’en fout de la marque. Ce qui m’importe, c’est qu’il incarne, comme tous les autres grands abattoirs, l’absurdité moderne. Je ne voulais pas avoir de freins — même si je n’ai pas tout mis, c’est-à-dire ce qui pouvait mettre en danger des employés. L’anonymat permet de raconter l’humain et pas seulement d’épingler une entreprise.
L214 nous avait dit combien la question animale est « politique ». En aviez-vous conscience ?
Je m’en doutais. Au même titre que les violences policières ou la drogue — ça implique toute la société. Quelle est la première cause du réchauffement climatique ? L’élevage. Mais j’ai découvert, en lisant notamment Faut-il manger des animaux ? et La Libération animale, qu’ouvrir sa propre conscience et sa propre sensibilité n’est pas instinctif, surtout dans nos sociétés ; c’est un travail. Et on ne peut pas enfermer cette question entre les urbains et ceux qui vivent à la campagne avec des bêtes ! Il existe des gens totalement insensibles à la souffrance de ceux qu’ils élèvent pourtant… Tout le monde n’est pas réceptif de la même manière. Certains vont arrêter du jour au lendemain de toucher aux animaux lorsqu’ils découvrent ce que ça implique, d’autres avancent par paliers — et d’autres ne bougeront pas. Les personnes qui gèrent L214 sont, contrairement à l’image qu’on pourrait en avoir, respectueuses de ça — ils ne m’ont même pas demandé si j’étais végétarien… Leur cible première est l’industrie et leurs appuis (élus, etc.), pas les consommateurs. Je n’exclus pas de devenir végétarien, voire même végane, d’ailleurs. Dès que je peux éviter de manger de la viande, je le fais.
L’image est souvent l’électrochoc le plus puissant. Difficile de manger un agneau une fois qu’on l’a vu écartelé sur une vidéo… Votre livre ne comprend aucune photographie. Quelle est la force spécifique de l’écrit ?
La question s’est posée. Beaucoup de gens sont heurtés par ces images, justement. Ils ne veulent ou ne peuvent pas les voir. Et pourquoi pas ? Le texte, c’est une histoire. Les images peuvent priver la réflexion : c’est l’émotion, le choc. Je suis un grand lecteur du dessinateur de bande dessinée Joe Sacco, du journaliste Albert Londres ou de Nellie Bly — elle s’était infiltrée dans un asile de fous : c’est un récit incroyable. Je ne voulais pas écrire quelque chose de froid, comme si j’étais totalement externe. On intervient toujours, lorsqu’on raconte un récit. J’ai en tête un journalisme à la frontière du gonzo — à la frontière car Hunter S. Thompson y plaçait encore plus de subjectivité ! Je me méfie des journalistes qui se disent « objectifs ». Un juge qui pense traiter une affaire d’une façon « neutre », aussi. Un être humain a des influences et des conditionnements. La subjectivité, c’est assumer, énoncer, puis laisser le lecteur réfléchir. Je devais dire que je mangeais de la viande, par exemple.
Vous écrivez que la situation dans les abattoirs s’empire. Ça pourrait sembler paradoxal, au regard des demandes croissantes de transparence…
« Les employés se trouvent dans un état catastrophique. Ajoutez à ça la schizophrénie des consommateurs : personne ne veut ouvrir les portes. »
Le secteur de l’agroalimentaire, très lié au monde politique, n’est pas prêt de bouger. Le député Olivier Falorni avait fait des propositions fortes, inspirées de ce qui se fait dans le carcéral ou dans le nucléaire : le droit de visite, dans les abattoirs, pour les parlementaires, les associations et les journalistes ; les abattoirs mobiles — tout est passé à la trappe. Sur 577 députés, seuls 32 étaient présents le jour du vote, en première lecture à l’Assemblée… Le site de l’Assemblée n’avait jamais autant été consulté. Il y avait un phénomène de société, une attente. Le rapport était excellent mais la loi a accouché d’une souris. Le ministre de l’Agriculture a enlevé le plus de trucs possibles et a fait savoir à Falorni qu’il allait avoir les députés PS contre lui s’il ne faisait pas des choix. À l’arrivée, il ne reste rien ! Rien ne change pour les animaux. Et la situation risque d’être pire pour les employés, puisqu’ils savent qu’ils seront désormais fliqués par leur hiérarchie.
Vous insistez sur les cadences et les rythmes infernaux, sur la gestion productiviste des abattoirs. Vous en appelez à des abattoirs « décroissants » ou à une remise en cause globale du système ?
Je ne peux me prononcer sur une « solution idéale » car je sortirais de mes compétences. Je voulais surtout décrire l’outil tel qu’il est, aujourd’hui. C’est-à-dire absurde — une vache par minute, un porc toutes les vingt secondes et une poule toutes les deux secondes. Tu ne peux pas traiter dignement les hommes ni les animaux dans de telles conditions.
Les propriétaires d’abattoirs répondent systématiquement à la demande de visibilité que ce sont des lieux privés.
Ils défendent leur bifteck : c’est déconnecté de la réalité, mais ça reste logique — si on se met à leur place. Il faut bien entendre que l’abattoir est une chaîne de tabous. Avant, on tuait les animaux en plein centre-ville. Les autorités craignaient, en plus des questions d’hygiène, que les hommes, face à tout ce sang et ces cris, deviennent plus violents encore à l’endroit d’autres hommes. Les « tueries », c’était le nom des abattoirs alors, ont été déplacés en périphérie des villes — banlieue et campagne. Après la Seconde Guerre mondiale, les abattoirs sont industrialisés. L’industrie a profité de ce tabou pour n’avoir à se préoccuper de rien. L’abattoir n’est pas une entreprise classique. Un animal sur cinq, comme le dit le ministère de l’Agriculture, est mal tué. Les employés se trouvent dans un état catastrophique. Ajoutez à ça la schizophrénie des consommateurs : personne ne veut ouvrir les portes. Quand, dans certaines régions, l’abattoir constitue le plus grand bassin d’emplois, le député, s’il veut garder son mandat, est obligé de défendre l’industrie.
La réalisatrice Maud Alpi a filmé la bouverie d’un abattoir. Elle fut comme hantée par le fait de pouvoir aller et venir à sa guise alors que les animaux autour d’elle ne le pouvaient pas. Avez-vous éprouvé cette sensation ?
Non, car tout est fait pour que l’animal soit absent ou chosifié, aux yeux de l’ouvrier. Je n’ai vu que des carcasses, dans la zone à laquelle j’étais affecté. Ça ressemble finalement à une boucherie géante. Je ne travaillais pas avec des animaux suspendus au plafond, avec leur peau. C’est bien pour ça qu’ils ont construit, dans l’abattoir où j’ai bossé, un mur autour de la tuerie. C’est sanctuarisé. Il faut avoir fait onze mois d’abattoir pour avoir accès à ces zones. C’est bien pour ça que j’essayais de m’y infiltrer, car ce n’était pas permis… Les animaux se débattent, dans la tuerie, ils foutent des coups. Certains collègues m’ont dit qu’ils ne pourraient jamais tuer un animal — il faut l’entendre, ça. Seule une minorité tue directement.
Des associations plus radicales — comme 269 Libération animale — estiment que les employés des abattoirs sont les bras armés de l’industrie et qu’il ne faut en rien les victimiser. Comment l’entendez-vous ?
« Les antispécistes ne sont pas des gens qui opposent les humains aux animaux : ils ont juste ouvert leur sensibilité à d’autres êtres sensibles. »
C’est tout à fait audible, pour moi. Tout comme ça l’est d’aller directement interroger des jihadistes pour comprendre leurs motivations, ainsi que l’a fait un collègue. Je suis journaliste, pas militant. Je propose une démarche honnête ; libre, ensuite, aux militants d’avoir un jugement moral sur mon récit. Ils se battent, ils ont une cause, très bien. Mais je dois dire, et je ne m’y attendais pas, que la sphère antispéciste a soutenu le livre bien plus qu’elle ne l’a rejeté. Des « viandards » m’ont plusieurs fois demandé comment j’avais pu le présenter à des militants de la cause animale ; pourtant, ce que j’ai souvent constaté, c’est que les antispécistes ne sont pas des gens qui opposent les humains aux animaux : ils ont juste ouvert leur sensibilité à d’autres êtres sensibles. Mais c’est lié, dans l’esprit de la grande majorité d’entre eux. Le bouquin est une expérience brute : l’enfer des mecs, la défonce, l’alcool. Ce sont des gens qu’on peut tous rencontrer. Je ne crois pas aux bourreaux ni aux coupables : personne n’est hors du champ de l’humanité.
L’habitude revient souvent, dans vos pages : on s’habitue, c’est comme ça, il faut bien…
Les gens qui y travaillent font des choix rationnels. Il n’y a pas de jobs, ils veulent rester vivre dans le coin, ils n’ont pas de diplôme : ils se retrouvent à l’abattoir. Mais personne, à part une minorité, ne s’y épanouit. Tout le monde sait que c’est un travail de merde. Mais il faut payer les crédits, les études pour les mômes…
Dans le documentaire que vous avez coréalisé sur le sujet, avec Envoyé spécial, certains travailleurs confiaient qu’ils avaient désormais, dans l’œil de leurs proches, honte de leur métier…
On en revient à la question du tabou. Quand tu réponds « Je travaille dans un abattoir », personne ne pose de seconde question. Ça fout une ambiance de glaçon dans la pièce. Ils ne parlent pas volontiers de leur métier, ils trouvent des parades… « Je suis dans l’alimentaire », « Je travaille dans une boucherie ». Et les voilà, notamment sur Internet, à se faire défoncer par des milliers des gens. C’est un choc violent, pour eux. Les employés sont une « donnée » du problème, qu’il ne faut, j’y reviens, pas opposer aux animaux. C’est un système.
Vous parlez des « damnés de la viande ». Pourquoi convoquer Frantz Fanon ?
J’aime bien Les Damnés de la Terre. Mais, au-delà, je songeais à la résignation qui touche leurs conditions de travail : ça ne va pas évoluer. Tout le monde s’en fout. Le consommateur réagit peu à la souffrance ouvrière. L’industrie s’en tape. Les politiques ne considèrent pas qu’il s’agit d’un sujet. Ils sont coincés. Ils sont les premières victimes de notre demande légitime de transparence : c’est eux qui prennent, pas les directions.
Comme partout ailleurs, la viande n’échappe pas aux lois du genre…
Les chaînes sont constituées de façon très sexuée. Plus tu approches de la tuerie, plus c’est masculin. Plus les animaux sont gros (porcs et bœufs), plus on trouve d’hommes. C’est historique, et je l’ai constaté.
Vous racontez que l’animal peut devenir, pour les ouvriers, « un ennemi » !
« Les chaînes sont constituées de façon très sexuée. Plus tu approches de la tuerie, plus c’est masculin. »
Quand les animaux se débattent, quand un taureau résiste, quand un veau s’échappe et qu’un chef gueule toutes les vingt minutes pour que tu tiennes la cadence de la chaîne… il peut devenir ton ennemi, oui. L’animal qui résiste, car il veut vivre, te rend plus difficile une tâche horrible en soi et, comme l’explique la sociologue Catherine Rémy, le percevoir ainsi aide psychiquement à le tuer en masse.
Verra-t-on un jour la fin des abattoirs ?
Ce n’est pas impossible, mais ça ne viendra peut-être pas de là où l’attend. Les militants de la cause animale ont fait sortir cette question de leurs cercles : c’est désormais une lame de fond au sein de la société. Sans même évoquer Mélenchon, les candidats se mettent à en parler ; c’est un signe. Mais, surtout, les abattoirs ne sont pas rentables : ils sont en négatif pour les porcs. C’est pour ça qu’ils sont tous aussi tarés sur les cadences. Ajoutez la viande in-vitro, qui se développe — les industriels hollandais investissent massivement et préparent le premier burger sans souffrance animale. C’est un steak qui a poussé en éprouvettes, avec de la betterave pour donner de la couleur, car il n’y a bien sûr pas de sang. L’industrie de la viande s’effondrera aussitôt, si ça prend.
Les éditions des Équateurs pensent que l’édition permet aujourd’hui de pallier le manque de longs reportages comme il en existait autrefois dans la presse. Était-ce une de vos envies, en créant les éditions Goutte d’Or ?
C’est compliqué, même dans la grande presse, de vivre en tant que pigiste. Impossible de vendre ton reportage au prorata des mois que tu as passés à le faire ! Sans compter que le livre a une durée de vie plus longue — l’article disparaît souvent aussitôt. Tu rentres plus en profondeur, tu as plus de place. Nous, on lit de la « narrative nonfiction » depuis longtemps. Les éditions du Sous-Sol l’ont remise au goût du jour mais Joseph Kessel faisait déjà ça ! Ça avait disparu, en France, contrairement à la tradition anglo-saxonne. C’est du journalisme qui emprunte des codes à la littérature, pour dire le réel sans rien sacrifier au plaisir de la lecture. On fait du journalisme qui nous ressemble. On sème, et aux autres de prendre la suite s’ils veulent. Nos thématiques croisent celles des militants mais on ne les sélectionne pas pour cette raison.
Toutes les photographies sont de Maya Mihindou, pour Ballast.
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Corine Pelluchon : « La cause animale va dans le sens de l’Histoire », avril 2017
☰ Lire notre entretien avec Maud Alpi : « Cet aveuglement est aujourd’hui impossible », novembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Les Cahiers antispécistes : « Sortir les animaux de la catégorie des marchandises », septembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Vincent Message : « Accomplir le projet inachevé des Lumières », juin 2016
☰ Lire notre entretien avec Renan Larue : « Boucheries et poissonneries disparaîtront progressivement », mars 2016
☰ Lire notre entretien avec Ronnie Lee : « Mettre un terme à l’exploitation animale », janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec L214 : « Les animaux ? C’est une lutte politique », novembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Aurélien Barrau : « Le combat animalier est frère des combats d’émancipation et de libération », septembre 2015