Texte inédit | Ballast | Série « Littérature du travail »
Souvent, pour se souvenir, il nous faut l’aide de passeuses, de passeurs. La mémoire en dépend. Sans Marie Josèphe Lemaire, la poésie de son mari Gérard Lemaire, décédé en 2016, ne serait pas arrivée jusqu’à notre rédaction. Depuis bientôt quatre ans, elle publie chaque jour un poème de son compagnon défunt sur un blog hébergé par Mediapart. L’impression que nous laisse la lecture, un jour, de quelques-uns du millier de poèmes déjà diffusés est nette : nous étions passés à côté d’une rencontre heureuse. Né en 1942, Gérard Lemaire a toute sa vie plaidé pour une poésie politique, inspirée par son quotidien d’intérimaire, ses périodes de chômage, ses accidents et ses voyages, comme par les moments de résistance et de révolte du XXe siècle. En novembre dernier, dans une brasserie parisienne, Marie Josèphe Lemaire nous a raconté sa vie, celle de son mari et la manière dont elle fait aujourd’hui vivre son œuvre. Sixième et dernier volet de notre série consacrée à la littérature du travail. ☰ Par Yanna Rival, Loez et Élie Marek
[cinquième volet : « Catherine Poulain : Brûler encore, brûler jusqu’au bout »]

Cette femme, c’est Marie Josèphe Lemaire. Elle nous raconte : « Quand Gérard est mort, sur sa table de travail il y avait une pile de poèmes dactylographiés. À force de voir cette pile, je me suis dit Un jour ça va tomber. Et si ça tombe, l’ordre va disparaître
. » Depuis ce jour où elle s’est emparée des feuilles laissées par son mari, elle en a numéroté les pages, a rassemblé les textes éparpillés puis s’est appliquée à les transmettre — par e‑mail ou par la Poste, notamment en direction d’une maison d’édition indépendante2, et sur Internet par l’intermédiaire d’un blog hébergé par Mediapart, où elle publie un poème par jour. Quand Marie Josèphe nous a contactés pour nous indiquer, simplement, la publication d’un poème de son mari susceptible de nous intéresser, nous nous sommes dits qu’il serait bon de la rencontrer. Pour ne pas l’oublier, lui, et pour la découvrir, elle.
Intérim, chômage et poésie
« Nous nous sommes dits qu’il serait bon de la rencontrer. Pour ne pas l’oublier, lui, et pour la découvrir, elle. »
Gérard est né à Saint-Quentin en 1942 dans une famille ouvrière. L’école lui réussit, mais dans un premier temps il ne peut pas étudier plus loin que le certificat d’études. En 1955, un grave accident de moto laisse sa mère hémiplégique. Ses deux parents font un long séjour en hôpital. Il s’engage alors dans un CAP d’aide comptable, où il apprend à taper à la machine — « vite et bien » comme le souligne Marie Josèphe — ce qui lui sera utile par la suite. Son père le fait entrer à l’usine, dans les bureaux. Mais Gérard est trop nerveux, le travail ne lui convient pas. Il enchaîne les emplois avant de devoir se faire opérer pour un décollement de rétine. Marie Josèphe complète : « Il a ensuite fait de l’intérim : refaire un escalier, placer des aspirateurs, travailler dans des gares de triage, dans les usines pour charger et décharger les camions, tailler de la pierre… L’intérim, ça peut être n’importe quoi. Une fois, il a refusé un travail parce qu’il devait marcher sur une planche en hauteur… Mais il y en a qui le font, il y a beaucoup d’accidents. Il y avait des travaux durs, mais Gérard trouvait le travail dans les bureaux tout aussi aliénant. »
Il adhère au Parti communiste en 1966. En 1969, il en est exclu. À l’automne 1968, il a participé à la confection d’un tract ouvertement critique à l’endroit du parti et de la CGT, qui a circulé dans les milieux ouvriers de Saint-Quentin. La rupture est consommée et Gérard se tourne vers un groupe conseilliste3, Informations et correspondances ouvrières, qui publie anonymement un long texte dans lequel il dresse le bilan de sa brève adhésion. Gérard y écrit : « L’adhésion à un parti répond à une peur, à un vide personnel. Mais l’embrigadement n’est pas la solution à ce vide. Comme d’autres prennent un engagement dans la Légion parce qu’ils ne trouvent rien de mieux ni d’autre à faire, parce qu’ils s’ennuient, j’ai donné mon adhésion à un parti qui, je le croyais, pouvait transformer la société4. »
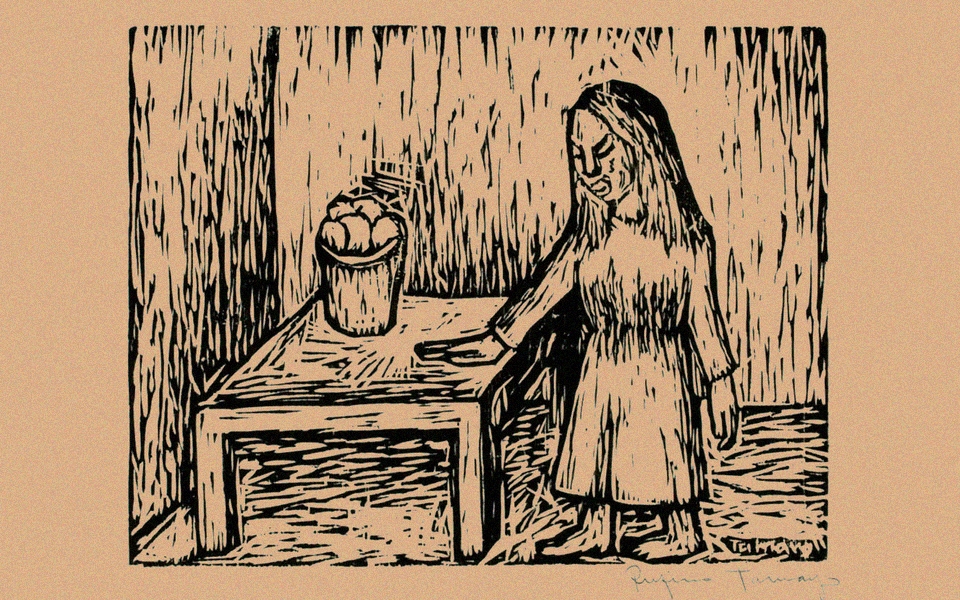
[Rufino Tamayo, Mujer y mesa, 1935]
Outre la poésie, Gérard a une passion pour les voyages. « Jeune, il vivait chez ses parents puisqu’il n’avait pas les moyens de vivre ailleurs. Et quand il avait assez économisé, il partait avec des copains en stop. De 1969 à 1971, il part un an et demi en Amérique latine, il est allé jusqu’au Canada, est retourné en Amérique Latine puis il est rentré. » Il lit régulièrement Granma, le journal officiel de la Révolution cubaine, et s’intéresse de près à la politique sud-américaine. Des amis situationnistes lui ont donné des contacts au Pérou. Là-bas, lors d’une visite à la prison de Lurigancho, près de Lima, il rencontre un commandant de l’Armée de libération nationale, Héctor Béjar : « le guérillero redoutable, l’inspirateur de la guerre révolutionnaire », comme il l’écrit dans dans un texte du recueil Transits, sur une heure sud-américaine où il revient sur cet épisode5. Pourquoi cet homme-ci, dans ce pays-là ? Une réponse peut-être ici : « Il y a des gens qui pourraient mourir pour un air de musique, j’entendais la révolution du continent comme cet air de musique-là. »
C’est le jour de visite pour les prisonniers. L’autobus est comble, la cour du pénitencier aussi. « Ce n’est qu’un tour en Amérique Latine que j’avais décidé de faire depuis longtemps. […] Je suis venu te saluer », explique-t-il sobrement pour se présenter au révolutionnaire péruvien. Deux heures passent. « Rien ne me sépare de lui comme il parle [de] ses idées, sans une ombre de dogmatisme, mais avec la même curiosité profonde pour les chemins de ceux qui œuvrent à la révolution en Europe que je pouvais en avoir pour les hommes de la guérilla. » Une rencontre qu’on imagine déterminante, pendant laquelle Gérard reste lucide quant à sa position de visiteur : « Il n’y a plus que deux êtres l’un en face de l’autre qui pourraient sans doute devenir des amis, mais qui se sentent surtout plongés dans un même combat : lui qui a pris les armes et les a maniées, en prison depuis quatre ans et moi libre et touriste. L’inexprimable gît entre nous : sa détention reste là comme un immense trou que je ne peux pas combler… » Il repart un manuscrit dans ses poches qu’il doit transmettre à des étudiants à Quito, en Équateur, pour qu’il puisse paraître là-bas. Il conclut : « Il faut aller voir ceux qui sont derrière, plus proches de la vérité que nous-mêmes. »
Une rencontre au travail
« Les années 1970 sont celles du chômage de masse en France. À son retour, Gérard travaille en intérim et se retrouve pendant de longues périodes sans emploi. »
Les années 1970 sont celles du chômage de masse en France. À son retour, Gérard travaille en intérim et se retrouve pendant de longues périodes sans emploi. Pendant ce temps, l’auteur est prolixe. Il écrit en 1972 son premier recueil de poésie, En travers de la main, tiré à 300 exemplaires par les éditions St-Germain-des-Prés. En 1975 les éditions Plein Chant, fondées quelques années plus tôt, publient son recueil Sommeil qui hurle, et les éditions l’Apostrophe L’Ouvre-monde. L’écrivain Jacques Morin, alors animateur de la revue Le Crayon Noir qui accueille certains poèmes de Gérard, écrit à la même époque : « Nous ne saurons oublier Gérard Lemaire récitant des poèmes. Tant de chaleur, de violence, de sincérité dans cette voix maladroite, émanant de ce corps embarrassé… » Enfin, inspiré par son quotidien, il publie en 1976 Journal d’un chômeur, tiré à environ un millier d’exemplaires. Dedans, il s’insurge contre l’image que la période accole aux personnes sans emploi : « On s’est fait avoir, couillonner. Les grands brisants de la tristesse vous poussent leurs esquilles dans le corps. C’est pas vrai ! Je ne suis pas cette momie, cette larve, ce crachat ! On m’a mis là de force, contre moi-même ! Je proteste6 ! »
Il quitte Saint-Quentin, où il animait des rencontres autour de la poésie, pour le Val-d’Oise — et collabore à plusieurs revues. En 1978, il est embauché par le mouvement ATD Quart Monde. Il s’est présenté comme « OS tout poste » et porte des pulls achetés 10 francs. Là, il rencontre Marie Josèphe Boucraut. Gérard a candidaté pour trouver un travail, quand Marie Josèphe, elle, a rejoint l’association « par idéalisme ». Venant de la bourgeoisie industrielle de Troyes, elle a d’abord travaillé comme ingénieure d’études en entreprise. Elle voulait s’engager dans un mouvement qui aborde la pauvreté sous un angle politique et pas seulement humanitaire. Gérard, on l’a dit, vient d’une famille ouvrière de Saint-Quentin, a fait divers boulots, voyagé en stop sur différents continents et est sans le sou. Il sait taper à la machine, faire de la sténo. Deux ans après leur rencontre, Marie Josèphe ajoute Lemaire à son patronyme : ils se sont mariés et ont eu trois enfants.

[Rufino Tamayo, La Mandolina, 1939]
Dans un court texte écrit en 2018, elle se souvient : « Épousez un poète… Gérard m’a assez vite cité Madame Jouhandeau… la première chose dont vous vous apercevez, c’est qu’il ne tire pas la chasse d’eau. » Elle ne comprends pas tout de suite ce que ça signifie, pour Gérard, être poète. Elle a peur, aussi, de ne pas aimer ses poèmes. Mais elle trouve qu’il y a dedans une étincelle qui lui fait saisir toute leur importance. « Je ne voyais pas Gérard comme un poète prolétarien. Mais lui, oui. Il était de la classe ouvrière et il écrivait pour elle. Il trouvait important de savoir d’où on venait, et ce qu’on voulait, en l’occurrence lutter contre l’injustice sociale. Pour lui, c’était clair, même s’il ne s’est pas cantonné à une écriture militante ». Cette manière d’aborder la poésie résonne avec les deniers mots de Travaux, de Georges Navel : « Il y a une tristesse ouvrière dont on ne guérit que par la participation politique. Moralement, j’étais d’accord avec ma classe7. »
Les voyages reprennent, et se font désormais à deux. « On est allés au Pérou deux fois trois mois. Comme Gérard lisait l’espagnol, on achetait le journal local. Quand on allait en Italie, on achetait au moins une fois le journal local. Même si on ne comprenait pas on avait au moins les grands titres. Le contexte social comptait beaucoup. » Chez les Lemaire, on lit la presse quotidiennement : « Les mensuels de Siné ou bien La Gueule ouverte. On a acheté régulièrement des numéros de différents journaux, on a comme ça un éventail de journaux d’extrême gauche de l’époque. On achetait Le Monde, Le Monde libertaire, un peu moins Le Monde diplomatique. » En 1981, le poète qui, enfant, n’a pas eu la possibilité de poursuivre ses études, s’inscrit à la fac. Pas n’importe laquelle : Paris 8, celle de Saint-Denis, qui accepte des étudiants sans le bac. En 1984, il y obtient une maîtrise de littérature, avec l’écriture d’un mémoire sur l’écrivain roumain Panaït Istrati : « Gérard s’identifiait à Istrati. Il avait fait les mêmes sales boulots, il avait eu aussi des amitiés fortes, il avait voyagé, il avait erré. On sent combien il a mis de lui-même dans ce mémoire. En le lisant, on en apprend sur Istrati mais aussi sur Gérard. »
Un poète prolétarien
« La poésie n’est pas affaire d’élite, de belle langue ou de culture qu’on aurait pris soin de fignoler dans de longues études ou dans un milieu favorisé. »
Gérard ne garde pas ses poèmes pour lui ou quelques proches ; il a le désir d’être publié, et aimerait être rémunéré pour ça. Il s’est fâché avec nombre d’éditeurs ou de directeurs de revue, leur reprochant de ne diffuser que la poésie « qui dérange le moins8 », et de ne pas hisser le poème à la hauteur de ce qu’il devrait servir : la révolution sociale. Gérard regrette que la poésie soit un milieu si fermé et, qu’au fond, le lectorat des revues spécialisées soit constitué des poètes eux-mêmes, qui s’abonnent aux revues dans lesquelles ils sont publiés afin de les faire vivre. Ce vase clos des publications, l’entre-soi qui se réunit sur des manifestations, comme au Marché de la Poésie à Paris où Gérard Lemaire n’a jamais mis les pieds, ne correspond pas à l’idée qu’il s’en fait. Pour lui, la poésie peut changer les choses, et « chacun et tout le monde a le pur droit d’écrire son poème ». La poésie n’est pas affaire d’élite, de belle langue ou de culture qu’on aurait pris soin de fignoler dans de longues études ou dans un milieu favorisé. Elle est affaire de parole, celle des prolétaires, qu’il s’agit de faire entendre là où on n’a que peu envie de l’écouter. Gérard affirme ainsi que « publier sans concession est une lutte sans merci8 ».
Lorsqu’il tombe par hasard, au détour d’un volume des dictionnaires de littérature que les Presses universitaires de France éditaient dans les années 1960, sur le nom d’un auteur qualifié de « prolétarien », Gérard s’empresse d’en prendre note. Souvent, un hommage ou une salutation suit dans l’un ou l’autre de ses poèmes. Nombreux sont les noms propres qui y surgissent, venant de temps et d’espaces plus ou moins lointains. Pour lui, l’oubli est insupportable. Citer devient alors une façon de se remémorer, de rendre hommage à des révolutionnaires — Dmitri Pissarev, Julius Janonis, Edith Lagos — ou à des écrivains prolétariens — Javier Heraud Pérez, Juan Gelman, Etheridge Knight — que l’Histoire n’a pas toujours jugé bon de faire entrer dans ses livres et ses archives. Hormis sa brève expérience au Parti communiste, le poète n’est pas encarté. Marie Josèphe non plus. Mais tous les deux sont sensibles au contexte social. Le voyageur est également internationaliste, et curieux. En 1966, sur un coup de tête, il est ainsi parti vivre quatre mois dans un kibboutz en Israël. C’était juste avant la guerre de 1967. L’expérience lui parle, mais il ne reste pas : il tarde à apprendre l’hébreu et assiste à des comportements racistes envers les ouvriers arabes. Marie Josèphe raconte que, par la suite, « chaque fois que quelque chose se passait en Palestine, Gérard écrivait un poème. Il soutenait aussi beaucoup Mumia Abu-Jamal et a écrit plusieurs poèmes sur lui ».

[Rufino Tamayo, La virgen de Guadalupe, vers 1931]
Elle poursuit : « Vous avez des poètes très connus, reconnus, qui écrivent des poèmes très beaux, très biens. Pour Gérard, la poésie ce n’était pas que ça, c’est aussi le message, l’engagement, ne pas forcément faire des phrases en bon français, parler comme les gens parlent. Pour lui ce n’était pas normal que ce soient toujours les beaux messieurs en cravate qui parlent bien qui soient invités pour parler. Ce n’était pas quelqu’un qui aurait fait l’antichambre des éditeurs, mais il aurait voulu bien sûr être reconnu comme poète. J’en viens à penser que la poésie de Gérard, par l’engagement qu’elle a, ne plaît pas à beaucoup de gens. Si vous critiquez les gens qui parlent bien, les gens qui parlent bien ne vous aiment pas. »
Poésie, voyages, militantisme, moments de dèches et périodes plus heureuses : ainsi s’égrainent les années suivant la rencontre de Gérard et Marie Josèphe. Puis, en 1987, une opération de l’œil droit, la deuxième, le cloue immobile pendant plusieurs mois. Il est reconnu invalide à 50 %. Deux ans plus tard, le couple déménage dans l’Indre. Les enfants vont à l’école du village et Gérard continue d’écrire. Il n’a jamais cessé. À sa mort début octobre 2016, il laisse derrière lui plus de dix mille poèmes, publiés entre 1972 et 2015. Après son décès, une deuxième vie commence pour son œuvre. Marie Josèphe refuse de voir s’éparpiller les vers de son compagnon. Si lui n’est plus, reste sa poésie.
La mémoire des poèmes
« Si vous critiquez les gens qui parlent bien, les gens qui parlent bien ne vous aiment pas.«
Il y avait donc une table et, dessus, une pile immense. « J’ai pris un crayon, j’ai commencé à numéroter et à écrire sur un cahier les titres, les dates, et je suis arrivée à plus de mille poèmes ! Ça m’a donné envie de continuer. J’ai regardé certaines revues que je connaissais pour voir dans quels numéros il avait été publié. Et puis je me suis aperçue que Gérard avait des chemises et des cahiers avec des poèmes dedans. Parfois c’était daté. Je les mettais dans l’ordre. Puis j’ai trouvé des volumes qu’il avait préparés et j’ai publié en 2017 deux volumes de poésie. »
En travaillant sur les écrits de Gérard, Marie Josèphe les redécouvre. « Pendant des années, j’ai lu des poèmes dans les revues qui publiaient Gérard ainsi que d’autres frais sortis de sa machine à écrire, mais je ne savais pas parler dessus. Je ne savais pas dire comment ils m’atteignaient. Maintenant que je tente d’organiser ce que Gérard a laissé, que je numérote des poèmes, recopie le titre ou la première phrase, que j’en lis souvent et beaucoup, que j’en enregistre sur ordinateur et donc lis et relis les textes, à force ma sensibilité s’est affinée et j’ai compris pourquoi une majuscule ou pourquoi une minuscule pour commencer une ligne, pourquoi une inversion de mots, une barre oblique, un tiret ; comment cela fait sens. L’intensité et la sensibilité avec laquelle Gérard vivait et regardait la vie faisaient naître des poèmes qui, au-delà du fait divers, de la personne rencontrée, d’un paysage, d’une lecture, d’une information, disaient quelque chose qui reste, qui est à la fois intemporel et ancré dans la réalité. J’ai compris que Rimbaud ne s’était pas trompé en disant : le poète est un voyant9
. »

[Rufino Tamayo, El leñador, vers 1926-1927]
Marie Josèphe est devenue passeuse de mémoire. Elle est celle qui maintient vivante une voix disparue. Sans relâche, elle travaille à l’édition de tous ces poèmes qu’elle a retrouvés et patiemment classés, rangés, relus. « Il y avait un volume qui avait été publié par Robert Roman en 2000. Je lui ai écrit pour savoir s’il voulait le republier. Robert Roman a pensé que ce serait intéressant de publier une sorte de biographie de Gérard, qu’il a appelée anthologique
. Il y a 200 poèmes dedans. C’est une biographie de poète. Pour faire ça, Robert Roman m’a demandé des trucs. Je lui en ai envoyés, j’en ai scannés et, de fil en aiguille, j’ai découvert plein de revues dans lesquelles Gérard avait publié. »
En août 2019, pour continuer la diffusion de tous ces écrits restés enfouis, Marie Josèphe ouvre un blog sur Mediapart où elle publie les poèmes de Gérard. Elle conserve, dans ce geste de partage, la conscience sociale qui a accompagné leur écriture. « C’est difficile de savoir ce qu’on pourrait faire pour changer les choses. Alors voilà, je publie un poème par jour, je me dis que ça apporte quelque chose de différent. Tout le temps vous avez des articles où on s’indigne pour beaucoup de choses, et c’est normal qu’on soit indigné, mais ça étouffe. Je crois que le fait qu’il y ait des gens qui ne publient que de la poésie permet de respirer. Il m’arrive de publier un poème parce que je trouve que ça va bien dans le contexte, mais souvent je les publie parce que je les aime bien. »
*
Écrire des poèmes ; se souvenir de poèmes écrits. Revendiquer une voix poétique ouvrière ; maintenir en circulation cette voix disparue. À leur manière, Gérard et Marie Josèphe Lemaire ont chacun et chacune une place dans l’histoire de la littérature prolétarienne, cette « production oubliée d’éléments d’une classe sociale constituée, faite de voix individuelles », comme nous l’a expliqué l’éditeur Edmond Thomas — une histoire sans cesse menacée par l’oubli, justement, ou la minoration. Gérard Lemaire, lui, n’oubliait pas. Ni le militant afro-américain Mumia Abu-Jamal ou les jeunes Palestiniens, ni sa classe, ni la chaîne de travailleurs qui rendait possible la publication de ses poèmes — celle-là même qui, comme il le note très justement dans l’un d’eux, rend possible la poésie même10.
Sur la palette de Spartacus
[1989-1993, envoyé par Marie Josèphe Lemaire]
Pourquoi ne pouvais-je aller pisser
Dans l’entrepôt
Les toilettes étaient à l’autre bout
De ce hangar plein de drôles martyrs
Dans lequel je n’avais même pas une place
Une demi place ou la pire
Et cette place qui n’en était pas une
À aucun moment
Je ne pouvais (pas) la quitter
Debout devant l’immensité des caisses et des ferrailles
Des pièces détachées et des tuyaux d’échappement
Des allées de casiers non lyriques
Où j’ai surpris un jeune garçon en gris
S’accrocher aux boîtes presque héroïquement
Là dans cet épuisement forcé
Dans cette fumeuse absence d’ivresse
Dans cette douce tuerie
Les heures avec l’autre
(Un ex-domestique du comte de Caulaincourt)
Ne passaient pas
Romantiquement
Seule une odeur de poussière dans une lumière à peu près jaune
Écrasait la misère des muscles
Orphelin sans aucun doute
[publié dans La cigogne, n° 68, novembre-décembre 2003]
Les ouvriers m’ont déçu
Ils n’ont pas fait la Révolution
Peut-être qu’ils ne la feront jamais
Ils m’ont piétiné de leurs sarcasmes
Mais souvent avec des attitudes mortelles
Ils s’amusaient de mes infirmités et
j’étais leur jouet
Une distraction comme une autre
Pourtant je déchargeais les mêmes
wagons qu’eux toutes les nuits
Dans cet entrepôt où le jour d’autres
ouvriers réparaient les locomotives
Ils ont perdu comme en 14-18
Marcel Martinet le savait
Avant qu’ils partent pour se battre
Et ils perdent ou ils abandonnent
encore aujourd’hui
J’espère que c’est un mauvais rêve
L’Histoire (tellement) toujours
plus longue
Jusqu’à ce que sorte l’effrayante
vérité
Il ne suffit pas toujours
De tirer son épingle du Jeu
Ne pas répéter
[octobre 2008, publié dans Pourquoi écrire ?, éditions Unicité, 2022, p. 19]
Une mort en entraîne une autre
Je ne m’appelle pas Otto René Castillo
Poète guatémaltèque mort sous la torture à trente-et-un ans
(en 1967)
Je ne m’appelle donc pas
Continuant d’exister
Attendant je ne sais quoi
Amoureux peut-être d’une couleur qui m’échappe
Écoutant la radio qui cause du sang inutilement versé
Jusqu’ici
M’apercevant clairement d’un retard
Que j’aurais du mal à éclaircir malgré quand même
Ici il pleut tous les jours les mêmes vagues
On les vomit mais difficilement
On oublie de temps en temps les suicidés les assassinés
bâillonnés
Dans les rues ou dans les murs
Ou ailleurs
Heureusement la radio de l’autre temps en temps en parle
Ou n’en parle pas
À Rafal Wojaczek
[2009, publié dans Pourquoi écrire ?, éditions Unicité, 2022, p. 70]
Je ne barbote pas dans le fleuve des résignations
Allant tout droit dans la griffe qui vient
Et je ne suis pas seul / mon nom est écrit sur la paroi d’un volcan
Et ces fumées si pâles ne renversent personne
Seuls les éboueurs de Łódź
M’apprendront l’alphabet qui me brûle
Ou un vagabond des alpages
Dans ce chalet d’occasion de misère avec son feuilles
Ce Manouche au teint des sournois malheurs
Prenant le repas à l’abandon des friches
On ne finit pas comme ça de malmener une torche de ruines
Je n’entends que des clameurs appelant l’autre face du monde
Quel désert nous fait avancer sans au-delà
Pulvérisant je ne sais quoi au bord des rues
(sans titre)
[2008, publié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 199]
Un poète un seul peut-il
Vivre ou survivre sans le peuple
Sans les bras de celui-ci
Le portant malgré tout d’une façon l’autre
Sans un souffle d’images inouï
Là tapi devant les foires d’écrans
Un quelqu’un ou d’autres
Hors des mascarades et des carnavals de meurtres
Aucun sifflet qui pourrait retentir
Comme ce postier à la main arrachée
Par l’explosif qu’il fabriquait dans sa cuisine
Pour caresser les radars sur les routes
Il attend la prison sur un lit d’hôpital
Toute voix éteinte outre la déflagration
L’aveu…
[1974, publié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 73]
Qui est celui
Les mains dissimulées
Au travers des fosses
Qui est celui
Lentement avachi
Enferme ses cris
Qui est celui
Le morcelé
Les bras noués
Qui est celui
Décousu
L’animal clignotant
Qui est celui
D’une traversée de lames
D’un chantier arc-boutant
Qui est celui
Par trop d’oreilles
L’envenimé
Qui est celui
Par un sentier abrupt
Perçant
Le mot imprononçable
Transfiguré
Saoul de par-chemins
Qui est celui
Sans âge
Pauvre
(sans titre)
[2001, publié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 166]
Ouvrier chômeur
Poète sans trace des bas quartiers
Homme de nulle part
Il t’est interdit de respirer
Il t’est militairement interdit de bouger
Seulement un doigt
Un muscle de ta face
Tu n’es que le fond d’une poubelle
Tu n’es même pas le pire du rien
Tu es plus inexistant qu’un insecte sur un tas de fumier
Tu es plus repoussant
Qu’une haine pestilentielle
Tu es quoi
Il n’y a pas de langage pour ton déchet
Ta dégaine
Tu es mort déjà
Tu es hors d’une seule poussière du verbe
Tu fais rire les dieux hilares sur leurs trônes
Cette scène d’arène se passe ailleurs
Ils ont défenestré l’ombre du dernier cri
Mon effort ici-même est tout à fait risible
tout à fait gobé par la puissance de leur
Empire sacré
Ils possèdent l’atome de leur jour
Et toutes les planètes d’ici-bas
Ils sont les maîtres d’une mort plus absolue que la mort réelle
Plus industrialisée que le plus actif des camps…
(sans titre)
[2000, publié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 150]
Il faut se ruiner quand on est pauvre
Il faut donner sa santé lorsqu’on est malade
Il faut aussi se jeter à l’eau sans avoir une seule brasse
Et bien d’autres choses
Bien d’autres stations debout
Aux portes closes des maisons closes
Devant des cathédrales resplendissantes de pierres illuminées
Pour que vienne un souffle
Une allée
Un espace où l’on puisse marcher
Et aller plus léger
Pour que ce qui n’a jamais eu lieu arrive
Une ombre qui se dénoue
Un dessin d’envol après le signal égal
Pour que le vin du Sud coule dans une gorge moribonde
Pour qu’une lettre sourie
Pour que quelque chose tremble et se mette là à respirer
(sans titre)
[2002, publié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 176]
Est-ce folie de croire aux mots
Quand la tempête abat les arbres les plus
enracinés
Est-ce refuge
A celui qui demande plus qu’il ne peut
recevoir
Quelle balance secrète quelque part
Agite son fléau dans la tempête
Existe-t-il un juge vraiment bon
Existe-t-il un remous dans la nature des hommes
Qui ferait le seul équilibre
A celui qui ne connaît de la justice que
son arme
Mais c’est folie d’oublier la tempête
C’est folie pire de ne pas attendre ses
souffles
(sans titre)
[1999, publié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 137]
Ils ont tué le peuple
Quelque part ils ont tué le peuple
Sans sommation par principe et habitude
Ils ont fusillé le peuple dans le dos
En plein centre du dos et sans raison
Le peuple n’était qu’une montagne magique
Il vivait comme à peine une invention sans
arrêt menacée
Le peuple n’a jamais dû vivre au fond
C’est une idée
C’est forcément virtuel
Le peuple c’est un gisant en haillons
C’est une statue décriée qui ne sort qu’en
pleine nuit
Il existe parfois dans une chanson qui risque
des sanglots
Il est muet comme moi
Il reste en retrait si bien qu’il ne peut
même pas esquisser un pas
Un vrai pas
Nulle part
Je suis la trace d’une voix toujours effacée de son
sacrifice obligatoire
Je suis sont souvenir abattu par tous les
fusils aux aguets
Le peuple sait tuer ses enfants quand il a peur
Quand vient la guerre qui emporte jusqu’à
ses cendres
(sans titre)
[2008, publié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 23]
Si personne ne te tend la main
N’oublie pas le vent soufflant sur ton ombre
Ce peu de choses est aussi un torrent
Laisse-le venir couler dans tes paumes
Cette légèreté flotte n’importe où dans les air
Elle t’appartient sans faire de bruit
Si personne ne vient vers les pas inconnus
Si l’accablement te poursuit sans que tu saches pourquoi
Trouve une croûte de pain sur ta table
Lance-la au diable pour jongler avec
Ce vent sera le plus merveilleux ami
Tu peux le gifler l’envoyer promener d’un geste
Il ne se laisse enfermer par aucune trappe
Le vent n’existe que si tu bats des mains
Pourquoi sont-ils si abstraits ?
[2008, publié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 29]
Ceux qui mentent en se laissant aller
Se demandent d’où vient la poésie
Ils disent qu’elle demeure toujours indéfinissable
Ces pauvres perturbateurs ne voient pas plus loin que leur nez
Même si celui-ci peut être assez long
Ils ne voient pas le bûcheron qui coupe le bois
Ils ne regardent pas le paysan sur son tracteur
Ni l’éboueur qui passe retirer leurs ordures
Ils ne voient pas les gens qui la nuit font tourner
Les machines pour le gaz l’électricité les meubles
Ils ne voient pas celui qui fabrique leur chaise
Ni même l’imprimeur ou le metteur en scène
La poésie est d’abord entre ces mains là
Où apparaîtrait-elle je me le demande encore
Dans la plus lourde bataille
[publié en 2010 dans la revue Portulan bleu, n° 9, et republié dans Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, éditions Le contentieux, 2019, p. 280]
La poésie n’a pas encore
Été inventée
Elle est devant nous peut-être
Si l’avenir s’ouvre un jour à elle
Je ne tiens rien par ces mains
Que ce désir qu’elle existât dans une autre aurore
Là pris dans un ouragan si puissant
Déjà évacué / car toutes scènes détruisent
Mais quel vent traverse la raison et la folie
Dans l’immense clarté d’un instant fuyant
Il s’enracine dans un instinct de fraîcheur des femmes
Si au dernier moment elles s’unissent en révolte
La poésie est à inventer toute et une
Oubliée sous la marche des ronflants virtuoses
À Tadeusz Borowski
[2008-2009, partagé par Marie Josèphe Lemaire]
Sorti des camps nazis
Ton « Mai rouge » éblouit les espaces
Mais il a été publié après ta mort (1953)
Quel âge antérieur aurais-tu aujourd’hui
Tu ne fus donc que ce flamboiement
Tu t’es jeté farouchement dans la mort
Laissant cruellement le monde à ses perditions
Pauvre misérable monde pour un homme tel que toi
Tu ne restes que cette trace de sève dans les
Écroulements de massacres du Présent
On s’accroche à tes épaules inimaginables
J’avais neuf ans en 1951 dans les rues à usines de mon quartier
Pas de rémission dans les temps écoulés
Permets-moi un instant de fouiller ta tombe
Les raisins bafoués
[« Poèmes pour Mumia Abu-Jamal », Comité de soutien à Mumia Abu-Jamal, Marseille, 2000]
Ne pas oublier Abu-Jamal
dans son oubliette voyage pour la mort
Ne pas oublier si possible quand
l’heure et les années s’enfuient ce prisonnier
Il attend pour les peuples du monde
ce qui ne peut même pas se formuler outre larmes
Il est là partout dans les geôles
à côté des suicidés
dans les yeux d’un chômeur en trimard
Ce n’est pas un poème qui fera
reculer les machines huilées du Désastre
Mais des mains d’automate palpent
l’infamie sans que personne ne leur demande
Tous les poèmes depuis le début du monde
n’auront servi à rien si cet homme n’était pas libéré
Yeux fermés des tués
[2004]
Tous les jours tombent de jeunes Palestiniens
Tués
Bien tués — rien ne les sépare
Aucun nom sur ces faces combattantes
Mais ont-ils même morts droit à la moindre
existence
Ont-ils droit de se lever et de regarder
autour d’eux
Ont-ils droit de voir la mer et de marcher
dans leurs rues
Mais pour moi ils prennent toutes les places
Ce sont eux la puissance irradiante des mosquées
Ce sont eux les versets du Coran
Ce sont Eux
Qui traversant le souffle glaciaire
Prennent la parole
Ces tués ont des vies qui perturbent le
monde affolé des propagandes
Ces tués bousculent la machine à mentir et
ses rouages
À anéantir
À laisser de côté le plus cher
Le vibrant témoignage
La clarté qui doit être massacrée — jour après
jour
Illustrations de bannière et de vignette : Rufino Tamayo
- Dans Absurde crépuscule, n° 2, mai 1997.[↩]
- Robert Roman, Gérard Lemaire, un poète à hauteur d’homme, Le Contentieux, 2019.[↩]
- Le conseillisme, aussi appelé communisme de Conseils, est un courant marxiste antiléniniste qui entend opposer à une organisation partisane centralisée une multitude de Conseils ouvriers. Ses principales expressions historiques se sont déroulées lors de la Révolution allemande de 1918-1919 puis en Hongrie, en 1956, lors de l’insurrection de Budapest.[↩]
- Cité dans Robert Roman, op. cit., p. 37.[↩]
- Cet extrait et les suivants sont tiré du texte « Penal de Lurigancho », présent dans le recueil Transits, sur une heure sud-américaine, Atelier du Gué, 1977, épuisé. Nous remercions Marie Josèphe Lemaire de nous avoir communiqué les pages correspondant à la rencontre avec Héctor Béjar.[↩]
- Cité dans Robert Roman, op. cit., p. 95.[↩]
- Georges Navel, Travaux [1945], Folio, 1995, p. 247.[↩]
- Cité dans Robert Roman, op. cit., p. 249.[↩][↩]
- Texte écrit par Marie Josèphe Lemaire en octobre 2018, cité dans Robert Roman, op. cit., p. 388-389.[↩]
- Voir le poème « Pourquoi sont-ils si abstraits ? », 2008, publié dans Robert Roman, op. cit., p. 29 et reproduit à la suite de cet article.[↩]
REBONDS
☰ Lire les bonnes feuilles « Les pauvres du monde entier — le journal de Françoise Ega », mai 2023
☰ Lire notre entretien avec les éditions Plein Chant : « Les voix d’en bas », mai 2023
☰ Lire notre entretien avec Éliane Le Port et Xavier Vigna : « Quand la classe ouvrière écrit : deux historiens en discussion », mai 2023
☰ Lire notre récit « J’ai quitté les rondes paisibles — journal d’un ouvrier », Louis Aubert, mai 2023
☰ Lire notre article « Poésie, anarchie et désir (II) », Adeline Baldacchino, septembre 2017


