Texte inédit | Ballast
Des écrits longtemps restés confidentiels de Goliarda Sapienza, également comédienne dans l’Italie des années 1950, nous connaissions surtout L’Art de la joie, un roman traduit en langue française en 2005. Enfin publiés, ses Carnets nous invitent à aller plus loin dans la découverte d’une œuvre toute entière traversée par l’art de dilater le temps « en le vivant le plus intensément possible avant que ne sonne l’heure de la dernière aventure ». Portrait d’une libertaire qui n’entendit pas être maudite. ☰ Par David Guilbaud
Cette année 2019 s’est ouverte avec la publication aux éditions Le Tripode des Carnets de Goliarda Sapienza, fruit d’une sélection opérée parmi quelque 8 000 pages de notes écrites entre 1976 et 1996. Cette parution marque une nouvelle étape du patient travail d’édition d’une œuvre vaste et riche, sauvée par les soins d’Angelo Pellegrino, écrivain qui a partagé les 20 dernières années de sa vie. Peu connus de son vivant, à l’exception de quelques succès tels que L’Université de Rebibbia, ses écrits ont refait surface au tournant des années 2000. En France, ce sont la traduction d’orfèvre de Nathalie Castagné et le soutien de l’éditrice Viviane Hamy qui ont permis à L’Art de la joie, magnum opus auquel l’écrivaine a été « rivée » de 1967 à 1976, de rencontrer enfin la reconnaissance digne de la profondeur de cette œuvre essentielle, charnelle et solaire. Mais celle-ci ne se limite pas à cet Art de la joie : de sa Lettre ouverte (1965) à Rendez-vous à Positano (1984), ses écrits nous donnent à voir la trajectoire singulière d’une femme qui a fait le choix résolu de l’émancipation et d’une liberté absolue vis-à-vis de tous les dogmes, de toutes les institutions et de tous les conformismes.
« La misère des petits logements crasseux, le parfum de la boutique du marchand de jasmin, la sagesse du marionnettiste dont les mains fascinent Goliarda… »
Jeune comédienne dans l’Italie des années 1950, Goliarda Sapienza se tourne rapidement vers l’écriture, activité dans laquelle elle trouvera un moyen de vivre et de continuer à grandir. Travailler sans relâche, continuer à cultiver son jardin : cette exigence, la jeune Goliarda l’hérite de sa mère. Militante socialiste et femme libre, Maria Giudice, après sept enfants d’un premier mariage, s’est mise en ménage avec Giuseppe Sapienza, « avocat des pauvres » de Catane, déjà père de trois fils. Milieu fertile que cette famille recomposée, qui donne son cadre à l’enfance de Goliarda dans la Sicile où elle est née en 1924 : d’un côté, cette mère qui lui a transmis l’urgence d’étudier, le goût des idées et un exemple de la manière dont une femme pouvait vivre libre dans une société profondément conservatrice ; de l’autre, ce père qui lui a légué son amour des gens, ceux qu’elle voyait défiler dans leur maison du quartier populaire de la Civita lorsqu’ils allaient le voir pour qu’il leur vienne en aide. De cette mère adorée, Goliarda Sapienza écrira qu’elle était « la femme la plus remarquable et instruite du continent », et peut-être « la seule mère véritable qui ait existé sur terre ». Dans l’atmosphère de plus en plus lourde des années 1930, la petite Goliarda grandit entourée de ses frères et sœurs qui forment ce « clan », cette « tribu » Sapienza-Giudice qu’elle décrira comme une « île cosmopolite, progressiste et féministe » dans une Sicile alors « rétrograde et cruelle ». Tous les membres de la famille, et particulièrement son frère Ivanoe, qu’elle adore, s’occupent de son éducation tandis que ses parents refusent qu’elle continue à fréquenter l’école fasciste, décrite par Giuseppe comme un « trou pourri où l’on n’enseigne que des mensonges ». Cette Civita, c’est un labyrinthe de ruelles misérables et animées qu’elle raconte dans Moi, Jean Gabin : pêle-mêle, son récit nous fait sentir la misère des petits logements crasseux, le parfum de la boutique du marchand de jasmin, la sagesse du marionnettiste dont les mains fascinent Goliarda, les grommellements du professeur Jsaya, vieil anarchiste aux enseignements duquel Maria et Giuseppe la confient… Mais bientôt survient la guerre, et avec elle une répression accrue contre les ennemis du régime mussolinien : Giuseppe est emprisonné tandis que Goliarda participe à la résistance, connaît la clandestinité sous le nom d’Ester Caggegi et tue même un soldat allemand.
La guerre finie, Goliarda Sapienza peut se consacrer au théâtre. Durant une décennie, elle joue dans plusieurs pièces et films tout en fréquentant des figures majeures de la scène artistique italienne de l’après-guerre, telles que Luchino Visconti et surtout Francisco « Citto » Maselli, qui partagera sa vie pendant 18 ans. Dans ces milieux intellectuels et cultivés, ces années sont celles d’un unanimisme communiste hostile aux « bourgeois individualistes » qui se préoccupent davantage de l’amour et de la vie que du prolétariat ; face à la bonne conscience de ces beaux esprits et à cette intransigeance qui ne tolère aucune dissonance, Goliarda Sapienza est tiraillée entre culpabilité et rejet. Elle notera, bien plus tard, combien son esprit « mortifiait » alors ses sens, « ankylosés par l’idéologie ».
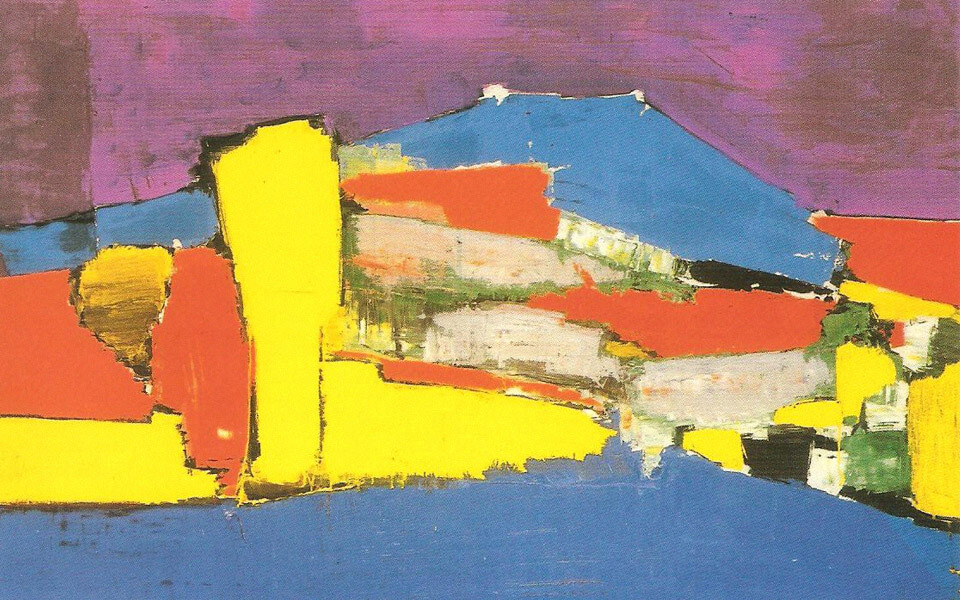
[Extrait d'une peinture de Nicolas de Staël]
À la fin des années 1950, le monde prend conscience de l’ampleur des crimes staliniens et Sapienza s’éloigne peu à peu de l’« atroce moralisme » de ces « professeurs d’utopie », de leur sectarisme et de leur « violent mensonge ». Elle traverse une crise profonde, ponctuée d’épisodes dépressifs et de tentatives de suicide qui la conduisent jusqu’à l’hôpital psychiatrique, où lui sont administrés des électrochocs qui font disparaître certains de ses souvenirs. La thérapie qu’elle entreprend ensuite auprès d’un jeune analyste, avec lequel elle se lie peu à peu, lui permet de surmonter cette crise sans pour autant faire entièrement disparaître cette dépression, qui resurgira périodiquement. Citto et elle se séparent, inévitable aboutissement d’une histoire voyant Goliarda Sapienza devenir « de plus en plus anarchiste » — mot qu’elle n’emploie que par « commodité » —, et lui « de plus en plus prêtre-communiste ». Demeurer dans ces milieux en général, et avec le réalisateur en particulier, lui aurait sans doute été fatal, dira-t-elle.
« Aux succès faciles, Sapienza préfère les
mots qui crachent un feu plus terrible que les canonset ne transige pas. »
Goliarda Sapienza peut désormais se consacrer à l’écriture, qui devient bientôt pour elle un « besoin primordial ». Après ses premiers écrits, Lettre ouverte et Le Fil de midi, dans lesquels elle analyse sa relation avec ses parents et relate sa thérapie, elle entame l’écriture de L’Art de la joie. Elle y raconte la vie de Modesta, fille de papier de celle qui conservera toujours la blessure de n’avoir pas eu d’enfant. De cet enfantement de près de dix années, elle se souviendra plus tard comme de « quelque chose de merveilleux », un « coffre-fort chaud et adoré » qui tenait à distance la « maudite réalité ». La vie de Modesta se déploie dans un univers lumineux dont la trame est faite d’émotions, d’instincts, d’énergie vitale et d’amour. Amour pour les hommes, d’abord, au premier rang desquels Carmine, dont la relation avec Modesta évolue et se transforme comme la vie à mesure que les années passent. Avec Carmine, Modesta comprend la force et la beauté de l’amour lorsqu’il est libéré des conventions sociales, cet amour qui nous permet de mieux sentir le monde en déchirant le voile qui obscurcit notre regard (« Comment pouvais-je le savoir s’il ne me le disait pas ? »). Mais l’amour des femmes occupe une place toute aussi importante dans la vie de Modesta. Comme elle, Goliarda Sapienza entretient un rapport ambivalent aux femmes, entre attirance pour les belles « demoiselles sans défense » — dont témoigne, entre autres, Rendez-vous à Positano — et détestation de l’« insupportable impuissance de la condition féminine ». Ici comme dans le reste de son œuvre, elle rappelle régulièrement combien elle a honte d’appartenir à son sexe lorsqu’il prend le visage repoussant de ces femmes prisonnières du rôle social qui leur est assigné et les a rendues idiotes ; elle entend bien suivre l’exemple de sa mère et de Titina Maselli, la sœur de Citto, qui ont cherché « un chemin pour être différentes, femmes parfaitement femmes et sages, mais différentes de ces oies hystériques et par-dessus le marché pas du tout féminines ».
Goliarda Sapienza ne s’intéresse guère au succès et n’écrit pas pour lui. En 1979, trois ans à peine après avoir achevé le « rêve magnifique » de L’Art de la joie, elle rejette la suggestion, faite par un ami, de mutiler son texte pour en mieux assurer la publication. Parfois, elle doute : dix ans après cet épisode, elle écrira dans son journal que Modesta « doit vivre, fût-ce au prix de crier moins fort ses exigences vitales de rébellion ». Mais elle ne se résoudra jamais à se soumettre aux éditeurs italiens qui refusent ce roman dont ils ne comprennent pas la profondeur, condamnant Modesta à n’être qu’une « enfant mort-née ». Sans doute les éditeurs ont-ils été effrayés par la force d’un texte dans les dernières pages duquel Goliarda Sapienza souligne, pour mieux s’en prémunir, le piège des succès faciles auxquels donnent accès les mots « aimables ». L’auteure préfère les « mots qui crachent un feu plus terrible que les canons » et ne transige pas : elle ne le peut, parce que l’écriture est pour elle un travail de type biologique qui « suit le devenir de la chair et des pensées ». Son manuscrit est bientôt achevé lorsque Goliarda Sapienza rencontre Angelo Maria Pellegrino, qu’elle épousera en 1979 ; Angelo est de 22 ans plus jeune qu’elle : une transgression de la morale bourgeoise pour celle qui critique les fausses différences d’âge, créées par l’arbitraire de l’état civil, qui « ghettoïsent » nos sociétés.

[Extrait d'une peinture de Nicolas de Staël]
En 1980, Goliarda Sapienza vole des bijoux dans l’appartement d’une amie. Le geste lui vaut un bref séjour à la prison pour femmes de Rebibbia, près de Rome, dont elle tirera l’un de ses plus beaux textes. Derrière les barreaux, nous dit-elle, les conventions sociales et la « construction idéale » que nous avons édifiée à l’extérieur ne tiennent plus : là réside la source de la terreur que la prison nous inspire tant que nous n’en avons pas fait l’expérience, mais aussi de la sensation de libération que l’on ressent lorsque l’on s’y voit enfermé, « hors de la société et de soi-même ». Tandis que la personne que l’on était auparavant est « morte socialement pour toujours », marquée par la flétrissure que représente pour les honnêtes gens un passage en prison, les jours qui s’écoulent derrière les barreaux sont pour l’écrivaine ceux d’une grande liberté, qui permet de nouer des liens profonds et sincères avec les êtres que l’on y côtoie, l’esprit délivré de ne plus avoir à penser à un avenir dont on ne possède plus les clefs. L’expérience de la prison lui fait aussi sentir l’importance et la rareté des vraies amitiés, comme celle qui l’unit à Peppino, le concierge de son immeuble qui, à sa libération, est l’un des seuls à l’accueillir sans lui demander d’expliquer son geste ou de faire le récit de son incarcération.
« Le geste lui vaut un bref séjour à la prison pour femmes de Rebibbia, près de Rome, dont elle tirera l’un de ses plus beaux textes. »
Rebibbia aura été pour Goliarda Sapienza l’occasion d’une énième métamorphose. Elle explique avoir voulu, par ce vol de bijoux, « déchirer cette trop facile image de sainte qu’on a cherché durant toute une vie à [lui] coller dessus », « mourir juridiquement […] pour renaître différente ». Ce thème de la métamorphose est omniprésent dans son œuvre : il faut, nous dit-elle, se réinventer régulièrement pour continuer à grandir et conserver cette « jeunesse éternelle de la vie ». Elle souligne également l’importance du silence et de la solitude, « exercice de santé » qui permet ce réexamen périodique de soi-même et de sa vie : « Il n’y a rien à faire, tous les dix ans il faut se refaire entièrement par une longue période de solitude et d’étude, et tous les cinq mois il faut faire la même chose par trois-quatre jours d’absence. » Même la dépression lui apparaît comme une nécessité vitale, aussi nécessaire à l’esprit que la léthargie hivernale l’est à la nature. « S’enterrer en pleine vie pour être en mesure de grandir ? C’est ainsi. Même ce que nous appelons douleur fait partie des choses de la vie, et si, comme des enfants gâtés
par l’utopie de l’absence de douleur, toujours et à tout prix, nous ne parvenons pas à écouter l’enseignement de la peine, de la mélancolie, du tragique, nous ne sommes pas dignes de vivre, comme personnes j’entends, et autant vaut dégringoler dans l’avidité et la non-pensée. »
Goliarda sait combien la mort est présente dans la vie : elle qui a hérité son étrange prénom d’un demi-frère, Goliardo, tué par les fascistes en 1921, et d’une première Goliarda morte peu après sa naissance cette même année. Il faut accepter la réalité de la mort pour mieux savourer les joies de la vie : comme sa famille, Goliarda n’a pas peur de celle que les Siciliens appellent la Certa et qui toujours « vous fixe, sévère et douce ». Modesta non plus ne craint plus « cette ligne d’arrivée qui, si on ne la redoute plus, rend éternelle chaque heure pleinement savourée » ; ainsi peut-on « être libre, profiter de chaque instant, expérimenter chaque pas de cette promenade que nous appelons vie. » La mort comme pendant de la vie, le sommeil comme pendant de l’éveil, l’activité qui puise sa force dans l’apaisement du silence, l’équilibre entre la fureur de Rome et la paix de Gaeta où elle se réfugie… Goliarda Sapienza fait de sa vie la recherche d’un équilibre entre ces deux pôles, comme moyen d’atteindre la sérénité dont elle s’est fait un horizon.

[Extrait d'une peinture de Nicolas de Staël]
De même, plutôt que de chercher une illusoire cohérence, son œuvre vise avant tout à saisir les contradictions qui font la substance de son être et de ceux qui l’entourent : pour elle, la cohérence n’est qu’un « mot totalement utopique […], l’une des nombreuses certitudes dogmatiques au nom [desquelles] d’innombrables deuils, crimes et douleurs ont pu être perpétrés impunément ». Accepter ces contradictions inhérentes à la vie exige de renoncer au piège du perfectionnisme, cette obsession inhumaine qui nous est si souvent infligée. « C’est la vie ; il n’y a pas de bien parfait, ni de beau parfait, ni de mal parfait. Tout doit alterner pour pouvoir être vie et pour ne pas se perdre au milieu des ailes mensongères de la raison, des théories, des utopies sans faille, parfaites de la plus cruelle des perfections : celle que l’esprit dessine abstraitement sans tenir compte du pain, des entrailles, du désir charnel, c’est-à-dire de la matière qui, si l’on suit sa leçon, est la seule qui puisse nous enseigner le sublime. » Goliarda Sapienza tient en horreur tous les « petits professeurs de mort » qui pullulent dans nos sociétés et qui, « à force de tout expliquer par la raison, vous enlèvent toute palpitation d’intuition et d’imagination ». Trop rationaliser l’existence est à ses yeux un piège redoutable : « Toujours cette mauvaise habitude d’analyser, qui comme un moustique vous fond dessus alors qu’on fait l’amour et vous démolit ce beau moment qu’après tout est la vie, parce qu’à la barbe de tous les philosophes du monde la vie n’est faite que de moments. » Ainsi se dessine, peu à peu, un portrait de l’écrivaine. Se mettre en danger, se confronter à l’épaisseur de l’existence, se remettre en question : de cette « gymnastique du doute », Goliarda Sapienza fait un principe de vie, un « exercice dynamique, vital, toujours en mouvement, réclamant une forte dose de volonté ».
« Peu lui importent les réflexions métaphysiques sur le sens de la vie : seuls les vivants ont raison. »
Peu lui importent les réflexions métaphysiques sur le sens de la vie : seuls les vivants ont raison. Ses écrits nous disent son émerveillement toujours renouvelé devant les beautés du monde, de l’amour, de l’amitié et des nourritures terrestres que nous offre la nature. Goliarda Sapienza sait nous communiquer l’intensité de cette joie pure qui la saisit lorsqu’elle savoure le pain chaud, l’huile et le vin de cette Italie du Sud à laquelle elle est toujours restée profondément attachée. En 1978, alors qu’elle voyage avec Angelo Pellegrino dans le Transsibérien, elle écrit qu’« il n’y a pas de bien-être pour moi là où ne fleurissent pas les orangers et les citronniers. On voyage pour revenir, on le sait ». Toujours, elle reviendra vers ce Sud qui l’appelle, vers son soleil et sa mer dont elle ne peut se passer, et vers son « joyeux ruban d’étoiles et de lunes, arc-en-ciel de lumières constantes, voie lactée or-argent, poussières palpitantes de couleur nourrissante ». Tout son talent d’écrivaine se révèle dans sa capacité à nous faire sentir la « douceur des choses infimes de la vie », ces bonheurs simples et communicatifs qui lui permettent d’accéder à cette « plénitude de joie des sens et de l’esprit » qu’elle exalte dans les dernières pages de L’Art de la joie. Ces joies simples, Goliarda sait les savourer seule aussi bien qu’avec ses semblables ; toujours, elle aura été animée de cette confiance à l’égard des autres, dont elle recherche la compagnie pour s’en nourrir. « Et comme j’ai raison — malgré les pressions pessimistes de tous contre les gens — comme j’ai raison d’aimer l’être humain quand je le rencontre ! Et à la barbe de tout le monde j’en trouve toujours un prêt à me tendre la main. »
De la loi des humains, elle n’a cure : elle ne se fie qu’à sa « loi intérieure », à l’image de sa Modesta qui revendique son refus de se soumettre à quelque maître que ce soit. Elle sait trop bien, par son expérience de la répression mussolinienne, du sectarisme communiste et du conformisme nanti, combien la société et ses pouvoirs peuvent devenir une menace pour l’individu et la substance même de la vie. Elle sait que le temps n’est jamais loin où « le caprice d’un homme, d’un signe bref de la main, peut nous arracher la paix, les crépuscules et la quiétude » ; elle se défie des « vices éternels de l’obéissance, de la lâcheté et du bourgeoisisme ranci ». Il faut, nous dit-elle, être révolutionnaire et le rester, « sans promesse de paradis au ciel ou sur terre, mais seulement pour grandir — et grandir veut dire se rebeller ». C’est cette exigence qui l’éloigne de la tentation du suicide, vers laquelle sa dépression tente de l’emmener. En dépit de la lassitude qui revient régulièrement s’emparer d’elle, elle sait qu’elle a une responsabilité, celle de tenir sa position : « Il faut que je continue, ne serait-ce que pour une raison éthique. Je ne veux pas être l’énième maudite
qui en se suicidant donne raison au système, lequel pourrait dire : Vous voyez, quand on a été élevé de façon différente, sans Dieu même ? Vous voyez ce qui se passe ?
C’est ainsi que tous les soi-disant rebelles en littérature ont annulé leur rébellion, avec cet acte de renoncement et peut-être aussi de repentir inconscient
. »

[Extrait d'une peinture de Nicolas de Staël]
Et s’il faut lutter, c’est aussi contre le supposé « progrès » du système capitaliste industriel qui gangrène peu à peu toutes les beautés du monde. Au fil de ses pages perce son dégoût, mais on sourit en lisant ses descriptions indignées de la télévision, cet « objet immonde, digne seulement d’une nouvelle de Kafka » qui déverse sur les téléspectateurs passifs « maladie mentale, lieux communs, mauvais goût et désinformation ». Elle se désespère de la situation de nos sociétés, soumises à « l’avancée barbare des produits, des marchandises, de la folie urbaine », prises au piège des « innombrables sortilèges du marketing » et confrontées à l’avènement du règne de la nourriture chimique et de sa « non-saveur ». Goliarda Sapienza s’éloigne de plus en plus de cette société — ou, plutôt, cette société s’éloigne de plus en plus d’elle. Ses Carnets prennent une teinte crépusculaire au tournant des années 1990, alors qu’approche la fin de son « cycle biologique ». Ses amis disparaissent les uns après les autres, la confrontant à une première expérience de la mort : « Nos morts sont les témoins de ce que nous avons vécu… et peut-on continuer à vivre sans l’histoire qui nous a faits ? Peut-être, mais c’est horrible : nos amis sont les témoins de notre façon d’être vivant, en nous voyant vivre ils ont été le miroir de nos actions. » Toujours, Sapienza s’efforce de tenir fermement entre ses mains les fils de son passé pour le fixer « aux épingles de la mémoire ». Pour celle qui a perdu une partie de ses souvenirs sous l’effet des électrochocs, « se souvenir est tout : l’éthique fondamentale de la vie et du respect envers les autres (comprendre : respect pour soi-même). » C’est pourquoi elle fait échapper à l’oubli les visages et les existences des personnes aimées, prolongeant ainsi un peu leur existence — et la sienne.
Travailler, encore et toujours, comme le lui a enseigné cette mère qu’elle aimait plus que tout. Travailler, malgré la pauvreté dans laquelle Angelo et elle doivent vivre. Travailler, parce que ce n’est qu’ainsi qu’elle peut se sentir sereine : « Les feuillets vides me prennent désormais à la gorge comme des journées privées de vie et de joie : parce que même une douleur, un échec, une humiliation, s’ils sont écrits, se transmuent sinon en joie, du moins en grande sérénité : sérénité qui atteint toujours celui qui sait que, dans le bien ou le mal, même dans un jour de douleur […], on a continué à cultiver à la bêche son petit jardin. » De ce travail, elle consacre une part importante à la rédaction quotidienne de son journal, dans lequel elle conserve le fil de ses journées et les gens qu’elle rencontre. « L’or du temps, nourriture première de l’écrivain ! » s’écrie-t-elle au détour d’une page, en 1992. Les années passent, et l’Italienne sent que le temps joue contre elle. « [P]arviendrai-je à refermer mon cycle d’idées avant de rejoindre Maria, Goliardo, mon père, Carlo ? » Le temps, finalement, lui manquera. En août 1996, dans sa maison de Gaeta, son « cycle d’idées » se referme avant qu’elle ait pu raconter les vies qu’elle voulait transmettre, à commencer par celle de sa mère, dont elle avait entamé la biographie. À ses lecteurs de poursuivre la quête sans fin à laquelle elle s’est consacrée à travers son écriture.
Illustration de bannière : extrait d’une peinture de Nicolas de Staël
REBONDS
☰ Lire notre article « Sam Hamill, ni beat ni abattu », Alexis Bernaut, mai 2017
☰ Lire notre article « Kenneth Rexroth, l’anarchiste érotico-mystique », Adeline Baldacchino, novembre 2016
☰ Lire notre article « Iaroslavskaïa, l’insurgée », Adeline Baldacchino, juillet 2016
☰ Lire notre article « Malcolm Lowry, plume trempée dans le mezcal », Guillaume Renouard, juin 2016
☰ Lire notre article « Jaroslav Hašek, éthanol et drapeau noir », Guillaume Renouard, janvier 2016
☰ Lire notre article « Rimer à coups de poings : vie et mort d’Arthur Cravan », Guillaume Renouard, mai 2015



