Entretien inédit pour le site de Ballast
La prostitution fait partie de ces sujets clivants sur lesquels la gauche peine à adopter une position tranchée. On retrouve, dans les mouvements féministes (et même au sein de notre revue), des jugements antagoniques : d’un côté, les abolitionnistes font de la prostitution une violence en soi dont il faut à tout prix sortir celles et ceux qui la pratiquent ; à l’opposé, les réglementaristes appellent à une reconnaissance du travail du sexe afin de l’encadrer législativement. Chacun prétend défendre au mieux les intérêts des personnes qui se prostituent et lutter efficacement contre les discriminations et oppressions de toutes sortes qu’elles subissent au quotidien. À Toulouse, l’association de santé communautaire Grisélidis s’efforce de favoriser l’accès des prostitué·es à la santé et aux droits. Cette rencontre est l’occasion de nourrir le débat et d’ancrer la réflexion théorique dans la réalité de terrain. C’est au local de l’association que Krystel Odobet, codirectrice, et Corinne Monnet, éducatrice spécialisée, nous exposent leurs engagements et les actions qui sont menées à Grisélidis « pour » et « par » les prostitué·es.

Grisélidis Réal était une prostituée, écrivaine, artiste et militante suisse pour le droit des prostitué·es. Elle a fait un énorme travail militant toute sa vie : archivage de divers articles sur la prostitution, participation à des colloques, à des mouvements internationaux pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, rédaction d’articles dans les journaux, etc. En tant qu’écrivaine, elle a écrit de nombreux livres littéraires qui parlent de son métier. Le plus connu est Le noir est une couleur, un roman autobiographique dans lequel elle raconte l’époque où elle se prostituait en Allemagne et en Suisse. Au moment de la création de l’association à Toulouse, on lui a demandé si elle voulait bien être marraine, puisqu’on la connaissait et que c’était une grande figure militante du travail du sexe ; elle a accepté. On a d’elle un magnifique portrait peint ici (elle pointe le mur du doigt), il y a sa photo là-bas et on trouve également des photos d’elle dans les vieux albums. Elle est venue une ou deux fois à l’association, avant qu’elle ne tombe malade…
L’association propose d’intervenir dans des domaines très variés (assistance médicale, psychologique, juridique, etc.). Quel type d’actions concrètes menez-vous pour répondre à la diversité des besoins que peuvent rencontrer les prostitué·es dans leur activité ?
« On considère que la santé, ce n’est pas juste l’absence de problèmes, c’est aussi la levée de tout ce qui l’impacte et agit comme des freins. »
Au départ, c’est une association qui s’est créée pour lutter plutôt contre le VIH, contre les inégalités de santé en favorisant l’accès aux soins. Mais on s’adapte désormais beaucoup plus aux besoins du terrain et on conçoit la santé sous son aspect global : on considère que la santé, ce n’est pas simplement l’absence de problèmes, c’est aussi la levée de tout ce qui l’impacte et agit comme des freins — le fait de ne pas avoir de logement, d’être discriminé·e, etc. Très vite, l’association a donc développé d’autres missions. On travaille désormais sur des problématiques d’accès aux droits sociaux, au logement, à l’hébergement, à l’emploi et à la formation, au séjour et au droit d’asile, et sur les problématiques de lutte contre les violences et les discriminations. Il y a quelques années, on ne s’occupait pas de droit d’asile : on orientait directement les personnes vers des associations spécialisées. Mais on a constaté, il y a quatre ou cinq ans, que de plus en plus de personnes que l’on rencontrait étaient concernées par l’asile et pouvaient prétendre au statut de réfugié. Or, les associations qui travaillent avec les demandeurs d’asile à Toulouse étaient saturées. On s’est donc mis à travailler là-dessus, alors que cela ne faisait pas du tout partie des missions initiales de Grisélidis définies il y a dix-sept ans.
Outre la proximité, avec les actions de terrain, et la pluridisciplinarité, Grisélidis se définit comme une association « communautaire » qui repose sur le principe de la parité : la moitié des membres du conseil d’administration et des salariés exercent, ou ont exercé, eux-mêmes la prostitution. Quel lien y a‑t-il entre cette structure et vos engagements ?
Faisons un rapide point historique sur les associations de santé communautaires qui travaillent avec les prostitué·es. Avant elles, l’encadrement social de la prostitution était assuré par des structures abolitionnistes. Celles-ci œuvraient principalement à la réinsertion des prostitué·es et effectuaient en général très peu de travail de terrain — de sorte qu’elles rencontraient peu de personnes. Des associations de santé communautaires se sont créées en France au moment de l’épidémie de Sida (à la fin des années 1980), à la suite d’études montrant qu’il y avait une désaffiliation sociale considérable dans le public des travailleuses et travailleurs du sexe, qui ne se tournaient pas vers les services sociaux existant à l’époque. Il existait, d’une part, des services de prévention et de réinsertion sociale (SPRS), encadrés par les ordonnances abolitionnistes de 19601, qui définissaient la prostitution comme un « fléau social » contre lequel il fallait lutter ; et, d’autre part, des associations de travail social classiques comme l’Amicale du Nid, axées sur la réinsertion et la sortie de la prostitution. Ces organismes ont tous disparu les uns après les autres parce que les gens n’y allaient pas.

© Francesca Woodman
La santé communautaire est donc apparue à ce moment-là, avec notamment la création, à Paris, du Bus des femmes, qui a mis en place un lieu d’accueil mobile et embauché comme salariées des personnes qui travaillaient dans la prostitution, à parité avec des infirmières et travailleurs sociaux. Ça, ça a créé une rupture fondamentale dans le traitement de la prostitution. L’enjeu premier de cette démarche, c’est de dénoncer le stigmate de prostitué·e. Embaucher des individus à parité, c’est reconnaître qu’ils ont des compétences à la fois liées à leur expérience et spécifiques : quelqu’un qui n’a pas l’expérience de la prostitution ne peut pas avoir ces compétences-là. C’est très important, parce que ça casse l’image traditionnelle que l’on se fait des prostitué·es. On ne veut pas travailler avec cette représentation qui considère, pour le dire vite, que ce sont des « victimes », qu’il faudrait à tout prix réinsérer, même contre leur gré.
Vous insistez sur le fait que votre action s’inscrit dans une démarche de « solidarité » plutôt que de « charité »…
« L’abolitionnisme considère que toutes les personnes qui se prostituent sont des victimes et que, si elles n’en ont pas conscience, c’est qu’elles sont aliénées ou qu’elles mentent. Cela revient à les nier en tant que sujets politiques. »
On ne peut pas aider les prostitué·es sans savoir ce qu’ils ou elles veulent. Notre idée est d’adapter les actions à la volonté des personnes concernées. On ne veut pas simplement les représenter dans un discours, mais porter leur parole avec elles, de manière à être au plus près de leurs intérêts. Grisélidis, c’est un peu comme une porte. D’abord, sur les questions sociales et de santé, c’est une porte vers le droit commun. On ne veut pas se substituer au droit commun, mais simplement accompagner les personnes pour qu’elles accèdent — comme elles devraient normalement pouvoir le faire — aux services de droit commun sans être discriminées (ne serait-ce que par la barrière de la langue, lorsqu’une femme migrante ne comprend pas le professionnel avec lequel elle a rendez-vous, faute d’interprète). C’est aussi une porte vers la prise de parole publique et les revendications politiques : on soutient des mobilisations collectives, des manifestations, on propose aux gens de venir au local faire des banderoles, des tracts, on essaie, quand on assiste à des situations d’injustice ou qu’on nous en parle dans la rue, de faire en sorte que les personnes se regroupent toutes ensemble pour dénoncer ces injustices et exprimer une revendication.
Vous avez mentionné l’abolitionnisme, vis-à-vis duquel vous voulez prendre des distances. En quoi les politiques mises en place pour lutter « contre la prostitution » reviennent-elles pour vous à lutter « contre les prostitué·es », pour reprendre l’une de vos formules2 ?
L’abolitionnisme considère que toutes les personnes qui se prostituent sont des victimes, et que si elles n’en ont pas conscience, c’est qu’elles sont aliénées ou qu’elles mentent. Cela revient à les nier en tant que sujets politiques. Notre logique est de dire que ce sont les individus concernés par la question qui savent mieux que les autres ce dont ils ont besoin. Nous parlons de « revendications » et de « droits » parce que le principal problème auquel ils sont confrontés, dans un système abolitionniste, c’est qu’ils n’ont pas de droits. Même s’ils souhaitent continuer à exercer la prostitution, même si c’est une activité qui leur plaît, ils n’ont pas de contrat de travail, pas de droit à la retraite, pas de droit au chômage. Cela signifie que certain·es prostitué·es — souvent des femmes, en l’occurrence — vont travailler jusqu’à 60 ou 70 ans parce qu’elles n’ont pas de pension, alors qu’elles ont exercé une activité — non reconnue, certes, mais une activité quand même — durant toute leur vie. Sans compter qu’elles n’ont pas de protection sociale si elles ont une maladie, un accident, etc. Elles n’ont pas de reconnaissance de leur statut, de sorte que tout devient compliqué au quotidien : allez chercher un appartement à louer sans bulletins de salaire ! Tout est comme ça dans la vie de tous les jours, sans parler des migrant·es qui ont aussi d’autres soucis, qui se cumulent avec ces difficultés.

© Francesca Woodman
L’abolitionnisme français, c’est aussi des lois, et notamment la loi contre le proxénétisme, qui encadre la prostitution en interdisant et pénalisant y compris le « proxénétisme de soutien », c’est-à-dire toute forme d’aide aux travailleurs et travailleuses du sexe. Un propriétaire peut « tomber » pour proxénétisme si la personne travaille dans la chambre qu’il loue, c’est pour ça que beaucoup travaillent dans la rue ; des prostitué·es peuvent également être accusé·es de proxénétisme si ils ou elles s’organisent en collectif ou s’entraident. Ces lois contribuent donc à marginaliser cette population. À Grisélidis, on est contre toutes les lois qui criminalisent les travailleurs et travailleuses du sexe, parce qu’on considère qu’elles sont responsables de l’état déplorable de leurs conditions générales de travail et de vie. En fait, il faudrait simplement leur reconnaître les droits dont bénéficie tout un chacun, plutôt que de leur appliquer des législations spécifiques. Et cela n’empêche pas de lutter contre le proxénétisme : il existe déjà tout un arsenal législatif contre l’exploitation, le travail forcé, les violences, etc. Il suffirait d’appliquer le droit commun, plutôt que de rajouter une catégorie de lois spécifiques qui stigmatisent et sont principalement utilisées contre les personnes elles-mêmes.
Face à l’abolitionnisme, il existe deux autres positions traditionnelles vis-à-vis de la prostitution : le prohibitionnisme, qui veut la criminaliser et l’interdire, et le réglementarisme, qui vise à l’encadrer en assurant aux prostitué·es de bonnes conditions d’exercice de leur activité. On pourrait croire que vous vous rattachez au réglementarisme. Or, Grisélidis se revendique d’une « quatrième voie » : pouvez-vous préciser de quoi il s’agit ?
« À Grisélidis, on est contre toutes les lois qui criminalisent les travailleurs et travailleuses du sexe parce qu’on considère qu’elles sont responsables de l’état déplorable de leurs conditions générales de travail et de vie. »
On utilise l’expression « quatrième voie » parce que, souvent, les gens savent qu’on s’oppose à la doctrine abolitionniste et présupposent donc qu’on est plutôt réglementaristes. Or, c’est un argument qui peut être utilisé par nos opposants, notamment les militants abolitionnistes qui nous accusent, sous prétexte de réglementarisme, d’être en faveur du proxénétisme, voire d’être nous-mêmes des proxénètes… L’expression « quatrième voie » permet d’insister sur le fait qu’aucun de ces modèles ne correspond vraiment à ce que nous faisons. Le réglementarisme est un système qui a été appliqué en France jusqu’en 1946, année de la loi Marthe Richard qui, en abolissant les maisons closes, acte le passage à la position abolitionniste de la France. Ce modèle considère que la prostitution est un « mal nécessaire » qu’il faut encadrer pour éviter qu’il ne transmette à la fois des maladies et de « mauvaises mœurs ». Le réglementarisme porte donc quand même une vision très stigmatisante des travailleurs et travailleuses du sexe, et leur impose beaucoup de contrôles (des examens gynécologiques réguliers, un fichage policier, etc.). C’est le type de fonctionnement que l’on retrouve en Suisse et en Allemagne.
Il peut représenter des avantages par rapport à notre système abolitionniste, notamment la reconnaissance d’un statut qui ouvre automatiquement à davantage de droits (l’obtention de bulletins de salaire, par exemple, permet l’accès au logement). Mais, outre que cela ne vaut pas pour les migrant·es non-régularisé·es — qui sont pourtant nombreu.ses.x dans la prostitution —, des voisins suisses ont pu montrer, dans un colloque que l’on a organisé il y a deux ans, que le système réglementariste n’était pas idéal non plus. Les personnes qui quittent des pays comme la France pour aller travailler dans des « entreprises » du type Eros center dans des pays réglementaristes, trouvent qu’il y a moins de liberté que dans la rue. Dans la rue, ce sont elles qui choisissent leurs clients, qui décident du moment où elles travaillent, tandis que dans ces centres, elles sont soumises à des logiques de rendement, avec un certain nombre de clients à faire ou une certaine somme d’argent à réunir. Si elles ne remplissent pas leur contrat, du point de vue de celui qui n’est plus un proxénète mais un « patron », une autre prendra sa place. Dans le modèle réglementariste donc, pas plus que dans les deux autres, les revendications des premier·es concerné·es ne pas sont placées au centre.

© Francesca Woodman
Depuis le début de l’entretien, vous utilisez l’expression « travailleurs et travailleuses du sexe », comme le fait aussi le STRASS3. Or, ce choix n’est pas neutre : il est refusé par certain·es féministes au motif que la prostitution ne devrait pas être considérée comme un travail comme un autre…
… comme un travail tout court, d’ailleurs ! Les féministes abolitionnistes considèrent effectivement que la prostitution est une violence en soi et qu’elle ne peut pas du tout être considérée comme un travail. Mais si on revendique l’emploi de cette expression, c’est parce que les personnes elles-mêmes parlent tout le temps en ces termes. Toutes utilisent le terme « travail » dans le sens où elles « vont au boulot » chaque jour. Par ailleurs, parler de « travail du sexe » permet de se séparer du nuage de représentations attaché au terme de « prostitution » et de se recentrer sur le cœur de la question, qui est bien la survie économique : même sans bulletins de salaire, c’est une activité rémunératrice qui permet aux individus de subvenir à leurs besoins — et c’est pour cela qu’ils la pratiquent.
La prostitution est une activité très fortement genrée : l’écrasante majorité des prostitué·es sont des femmes, et les clients des hommes. La considérer comme un « travail » comme un autre et aborder la question en terme de « droits » des travailleurs et travailleuses ne contribue-t-il pas à admettre implicitement une forme très violente du patriarcat, qui perpétue l’idée selon laquelle le corps des femmes est au service de la satisfaction des hommes ?
« Entre la femme victime exploitée et la femme libre, super épanouie, il y a un éventail infini de situations, et la majorité des prostitué·es que l’on rencontre sont entre les deux. »
Il faut préciser le contexte : actuellement, en France, ce sont principalement des femmes — et des femmes migrantes — qui exercent la prostitution dans la rue, bien qu’il y ait également des hommes. À Toulouse, on rencontrait auparavant beaucoup d’hommes dans la rue, mais on ne les voit plus aujourd’hui. C’est notamment dû au fait que la majorité d’entre eux exerce désormais via Internet. Ils sont donc moins visibles, mais toujours présents. Au final, dans les actions de prévention que l’on mène au niveau national, on rencontre à peu près 60 % de femmes et 40 % d’hommes. Il y a des transsexuels, aussi. Le public de la prostitution est donc plus varié que ce que l’on pourrait croire, que ce soit en terme d’âge, d’origine géographique, de parcours personnel ou de genre. Pour revenir à votre question : reconnaître la prostitution comme un travail, c’est exactement du même ordre que reconnaître les tâches domestiques en tant qu’activité à part entière. Celles-ci ont été considérées pendant très longtemps comme quelque chose de naturel, d’inné, lié aux compétences biologiques des femmes et donc ne requérant pas de savoir-faire spécifique. Il a fallu un combat féministe de plusieurs décennies pour que le travail domestique soit finalement considéré comme un vrai travail. Pour le travail du sexe, c’est pareil : se prostituer, ce n’est pas juste vendre son corps ou être à la disposition des clients. Il y a des compétences techniques et relationnelles que les individus mettent en place, des règles et des limites qu’ils imposent (choix du client, des pratiques, des tarifs, des conditions — beaucoup de clients demandent par exemple des relations sans préservatif, qui sont refusées). Si on ne reconnaît pas ces compétences comme telles, c’est probablement parce que ce sont majoritairement des femmes qui pratiquent la prostitution. Donner de la visibilité à cette activité permet d’entendre celles et ceux qui la pratiquent et de lutter contre sa naturalisation.
On mentionne souvent le chiffre de 9 prostitué·es sur 10 qui souhaiteraient ardemment quitter la prostitution. Certain·es reprochent au STRASS de parler uniquement des 10 % qui sont satisfait·es de leur activité. Inversement, les abolitionnistes nient la réalité de ces 10 %. Grisélidis affirme vouloir « accompagne[r] les personnes prostituées, que celles-ci souhaitent ou non arrêter la prostitution ». Comment gérer cette diversité de situations sans parler à la place des concerné·es ?
Les gens ont tendance à avoir une vision très stéréotypée de ce qu’on fait et de la situation des individus que l’on rencontre. Souvent, ils pensent que Grisélidis travaille exclusivement avec celles et ceux qui veulent continuer à se prostituer et vivent bien leur activité, tandis que les institutions abolitionnistes, elles, ne travailleraient qu’avec les victimes. En réalité, les abolitionnistes prennent en charge tous les types de situations, mais comme ils luttent contre la prostitution en elle-même, ils n’ont qu’un seul et unique objectif : la sortie et la réinsertion des personnes. Nous, à Grisélidis, on dit toujours qu’il y a un continuum de situations et qu’on doit s’adapter aux demandes ; on part du principe qu’on ne doit pas juger et qu’il faut respecter le choix des gens. En entretien, on rencontre par exemple des personnes qui apprécient leur activité mais qui ont besoin de conseils pour mieux la pratiquer (en matière de sécurité, de prévention), d’autres qui désirent arrêter la prostitution parce qu’elles y ont été forcées, ou parce que ça ne leur convient plus, parce qu’elles ne s’attendaient pas à ce que ce soit si difficile, etc. On construit un accompagnement à partir de ce que la personne amène. La réalité est bien plus complexe que la question des « 10 % — 90 % » : entre la femme victime exploitée et la femme libre, super épanouie, il y a un éventail infini de situations, et la majorité des prostitué·es que l’on rencontre se situe entre les deux.

© Francesca Woodman
Il faut rappeler que la grande majorité des prostitué·es appartient aux franges les plus opprimées de la société. Cette valorisation de l’autonomie et du respect du choix des personnes n’empêche-t-elle pas la reconnaissance des déterminismes socio-économiques qui pèsent sur elles et les maintiennent dans la prostitution ?
Là, on est dans la sociologie ! C’est le choix entre Bourdieu et l’individu rationnel ! Nous, on ne nie pas ces déterminismes. Mais on essaie de développer des stratégies pour lutter contre eux. Simplement, on le fait en respectant les choix des personnes, en ne les considérant pas comme des victimes impuissantes qui ne peuvent rien faire face à ces freins. Évidemment, il faut mettre des guillemets : le vrai « choix », on ne sait pas où il est, il n’existe nulle part. Mais la question, c’est : pourquoi considérer que ces déterminismes-là ne pèsent que sur les prostitué·es ? Ce ne sont pas les seules personnes exploitées ! La violence économique au travail concerne tout le monde ! Par exemple, on en rencontre qui, dans l’idéal, préfèreraient faire un travail reconnu socialement, moins dangereux, salarié, etc. Mais quand elles s’y essaient, elle se retrouvent à faire un boulot dans lequel elles sont très mal payées, maltraitées par leur patron, et elles retournent à la prostitution. Là, elles peuvent au moins imposer certaines limites, décider quand elles travaillent, pour combien elles travaillent, etc., et elles se sentent moins humiliées que dans d’autres types de travail salarié.
La féministe abolitionniste Mona Chollet considère justement que lutter contre la prostitution est une manière de lutter contre la violence économique dont les prostitué·es sont « victimes », non pas dans un sens psychologique (faiblesse, passivité, etc.), mais au sens objectif d’une position défavorable dans un rapport de force4. En somme, elle revendique une lecture par la catégorie de classes.
« Ce ne sont pas les seules personnes exploitées ! La violence économique au travail concerne tout le monde ! »
À cette différence près : la première revendication des luttes ouvrières, avant d’abolir purement et simplement le capitalisme, c’est de donner des droits aux ouvriers, d’éviter que les gens se fassent complètement exploiter. Pour la prostitution, on saute cette étape des droits, et on passe tout de suite à l’abolitionnisme, sans chercher à protéger les travailleurs et travailleuses, ici, maintenant, contre la violence économique qu’ils subissent. C’est curieux que le principal argument que nous opposent les abolitionnistes — qui considèrent que, dans l’absolu, on doit sortir de la prostitution — porte justement sur la question des oppressions systémiques, alors que les associations de santé communautaire comme la nôtre, grâce à leurs actions sur le terrain, partent de réalités sociales concrètes pour diminuer l’impact des déterminismes et aider les personnes qui les subissent. Par exemple, sur la question des migrant·es, notre slogan, c’est « Des papiers pour toutes, des papiers pour tous ! », parce qu’on ne peut pas parler de la prostitution des migrant·es sans parler des lois sur l’immigration, de l’exploitation des pays du Sud par les pays du Nord, sans parler du néocolonialisme, etc. À Grisélidis, on a trois sociologues qui travaillent sur les mécanismes d’oppression, de domination : je pense qu’il y a peu de structures associatives où l’on embauche autant de sociologues !
Le Parlement a adopté la loi de pénalisation des clients il y a un an5. Grisélidis avait critiqué cette mesure (en s’appuyant sur le fait que 98 % des travailleurs et travailleuses du sexe y étaient opposé·es). Quel bilan en tirez-vous aujourd’hui ?
On disait tout à l’heure que les prostitué·es n’étaient pas des victimes passives ; mais il y a effectivement tout un contexte social et politique à prendre en compte qui leur permet, ou bien de poser des règles et d’être acteurs dans leur activité, ou bien, au contraire, les en empêche. La pénalisation du client — comme les arrêtés antiprostitution, le délit de racolage à une époque, et toutes les formes de criminalisation de la prostitution — font que les personnes sont moins à même d’imposer des limites. Les clients ont peur de la loi ; et qui dit peur des clients dit baisse de leur nombre, donc baisse des revenus et, par conséquent, hausse de la précarité pour les prostitué·es, qui du coup acceptent plus facilement de revoir leurs limites à la baisse. De plus en plus de clients demandent par exemple de se rendre dans des hôtels ou à leur domicile ; cela représente plus de risques de violence. La précarité conduit également à accepter des pratiques qui auraient été refusées auparavant (des passes sans préservatif, notamment, que les clients proposent parfois de payer plus cher). Moins il y a de clients, plus ceux qui restent sont en mesure d’imposer leurs conditions. Globalement, on observe les conséquences que l’on avait anticipées, c’est-à-dire une dégradation des conditions de travail : hausse des contrôles policiers, de la précarité, de l’exposition au VIH et aux violences, du pouvoir donné au client, du stress des prostitué·es.…
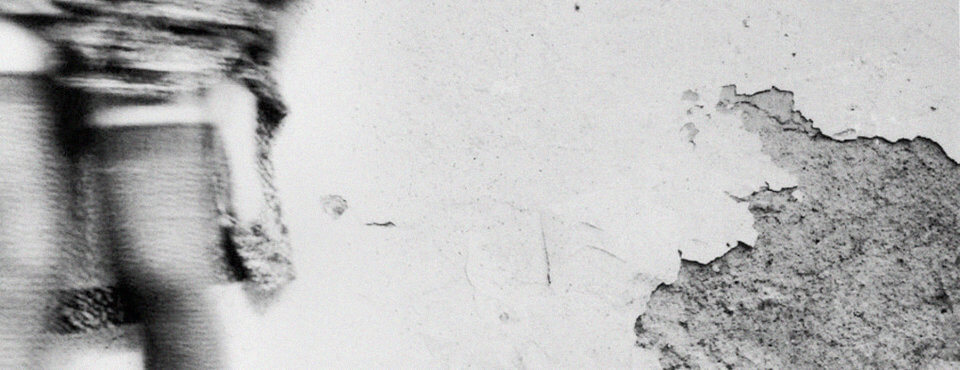
© Francesca Woodman
Mais il faut aussi noter que cette loi était censée comporter deux volets : un volet social et un volet répressif. Le volet social consistait en un parcours de sortie de la prostitution, qui devait garantir un titre de séjour de six mois renouvelable pour les migrant·es, une petite allocation et un accès facilité au logement, si les personnes n’avaient pas d’autres revenus. Le problème, c’est que l’allocation n’est pas cumulable avec le Revenu de solidarité active (RSA) ou avec l’Allocation pour demandeurs d’asile (ADA) ; or, beaucoup se prostituent parce que les minima sociaux ne sont pas suffisants pour vivre. Donc cette loi revient à leur dire « Arrêtez la prostitution, mais restez sur votre minima social », ce qui est absurde. D’autre part, alors que le volet répressif a été appliqué immédiatement après le vote de la loi, le volet social est tranquillement en train de se mettre en place plus d’un an après (il est appliqué dans deux départements depuis un mois ou deux6). C’est là qu’on voit l’hypocrisie de la loi : si l’objectif était vraiment de sauver les personnes, pourquoi faut-il un an pour que le volet social soit mis en place ?
À travers ce type de lois, il semble que les politiques menées ne cherchent pas tant à lutter contre la prostitution en elle-même — les escort girls, la prostitution sur Internet ne sont pas visées —, mais contre certaines formes particulièrement « gênantes » de la prostitution du point de vue de l’« ordre public » (prostitué·es de rue, plus ou moins proches des centres villes, etc.)…
« On a d’un côté des hommes français, blancs, souvent bourgeois, et d’un autre côté des femmes migrantes sans-papiers… Devinez quelles revendications sont écoutées ? »
Oui, c’était le cas du délit de racolage, ou encore, aujourd’hui, des arrêtés antiprostitution, qui sont mis en place essentiellement pour faire plaisir aux riverains. « Le riverain », c’est une nouvelle figure du débat public qui est apparue dans les années 2000, qui n’était pas du tout présente quand on discutait, avant, sur le terrain de la prostitution. Dans toutes les grandes villes, la prostitution devient un problème de « tranquillité publique ». Et c’est certainement lié au phénomène de gentrification : de plus en plus, les bourgeois essaient de récupérer le cœur des villes et d’en éloigner les pauvres — et pas que les prostitué·es : les usagers de drogues, les migrants, les Roms, les SDF. On parlait d’oppression systémique tout à l’heure : ici, on a d’un côté des hommes français, blancs, souvent bourgeois — parce que c’est plutôt dans les quartiers de classe moyenne-supérieure que ça crée des problèmes —, et d’un autre côté des femmes migrantes sans-papiers… Devinez quelles revendications sont écoutées ?
Au niveau local, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR) continue de reconduire les arrêtés antiprostitution ; au niveau national, au-delà d’une parité de façade affichée par le gouvernement, rien n’indique que le féminisme soit une préoccupation pour le pouvoir. Comment voyez-vous la suite de votre activité et de vos actions ?
On ne se fait pas trop d’illusions. Il faut savoir que Grisélidis est une association en survie perpétuelle : tous les ans, on se demande si on aura assez d’argent pour tenir toute l’année. Cela vient de la manière dont est perçue la santé communautaire : on a des partenaires qui nous financent depuis des années et qui reconnaissent la qualité de notre travail. On a aussi des interlocuteurs qui n’ont jamais voulu nous financer, alors qu’ils soutiennent d’autres associations qui font le même travail mais qui ont des positionnements différents. La réduction des risques, dans le domaine de la santé, n’est pas ce qui est le plus valorisé. Ce sont des politiques qui existent depuis l’apparition du VIH (donc depuis la fin des années 1980) mais, pour autant, on doit toujours prouver que c’est efficace et qu’on le fait pour de bonnes raisons. Pour être reconnu dans un contexte abolitionniste, il faut prouver en permanence qu’on essaie vraiment d’accompagner les personnes et de garantir leur sécurité, leur santé et leur bien-être, et qu’on n’est pas des proxénètes…
Photographie de bannière : Danie Bester
Photographie de vignette : Grisélidis Réal (DR)
- L’ordonnance n° 60–1245 du 25 novembre 1960 « relative à la lutte contre le proxénétisme », qui autorise « le gouvernement à prendre […] les mesures nécessaires pour lutter contre certains fléaux sociaux », constitue la traduction, dans la législation française, de la ratification de la « Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui » adoptée par l’assemblée générale des Nations unies. C’est par cette ordonnance que la France affiche officiellement sa position abolitionniste.[↩]
- Formule employée par Krystel Odobet dans son article « Un antiféminisme qui ne dit pas son nom ? L’influence du discours abolitionniste sur le quotidien des travailleur-se‑s du sexe et des associations de santé communautaire ».[↩]
- Le STRASS est le Syndicat du travail sexuel, créé en 2009.[↩]
- Voir l’article de Mona Chollet « L’utopie libérale du service sexuel », Le Monde diplomatique, septembre 2014.[↩]
- Le 13 avril 2016, les députés ont voté une proposition de loi du Parti socialiste qui supprime le délit de racolage — institué en 2003 par le ministère de l’Intérieur Nicolas Sarkozy —, qui pénalisait les prostitué·es, mais qui reporte la peine sur le client en le sanctionnant d’une amende de 1 500 €.[↩]
- En avril 2017, il s’agissait des Alpes-Maritimes et de la Vienne.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Chahr Hadji : « Remettre en question ce que peut supporter
☰ Lire notre entretien avec Amandine Gay : « À qui réussit-on à parler ? », janvier 2017
☰ Lire notre entretien avec Christine Delphy : « La honte doit changer de bord », décembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Mona Chollet : « Écrire, c’est un acte à part entière », novembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Clémentine Autain : « Rendre au féminisme son tranchant », février 2015


