Entretien inédit pour le site de Ballast
Le temps d’un mandat, Isabelle Attard, archéozoologue de formation, a défendu à l’Assemblée nationale les couleurs d’Europe Écologie – les Verts. Sous les ors du palais Bourbon, elle est l’une des rares députés à s’opposer, en 2015, à la prolongation de l’état d’urgence et, la même année, à celle des frappes aériennes sur le sol syrien. Deux ans après la fin de sa députation, elle publie le livre Comment je suis devenue anarchiste : un ralliement explicite à la tradition libertaire, doublé d’un constat sans appel quant à la possibilité de changer le système de l’intérieur. Certaine que la lutte écologique, féministe et anticapitaliste ne passera plus par la prise du pouvoir central, elle aspire à la création, ici et maintenant, d’espaces parallèles autonomes. Nous en discutons ensemble.

Effectivement. Et je peux même dire que je n’étais pas vraiment prévue au programme puisque la circonscription dans laquelle je me suis présentée ne m’était pas du tout favorable. Je débutais en politique et très peu de personnes croyaient en une victoire possible. Je ne la dois finalement qu’à la grande division qui régnait alors à droite comme à gauche. Lorsque je suis entrée à l’Assemblée nationale, je ne faisais pas partie du sérail, j’ai donc découvert son fonctionnement, ainsi que les combinaisons politiques, en me jetant directement dans le grand bain. Comme n’importe quelle personne qui croit encore à ce système, j’étais pétrie de grands principes républicains et d’idéaux démocratiques. J’ai assez vite déchanté. Lorsque je n’ai pas voté le budget en 2013, je me suis de facto retrouvée dans la position d’une opposante à la majorité présidentielle. Dès lors, celle-ci n’a eu de cesse de me marginaliser. La plupart du temps, elle préférait d’ailleurs m’ignorer — il serait même encore plus juste de dire qu’elle me dédaignait. Il n’existe que deux camps à l’Assemblée : soit vous soutenez la majorité, soit vous vous y opposez. C’est très manichéen. Or si j’étais franchement en désaccord avec la politique du gouvernement, je n’avais rien à voir avec l’UMP ou le FN. J’ai bien essayé, avec d’autres collègues, déçus comme moi, de proposer en 2015 la création d’un groupe « rouge-rose-vert » qui aurait alors permis d’apporter une autre voix, mais nous n’avons reçu que très peu d’écho.
Comment l’expliquez-vous ?
« L’Assemblée nationale est un grand théâtre dans lequel la pièce est déjà écrite à l’avance. Chacun y tient le rôle qui lui a été attribué. »
Ça ne correspondait pas à la stratégie des écuries présidentielles de l’époque. Et je ne suis toujours pas convaincue que ça corresponde à celle des partis en place aujourd’hui. L’Assemblée nationale est un grand théâtre dans lequel la pièce est déjà écrite à l’avance. Chacun y tient le rôle qui lui a été attribué. Si vous déviez un tant soit peu de la ligne, vous vous faites aussitôt « excommunier ». Alors, pour répondre à votre question, je pense qu’on peut dire que l’opposition parlementaire joue son rôle : elle s’oppose. Parfois de manière grandiose mais, la plupart du temps, en usant surtout de démagogie car elle sait très bien qu’il lui est impossible de proposer autre chose que des coups d’éclats médiatiques et symboliques. Comment lui en vouloir ? Tout est prévu pour que ça se passe comme ça, et uniquement comme ça.
Depuis, vous tenez au mot « anarchisme ». Qu’a‑t-il à vos yeux de plus fécond que « socialisme » ou « communisme » ?
C’est assez simple et, il me semble, très cohérent avec ce que je viens de vous dire. Il faut néanmoins revenir à l’histoire de ces différents courants politiques pour comprendre pourquoi je me suis tournée vers l’anarchisme et pourquoi, aujourd’hui, je revendique fièrement ce mot. Tancrède Ramonet l’explique très bien dans son documentaire Ni Dieu ni maître, qui fait partie des ressources qui m’ont accompagnées lors de ce processus de déconstruction-reconstruction politique. Historiquement, le mouvement socialiste s’est divisé en trois grands courants : réformiste, marxiste et anarchiste. Vous aurez bien compris que je ne croyais dorénavant plus au premier, qui a abandonné depuis longtemps l’idée de révolutionner la société et de mettre fin au capitalisme… Quant au deuxième, s’il est possible de partager de nombreuses analyses, voire un objectif commun, je ne me retrouve pas du tout dans la vision autoritaire qui en découle. Mikhaïl Bakounine disait que « la liberté sans le socialisme, c’est le privilège et l’injustice, et le socialisme sans la liberté, c’est l’esclavage et la brutalité ». Je pense également que si le terme « libertaire » n’est pas étroitement associé à ceux de « socialisme » ou de « communisme », alors la société qu’on souhaite construire ne m’intéresse pas. Elle ne m’intéresse d’ailleurs pas du tout, si elle n’est pas aussi féministe et écologiste. Et justement, l’anarchisme a ceci d’incomparable avec les autres courants qui se positionnent à gauche : il s’oppose farouchement à toutes formes de dominations, quelles qu’elles soient.
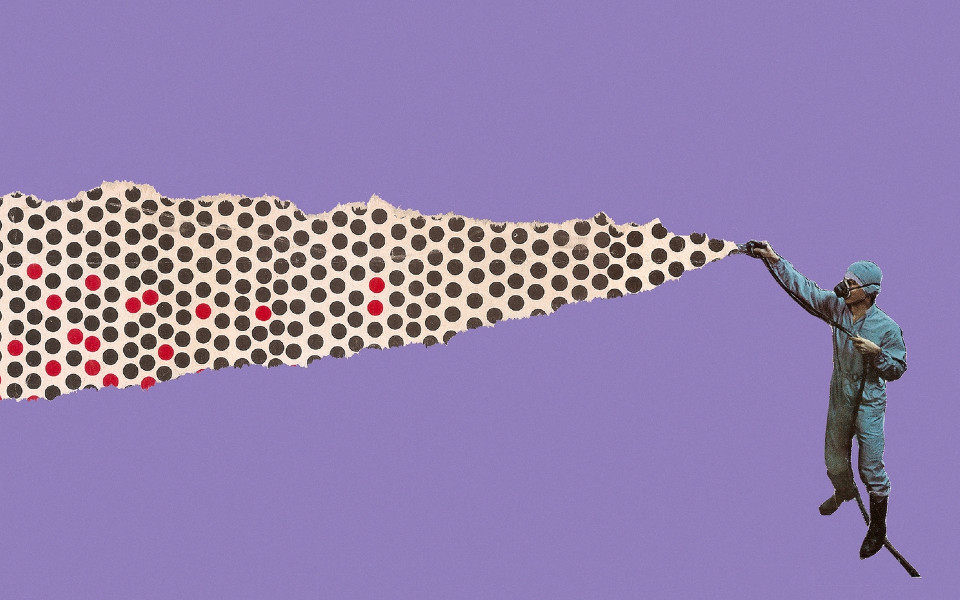
[Graça et Carlos Quitério | fitacola.com]
En théorie, en tout cas…
Dans la pratique, il n’est évidemment pas exempt de tous reproches. Derrière des idées, il ne faut jamais oublier qu’il y a des femmes et des hommes qui les défendent. L’aspect psychologique est très présent en politique — et tout le monde n’est pas au même stade de déconstruction ou de reconstruction. Tout le monde n’a pas le même vécu, la même interprétation, les mêmes névroses. Mais il suffit de visionner des documentaires ou de lire des livres sur l’anarchie, écrits par des anarchistes, pour se rendre compte de la grande richesse de cette philosophie. D’ailleurs, si les idées anarchistes n’étaient pas aussi révolutionnaires, on les enseignerait très certainement en classe de terminale. Or on préfère les dénigrer en confondant le terme « anarchie » avec celui de « chaos ». Ça permet ainsi de masquer le véritable chaos, celui qui provient du capitalisme et du libéralisme.
C’est d’ailleurs pour cette raison que vous préférez le mot « anarchiste » à celui de « libertaire ».
J’ai même mis un point d’honneur à l’utiliser dans le titre de mon livre. Il me semble qu’il est temps de le réhabiliter et de l’assumer comme le font de nombreuses autres personnes aujourd’hui. Et puis, il a l’énorme avantage d’être des plus clairs. La clarté, à une époque où le confusionnisme règne, c’est primordial !
Noam Chomsky se revendique lui aussi de l’anarchisme. Face au « gang de fous psychopathes » que sont Trump et les siens, il a récemment appelé à voter pour le fort peu révolutionnaire Biden — au motif que refuser de voter pour le moins pire, c’est soutenir « le pire ». Cet argument vous parle-t-il encore ?
« Je peux comprendre qu’on puisse préférer un Obama à un Trump. Mais si, dans la forme, ça n’a évidemment rien à voir, sur le fond, les différences se situent seulement à la marge. »
Chomsky est avant tout membre de l’Industrial Workers of the World. Je le précise car il me semble que ça permet de comprendre pourquoi son approche est différente de la plupart des anarchistes. Les Wobblies1 proviennent de tendances différentes — syndicalistes, socialistes, libertaires, anarchistes ou syndicalistes révolutionnaires — et ont pour objectif de s’unir au sein d’un seul grand syndicat — « One Big Union ». Je trouve l’idée de cette plateforme commune intéressante, mais elle amène à faire certains compromis. Chomsky dit partager l’idéal anarchiste, c’est-à-dire celui qui tend vers un démantèlement du pouvoir étatique. En même temps, il considère que cet idéal entre en conflit direct avec des objectifs immédiats, qui sont de défendre, voire de renforcer certains aspects de l’autorité de l’État. Il l’explique d’ailleurs d’autant mieux dans une analogie qu’il a reprise chez des travailleurs brésiliens. L’État serait une cage qui nous protégerait des fauves que sont les compagnies privées et qui sont en-dehors de celle-ci. La seule perspective que nous donne finalement Noam Chomsky est celle d’étendre les barreaux de la cage en attendant que nous soyons capables de les briser et de combattre les fauves nous-mêmes. Murray Bookchin considérait qu’il était pure folie de vouloir jouer le jeu d’un État centralisé qui avait toujours démontré une excessive complaisance envers ces compagnies. Je pense exactement la même chose que lui.
Il n’y a rien à attendre des États-nations qui protègent avant tout les intérêts capitalistes. Par contre, je peux comprendre qu’on puisse préférer un Barack Obama à un Donald Trump. Mais si, dans la forme, ça n’a évidemment rien à voir, sur le fond, les différences se situent seulement à la marge. Nous en avons eu l’exemple flagrant dernièrement lorsque Joe Biden a suggéré à la police de viser les jambes plutôt que le cœur pour réduire les tirs mortels. Il n’y a donc jamais de remise en cause globale du système. Il est totalement illusoire de penser qu’il est possible de changer les choses de l’intérieur, notamment en appliquant la « stratégie des petits pas ». Ça ne mène généralement à rien. Par contre, le concept de « gradualisme révolutionnaire » d’Errico Malatesta me parle beaucoup plus. S’il rejette l’idée d’un Grand Soir révolutionnaire, il n’envisage pas, pour autant, de renforcer l’autorité de l’État. Au contraire, l’idée est d’avancer vers l’anarchie en réalisant un travail de sape qui permettra, au terme d’un processus graduel, de s’émanciper de cette autorité. La renforcer est donc un non-sens. Ce qui n’empêche cependant pas de lutter pour ses droits.
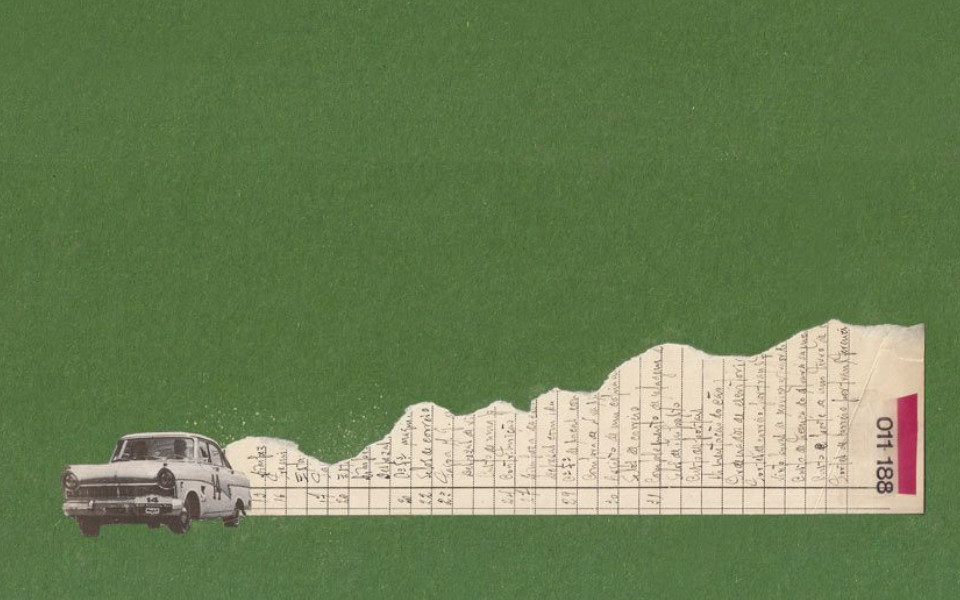
[Graça et Carlos Quitério | fitacola.com]
Vous avez dit dans une conférence que, écologiquement, nous avons déjà franchi un « point de non retour » : cela signifie-t-il que l’horizon de l’émancipation est de sauver les meubles ?
Il est assez difficile de nier que nous sommes effectivement arrivés à ce point en ce qui concerne le climat et la biodiversité. D’ailleurs, avec le confinement, nous avons pu constater in situ l’impact du capitalisme sur ceux-ci. Il va être très difficile pour les climato-sceptiques d’argumenter après ça — même si je les en crois tout à fait capables… Toutes les études scientifiques vont dans le même sens : nous assistons à une augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques et à une chute extrêmement brutale de la biodiversité. Ne pas comprendre qu’il s’agit là de phénomènes irréversibles s’appelle tout simplement du déni. Les conséquences, à plus ou moins long terme, auront un impact sur l’ensemble de nos sociétés, tant d’un point de vue écologique que social ou démocratique. Ça a d’ailleurs déjà commencé. Alors je dois avouer que j’ai un peu de mal avec les mouvements qui prétendent qu’« il est encore temps » et qui laissent à penser que nous allons pouvoir sauver la maison des flammes en ne s’attaquant pas au pyromane : le capitalisme. Je sais très bien qu’en disant ceci, je passe pour une personne radicale — mais je considère qu’être radicale est la condition sine qua non à toutes les luttes d’aujourd’hui. D’ailleurs, le mot « radical » me tient tout autant à cœur que celui d’« anarchie ». On en a fait un mot qui fait peur pour dissuader les gens de le devenir : pourtant, ça ne signifie pas autre chose que s’attaquer à la racine du problème !
« J’entends bien cette petite musique lancinante qui cherche à nous convaincre que le problème provient de
l’humain. »
Toutefois, je ne suis pas dupe. J’entends bien cette petite musique lancinante qui cherche à nous convaincre que le problème provient de l’humain, de son incapacité à comprendre l’urgence dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Cette analyse est dangereuse car elle suggère que la solution se trouve dans la mise en place d’un pouvoir coercitif, voire d’une dictature. Or, qu’elle soit verte, rouge ou bleue, une dictature reste une dictature. Je ne pense pas non plus que la solution viendra de la technologie, qui ne fait que déplacer le problème et qui permet seulement aux multinationales de paraître un peu plus vertes. L’horizon de l’émancipation n’est donc absolument pas de sauver les meubles, et encore moins de ces manières-là. La solution, nous l’avons entre les mains, c’est ce que l’anarchie a prouvé à maintes reprises au cours de notre histoire récente : « Don’t mourn, organize! » (« Ne vous lamentez pas, organisez vous ! » [ndlr])
L’écologie, telle qu’on la connaît sous ses formes électorales depuis les années 1970, a‑t-elle entièrement échoué ?
Si on résume l’écologie politique, et même la politique plus généralement, à l’idée de conquérir le pouvoir par les élections ou par la participation au gouvernement, alors oui, je pense qu’elle a échoué dans son objectif de transformation sociale et sociétale. Elle a peut-être contribué à une meilleure prise en compte de certains sujets ces dernières années mais elle ne s’est pas donnée les moyens de changer radicalement les choses en se bornant à cette stratégie purement électoraliste. La bonne nouvelle, c’est que l’écologie ne se réduit pas uniquement à ça. Il me paraît évident que les mouvements anti-nucléaires, la lutte pour préserver les terres sur le plateau du Larzac, ou encore la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ont permis d’apporter des propositions beaucoup plus concrètes, de rendre l’utopie palpable. De mon point de vue, l’écologie doit désormais s’inscrire au sein du mouvement révolutionnaire. Et c’est en lisant le livre de Floréal Romero et Vincent Gerber, Murray Bookchin, pour une écologie sociale et radicale, que je l’ai enfin compris. Le mouvement écologiste a longtemps ignoré le travail de Murray Bookchin qui a été un précurseur dans les années 1960. Aujourd’hui, il est à la mode : tant mieux ! Pour autant, il s’agit de rester vigilant sur la réappropriation qui peut en être faite. Je me réfère souvent à un article de l’un de vos auteurs, Elias Boisjean, qui rappelle qu’« on ne saurait […] enrôler Bookchin sans saisir la cohésion d’ensemble de sa doctrine » et qu’« intégrer un conseil municipal, voire diriger une ville, n’est d’aucun secours si cela ne participe pas d’une transformation globale sans compromis avec cet ordre social
. Donc de la fin du règne capitaliste au profit d’une société communiste libertaire
».
Vous avez d’ailleurs postfacé l’ouvrage Agir ici et maintenant, consacré à Bookchin, à l’écologie sociale et au communalisme. Comment cette proposition permet-elle de répondre à « l’effondrement » dont vous parlez ?
Comme je l’exprime dans mon livre, la lecture de Bookchin a été pour moi une sacrée claque. Comme beaucoup, j’étais passée à côté de son travail et je ne l’ai découvert que très tardivement. Et c’est bien dommage ! Je ne suis pas pour autant une « bookchiniste », dans le sens où je ne considère pas qu’il serait à lui seul l’alpha et l’oméga d’une solution toute prête à un effondrement écologique, social et démocratique. Il reste néanmoins un auteur très important dans le débat anarchiste, même s’il a lui-même été, pour des raisons plus ou moins claires, relativement critique envers le mouvement. Son apport est considérable : il est l’un des premiers à avoir apporté une analyse globale et assez fine de la situation, en y incluant la notion d’écologie qui pouvait parfois faire défaut. Je ne dis pas que l’anarchisme ne se préoccupait pas d’écologie avant lui mais il me semble qu’il a réussi à en faire la pierre angulaire du projet de société qu’il propose.

[Graça et Carlos Quitério | fitacola.com]
La véritable claque a été de comprendre qu’il fallait arrêter de jouer à un jeu auquel nous serions toujours perdants et qu’il s’agissait dorénavant de créer une déviation ou une dérivation du système, si nous voulions radicalement et foncièrement en sortir. L’effondrement, même si on peut employer d’autres mots tant celui-ci a été récupéré, sera vraisemblablement assez violent. C’est logique, puisque nous sommes déjà entrés dans une ère de transformation dont nous ne maîtrisons plus entièrement le processus. Il va donc falloir que nous réfléchissions à nous adapter à ces changements, à plus ou moins long terme. L’État, qui protège les intérêts des compagnies privées et plus généralement du capitalisme, va continuer à durcir ses relations avec celles et ceux qui s’opposent à lui. Nous pouvons donc continuer exclusivement à nous opposer frontalement à lui en espérant qu’il s’effondre de lui-même, ce qui me semble hasardeux et peut-être même dangereux puisque nous risquons le conflit direct avec des forces réactionnaires. Mais nous pouvons aussi commencer à créer cette dérivation dont je parle, en créant des espaces autonomes et en les reliant entre eux. Dans mon esprit, les deux choix ne sont pas incompatibles.
Comment ça ?
« Nous avons un exemple concret devant nos yeux, au Rojava. Nous ne partons pas de zéro — même si les conditions ne sont pas entièrement semblables. »
Ça correspond à l’esprit du gradualisme révolutionnaire de Malatesta, dont je vous parlais. L’écologie sociale a cette particularité qui permet à la fois d’amortir le choc auquel nous allons devoir nous confronter mais aussi de préparer « l’après », dans la perspective d’un effondrement de l’État-nation. C’est en lisant le livre de Raphaël Lebrujah sur le Rojava, Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne, que je me suis aperçue que nous avions un exemple concret devant nos yeux. Nous ne partons pas de zéro — même si les conditions ne sont pas entièrement semblables et même si la culture politique peut s’avérer aussi relativement différente.
Dans son dernier ouvrage, Trop tard pour être pessimistes !, l’écosocialiste Daniel Tanuro objecte aux tenants des solutions locales ou communales qu’il faut, face aux « défis terribles » auxquels nous sommes confrontés, travailler à un « plan de transition » écologique coordonné, lequel passe obligatoirement par la prise du pouvoir politique, c’est-à-dire de l’État. Cette objection ne vous convainc donc pas ?
Je n’ai pas encore pu lire ce livre [paru le 10 juin 2020, ndlr] : je me garderai donc bien d’en parler. Surtout que, d’après la quatrième de couverture, il semblerait que nous partagions plus ou moins le même constat sur la collapsologie, le capitalisme vert ou le Green New Deal. Par contre, si l’idée est de conquérir le pouvoir et, comme vous dites, par extension l’État, je ne vois rien de révolutionnaire là-dedans. Nous pourrions alors réellement dire que cela signifie que l’horizon de l’émancipation consiste à sauver les meubles. Il m’est impossible de concevoir l’émancipation si ça ne permet pas aux individus de prendre part, de manière directe, au fonctionnement démocratique. C’est un principe de base. C’est pour cette raison que je suis anarchiste. En tous cas, je suis d’accord avec le titre du livre de Daniel Tanuro : oui, il est trop tard pour être pessimistes. Et, là encore, je vais faire référence à Malatesta lorsqu’il pense que la révolution est un acte de volonté et que son action a deux objectifs bien clairs : la destruction violente des obstacles à la liberté, et la diffusion graduelle de la pratique de la liberté, privée de toutes coercitions. Le seul moyen de faire face aux « défis terribles » qui s’annoncent me semble d’y répondre justement de manière audacieuse, et l’anarchie s’y prête merveilleusement bien.
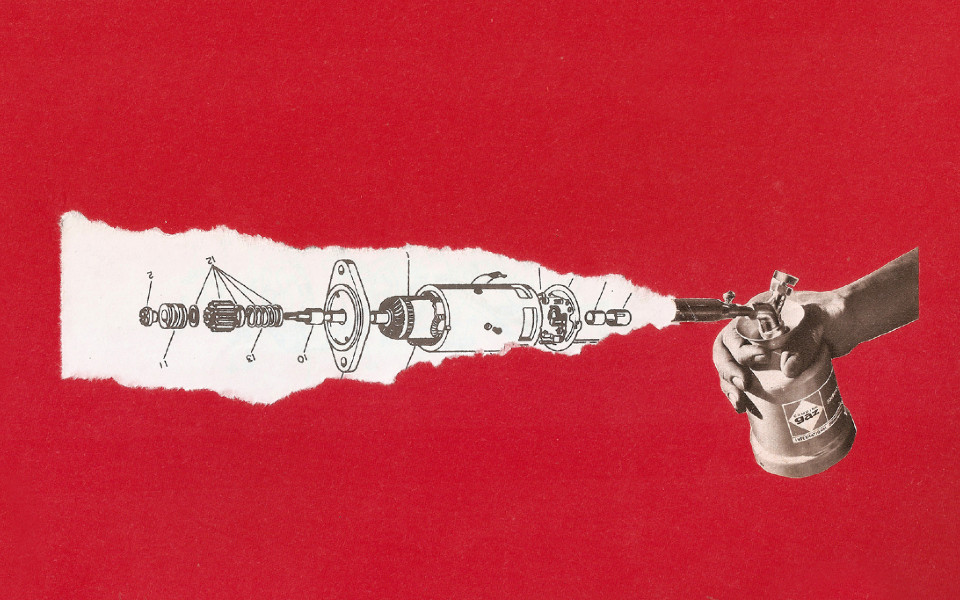
[Graça et Carlos Quitério | fitacola.com]
La police française compte environ 150 000 agents, la gendarmerie 100 000 et l’armée plus de 40 000. L’extrême droite y est massivement présente. Comment imaginer les possibilités d’une transformation radicale face à cette colossale puissance de feu, qui, l’Histoire en est témoin, se rangera aux côtés du capital si celui-ci est menacé ?
L’État dispose effectivement d’un outil très puissant, dont il se sert à outrance depuis quelques temps déjà. Le fait que l’extrême droite y soit massivement représentée n’arrange rien, même si ça ne change rien à l’affaire. C’est pour cette raison que je vous disais que la confrontation directe avec l’État n’était peut-être pas, à mes yeux, la meilleure stratégie. En tous cas, elle ne peut être la seule. Maintenant, je peux comprendre que le niveau de colère des gens soit tel qu’ils souhaitent en découdre avec ce qui symbolise, un peu trop à mon goût, l’État et le gouvernement. Il est impossible d’éluder la question de la confrontation physique avec les forces réactionnaires lors d’un processus révolutionnaire. Penser que le changement se fera intégralement de manière non-violente, en se déguisant en bisounours, est totalement illusoire. Ou alors, c’est que le changement proposé est très loin d’être radical, quand il n’est pas carrément un faux-nez du capitalisme. Je suis pacifiste et anti-militariste, mais je ne suis pas naïve. Bookchin parle d’ailleurs de constituer une milice populaire pour défendre les communes libertaires. C’était déjà la question lors de la Commune de Paris. En 1936, les républicains et les anarchistes avaient aussi dû constituer des milices pour combattre les troupes de Franco. Au Rojava ou au Chiapas, les populations luttent physiquement et quotidiennement pour défendre leur révolution. C’est pour cette raison qu’il est primordial, avant toute chose, de constituer un réseau solide de soutien et de solidarité dès le début, localement mais aussi internationalement. Ceci dit, je m’inscris légèrement en faux avec l’idée qu’historiquement les « forces de l’ordre », pour globaliser, se rangent systématiquement aux côtés du capital.
À quoi pensez-vous exactement ?
« Je m’inscris légèrement en faux avec l’idée qu’historiquement les
forces de l’ordrese rangent systématiquement aux côtés du capital. »
Il existe quelques exemples, certes rares, qui montrent que ce n’est pas toujours aussi fiable. En 1871, la garde nationale parisienne s’était rangée du côté des communards. En février 1917, à Pétrograd, une partie des troupes avait rejoint les insurgés, c’est d’ailleurs ce qui a fait basculer la révolution de leur côté. En 1974, au Portugal, la révolution des Œillets a été portée par l’armée. Év<idemment, tout ça n’a pas forcément débouché sur une société anarchiste, mais il existe parfois de bonnes surprises. Très récemment encore, aux États-Unis, en plein mouvement Black Lives Matter, on a pu voir quelques exemples de policiers ou de gardes nationaux qui ont posé le genou à terre en signe de solidarité. Un démocrate de la chambre des représentants, ancien marine, a appelé les soldats à déposer les armes et à rejoindre les manifestants. Quant au chef du Pentagone, il a exclu de recourir à l’armée alors que Donald Trump le lui avait demandé.
Ça reste marginal…
Oui, et il est possible que quelques-uns aient cédé à la pression populaire. Je ne suis pas certaine qu’on verra ceci un jour en France mais, heureusement, rien n’est jamais définitivement écrit. Je voudrais insister sur une époque de l’Histoire qui me semble essentielle, tant elle a de choses à nous apprendre : la révolution sociale espagnole de 1936. Les anarchistes, notamment la CNT-FAI, et le POUM ont donc constitué des milices pour défendre la révolution et combattre le fascisme. La situation n’était pas simple mais celles-ci tenaient assez bien leurs positions. Le problème venait du manque d’armes qui leur étaient fournies par l’URSS de Staline et qui leur étaient refusées par les « démocraties » capitalistes. Or le gouvernement, sous la pression du Parti communiste espagnol, et malgré son consentement apparent aux thèses révolutionnaires, n’a eu de cesse de faire du chantage aux armes et de casser les milices confédérales afin de les remplacer par une armée dont elle pouvait avoir entièrement le contrôle. La morale de cette histoire, c’est qu’il est impossible de faire confiance à l’État et au gouvernement, même quand celui-ci revêt les habits de la révolution.
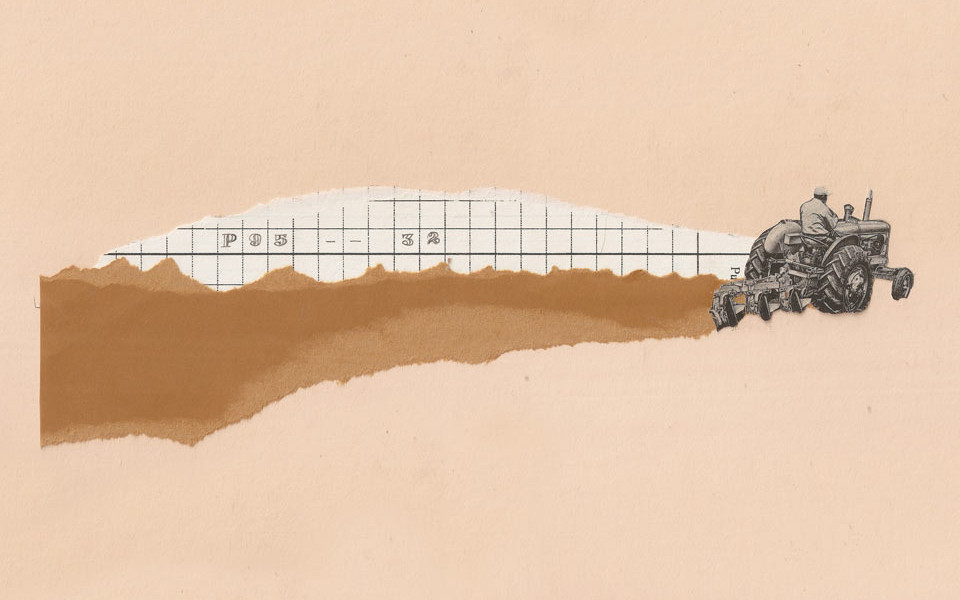
[Graça et Carlos Quitério | fitacola.com]
Nous commençons à sortir d’une crise sanitaire mondiale : des États, justement, ont confiné des gens par millions par la force de la loi. À quoi aurait pu ressembler une gestion anarchiste de la pandémie ?
Nous avons eu quelques exemples concrets en France durant le confinement, comme à Dijon, où plusieurs collectifs affiliés à l’espace autogéré des Tanneries ont mis en place un réseau d’entraide pour ravitailler les plus démunis. À Marseille aussi, un McDo a été réquisitionné dans le même but par un autre collectif autogéré. Et on retrouve d’autres exemples de ce type au travers le mouvement des Brigades de solidarité populaire, principalement en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Lyon, Nantes, Lille, ceci en collaboration avec les Gilets noirs2. Leur slogan en dit long : « Seul le peuple sauve le peuple, pour une autodéfense sanitaire ». Il faut dire qu’avec la gestion totalement catastrophique du gouvernement et l’absence de réponse concrète de l’État, la population a dû très rapidement se convertir à l’autogestion. Chose incroyable pour ses détracteurs : les gens étaient véritablement heureux de pouvoir s’organiser par eux-mêmes ! Dans les quartiers populaires, beaucoup souhaitent d’ailleurs continuer à s’auto-organiser et à agir sans attendre l’État. C’est assez encourageant. Il y a vraiment de quoi être optimiste.
C’est à vos yeux une tendance de fond populaire et irréversible ?
« Avec le recul, on peut même se poser la question de l’efficacité des grèves étudiantes pour le climat du vendredi, comme de celle des manifestations… »
Elle l’est. L’envie de faire les choses soi-même, de cultiver de manière saine et de devenir de plus en plus autonome — ce qui est en partie un moyen de s’émanciper. Le problème, c’est que tout le monde n’en est pas au même stade et n’aura pas les mêmes moyens d’atteindre cette autonomie. Et c’est là que peuvent intervenir les anarchistes en créant des réseaux de soutien et de l’entraide entre les zones urbaines et rurales. Il existe un champ des possibles extraordinaire. Et nous comptons bien y participer aussi, avec mon compagnon, en Bretagne où nous souhaitons faire vivre un lieu d’accueil et d’éducation populaire.
Début 2019, vous aviez mis en garde contre les liens qui existent entre Greta Thunberg et le capitalisme vert. Qu’ajouteriez-vous à cet article, remarqué à l’époque, un an plus tard ?
Pas grand-chose. Cette chronique était absolument factuelle et a permis de mettre en avant des éléments que n’importe quel journaliste aurait pu trouver en effectuant quelques recherches sur Internet. Tout a d’ailleurs été vérifié, et confirmé par la suite. À la base, j’effectuais moi-même des recherches pour écrire une chronique sur le problème d’« adultsplaining » que j’avais pu déceler dans diverses émissions. Nous étions alors au tout début de la mobilisation des grèves pour le climat en France. Cette chronique n’a jamais remis en question la sincérité de Greta Thunberg. D’ailleurs, je pense qu’elle a globalement raison dans son analyse concernant la situation écologique dans laquelle nous nous trouvons. Mais comme j’étais la seule voix de gauche à se poser des questions, on a très vite voulu m’assimiler aux attaques de la droite, qui, elles, étaient franchement dégueulasses. Je ne regrette absolument pas d’avoir écrit cette chronique — même si j’ai eu le droit à des insultes qui n’avaient rien à envier à celles que j’avais reçues lors de mon vote en faveur de la loi sur le mariage pour tous ou encore celui où je m’opposais à la prolongation de l’état d’urgence. Ça montre bien cette difficulté à laquelle on doit faire face lorsqu’on ose apporter une critique qui touche une personne que tout le monde a érigé au rang de sauveur. Avec le recul, on peut même se poser la question de l’efficacité des grèves étudiantes pour le climat du vendredi, comme de celle des manifestations…
Pourquoi ?
Elles n’avaient pas d’autre objectif que de faire pression sur un gouvernement… qui s’en fiche éperdument. Au mieux, ça aura permis à Yannick Jadot et EELV de faire un bon score aux élections européennes, ou à quelques ONG de récolter des financements. J’ai envie de dire : « Quoi d’autre ? » Ce qui me gêne aussi dans la démarche, c’est qu’elle concerne principalement une population urbaine, issue des classes moyennes blanches de l’hémisphère Nord, alors que les premiers concernés par le changement climatique sont plutôt ceux de l’hémisphère Sud. Un mouvement, lorsqu’il se veut révolutionnaire, doit pouvoir être irrigué de toutes parts, que ce soit pour l’écologie, le féminisme, les luttes contre les violences policières, contre les discriminations raciales ou celles fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre — il est nécessaire que ce soit très clair et radical, afin d’éviter toute récupération et confusion possible. Aujourd’hui, alors qu’on entame la seconde phase du déconfinement, on entend beaucoup moins toutes ces voix qui s’élevaient à l’époque. On parle encore d’écologie mais on s’attarde bien plus sur la question de la reprise économique. C’est tout à fait légitime puisque ce sont les plus fragiles qui vont subir les effets de la récession, mais ça montre aussi la relative hypocrisie qui règne durant les campagnes électorales.
Illustration de bannière : Carlos Quitério
Photographie de vignette : Liberté Bonhomme Libre
- Surnom donné aux adhérents du syndicat [ndlr].[↩]
- Mouvement de sans-papiers qui demandent la régularisation de tous les sans-papiers, des logements décents et des conditions de vie dignes [ndlr].[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Floréal Romero : « Communalisme : se doter d’une organisation », mai 2020
☰ Lire notre entretien avec Daniel Tanuro : « Collapsologie : toutes les dérives idéologiques sont possibles », juin 2019
☰ Lire notre article « Le moment communaliste ? », Elias Boisjean, décembre 2019
☰ Lire notre abécédaire de Murray Bookchin, septembre 2018
☰ Lire notre entretien avec Pierre Charbonnier : « L’écologie, c’est réinventer l’idée de progrès social », septembre 2018


