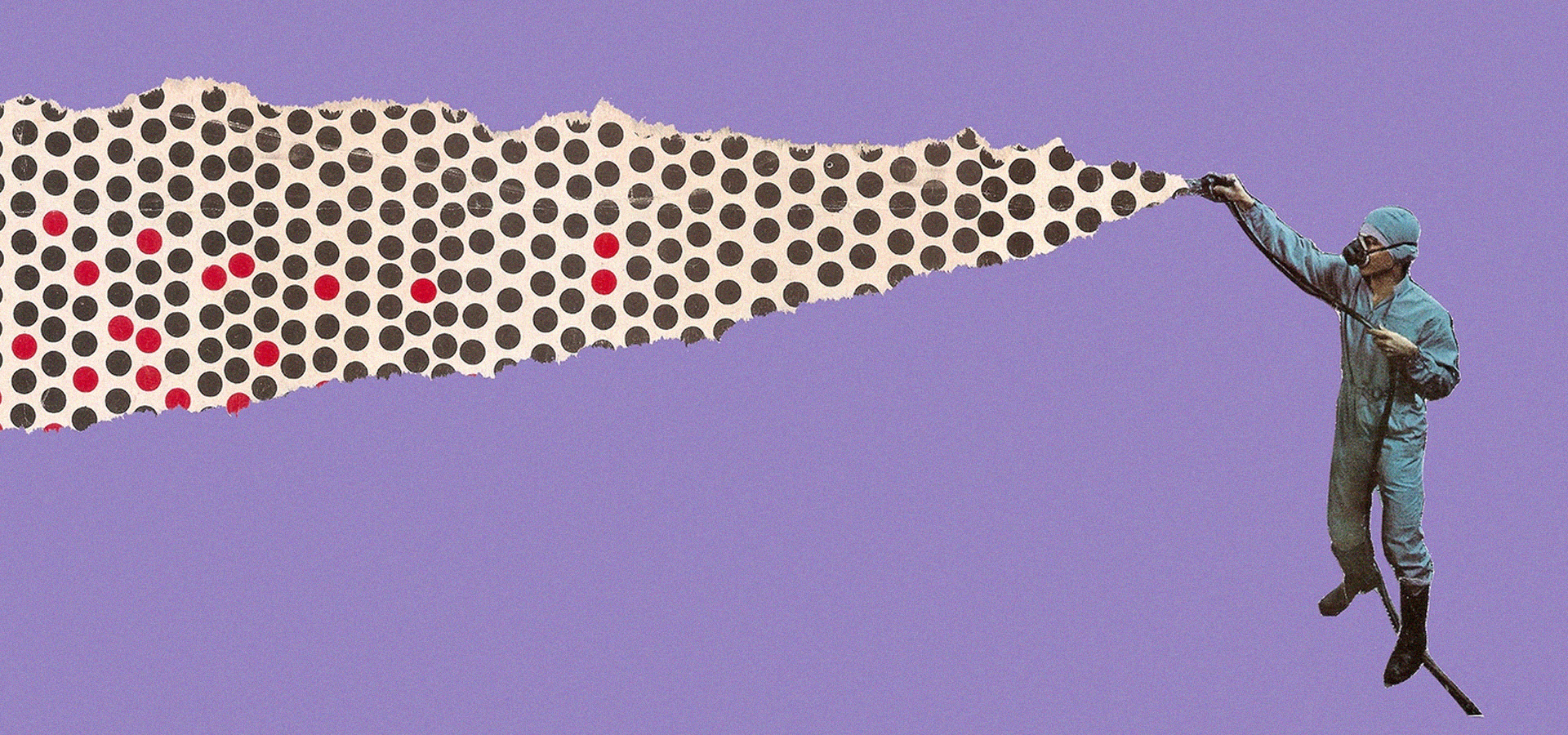Entretien inédit pour le site de Ballast
Janet Biehl a été la collaboratrice et la compagne de Murray Bookchin durant 20 ans. Elle publie ce mois-ci, en anglais, la biographie du théoricien de l’écologie sociale et du municipalisme libertaire : Ecology or Catastrophe : The Life of Murray Bookchin. Une somme incontournable pour qui s’intéresse à sa pensée. Biehl rentre tout juste du Rojava, au nord de la Syrie : c’est que la doctrine révolutionnaire qui s’y déploie n’est pas totalement étrangère aux vues de l’Américain… Entretien avec celle qui continue de porter, avec des divergences sur lesquelles nous revenons ici, le projet communaliste.

Bookchin avait longtemps essayé de convaincre les anarchistes que la démocratie du vis-à-vis, fondée sur les assemblées citoyennes, représentait une politique idéale : elle serait enracinée dans le peuple, le pouvoir émanant du bas vers le haut. Mais les anarchistes ont rejeté cette conception au motif que la démocratie implique l’usage de la majorité, laquelle constituait pour eux une forme de « règle » — donc inacceptable en cela. Ils ont fini par rejeter le municipalisme lui-même, considérant que les gouvernements municipaux ne représenteraient que de nouvelles formes de « petits États » — tout en ignorant le fait que le projet démocratique de Bookchin impliquait la transformation de ces gouvernements municipaux en confédération d’assemblées ! Pendant les années 1990, alors que le spectre politique penchait vers la droite, l’anarchisme s’est encore éloigné du projet de Bookchin. En 1995, il regrettait que les anarchistes aient renoncé à « tout engagement sérieux en faveur d’une confrontation sociale avec l’ordre établi, organisée et cohérente en termes de programme ». Et à construire une « société libertaire orientée vers la commune ». Les anarchistes rejetaient non seulement la démocratie mais le socialisme lui-même, en lui préférant l’individualisme. Ils semblaient plus intéressés par l’expression de leur moi et des actes de « bravoure » consistant à jeter des pierres sur la police… Beaucoup se sont tournés vers le mysticisme ou le paganisme et ont rejeté la civilisation au profit du primitivisme. À partir de là, Bookchin en a conclu que l’anarchisme était au fond individualiste : « Il doit y avoir une place dans le spectre politique où les anti-autoritaires qui ont des préoccupations sociales pourraient développer un programme et une pratique pour tenter de changer le monde, et pas seulement eux-mêmes. Il doit y avoir une arène où le combat peut mobiliser le peuple, l’aider à s’éduquer lui-même et à développer une politique anti-autoritaire qui inventerait une nouvelle sphère publique contre l’État et le capitalisme. » Il a alors choisi de qualifier cette attitude de « communaliste », pour inclure à la fois sa dimension socialiste anti-étatique et sa dimension politique, démocratique.
Quelle était sa position finale quant à la possibilité d’une transformation sociale ? L’État, qu’il a vivement critiqué, restait-il cet obstacle définitif ?
« Il a alors choisi de qualifier cette attitude de
communaliste, pour inclure à la fois sa dimension socialiste anti-étatique et sa dimension politique, démocratique. »
Il rejetait complètement le principe étatique — pour plusieurs raisons. D’abord, parce que l’État exerce le monopole de la violence, parce qu’il régule et contrôle la société par les corps législatifs et exécutifs qui deviennent des professionnels du contrôle, à travers les forces de sécurité et la bureaucratie. Et, surtout, parce que l’État traite les citoyens comme des enfants incapables de se gouverner eux-mêmes. En revanche, il n’a cessé de réaffirmer le rôle de la politique dans la Cité, par laquelle il entendait la sphère civique locale, la ville ou l’ensemble urbain à petite échelle, où l’interdépendance du social et de la politique est la plus forte. C’est dans ce cadre seulement que les citoyens peuvent s’investir en politique et participer à l’autogestion d’une communauté, qui n’implique pas seulement le vote mais la participation la plus large à ses activités et la création d’institutions publiques qui encouragent l’association. Le municipalisme libertaire cherche à retrouver, revitaliser et dynamiser la politique dans ce sens-là. Il ne s’agit pas de former un nouveau parti politique, et Murray rejetait les partis — qu’ils considérait comme de simples machines à acquérir le pouvoir. Le municipalisme libertaire ne consiste pas à entrer dans les conseils municipaux pour soutenir des politiques plus environnementales, par exemple. Son but est de créer de nouvelles assemblées citoyennes : des institutions capables de rendre le pouvoir directement au peuple, puis de confédérer ces assemblées. Cette nouvelle sphère politique se conçoit en opposition totale à l’étatisme. Bookchin cherchait à renforcer et à exacerber ce qu’il ressentait comme une tension fondamentale entre les villes et l’État. Il voulait créer une force qui s’oppose activement au pouvoir centralisé de l’État.
Comment imaginer concrètement la coordination des échelons locaux et le remplacement progressif de la structure étatique ?
Dans la mesure où ces unités à petite échelle sont nécessairement interdépendantes à un niveau régional, elles finissent par former des confédérations. Les assemblées peuvent alors élire des délégués aux conseils des confédérations, qui prennent les décisions sur les problèmes communs relevant d’une responsabilité partagée. Ces délégués sont mandatés et doivent rendre compte à leur communauté, ce qui signifie que celle-ci a le droit de reprendre ce mandat. « Le pouvoir viendrait ainsi de la base plutôt que du haut », affirmait Bookchin. Ces conseils confédérés ne mettraient pas en place des politiques publiques — leur fonction serait plutôt administrative, pour coordonner la mise en place des politiques définies par les assemblées locales. Le confédéralisme devient alors un moyen de rendre le pouvoir aux communautés, qui se le partagent au sein d’un ensemble qui les dépasse. À mesure qu’elles grandiront en force et en popularité, ces confédérations deviendront des contre-pouvoirs face à l’État, et les instruments de sa contestation. Bookchin considérait bien que le municipalisme libertaire s’inscrit dans une tension dialectique permanente entre l’État-nation et la confédération municipale. « La tension entre les confédérations et l’État doit rester claire et sans compromis… le municipalisme libertaire se forme dans un combat contre l’État, est renforcé, et même défini par cette opposition. »
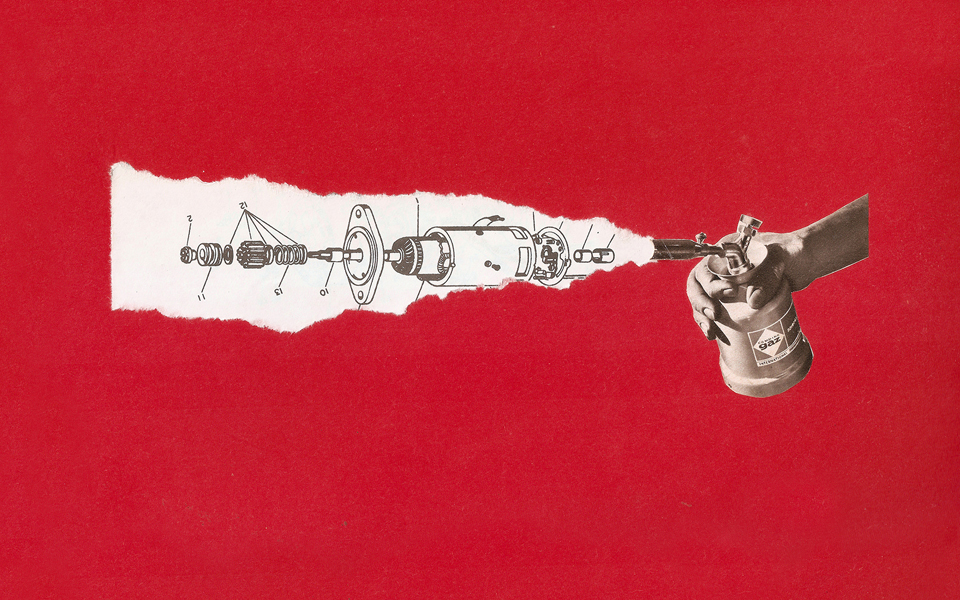
[Torn Around]
Bookchin était favorable à la règle de majorité, considérant que le « consensus » n’était qu’une manière de conférer un droit de veto à un individu isolé. Comment neutraliser les formes de domination majoritaire qui pourraient s’exercer contre certaines minorités ?
Le consensus est un processus décisionnaire qui implique que chacun, dans un groupe, doit être en accord avec une décision pour que celle-ci soit validée. Bookchin pensait que ce processus était approprié pour de tout petits groupes dans lesquels les gens se connaissent. Mais il pensait que si des groupes plus importants tentaient de procéder ainsi, cela risquait de conduire au mieux à des décisions médiocres — avec une perte de temps considérable —, et au pire à des comportements antidémocratiques. Il avait atteint cette conclusion en se fondant sur son expérience personnelle du consensus au milieu des années 1970, quand il était membre de la Clamshell Alliance (qui s’était opposée au réacteur nucléaire Seabrook dans le New Hampshire). Dans n’importe quel groupe politique, il y aura forcément des désaccords sur des problèmes de fond : il serait irréaliste de ne pas s’y attendre. L’une des dimensions du processus démocratique, c’est la délibération, quand les citoyens discutent un sujet, argumentent leur point de vue et tentent de convaincre les autres de l’adopter.
« Les assemblées citoyennes et les confédérations exproprieraient les classes possédantes et placeraient leurs propriétés entre les mains de la communauté. »
À un moment donné, ils votent. Et c’est le point de vue qui remporte le plus de suffrages qui l’emporte et justifie la décision. Mais quand on vise le consensus, on cherche l’unanimité. Comme celle-ci est souvent impossible à atteindre, les acteurs les plus agressifs cherchent à faire pression sur les dissidents. Publiquement ou non, ils essaient de les manipuler ou de les intimider, ou au moins de les écarter — c’est-à-dire de les forcer à se retirer du processus décisionnel. Dans le cas de la Clamshell Alliance, Murray expliquait que le consensus n’avait été atteint qu’à ce prix, les membres en désaccord ayant été poussés à se dédire eux-mêmes ! Il trouvait bien mieux que les minorités puissent continuer d’exprimer une divergence à travers leur vote. La dissidence était pour lui vitale et créative, et la dialectique des idées devait pouvoir passer par l’opposition et la confrontation. La majorité permet aux contestataires d’articuler ouvertement des contre-arguments potentiellement persuasifs, libre à chacun ensuite de les étudier ou d’y revenir plus tard.
À quoi ressemblait le système économique idéal de Bookchin ?
Il voulait contribuer à un système alternatif au capitalisme, qui remplacerait la recherche du profit par des valeurs, des pratiques et des institutions humanistes, dans une économie du partage, coopérative. Dans un tel système, l’économie reposerait sur la communauté, qui posséderait toutes les propriétés ayant une valeur sociale significative. Mais il n’entendait pas par propriété publique une mainmise de l’État comme dans l’Union soviétique ! Il ne parlait pas de nationalisation de l’économie, mais de municipalisation. Les assemblées citoyennes et les confédérations exproprieraient les classes possédantes et placeraient leurs propriétés entre les mains de la communauté, afin qu’elles servent à tous. Une fois en mesure de contrôler l’économie, ces assemblées, grâce au niveau confédéral, pourraient redistribuer la richesse à travers les municipalités d’une région. Elles s’assureraient que les entreprises individuelles n’entrent pas en compétition les unes avec les autres mais adhèrent plutôt à des principes éthiques de coopération et de partage. Si l’une des municipalités essayait de s’enrichir aux dépens d’une autre, la confédération aurait le droit de l’en empêcher. Les notions classiques de mesure et d’équilibre pourraient remplacer l’impératif capitaliste d’expansion et de compétition pour la recherche du profit. Les assemblées définiraient le niveau des besoins et répartiraient les ressources matérielles selon le principe « de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins ». Chacun au sein de la communauté aurait accès aux ressources de base, indépendamment du travail qu’il ou elle serait capable d’accomplir. La communauté valoriserait les gens, non en fonction de leur niveau de production et de consommation, mais pour leur contribution positive à la vie de la société. Une éthique de la responsabilité publique permettrait d’éviter le gâchis, l’exclusivité et l’inconscience dans l’acquisition des biens, comme la destruction écologique et la violation des droits humains. L’économie municipalisée serait en pratique absorbée dans le régime démocratique, moralisée, guidée par des principes rationnels et écologiques.

[Torn Around]
Bookchin était un anti-autoritaire revendiqué. Mais il reconnaissait que chaque mouvement social implique l’émergence d’un « leader ». N’y avait-il pas une contradiction entre le fait de refuser la notion de hiérarchie et cet acquiescement à la figure, même provisoire, du meneur ?
Tout mouvement de transformation sociale doit être vigilant devant la montée possible d’un autoritarisme : Bookchin en était conscient. Mais la spontanéité induit aussi d’autres problèmes. Son étude sur trois siècles de révolutions a montré que l’organisation démocratique est cruciale, et que le manque d’organisation conduit au désastre. Ainsi rappelait-il que « pendant la Révolution française, l’échec des Enragés qui ne surent pas s’organiser en 1793, en particulier lors de l’insurrection du 2 juin, a rendu possible la prise de contrôle de la Révolution par les Jacobins et au final détruit le mouvement populaire, notamment celui des assemblées des sections parisiennes. […] En février 1848, l’échec des militants qui ne surent pas s’organiser a rendu possible la prise de contrôle par Lamartine et ses proches, qui ont volé la révolution populaire aux masses. […] En Russie en octobre 1917, la gauche libertaire n’était pas organisée, ce qui a permis aux Bolchéviques de saisir le pouvoir. […] En Allemagne, la ligue de Spartacus de Rosa Luxemburg et Liebknecht, principalement composée de syndicalistes et d’anarchistes, a été écrasée parce qu’elle n’a pas su se séparer dix ans plus tôt du Parti social-démocrate allemand et créer une organisation indépendante. »
« Il affirmait l’importance pour le peuple de pouvoir défendre par les armes, si nécessaire, l’économie municipalisée. »
Il était illusoire de penser, disait-il, qu’« une révolution et une transition vers un nouvel ordre social peuvent être portées par le seul instinct et l’enthousiasme », ou par une sorte de volonté populaire mystique. L’organisation d’un tel mouvement est nécessaire pour construire une nouvelle société. Heureusement, il y aura toujours des « leaders », parce que certains ont un sens politique plus approfondi que d’autres, ou plus d’expérience, ou plus de savoir. Même si « toutes les grandes révolutions commencent souvent spontanément », les vrais militants sont eux aussi « toujours présents dès le commencement ». Ils sont « les plus respectés, actifs, agressifs et socialement conscients des révolutionnaires », et, par conséquent, les plus capables de rassembler le peuple autour d’un projet. Mais le « leadership », que ce soit celui d’individus ou de groupes, doit absolument rester ancré dans une organisation démocratique qui exige qu’on lui rende des comptes. Une révolution implique donc « un équilibre rationnel entre le recul théorique et l’enthousiasme populaire, entre l’organisation et l’élan. L’une sans l’autre, c’est une garantie d’échec ».
Comment réfléchissait-il, d’ailleurs, aux les liens entre la violence et la révolution ?
Il affirmait l’importance pour le peuple de pouvoir défendre par les armes, si nécessaire, l’économie municipalisée. Il considérait qu’il fallait « mettre en place une milice populaire — plus exactement, une garde civile, composée de patrouilles tournantes, à des fins de police, et des contingents militaires bien entraînés pour répondre aux menaces extérieures ». Dans l’ancienne Athènes, les « hoplites » (citoyens-soldats) répondaient aux mobilisations avec leurs propres armes et élisaient des commandants pour protéger la démocratie. Les milices ont aussi fait partie des révolutions américaines, anglaises, espagnoles (et, depuis la mort de Bookchin, elles existent au Rojava et à Bakur). « Que le peuple dispose ou non du pouvoir repose finalement sur la question de savoir s’il dispose d’armes et de sa propre milice, pour se préserver non seulement des criminels et des envahisseurs, mais aussi pour préserver son propre pouvoir et sa liberté face au pouvoir toujours renaissant de l’État lui-même. Les Athéniens, les Britanniques et les Américains savaient trop bien que les militaires professionnels représentent une menace pour la liberté et que l’État est un vecteur pour désarmer le peuple », disait-il. Il considérait donc comme crucial, dans un épisode révolutionnaire, le moment où l’armée choisit de baisser les armes et de rejoindre la révolution politique et sociale, comme à Saint-Pétersbourg en février 1917.
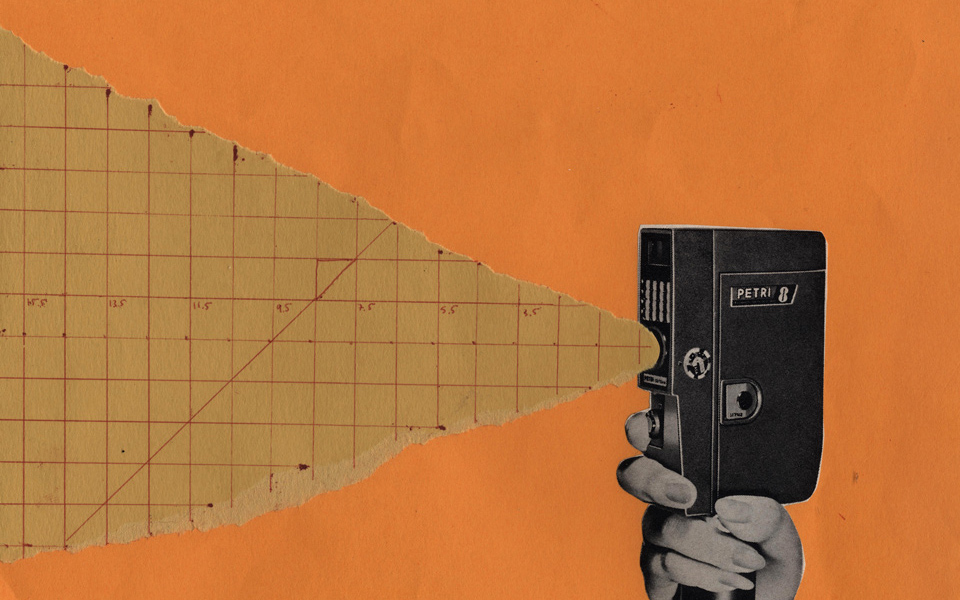
[Torn Around]
Pour lui, qu’est-ce qui était premier, structurel : la culture ou l’économie ?
Bookchin considérait comme Marx qu’atteindre le socialisme impose quelques conditions préalables, comme un estomac rempli et la liberté de ne pas être exploité. Par exemple, les sociétés tribales agricoles ne remplissaient pas ces conditions, puisqu’on y manquait de tout. Bookchin n’était pas d’accord avec des anthropologues comme Marshall Sahlins, qui considérait que la nourriture devait à l’époque être abondante et les besoins limités, et que par conséquent l’on disposait de beaucoup de temps libre et de loisir dans ces sociétés. « Je trouve cette vision peu convaincante et naïve », disait-il. Dans la plupart de ces sociétés, la coopération était certes importante, mais au sein d’une famille ou d’un voisinage, alors que « la conscience était enrobée de mythe et de magie ; leurs archives
étaient constituées principalement d’une généalogie transmise de mémoire par les anciens, de mythes et d’un ensemble de croyances mystiques, tandis que les notions de cause et d’effet étaient le plus souvent confuses : de telles sociétés actualisent-elles vraiment tout le potentiel humain en matière de savoir et d’action sur le monde ? ».
« Bookchin considérait comme Marx qu’atteindre le socialisme impose quelques conditions préalables, comme un estomac rempli et la liberté de ne pas être exploité. »
Donc il était d’accord avec Marx pour dire qu’un développement suffisant des conditions de vie matérielles était nécessaire au développement social, à la pleine actualisation des potentialités humaines. Mais d’un autre côté, il était convaincu que si le développement matériel est une condition nécessaire, il n’est pas une condition suffisante. Parce qu’il ne suffit pas d’un estomac plein et de la liberté de ne plus travailler, il faut encore une capacité à penser, à créer, à faire avancer la connaissance. Marx était trop rapide sur la superstructure : une immense variété de facteurs culturels affecte aussi le développement social, en dehors de l’économie, comme « l’organisation, la politique, les institutions démocratiques, l’éthique et oui, les traditions, l’expression intellectuelle, les espoirs et l’aspiration à une vie meilleure ». Par exemple, dans la Rome ancienne au temps de Constantin, certains avaient accumulé une immense richesse et auraient aussi bien pu développer ce capital, investir cet argent et le regarder fructifier. Mais les valeurs romaines étaient liées à la propriété de la terre. Les riches Romains voulaient devenir de grands propriétaires terriens et dissipaient ainsi leur fortune en achetant toujours plus de terrain : « ce désir de prestige était un facteur culturel — un facteur superstructurel ».
En Angleterre, après les années 1760, une nouvelle strate de la société est apparue et a investi principalement dans de nouvelles machines à tisser et à filer. Les facteurs superstructurels auraient pu ralentir la révolution industrielle : « les petites entreprises, capitalistes pourtant, auraient pu s’engager dans une production qualitative plutôt que quantitative de masse ». Mais le textile fabriqué à la machine coûtait si peu cher qu’il a submergé la production artisanale et que les considérations économiques ont prévalu… Aujourd’hui, cela se vérifie partout. « Le capitalisme, qui était d’abord principalement une notion économique, incarne aujourd’hui la société elle-même, au sens où la famille devient à peine plus qu’une unité de consommation, et les villes ou leurs banlieues se transforment en centres commerciaux. » Les aspects non matériels de la vie sont eux-mêmes réifiés. « Aussi ironique que cela puisse paraître aux yeux des radicaux nourris au lait de la guerre des classes économique, écrivait-il au milieu des années 1980, la politique doit maintenant retrouver sa suprématie sur l’économie, l’éthique reprendre la main sur l’intérêt matériel, les revendications de la vie retrouver leur voix face à la notion de survie du plus fort, si un mouvement pour un renouveau radical ou un changement doit être effectif… La soi-disant superstructure… ne peut pas être considérée comme un épiphénomène de la base, s’il doit y avoir une quelconque résistance à la société de marché qui tend à produire de l’individu ordinaire, et même du révolutionnaire auto-proclamé, une image en miroir d’elle-même. Dans la seule mesure où l’homo politicus peut remplacer l’homo oeconomicus, et l’homo collectivus remplacer ces deux-là, l’humanité aura une chance d’échapper à une catastrophe spirituelle. »
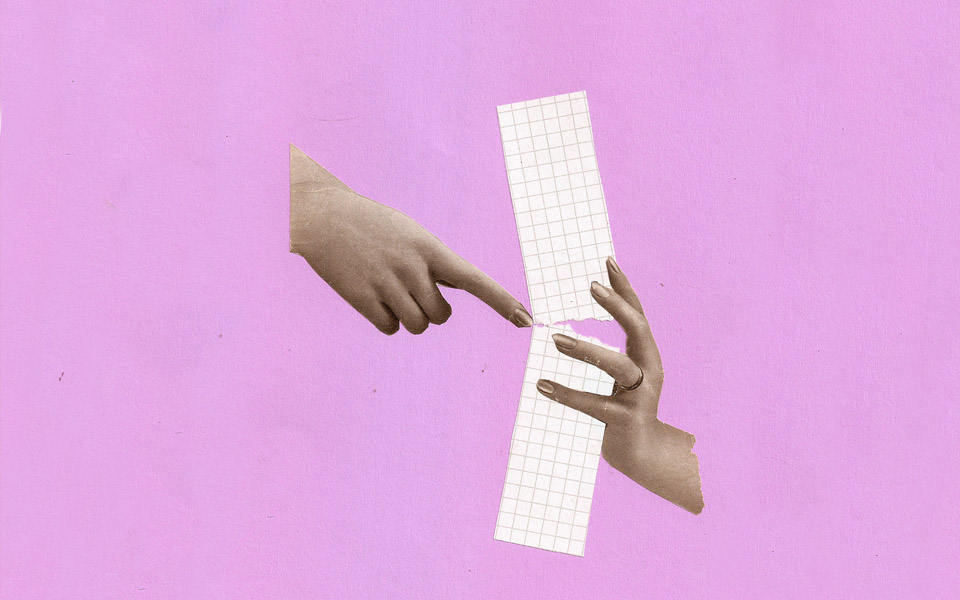
[Torn Around]
Vous vous décrivez vous-même comme étant « retournée à [votre] identité d’avant 1987 » : social-démocrate plutôt qu’anti-étatique. Quelle est votre vision personnelle concernant la manière d’utiliser le système politique existant, représentatif, pour promouvoir des idées plus radicales sur la transformation de la société ?
La méfiance et parfois la haine du gouvernement sont partout, aujourd’hui — pas besoin de lire Bakounine ou de connaître toute l’histoire de l’anarchisme pour éviter la politique et refuser de voter. Aux États-Unis, c’est de la droite à la gauche que l’on diabolise Washington, avec de vraies raisons : les milliardaires mettent de l’argent dans des élections qui permettent aux gens de choisir entre la droite et l’extrême droite. Le pouvoir législatif est paralysé ou dysfonctionnel. Aujourd’hui, les gens n’attendent plus des théories gauchistes abstraites pour renoncer et devenir cyniques. Quant à moi, je suis une… bizarrerie.
Comment ça ?
« Éliminer le niveau national et disperser de telles missions, même entre des confédérations, pourrait, je le crains, mettre des citoyens entre les mains de tyrans locaux. »
Je suis enthousiaste à l’égard du vote et de la participation politique. L’accent mis par Bookchin sur la revitalisation de la sphère civique et la citoyenneté active est ce qui m’a attiré vers son œuvre dès le début, et qui m’y rattache encore. Je crois à un fort engagement citoyen et donc politique, et je chéris la tradition de l’humanisme civique, dont le municipalisme libertaire fait partie. La théorie de gauche nous dit souvent que le système est irrécupérable, mais je crois qu’il ne le devient que quand les progressistes cessent de voter et laissent toute la place aux réactionnaires et aux intérêts des grandes entreprises. Je voudrais que les citoyens engagés s’impliquent dans le gouvernement local, créent des assemblées, comités, conseils, coopératives, collectifs, ONG et toutes sortes de modes d’association garantissant autant de participation démocratique que possible et exigeant d’être pris au sérieux. Parce qu’à ce train, si la gauche décide de ne plus voter, elle abandonne le gouvernement aux mains de la droite ! Je suis d’accord avec Murray quand il estimait que dans une société de démocratie participative, un degré de décentralisation est impératif. Mais quel degré, jusqu’à quel point ? Je suis encore en train d’essayer de le comprendre. Aux États-Unis, les niveaux intermédiaires qui existent maintenant, les 50 États, sont mal conçus et non démocratiques : ils « interfèrent avec le pouvoir municipal, paralysent le gouvernement fédéral, collaborent avec les lobbyistes et gâchent l’argent du contribuable », comme l’écrit Michael Lind dans une fascinante proposition pour défaire ce système.
Je crois comme Bookchin que les villes sont la clé d’un avenir démocratique et que pour être durables, elles doivent être intégrées dans leur environnement (il appelait ça le « mariage de la ville et de la campagne »). Je pense que les réflexions pratiques les plus intéressantes viennent par exemple d’urbanistes comme Peter Calthorpe, qui a mis en avant des principes intéressants de « cités régionales ». J’aimerais voir les cinquante États remplacés par de telles villes ! Je crois comme Lind que les écoles, les hôpitaux et les services publics (qui doivent tous le rester !), ainsi que certaines infrastructures, sont mieux gouvernés au niveau local. C’est de là que doit partir le pouvoir pour remonter vers le haut. Un jour, le Capitole deviendra peut-être une maison des délégués de la confédération… Mais je m’écarte à titre personnel de la pensée de Bookchin en ce qui concerne la fin de l’État-Nation. Je crois que certaines missions sont remplies plus efficacement et équitablement au niveau national, par exemple la garantie des libertés civiles, du droit du travail et des travailleurs, les droits en matière de procréation, les questions de parité. La sécurité sociale est mieux administrable de manière centralisée, comme les soins de santé et le financement de la recherche. Le revenu minimum garanti, que je soutiens, devrait aussi venir du centre. Car éliminer le niveau national et disperser de telles missions, même entre des confédérations, pourrait, je le crains, mettre des citoyens entre les mains de tyrans locaux. Qu’arriverait-il dans le Mississippi ou l’Alabama sans la législation fédérale sur les droits civiques ; et au Texas ou au Kansas sans la jugement Roe v. Wade de la Cour suprême (qui a reconnu l’avortement comme un droit constitutionnel en 1973) ?
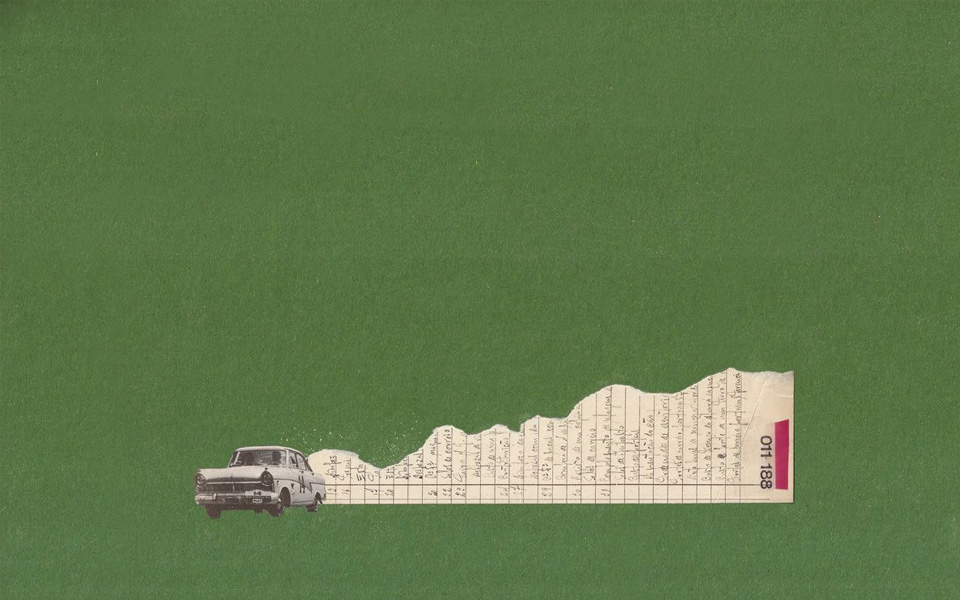
[Torn Around]
En résumé, je crois que le gouvernement, bien qu’il serve le plus souvent les intérêts du capital, a aussi historiquement représenté une force capable, avec les syndicats, de freiner le capitalisme en l’encadrant par des législations et des régulations. Et qu’il pourrait redevenir une telle force. Alors que je ne suis pas certaine qu’une confédération le pourrait, parce que le capitalisme cherchera toujours le maillon faible de la chaîne, s’insinuera dans la municipalité qui le laissera faire ce qu’il veut et même, par exemple, réinstaurer le travail des enfants sans contrôle ! Et donc, loin de renoncer à voter, je crois que les progressistes devraient affluer vers les urnes, à tous les niveaux de gouvernement, en particulier quand apparaissent des candidats comme Bernie Sanders ou Jeremy Corbyn, qui donnent de l’espoir. Mais même les meilleurs candidats, une fois élus, ne seront pas capables de faire quelque chose s’il n’y a pas un fort mouvement de pression sociale sur le système. Sanders répète sans arrêt, et je suis d’accord, qu’on ne peut pas seulement élire quelqu’un puis s’asseoir, sinon on est certain de l’échec. Historiquement, le progrès est toujours venu d’une action de la base vers le haut, combinée à une action du haut vers le bas. Dans les années 1930, l’administration de Roosevelt a pu mettre en place les programmes sociaux du New Deal et l’encadrement du capitalisme grâce aux mouvements de masse dans la rue. À un moment, Roosevelt a rencontré les dirigeants des syndicats, ils lui ont dit ce qu’il préparaient, et il aurait répondu : « Je suis d’accord. Maintenant allez‑y et forcez-moi à le faire ! » En d’autres termes, faire pression c’est s’organiser. Et c’est la même dynamique qui fait que, dans les années 1960, Lyndon Johnson a pu signer la législation sur les droits civiques, grâce à la force morale du mouvement populaire. Bookchin ne serait pas forcément d’accord avec moi sur tout cela, j’en suis consciente… C’est au lecteur de se décider.
Pourquoi Bookchin n’est-il pas plus connu ? Son nom n’apparaît même pas dans l’index de l’un des derniers grands succès de librairie, Tout peut changer de Naomi Klein, au sujet des rapports entre capitalisme et climat, pourtant inspiré de ses travaux…
« Il y avait une sorte de prescience dans l’œuvre de Bookchin. Mais c’est toujours difficile, car si vous dites les choses avant que les gens ne soient prêts à les entendre, vous êtes ignoré… »
Il a dit des choses qui étaient très radicales dans les années 1950 et 1960, vraiment à la marge, et qui sont devenues des évidences aujourd’hui, par exemple que les racines de la destruction écologique reposaient sur l’approche capitaliste, que l’énergie fossile causait le réchauffement climatique, que nous aurions à nous tourner vers l’énergie renouvelable, que pour construire un futur écologique il faudrait décentraliser la société et rapprocher villes et campagnes, qu’il faudrait « manger local », que nous avions besoin de plus de démocratie… Ce n’est pas seulement Naomi Klein. Même le Pape maintenant parle parfois comme un écologiste social, quand il parle du capitalisme et de l’environnement ! Il y avait une sorte de prescience dans l’œuvre de Bookchin. Mais c’est toujours difficile, car si vous dites les choses avant que les gens ne soient prêts à les entendre, vous êtes ignoré… Des années après, quand on s’aperçoit que vous aviez raison, cela paraît évident, et on oublie qui a eu une pensée originale… Je pense aussi que Bookchin a été marginalisé pour avoir si longtemps défendu l’anarchisme.
En France, il est complètement éclipsé par d’autres penseurs, et ses idées n’irriguent pas vraiment le débat public…
… Dans les années 1990, ceux qui avaient de l’influence dans le mouvement anarchiste français n’étaient pas en accord avec le municipalisme libertaire de Bookchin, et son rejet final de l’anarchisme et de l’anarcho-syndicalisme. Ils étaient très critiques à son égard. Et ils avaient bien le droit de l’être. Cela a suffi à faire disparaître tout intérêt pour lui parmi les anarchistes français. Mais à Montréal, au Québec, les choses se sont passées autrement. Les éditions Ecosociété ont publié quelques traductions françaises. En Suisse, Vincent Gerber travaille dur pour attirer l’attention sur ses travaux grâce à son site. Et l’année prochaine, à Lyon, il y aura un séminaire d’écologie sociale.
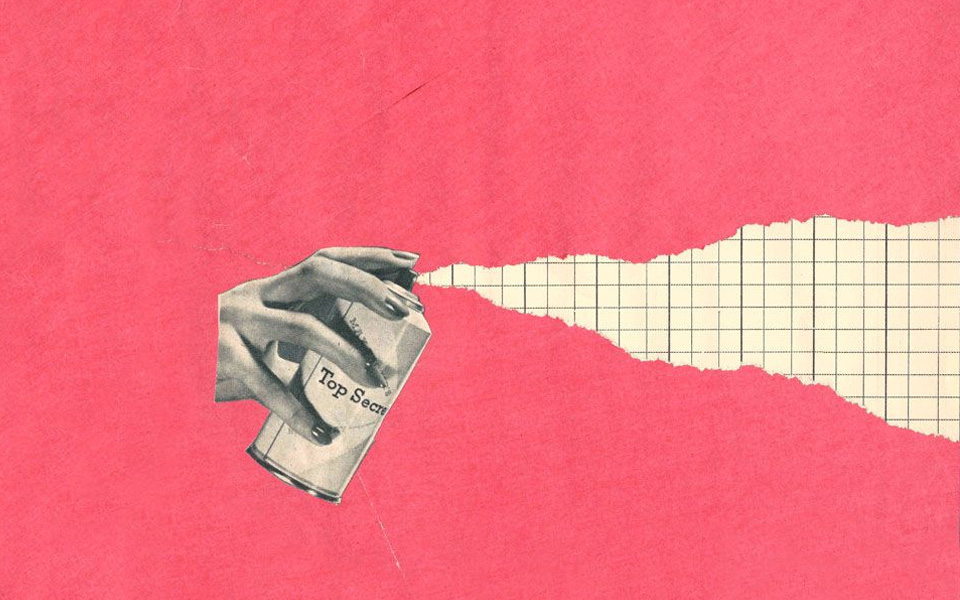
Considérait-il qu’il avait des « héritiers intellectuels » ? Était-il familier du concept de « démocratie inclusive », développé par exemple par Takis Fotopoulos, ou d’autres propositions visant à repenser la société dans son ensemble ?
Bookchin et moi avons travaillé avec Fotopoulos dans les années 1990. Il a étudié très en détail les idées de Bookchin et les a reformulées à sa manière. Mais sans aucun doute, l’héritier le plus important de Bookchin aujourd’hui, c’est Abdullah Öcalan — ce qui, malheureusement, n’est devenu clair qu’après la mort de Bookchin en 2006. Öcalan l’avait lu en prison (il y est encore) et avait engagé la transformation de l’idéologie du PKK, du marxisme-léninisme vers ce qu’il appelle « le confédéralisme démocratique ». C’est aujourd’hui l’idéologie du mouvement kurde pour la liberté, à la fois à Bakur (le Kurdistan turc) et dans le Rojava (le Kurdistan syrien).
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’expérience qui se mène actuellement au Rojava ?
« L’héritier le plus important de Bookchin aujourd’hui, c’est Abdullah Öcalan. »
Il est bouleversant de voir tant de choses sur lesquelles Murray a parlé et écrit en théorie, abstraitement, soudainement se manifester dans le réel, jusque dans les détails, en améliorant même le modèle ! On y trouve une citoyenneté active qui a créé une sphère publique là où il n’y en avait aucune, rien à part une dictature brutale. Des assemblées (appelées « communes », au niveau de la rue), et plusieurs niveaux de conseils confédérés (au niveau du voisinage, du district puis du département). Des délégués mandatés, révocables, pour garantir que le pouvoir part de la base. Un refus des hiérarchies — l’inclusion de toutes les ethnies et religions sur une base égalitaire. L’affirmation du rôle des femmes — pas seulement leur participation, mais l’accent mis sur leur importance centrale, au-delà même de ce que Bookchin avait imaginé. Un effort de socialisation de l’économie — dans leur cas, à travers des coopératives plutôt qu’une municipalisation. Je pense que le Rojava est devenu un phare pour la gauche internationaliste, susceptible d’inspirer un degré de solidarité qui pourrait déboucher sur de nouveaux efforts municipalistes.
Dites-nous : quels livres aurait-il emportés sur une île déserte ?
Il aimait passionnément l’histoire des révolutions, et il aurait emporté quelques-uns de ses favoris, au moins pour leur valeur sentimentale : L’Histoire de la Révolution russe de Trotsky, Trois qui ont fait une révolution de Bertram Wolfe, World communism de Franz Borkenau, et les livres de Burnett Bolloten sur la révolution espagnole. Pendant qu’il écrivait La Troisième révolution, il a revisité la tradition révolutionnaire occidentale. L’une des questions qui l’a occupé jusqu’à la fin était celle de la révolution avortée de 1919 en Allemagne : il voulait comprendre comment toute l’Histoire aurait été bouleversée si quelques éléments seulement avaient été différents… Il aurait emporté le livre de Richard Watt, The Kings depart (sur le traité de Versailles), et Failure of a Revolution de Rudolf Coper — le dernier livre qui l’a vraiment obsédé. Vers la fin, il essayait encore de comprendre ce qui s’était passé, avec deux livres, Stillborn Revolution de Werner Angress et le troisième volume de la Révolution bolchévique de E.H. Carr. Il était aussi très intéressé par l’entre-deux-guerres, quand les marxistes annonçaient que le capitalisme arrivait au bout de ses forces, était moribond… Ces prédictions ont complètement échoué. Il aurait emporté des livres sur ce sujet, particulièrement les essais de Georges Lichtheim qu’il admirait. Il aurait encore pris ses livres préférés sur la philosophie dialectique, la Logique et la Science de la logique de Hegel, même s’il ne devait jamais les relire — il ne pouvait pas vivre sans les avoir à portée de main sur son étagère. Il aurait emporté le Hegel de Charles Taylor et le From Hegel to Marx de Sidney Hook. Et finalement il aurait emporté un livre sur la guerre civile américaine — il n’avait pas vraiment de favori en la matière, mais il était fasciné par le fait historique que des hommes aient combattu avec succès, et accepté de mourir pour sauver d’autres hommes de l’esclavage.
Finalement, quelle était sa vision de la nature humaine ?
Il considérait que l’écologie et le socialisme libertaire, la démocratie des assemblées et la rationalité constituent l’aune par rapport à laquelle juger une société. Sa dernière position a justement visé à poser cette question : l’humanité est-elle assez intelligente pour aller vers cette société rationnelle ? Il affirmait qu’elle l’était potentiellement, mais quant à savoir si cette possibilité sera véritablement actualisée, c’est-à-dire réalisée, la question reste ouverte aujourd’hui…
Illustration de bannière : Fitacola collage
REBONDS
☰ Lire notre article « Bookchin : écologie radicale et municipalisme libertaire », Adeline Baldacchino, octobre 2015