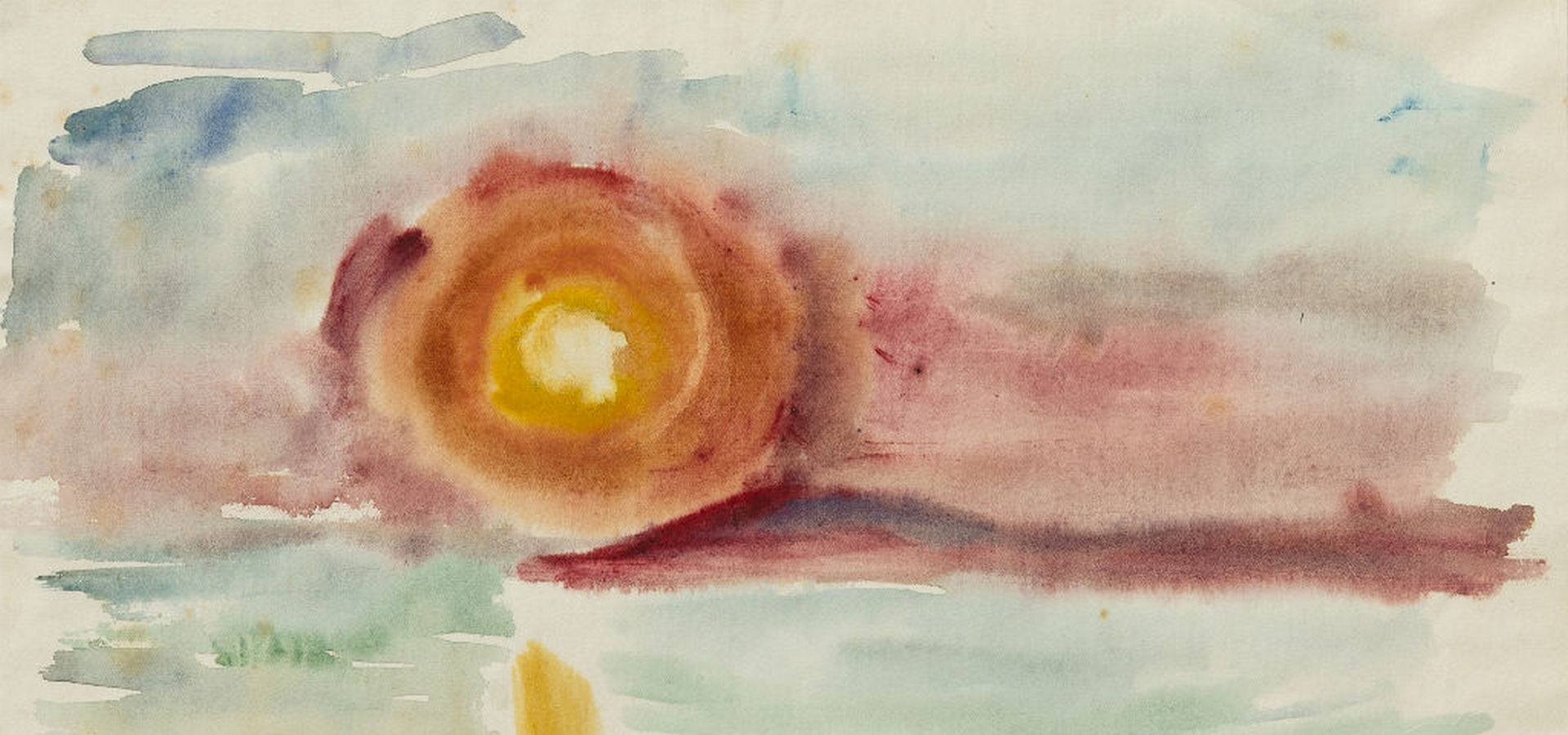Texte inédit pour le site de Ballast
Alcoolique, anarchiste et bolchevik, trublion impénitent, bouffeur de bourgeois et de curés, journaliste faussaire et délirant, l’écrivain tchèque Jaroslav Hašek ne serait-il pas l’ancêtre d’un certain Hunter S. Thompson, mythique inventeur du « journalisme gonzo » ? Des bars de Prague aux camps de l’Oural, portrait d’un déjanté dont l’œuvre finira brûlée par les nazis. ☰ Par Guillaume Renouard

Vadrouille et plume incisive
Entre deux cuites dans un bouge pragois, le jeune Hašek, ayant hérité du penchant immodéré de son géniteur pour la boisson, commence à faire travailler sa plume — avec un succès quasi immédiat. Plusieurs journaux éditent ses écrits et son premier recueil de poèmes paraît en 1903. Piquants, incisifs, ses travaux journalistiques évoquent notamment la vie politique de l’époque, la plupart du temps pour la tourner en dérision : en 1904, il rallie les milieux anarchistes et se met à tirer à boulets rouges sur les politicards tchèques, la monarchie austro-hongroise et l’Église catholique. Sa marque de fabrique ? Une ironie mordante, qui tourne en dérision tout ce que la société tchèque de l’époque compte de plus respectable : bourgeois, curés, militaires, hommes politiques et consorts. Si les ennemis traditionnels du mouvement anarchiste, bourgeoisie et corps constitués, forment sa cible privilégiée, il s’assure que tout le monde en prend pour son grade et ne manque pas, à l’occasion, d’égratigner gentiment les petites gens.
« Sa marque de fabrique ? une ironie mordante, qui tourne en dérision tout ce que la société tchèque de l’époque compte de plus respectable : bourgeois, curés, militaires, hommes politiques. »
Malgré le succès relatif de ses premiers pas journalistico-littéraires, le jeune Hašek peine à joindre les deux bouts — d’autant qu’une bonne partie de ses revenus file directement dans la poche des taverniers. Aussi, pour mettre du beurre dans les épinards, prend-il à l’occasion des emplois annexes dont il est immanquablement renvoyé : guichetier, assistant chimiste, épicier… En 1905, le jeune anarchiste est pris d’enthousiasme à l’annonce des insurrections qui ont lieu en Russie. Gagné par une fulgurante russophilie, il apprend la langue et parade dans les rues, vêtu d’habits traditionnels russes. Son engagement dans les milieux anarchistes ne cesse alors de s’affirmer : il collabore à la rédaction de plusieurs journaux, fait la lecture à des ouvriers afin de forger leur conscience politique, se fritte avec la police, dort parfois au cachot, prend régulièrement la route pour de longues périodes de vagabondage, sillonnant l’Europe centrale et les Balkans, couchant chez l’habitant ou au bord des chemins, éclusant toutes sortes de bières locales, vomissant dans le caniveau et partageant le quotidien d’une clique de marginaux, d’accidentés de la vie, d’alcooliques notoires, de losers bigarrés et de laissés-pour-compte qui peupleront la plupart de ses récits.
Embardées éthyliques et vie conjugale
Lorsqu’il rentre au pays, ses frasques créent une certaine agitation dans la bonne société pragoise. Au cours de ces années vertes, il est l’instigateur d’une grève de conducteurs de tramway (sans jamais s’être assis aux commandes d’une machine), est exclu d’un mouvement anarchiste – pour avoir troqué le vélo de l’organisation contre quelques chopines de bière – et séjourne régulièrement à l’ombre pour des rixes avec les forces de l’ordre et des rapines en tout genre, sans jamais se départir de son sourire goguenard ni de son humour singulier. Arrêté pour avoir jeté une pierre sur un policier lors d’une émeute, il se défend en affirmant le plus sérieusement du monde avoir, durant la manifestation, mis la main sur un superbe fossile, et craignant que celui-ci ne soit perdu ou piétiné, décidé de le lancer derrière un mur pour le mettre à l’abri, mur derrière lequel se trouvait malencontreusement l’infortuné gardien de la paix… Lorsqu’il n’est pas occupé à fomenter la révolution ou à tabasser la police, il écluse des litres de bière tchèque dans les établissements de la capitale, griffonne des nouvelles sur des cahiers, des feuilles éparses ou même des coins de nappe, les distribuant gracieusement à ses amis ou s’en servant pour éponger ses dettes auprès des tenanciers les plus conciliants.

[Imre Ámos]
En 1907, pourtant, l’existence du trublion anarchiste semble prendre un tournant plus conventionnel. Hašek fait la connaissance d’une journaliste tchèque, Jarmila Mayerova, dont il tombe fou amoureux au point de vouloir l’épouser. Les parents de la jeune femme ne voient franchement pas d’un bon œil l’union de leur fille avec ce voyou porteur d’un drapeau noir et d’une réputation sulfureuse. Aussi exigent-ils, avant de donner leur accord, que l’écrivain rompe avec la bohème pragoise et trouve une situation stable dotée d’un bon salaire. Voici donc Hašek rédacteur en chef du Monde des animaux, journal satirique, jeune marié et bientôt père de famille. Sur son temps libre, il écrit des nouvelles à un rythme effréné. Le jeune anar’ aurait-il remisé ses idéaux de jeunesse pour épouser le confort bourgeois ? Oui, mais pour un temps seulement. Passé les premiers émois, le carcan familial commence à lui peser, lui qui aime à vadrouiller le long des chemins de traverse. Pour ne rien arranger, il se fait renvoyer de son journal pour avoir rédigé des articles sur des animaux issus de sa propre imagination, et en avoir proposé certains à la vente. Comme ses écrits personnels ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de sa famille, il fonde un étrange « Institut cynologique », petite entreprise qui repose sur le commerce de corniauds volés dans la rue et revendus comme étant des chiens de race. La supercherie finit par être dévoilée, provoquant un mini-scandale dans la société pragoise.
Un écrivain prolifique
« Il se fait renvoyer de son journal pour avoir rédigé des articles sur des animaux issus de sa propre imagination, et en avoir proposé certains à la vente. »
Quelques jours plus tard, Hašek tente de se suicider en se jetant du pont Charles, ne devant son salut qu’à l’intervention providentielle d’un perruquier du Théâtre national. Difficile de savoir s’il s’agit là d’une véritable volonté d’en finir – Hašek étant un être instable, lunatique, soumis à des bouffées de joie comme à de violents accès mélancoliques – ou d’une supercherie ratée visant à mettre en scène sa propre mort afin d’échapper à la justice. Rescapé des eaux de la Vltava, notre écrivain se remet à noircir des pages, tel un véritable stakhanoviste du stylo à plume. De 1910 à 1913, la période est l’une des plus productives de l’existence d’Hašek qui aligne nouvelles, contes satiriques et récits loufoques à la pelle — parfois à raison de plusieurs par jour. Comme de raison, hommes d’Église, petits-bourgeois tchèques et fonctionnaires autrichiens figurent parmi ses cibles de prédilection. La méthode Hašek est toujours la même : plus qu’un pamphlétaire ou qu’un critique acerbe, il se veut médecin, usant du ridicule en guise de diagnostic. Les individus qu’il exècre ne sont pas couverts d’insultes mais caricaturés à l’extrême et tournés en dérision jusqu’à l’humiliation. Tel un Diogène des temps modernes, il se gausse de ses contemporains depuis son tonneau rempli de bière : le monde est trop absurde pour qu’on le prenne au sérieux… Sa plume adopte fréquemment une ironie voltairienne, notamment lorsqu’elle vise l’Église. Ainsi peut-on lire, dans la nouvelle « Les oreilles de Saint-Martin d’Ildefonse » : « Le père Fernando, en particulier, que la confrérie de saint Antoine était venue consulter pour apprendre de lui comment faire barrage au culte de Martin Barbarello, était un homme de grand mérite dans la lutte de l’Église contre les hérétiques. C’est à lui qu’on devait le fameux ouvrage intitulé Soixante manières de chasser le Diable à froid. On utilisait aussi communément, depuis déjà une bonne dizaine d’années, la méthode par lui préconisée pour arracher la peau des flancs et des cuisses des huguenots, picards, calvinistes et autres Juifs. Il s’était encore rendu célèbre par la diffusion d’un autre écrit, certes plus théorique que pratique, dans lequel il démontrait que, pendant la torture, le Diable sortait du corps de l’hérétique par l’oreille gauche, ce qui n’allait pas sans quelques complications lorsqu’on utilisait le casque de saint Emmerich, parce que, régulièrement, le crâne se brisait juste au-dessus de l’oreille. »
Voyons aussi cet étonnant passage, attestant l’hérésie d’un chat noir : « En ce temps-là se trouvait à Tolède, dans les geôles de la Sainte Inquisition, une certaine señora Inès Ladro qu’on avait accusée d’avoir appris à parler à son chat, lequel, ensuite, ne cessait d’invoquer le nom du Seigneur en vain. Le chat avait bravement résisté au supplice – plutôt cocasse, au demeurant, car, faute d’instruments adaptés, on avait dû se contenter de lui faire couper la queue d’un coup de hache par le bourreau. Le matou n’avait rien avoué et, pour en finir avec cette affaire, leur avait filé sous le nez. La señora, en revanche, avait confessé sous la torture que le chat n’avait jamais supporté le signe de la sainte Croix, que, de plus, à l’origine, il était jaune et à poil ras, mais qu’un jour, tandis qu’il attrapait des mouches, il avait renversé le bénitier dont le contenu s’était répandu sur son dos ; la bête, alors, avait sauté par la fenêtre en poussant d’horribles sifflements et n’était revenue que le lendemain, à minuit, changée en un gros matou noir à l’épaisse fourrure. Le feu jaillissait de ses yeux, le soufre de sa bouche et, d’une voix de tonnerre, il s’était écrié en dialecte castillan : « Je te maudis, Jésus ! » […] Soumise à un nouveau supplice, Inès Ladro avait complété ses aveux : le chat ne se nourrissait que d’hosties consacrées qu’elle lui procurait en allant quotidiennement prendre la communion dans toutes les églises de Tolède, comme le lui avait ordonné l’animal. Elle reconnaissait en outre avoir, pendant des années, entretenu avec lui des relations coupables chaque Vendredi saint et Samedi de Pâques. Le matou savait quelques prières latines mais, lorsqu’il les disait, il entrecoupait sa récitation de miaulements impies. Un jour qu’il se sentait d’humeur causante, il lui avait raconté qu’il descendait de la lignée des démons Uzurias et s’était vanté d’avoir fourré, lors de la fuite de saint Joseph et de la Vierge Marie à Bethléem, quelques graines d’ivraie sous le nez du petit Jésus, si bien que le divin Enfant avait éternué toute la nuit. »

[Imre Ámos]
L’aventure politique
C’est également à cette période qu’Hašek se lance dans une expérience politique inédite, potache et carnavalesque. En 1911, des élections partielles sont organisées à Vinohrady pour le conseil d’Empire. L’écrivain tchèque est alors au sommet de sa gloire parmi la bohème de Prague : il a pour habitude d’amuser l’auditoire des innombrables cabarets qu’il fréquente par des discours, anecdotes et improvisations hautement chargés en éthanol, avec un talent de conteur et d’amuseur public qui lui confère une solide réputation de tribun de comptoir. Aussi, lorsque la bande de soiffards impénitents qui composent son cercle d’amis lance l’idée de monter un parti fantoche pour tourner ces élections en ridicule, Hašek apparaît d’emblée comme le candidat idéal. Nul ne doute de ses capacités à singer la platitude et la langue de bois des discours politiques traditionnels pour amuser la galerie. N’ayant aucune prétention politique mais désirant malgré tout faire les choses correctement, la troupe de joyeux lurons nomme un comité exécutif, un trésorier, choisit un hymne officiel, et baptise son tout nouveau parti d’un nom pompeux et rébarbatif : ce sera donc le « Parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi ». Des missionnaires seront même chargés d’aller prêcher la bonne parole (éthylique) au-delà des frontières. Le tout nouveau parti organise des séances de discussion avec le public, qui se tiennent un peu n’importe où, pourvu que l’on y serve de la bonne bière. Car si chacun est invité à débattre et à défendre ses opinions, un mantra réunit toute la clique derrière un socle de valeurs communes, simples et fédératrices, comme Hašek le rapporte lui-même dans les chroniques relatant son simulacre de tentative de conquérir les urnes : « L’ardeur qui nous poussait au combat politique, nous la puisions surtout au fond de la barrique. » On débat bien mieux après une bonne chopine : la bière élève l’esprit, tisse des liens entre les hommes, rend la langue agile et le verbe haut. Très vite, ces curieux rendez-vous qui tiennent à la fois du débat, du spectacle potache et de la beuverie collective attirent un certain nombre de curieux aux noms célèbres, dont le journaliste et reporter Egon Erwin Kisch, l’écrivain Max Brod, et même un jeune homme discret, tiré à quatre épingles, à l’œil halluciné : Franz Kafka en personne.
« Le tout nouveau parti organise des séances de discussion avec le public, qui se tiennent un peu n’importe où, pourvu que l’on y serve de la bonne bière. »
Au cours de l’un de ces rassemblements, un policier chargé de surveiller cette bande d’agitateurs interroge Hašek, l’œil soupçonneux : « Que pensez-vous de la Couronne ? » Réponse de l’intéressé : « C’est un excellent établissement, j’y bois régulièrement. » Une autre fois : « Pourquoi le portrait de l’empereur est-il tourné face au mur ? », « De peur qu’une mouche ne chie dessus et que quelqu’un ne fasse une remarque malheureuse. » Lors d’une réunion publique, Hašek promet pour le meeting à venir de donner la liste de vingt conseillers municipaux pragois ayant assassiné leur grand-mère. La tension monte, les forces de l’ordre, flairant un coup fourré, se rendent en nombre à la réunion suivante. Avant qu’Hašek ne puisse débuter, le président du parti (fonction qui, en réalité, n’a jamais été attribuée à personne) annonce gravement qu’une question d’urgence vient d’être posée et qu’il faut y répondre de manière prioritaire en vertu de la Constitution (fantaisiste) dudit parti, « Section 35 sur l’agriculture » (qui n’existe naturellement pas) : « Que pensez-vous de la fièvre aphteuse ? », demande-t-il gravement. Réponse d’Hašek : « C’est une question extraordinairement stupide, mais à laquelle il faut bien répondre. » S’ensuit un discours d’une heure et demie à propos des ravages de la fièvre aphteuse sur les bovins dans les empires ostrogoth et wisigoth, concluant que le seul porteur actuel de la maladie serait le maire de Prague, à qui il faut par conséquent prescrire des bains de bouche de créosote.
Ridiculiser la mascarade électorale
Au cours de ces nombreuses séances où le houblon coule à flot, Hašek se livre à de brillantes parodies de ses adversaires politiques, singeant avec talent la phraséologie creuse, la langue de bois, les promesses ronflantes et les boniments servis jusqu’à overdose par les politiciens tchèques, tandis que le public l’approvisionne en saint breuvage pour maintenir son flot continu de paroles. Nul n’est épargné, du Parti social-démocrate – qui, jadis défenseur des travailleurs, s’est mué en un parti d’affairistes – aux partis cléricaux et petits-bourgeois que sont les Jeunes tchèques et les Vieux tchèques, en passant par le Parti national-social qui entend défendre les ouvriers en promouvant le nationalisme. Les anarchistes ne sont pas non plus épargnés, Hašek, bien qu’ayant milité dans plusieurs mouvements affiliés à cette idéologie, n’était membre d’aucune chapelle sinon celle de la satire et de l’impertinence. Les élections sont finalement remportées haut la main par le Parti national-social. Hašek réussit toutefois à réunir quelques bulletins, sans s’être vraiment inscrit sur les listes. En 1912, il remet à son éditeur, qui en avait fait la demande, le manuscrit de sa chronique relatant la genèse du parti. S’attendant à une farce potache et gentillette, l’éditeur découvre une satire féroce qui discrédite radicalement la classe politique, l’Église, l’empereur et l’Empire austro-hongrois – le tout entrecoupé de contes philosophiques loufoques et de récits de beuveries dantesques. Effrayé, il refuse catégoriquement de le publier. Il faudra attendre plus de cinquante ans pour que l’ouvrage voie finalement le jour, aux éditions de L’Écrivain tchécoslovaque.

[Imre Ámos]
Cette aventure politique aussi brève que cocasse n’est pas sans rappeler celle entreprise par le journaliste Hunter S. Thompson pour devenir shérif du comté de Pitkin. En 1970, l’écrivain déjanté, las de voir la ville d’Aspen, petit bled perdu au milieu des Rocheuses où il a élu domicile, perdre progressivement son âme de tranquille bourgade hippie alors que de nombreux milliardaires s’y installent et que les promoteurs immobiliers multiplient les projets d’investissement, fait campagne avec un programme politique sidérant. Jugez plutôt : légalisation de toutes les drogues, avec interdiction formelle d’en vendre à profit sous peine de lourdes sanctions, interdiction de circuler en voiture dans la ville d’Aspen, suppression de toutes les routes pour les remplacer par du gazon, rebaptisation d’Aspen en « Fat City » pour décourager les investisseurs, désarmement des policiers, qui seront désormais chargés de surveiller et d’entretenir le tout nouveau parc à vélos mis à la disposition du public. À la surprise générale, Thompson parvient à rassembler l’électorat freak – l’ensemble des marginaux, drogués et paumés en tout genre qui peuplent le comté et voient leur existence menacée par la gentrification – et ne perd que de justesse. Les deux écrivains partagent également de nombreuses facettes, au point qu’il n’est pas absurde de voir en Hašek l’ancêtre tchèque de Thompson, l’inventeur du journalisme gonzo : un penchant immodéré pour la picole, un talent indéniable pour se faire renvoyer de n’importe quel travail, un goût pour la satire et la subversion, l’humour absurde et délirant, l’anarchisme jusqu’au-boutiste qui conduit à tourner le monde en dérision, y compris son propre camp, des ennuis avec les autorités et une pratique du journalisme aussi douteuse que novatrice. Les deux trublions ont d’ailleurs eux-mêmes pour ancêtre commun le français Alphonse Allais, lui aussi à l’origine d’une liste électorale bidon pour les élections législatives de 1893. Au programme, inspiré par les idées fantaisistes d’un de ses amis, le « Captain Cap » : relocalisation des villes à la campagne et promotion de l’imparfait du subjonctif parmi les classes populaires.
Hašek sous les drapeaux
« Les forces de l’ordre ne cessent de le harceler – son passé bolchevique le rend encore plus sulfureux qu’avant – et l’armée songe à l’attaquer pour désertion. »
En 1915, Hašek est mobilisé dans l’armée austro-hongroise et envoyé sur le front russe. Il ne tarde pas à être fait prisonnier et interné dans un camp en Ukraine, puis dans l’Oural. Libéré grâce à la Révolution russe, il s’enrôle dans la légion tchèque, qui se bat contre l’Empire austro-hongrois pour la création d’un État indépendant. Deux ans plus tard, galvanisé par la Révolution, il intègre les rangs de l’Armée rouge, entre au parti bolchevik et devient commissaire politique en Sibérie. En 1920, de retour à Prague avec sa nouvelle femme, Alexandra Gravilovna Lvova, rencontrée en Russie, il a pour ambition d’aider à l’organisation du mouvement ouvrier sur place et de préparer le Grand Soir. Mais il doit rapidement déchanter : les mouvements sociaux de décembre ont été durement réprimés et la gauche radicale n’a pour l’heure que peu de cartes en main. En outre, l’accueil qu’il reçoit de la part de ses compatriotes n’est pas des plus chaleureux. La presse bourgeoise l’accuse de crimes de guerre, celle de gauche le traite de guignol et d’amuseur public. Les forces de l’ordre ne cessent de le harceler – son passé bolchevique le rend encore plus sulfureux qu’avant – et l’armée songe à l’attaquer pour désertion. Au-delà des tensions idéologiques, nul doute que la propension d’Hašek à tourner la société en ridicule depuis des années ne lui a pas fait que des amis, et que beaucoup voient dans son retour l’opportunité de lui rendre la monnaie de sa pièce. Le fait qu’il soit revenu de Russie avec une seconde femme, sans être matériellement ni juridiquement séparé de la première, ne jouera pas non plus en sa faveur : Hašek n’échappe au procès pour bigamie que parce que le nouveau gouvernement tchécoslovaque ne reconnaît pas les mariages contractés en Union soviétique.
Le brave soldat Chveik
Pour ne pas changer, Hašek noie ses ennuis dans l’alcool, levant le coude en compagnie de ses anciens acolytes de la bohème pragoise — avec qui il vient de renouer et qui le décrivent comme un homme épuisé, brisé, amer, se dégradant physiquement. Lorsqu’il n’est pas en train de se soûler ou de régler ses démêlés avec les autorités, Hašek s’attelle à l’écriture de ce qui deviendra son chef‑d’œuvre, Les Aventures du brave soldat Chveik, récit picaresque et déjanté de l’engagement d’un marchand de chiens (volés, pour la plupart) dans l’armée austro-hongroise durant la Première Guerre mondiale. Déjà esquissé dans quelques courts récits, le brave soldat Chveik est un personnage à l’identité trouble. Passé sous les drapeaux par conviction patriotique, il ridiculise l’armée et l’Empire dans son ensemble, non pas en les critiquant mais en les vénérant avec une béatitude qui confine au ridicule, sans qu’il soit jamais possible de savoir si le personnage agit par stupidité ou par ironie. Sur les quelque 800 pages qui composent le roman, Hašek ne donne jamais d’indication définitive sur la santé mentale de son personnage : est-il un crétin fini ou un esprit malin et farceur qui se gausse ouvertement de son entourage ? Feint-il l’imbécilité pour mieux souligner les dysfonctionnements de l’appareil bureaucratique austro-hongrois ? Hašek laisse la question en suspens, conférant à son personnage une savoureuse ambiguïté. Le récit est constitué d’une série de mésaventures auprès des autorités et de ses supérieurs militaires, qui prennent (à juste titre ?) son patriotisme forcené et son optimisme délirant pour de l’ironie dirigée à leur encontre. Hašek en profite pour ridiculiser ses anciens supérieurs militaires en les intégrant dans le roman sous leur véritable nom.
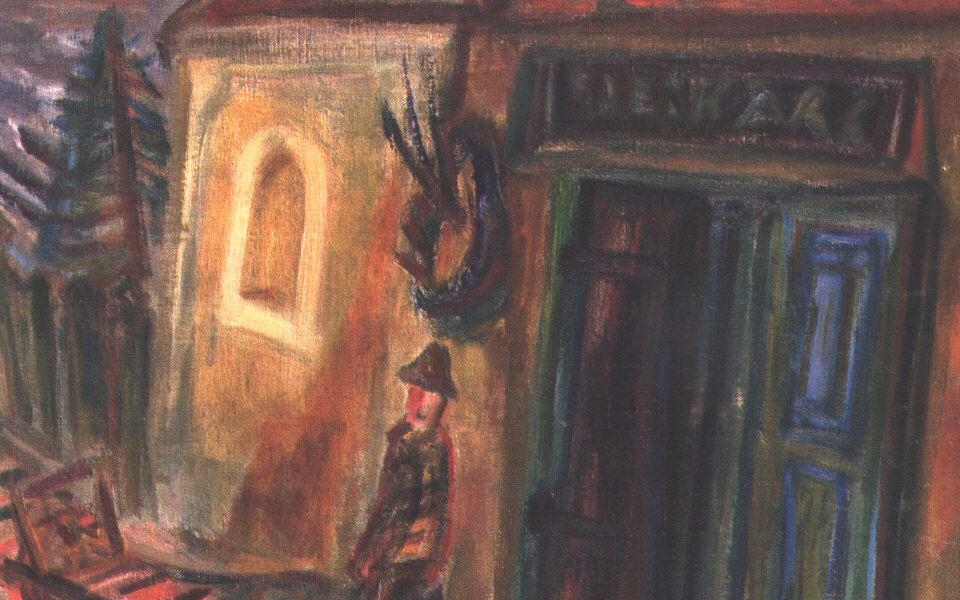
[Imre Ámos]
Si le livre, illustré par le dessinateur Josef Lada, deviendra l’une des bibles du mouvement pacifiste, il ne s’agit pas à proprement parler d’un roman de guerre. L’absurdité du quotidien d’un militaire donne certes lieu à de nombreux rebondissements et situations absurdes, mais la mort est totalement absente du roman, lequel s’achève avant que Chveik ne prenne part aux combats et ne voie même jamais l’intérieur d’une tranchée. Davantage qu’une satire de la guerre et du système militaire, le roman est en réalité une charge contre l’administration impersonnelle, la hiérarchie et la complexité des grandes organisations, qui donnent lieu à des chaînes de responsabilité interminables, des procédures lourdes et obscures, des ordres absurdes et dépourvus de sens. Sans doute Hašek fut-il autant inspiré par son expérience sous les drapeaux que par la bureaucratie tentaculaire de l’Empire, qui inspira également les œuvres de Franz Kafka. À l’époque où Hašek grandit, la dynastie des Habsbourg règne sur les territoires tchèques depuis 1526. Prague est en pleine ébullition : la révolution industrielle bat son plein, des colonnes d’individus migrent des campagnes pour venir s’installer en ville, une importante classe ouvrière se constitue. Le pouvoir, parfaitement dépourvu de la souplesse nécessaire pour réagir à ces changements, apparaît comme de plus en plus inefficace et anachronique : le système se délite peu à peu et semble de plus en plus absurde aux citoyens, qui commencent à se révolter, le pouvoir réagissant par davantage de propagande et de répression. De cette situation implosive naîtra une œuvre littéraire féconde, dont Les Aventures du brave soldat Chveik, qui s’ouvre de la manière suivante, est l’un des joyaux : « « V’là qu’ils nous ont tué Ferdinand ! » lança la gouvernante de monsieur Švejk au propriétaire des lieux – lequel ayant dû, quelques années plus tôt, renoncer au service militaire après qu’une commission médicale l’eut déclaré irrémédiablement idiot, vivait à présent du commerce de chiens, d’horribles monstres bâtards auxquels il s’employait à forger un pedigree. Il avait pour autre occupation d’être régulièrement perclus de rhumatismes et, à ce moment précis, était tout justement en train de se frictionner les genoux avec du baume Opodeldok. »
Retiré des librairies militaires tchécoslovaques en 1925, l’ouvrage sera également interdit en Pologne, en Bulgarie et brûlé par les nazis en 1933. Sur six volumes prévus au départ, quatre seulement seront rédigés, trois entièrement par Hašek et le dernier achevé par son ami Karel Vanek. Le 3 janvier 1923, alors qu’il n’a pas tout à fait quarante ans, Hašek meurt d’une tuberculose contractée durant la guerre, certainement aggravée par son alcoolisme. Obèse et malade, il dictait avant de mourir les pages de son roman depuis son lit. La rumeur de sa mort ayant déjà couru à maintes reprises au cours de son existence, lorsque les journaux relaient la nouvelle, personne n’y croit.
Illustration de bannière : Imre Ámos
Les passages cités ont tous été traduits par Michel Chasteau. L’auteur tient à le remercier pour ses conseils et aiguillages ; la préface à l’ Histoire du parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi (également traduit par ses soins) a du reste inspiré la rédaction de cet article.
REBONDS
☰ Lire notre article « Rimer à coups de poings : vie et mort d’Arthur Cravan », Guillaume Renouard, mai 2015