Entretien inédit pour le site de Ballast
C’est un mot qui a trouvé sa place dans les débats environnementaux : Anthropocène. Les humains seraient ainsi devenus une force géologique à même de modifier le système Terre. Si le concept a un certain mérite, il a toutefois la fâcheuse tendance d’unifier l’humanité de manière indifférenciée : désigner l’espèce humaine comme responsable de la crise environnementale, c’est oublier les rapports économiques, sociaux et coloniaux qui, sous l’effet de la classe dominante, ont conditionné le changement climatique. Co-auteur, avec Christophe Bonneuil, de L’Événement Anthropocène, Jean-Baptiste Fressoz est historien des sciences et des techniques : en interrogeant les catégories et les récits qui nous permettent de penser la crise climatique, il souhaite repolitiser l’histoire longue de l’Anthropocène. Nous rencontrons l’historien dans une librairie toulousaine.

C’est d’abord un constat d’historien. En thèse, en bossant sur les plaintes et les procès contre les usines polluantes aux XVIIIe et XIXe siècles, j’avais été très frappé par l’omniprésence des arguments liant l’environnement à la santé. Les pétitions parlaient de l’air, des miasmes et des émanations, les médecins parlaient quant à eux de circumfusa — des « choses environnantes », en latin — pour expliquer à quel point les fumées avaient des effets délétères sur la santé des populations, et même, à long terme, sur la forme des corps. En un sens, l’environnement était beaucoup plus important au tournant des XVIIIe et XIXe siècles que pour nous maintenant. Pourtant, malgré ces théories médicales qui faisaient de l’environnement quelque chose de très important, l’industrialisation, avec son cortège inouï de pollution, a bien eu lieu. L’histoire est plutôt celle d’une désinhibition que d’une prise de conscience. Ce constat s’applique à bien d’autres dimensions, y compris globale. Avec mon collègue Fabien Locher, on achève une enquête au long cours qui retrace tous les savoirs qui ont existé sur le changement climatique depuis le XVIe siècle. Ça peut paraître étrange ou anachronique, mais le climat a été un lieu central pour penser les conséquences de l’agir humain sur l’environnement, et en retour ce que l’environnement fait sur les humains. C’est un lieu crucial de la réflexivité environnementale des sociétés passées. Depuis le XVIIe siècle et surtout à la fin du XVIIIe, on estime que le déboisement menace le cycle de l’eau, un cycle global reliant les océans à l’atmosphère et au sol, un cycle providentiel, aussi, qui assure la fertilité des régions tempérées. À travers la question du déboisement, celle du changement climatique s’insinue au cœur des préoccupations politiques de l’époque, pour une raison très simple : toute l’énergie ou presque provient justement du bois. Dans les économies que les historiens qualifient « d’organiques », il y a en effet un arbitrage constant à faire entre la forêt et les champs, entre l’énergie pour produire des choses et le grain pour nourrir la population.
« Le problème patent est qu’il ne s’est rien passé depuis qu’on a fait cette soi-disant
révolution environnementale: les modes de production continuent sur leur lancée, le taux de CO2 n’a fait qu’augmenter. »
La question du lien entre déboisement et changement climatique est très présente à la fin du XVIIIe siècle ; la France a joué un rôle pivot dans sa diffusion globale. Pour une raison assez conjoncturelle : après la nationalisation des biens du clergé en 1789, pour solder les dettes de la monarchie, l’État français se trouve à la tête d’un immense domaine forestier par rapport aux autres États européens. À chaque fois qu’on discute de la vente d’un bout de forêt nationale pour désendetter, on reparle de climat. Le résultat est que dès 1792, à l’Assemblée nationale, on parle de déboisement, de changement climatique, d’érosion des sols, d’inondations… Attention, ça ne veut surtout pas dire « rien de nouveau sous le soleil » ! Le changement climatique en question n’est pas le même que le nôtre pour une raison principale : l’enjeu était alors le cycle de l’eau et pas celui du carbone. Évidemment, il y a eu entre temps le développement d’un énorme équipement scientifique1. Mais il y a aussi des continuités impressionnantes : au début du XIXe siècle, on pense déjà le climat comme la moyenne des températures, on le pense déjà au niveau global, on fait de la très bonne science sur cette question (c’est à ce moment qu’on étudie l’évolution des glaciers, les bans des vendanges, etc.). Enfin, on pense le changement comme irréversible, car en coupant les forêts, on produit un changement climatique qui va rendre impossible la croissance ultérieure des forêts. Le déboisement peut donc produire une dégradation conjointe des climats et des populations qui les habitent.
Si on raconte l’histoire de la transformation des environnements comme celle des sociétés qui agissent sur eux sans trop s’en soucier, ce n’est pas très intéressant : c’est plus une écologie historique qu’une histoire écologique. On a donc besoin de voir comment les gens percevaient les transformations qu’ils opéraient sur l’environnement. Racontée comme cela, l’histoire environnementale nous sort des théories de la modernité réflexive à la Ulrich Beck. D’après elles, on aurait eu une première phase moderniste, aveugle et depuis les années 1970 ; on aurait une sorte de révélation, une rupture fondamentale de la modernité — un changement historique au même titre que le passage du féodalisme au capitalisme. Le problème patent est qu’il ne s’est rien passé depuis qu’on a fait cette soi-disant « révolution environnementale » : les modes de production continuent sur leur lancée, il n’y a pas eu de grand changement, le taux de CO2 n’a fait qu’augmenter, etc. Ce n’est donc pas une affaire de prise de conscience. L’enjeu est de dé-idéaliser ces questions, de sortir la question de la crise environnementale d’un récit cliché de la modernité prise comme un bloc responsable : à chaque étape de celle-ci on avait bien conscience des conséquences de ce qu’on faisait. Ça nous sort aussi de l’idée très gratifiante que nous sommes la première génération ou presque à nous préoccuper d’environnement et que la prise de conscience est une rédemption — maintenant qu’on a compris, tout va aller pour le mieux. Eh bien non, pas du tout : ça empire plutôt.

[Klaus Leidorf | www.leidorf.de]
Le discours dominant est celui d’un dépassement de la politique classique par la question écologique : il faudrait avancer ensemble au-delà des clivages… Ceci car l’Anthropocène regrouperait indifféremment tout le monde, abolirait certaines frontières (nature et culture, vivant et non vivant, etc.). Vous pensez au contraire qu’il faut réaffirmer certaines oppositions…
Complètement. Sur ce point encore, la question de l’ancienneté de la réflexivité est importante. En France, la question environnementale a été prise en charge dans les années 1980-1990 par deux philosophes majeurs : Michel Serres et Bruno Latour. Dans Le Contrat naturel, le premier inscrivait la question environnementale à l’intérieur de la philosophie politique. Le projet a été repris et approfondi par le deuxième (Politiques de la nature). On a un cadrage essentiellement philosophique et institutionnel. La modernité aurait secrété une vision duale du monde avec d’un côté la société, de l’autre, la nature ; d’un côté la politique avec ses institutions, de l’autre, la science avec d’autres institutions. En gros, la crise environnementale nécessiterait de nouveaux Rousseau, une nouvelle constitution : faire un « parlement des choses », donner des porte-paroles aux non-humains, imaginer aussi des formes dialogiques entre les experts, les citoyens, les industriels. Tout cela est extrêmement intéressant mais pose quand même plusieurs problèmes. Premièrement, je ne crois pas que la modernité ait séparé nature et société. Au contraire, on n’a pas cessé de penser les deux de manière intriquée et d’agir en fonction ; on n’a pas été rendu « aveugles » par un « grand partage » moderne. Depuis le XVIIe, on n’a pas arrêté de se poser des questions sur l’environnement, sur le climat, sur l’épuisement des sols, sur le statut des animaux2, etc. Dans une cosmologie soi-disant moderne, les juristes ont aussi su faire preuve de beaucoup de créativité. Par exemple au XIXe, en Angleterre, pour faire payer les compagnies de chemin de fer en cas d’accident, ils ressortent un outil du droit médiéval, le deodand, qui permet de déclarer des objets coupables ! Bref, si Latour a parfaitement raison de dire que « Nous n’avons jamais été modernes », il faut ajouter soit qu’on l’a toujours su, soit que toute cette affaire de modernité est un « homme de paille » philosophique.
« Ce qu’il faut faire est assez évident : mater les lobbys et les entreprises polluantes et extractivistes, laisser le carbone dans le sol, stopper l’agriculture industrielle, mettre en place un rationnement écologique. »
Deuxièmement, ce grand récit est à la fois très radical et très consensuel : en remettant tout en cause, on ne s’attaque à rien, ni à personne précisément. Comment faire advenir une révolution cosmologique et ontologique ? Par l’esthétique ? par la culture ? Ça donne une grande place aux intellectuels et aux artistes, moins aux ouvriers, aux paysans ou aux cheminots, qui sont pourtant ceux qui organisent et manipulent la matière. Bref, j’ai peur que ce soit un discours assez académique, fascinant mais peu concret. Dans sa version plus pragmatique, l’idée est de donner une personnalité juridique aux rivières et aux forêts. C’est sans aucun doute un pas en avant, mais on connaît le gouffre entre les grands principes et leur application. Si on s’est modernisés depuis deux siècles en dépit de la prise de conscience, ça veut aussi dire que le capitalisme est très efficace pour ingérer, digérer la critique, normaliser les situations, limiter les cas extrêmes à la Nauru tout en nous donnant l’impression d’avoir tout compris. Par exemple, inscrire dans la constitution des grands principes sans considérer les modes de production et de vie, c’est être sûr que le capitalisme avalera tout cru les droits de la nature. Je suis désolé si ça semble intellectuellement peu enthousiasmant comparé aux grandes refondations cosmologiques proposées par les philosophes, mais étant donné l’urgence des enjeux, le fait qu’il faille agir partout et maintenant, la crise environnementale contemporaine oblige à agir dans le monde politique et géopolitique tel qu’il existe actuellement. Ce qu’il faut faire est assez évident : mater les lobbys et les entreprises polluantes et extractivistes, laisser le carbone dans le sol, stopper l’agriculture industrielle, mettre en place un rationnement écologique (sur le CO2 par exemple), changer le système fiscal, changer les modes de transport et d’alimentation, punir avec une égale sévérité les atteintes à l’environnement que les atteintes aux biens et aux personnes. Ça ne paraît pas révolutionnaire comparé aux « utopies concrètes » et aux projets de changement cosmologique, mais ça l’est finalement peut-être davantage.
Vous utilisez le concept de Capitalocène : en quoi serait-il plus approprié que celui d’Anthropocène ?
Anthropocène, c’est le pire nom possible pour désigner la crise environnementale puisque ça charrie des relents malthusiens : l’anthropos en tant qu’espèce biologique serait un problème. Or la démographie joue évidemment un rôle mais ce n’est sans doute pas le facteur déterminant. Entre 1800 et 2000 on passe de un à six milliards d’individus sur la planète, alors que la consommation d’énergie est multipliée par 40 et le capital par 134 (si on prend les chiffres de Thomas Piketty). Il y a donc plein de grandeurs qui sont beaucoup plus importantes et déterminantes. S’il ne fallait qu’un seul mot pour expliquer la crise environnementale, c’est probablement « Capitalocène ». C’est sans doute mieux qu’Anthropocène — évidemment, les géologues n’adopteront jamais le terme Capitalocène… Maintenant, ce n’est pas un débat très intéressant et il n’y a aucune raison de se limiter à un seul mot, une seule lorgnette. Dans le livre avec Christophe Bonneuil, L’Événement anthropocène, j’insiste beaucoup sur le rôle de la Seconde Guerre mondiale, qui ne peut pas être simplement subsumée dans l’histoire du capitalisme. On en parle beaucoup moins que le Capitalocène mais le Thanatocène est aussi important — et c’est sans doute l’interaction des deux qui joue un rôle essentiel.

[Klaus Leidorf | www.leidorf.de]
Attardons-nous un instant sur ce terme, Thanatocène. Lorsque l’on parle des relations entre environnement et guerre, la première image qui vient est souvent la guerre du Viêtnam. Mais, au-delà des destructions, l’environnement est pensé militairement en tant qu’espace à aménager : qu’est-ce que l’histoire militaire peut nous dire sur l’histoire environnementale ?
Ce qui m’a frappé en écrivant ce livre, c’est que l’histoire de la crise environnementale est déjà en grande partie écrite, mais il ne faut pas nécessairement la chercher dans l’histoire environnementale en tant que telle ou chez les historiens écologistes. Les livres les plus éclairants pour comprendre l’Anthropocène sont souvent ceux d’historiens économistes du fait militaire. Je pense notamment à Alan Milward, qui a écrit un livre sur la mobilisation militaire industrielle aux États-Unis pour la Seconde Guerre mondiale, à Adam Tooze, avec les mêmes questions sur le IIIe Reich, ou à David Edgerton, sur l’économie anglaise et la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, la façon dont on agit sur l’environnement de l’ennemi pour le détruire est très ancien, même s’il prend des proportions industrielles et technologiques considérables avec la guerre du Viêtnam. Le plus important, c’est à quel point le fait militaire contamine les technologies civiles. Et comme celui-ci s’oriente vers le choix de la puissance plutôt que celui du rendement, ça fait bifurquer vers des technologies très énergivores, très polluantes. Les mêmes technologies de destruction contre les humains sont ensuite appliquées sur les vivants en général : les pesticides, le fil à nylon utilisé pour la pêche vient des parachutes, l’aviation, les autoroutes, autant d’éléments très polluants qui viennent des militaires. L’interaction de tout ceci avec le capitalisme est le nœud de l’affaire.
L’histoire de l’énergie semble accompagnée d’une recherche de meilleure efficacité. Vous prenez un exemple qui bat en brèche cette idée : l’agriculture intensive et mécanisée est moins efficace — énergiquement parlant — que l’agriculture traditionnelle, puisqu’il faut fournir plus de calories pour produire une calorie alimentaire. Le progrès énergétique est-il un mythe ?
« Le fait militaire contamine les technologies civiles. Et comme celui-ci s’oriente vers le choix de la puissance plutôt que celui du rendement, ça fait bifurquer vers des technologies très énergivores, très polluantes. »
Le système énergétique peut ne pas être efficace sans que ça n’ait d’importance : s’il y a de l’énergie en abondance pour pas cher, on s’en fiche, c’est ça le problème. Tant qu’il y a du pétrole bon marché, on peut transformer beaucoup de pétrole pour récupérer un produit agricole qui contient peu d’énergie… L’agriculture, c’est exactement ça : la culture industrielle peut être déficitaire énergétiquement — il y a tout de même des débats, selon ce qu’on compare, quelles céréales, quels produits — mais ça ne l’empêche aucunement de conquérir le monde. C’est aussi pour ça que le discours des énergéticiens disant que c’est la fin de la fête parce que l’EROI (l’Energy return on investment, le taux de retour énergétique) diminue — il faut de plus en plus de calories pour récupérer une calorie de pétrole —, ne m’a jamais semblé très concluant. Si on prend l’EROI des premières mines de charbon, il est désastreux : il fallait pomper de l’eau et il y avait beaucoup d’humains qui travaillaient dans ces mines (pas loin d’un million de mineurs en Angleterre à la fin du XIXe siècle). Pourtant, ce sont ces mines de charbon énergiquement peu efficaces qui ont lancé le capitalisme fossile. Il y a donc eu des trajectoires qui se sont enclenchées sur des EROI très mauvais. Quelque soit l’EROI, tant qu’il y a un intérêt financier à le faire, on le fera. À la fin des années 2000, les firmes pétrolières ont sérieusement envisagé d’installer des centrales nucléaires pour récupérer les pétroles bitumineux de la province de l’Alberta, au Canada. Et si le cours du pétrole remonte, il y a des chances que ces projets réapparaissent. Il faut prendre en compte l’EROI mais aussi relativiser cette vision purement énergéticienne de l’histoire de l’énergie. Ce que je trouve intéressant, ce sont plutôt les histoires politiques de l’énergie3 qui montrent les enjeux stratégiques, capitalistiques, etc., qui sont des facteurs explicatifs beaucoup plus importants.
Si la quantification et la mise à prix de la nature s’étendent largement aujourd’hui, certains principes, comme celui du « pollueur-payeur », sont anciens. À quand remonte cette idée ?
Cette affaire de compenser pour les dommages dont on est responsable est une vieille idée du droit romain reprise par les élites du capitalisme industriel au début du XIXe siècle. Dès le début de la révolution industrielle, il y a un projet très important de stabilisation des propriétés industrielles, avec des droits de propriété solides. Et donc, quelles que soient les plaintes contre la pollution, l’industriel doit être garanti dans son droit d’exercice et ne doit pas être contraint de déménager. La « solution » qui se met en place, avec le décret de 1810 sur les établissements classés, consiste à accorder des dommages et intérêts à ceux qui subissent des nuisances. Comme on le sait, ça ne règle pas le problème de la pollution mais ça apaise les conflits de voisinage. C’est un enfumage évident. Aujourd’hui, ça prend des formes beaucoup plus impressionnantes, plus subtiles, avec l’idée qu’on peut même compenser la perte des services éco-systémiques (combien vaut non pas une prairie, mais l’activité de pollinisation des insectes qui y vivent, par exemple) ; la logique reste assez équivalente — et le résultat final aussi. Ce qui est dangereux dans ces affaires de compensation éco-systémique, c’est la mise au même niveau des valeurs financières et de la nature : l’idée qu’on peut aller détruire du bocage en Vendée puis acheter des « bons » biodiversité ailleurs en France. Ceci repose en fait sur des terrains qu’une institution (par exemple la Caisse des dépôts et consignations Biodiversité) s’engage pour un temps limité à conserver (de l’ordre de 20 à 30 ans) : c’est un mode de désinhibition, on se donne bonne conscience en disant « On va bétonner ici et protéger là-bas ». La réalité ? On risque de bétonner ici et là bas.

[Klaus Leidorf | www.leidorf.de]
Comment sortir d’une telle vision comptable, économiciste ?
Depuis le XIXe, on a inventé plein de choses pour protéger la nature : l’interdiction de pêcher, de déboiser, de trop polluer, etc. Ce sont des outils très anciens. Au XIXe siècle, on a créé, surtout aux États-Unis, les parcs naturels avec la volonté de préserver un endroit en dehors de la logique économique. Le parc a été énormément critiqué par les historiens et les philosophes post-modernes. Par les historiens, parce qu’au XIXe, les parcs ont aussi servi à chasser les gens qui y habitaient, les Indiens aux États-Unis notamment, et on leur piquait leur terre sous prétexte de préservation de la nature. Par les post modernes puisque cela revenait à séparer la nature de l’Homme. Je comprends leurs arguments, mais ça reste un outil de protection de l’environnement efficace et il est important de le réhabiliter. De même, tous les corridors pour permettre aux animaux de migrer, de bouger, de se reproduire : il n’y a pas de financiarisation de la nature, on n’essaye pas de valoriser un service éco-systémique — on réfléchit à la bonne organisation des activités humaines pour éviter qu’elles empiètent trop fondamentalement sur celles des autres espèces.
La notion de « développement durable » est dorénavant assez critiquée, mais une autre expression est moins questionnée, celle de « transition énergétique » : qu’en est-il ?
« On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole à autre chose : on n’a fait qu’additionner ces sources d’énergies les unes aux autres. »
Le terme de « transition énergétique » apparaît en anglais vers 1975, pour remplacer la notion de crise énergétique : c’est beaucoup plus rassurant et ça donne l’impression qu’il y a une sorte de rationalité gestionnaire. Ça vient des énergéticiens et des professionnels de l’énergie nucléaire. Ils disent que s’il n’y a pas assez de pétrole — on a passé le pic de pétrole conventionnel aux États-Unis —, on fera du nucléaire, du coal to fuel (liquéfaction du charbon pour en faire du pétrole), du pétrole de schiste. Cette notion de transition énergétique est ensuite réutilisée dans les années 1980, surtout en Allemagne (« tournant énergétique »), pour désigner la transition vers les énergies renouvelables avec le solaire, l’éolien — même si, derrière, c’est une idée très naïve de ce qu’est un système énergétique. C’est une notion qui a servi à apaiser les craintes. Le second problème est qu’historiquement il n’y jamais vraiment eu de « transition énergétique » mais surtout des « additions énergétiques ». On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole à autre chose : on n’a fait qu’additionner ces sources d’énergies les unes aux autres. Le pic du charbon n’a pas eu lieu au XIXe, ni même au XXe, espérons qu’il aura lieu bientôt au XXIe siècle… Quand on parle un peu trop légèrement de « transition énergétique », il faut bien voir qu’il s’agit d’une transformation sans précédent.
Reste la question de l’innovation : il ne faut pas être technophobe car il n’y a pas de raison de se méfier davantage d’une technique nouvelle que des vieilles techniques qui nous ont mis dans la situation que l’on connaît. Mais il ne faut pas être naïf non plus : étant donné l’inertie considérable des systèmes techniques, étant donnée une fois encore l’urgence (réduire de 75 % les émissions globales avant 2050), la probabilité que « l’innovation verte » nous sorte de la crise me paraît proche de zéro.
La philosophe Catherine Larrère affirme que le succès du concept d’Anthropocène « tient sans doute à son nom : il nous plaît qu’une époque géologique (rien de moins !) porte le nom des humains4 ». L’Anthropocène est-il en train de devenir un nouvel anthropocentrisme ?
Ça peut l’être effectivement, surtout dans le discours du « bon Anthropocène ». Il y a tout un groupe de savants qui popularisent le concept, les éco-modernistes, et ont tendance à ramener ça à des processus très anciens en disant que, depuis le Néolithique, on serait entrés dans l’Anthropocène (l’augmentation du méthane vers -4000 n’est pas naturelle) et qu’il faut maintenant entrer dans un « bon Anthropocène » éclairé par les sciences du système Terre. Le scientisme se ressource dans l’écologie. Ce thème du « bon Anthropocène » est très anthropocentrique. Ces éco-modernistes sont pessimistes en partant du principe que l’on n’arrivera pas à infléchir la trajectoire de développement — en un sens, ils n’ont pas tout à fait tort — et qu’il faut ouvrir la porte à la géo-ingéniérie. Les sciences du système Terre nous permettraient de gérer la planète au niveau global par des solutions technologiques : l’Homme se considère alors comme garant de l’équilibre planétaire. Une idée assez délirante…

[Klaus Leidorf | www.leidorf.de]
Mon explication du succès du concept d’Anthropocène tient à l’esthétique qu’il charrie. L’Anthropocène n’est pas une avancée scientifique ni un nouveau paradigme, c’est juste une manière brillante de renommer les acquis des sciences du système Terre, depuis les années 1960 jusqu’aux années 1990. L’Anthropocène utilise les ressorts très classiques de l’esthétique du sublime, un concept théorisé par le philosophe conservateur anglais du XVIIe Edmund Burke : c’est le sentiment de terreur face à la vaste nature, mais qui est aussi mêlé de plaisir. Il prend un exemple : si Londres était dévastée par un tremblement de terre, plein de gens viendraient voir ça et y prendraient un certain plaisir5. Le sublime de l’Anthropocène reporte le plaisir esthétique qu’on avait à contempler la vaste nature — tremblements de terre, volcans, etc. — sur l’espèce humaine. Donc ça inverse les polarités. Dorénavant, l’espèce humaine se compare avec des forces géologiques, qu’on avait appris à craindre mais aussi à révérer. L’idée surfe avec une autre branche du sublime : le technologique, c’est-à-dire l’admiration face aux immenses réalisations humaines (pensez au viaduc de Millau). Le discours de l’Anthropocène, tout comme la géo-ingénierie, réactive cette jonction entre la grande nature et une technologie qui rivalise avec elle, puisqu’elle est désormais à cette échelle. De plus, les philosophes et théoriciens de la modernité nous serinaient qu’il n’y avait plus de « grand récit », que la modernité était finie, que le communisme n’était plus une perspective : l’Anthropocène a permis de remettre en place un grand récit majestueux, où on sait ce qu’il va se passer. Ça plaît aussi à certains philosophes, pour qui il s’est produit quelque chose de métaphysique puisque l’humanité serait devenue un agent géologique conscient6.
« Objecter à l’agir anthropocénique », dites-vous, revient à opérer une contestation généralisée (défendre la forêt, questionner les machines, les innovations et l’industrialisme, s’opposer aux pollutions et nuisances), reprenant et prolongeant des critiques (Gorz, Illich, Ellul, etc.). Quels espaces concrets de luttes trouver sans se retrouver dans une marginalisation totale, dont le système s’accommode très bien ?
« Quand un moteur dégueulasse vous pétarade des fumées noires à la figure, il n’y a pas besoin de changer nos cosmologies pour comprendre que ça pose un problème. »
Personnellement je tiens au contraire à sortir de la gloriole qu’on donne à quelques intellectuels critiques des années 1950-1970. En tant qu’historien, ce qui me frappe c’est l’extraordinaire banalité de la critique des techniques et surtout des plus dégueulasses. Je prends un exemple essentiel : la voiture. Au début, tout le monde s’en plaint, tout le monde râle contre la voiture, c’est une nuisance pour 99 % de la population et un luxe pour 1 %7. Les enfants se font écraser en masse et dans les années 1920, on érige même des monuments aux morts en leur honneur. Il y a des défilés immenses contre les voitures en ville. Donc ce ne sont pas du tout des petits groupes marginaux, romantico-écologiques, qui mènent ces combats. Face aux technologies les plus importantes de l’Anthropocène — celles qui nous ont vraiment fait basculer — l’opposition était générale tant elles transformaient les modes de vie, les environnements. Sur l’automobile, c’est typiquement le genre de chantier écologique où on pourrait imaginer un front politique très large : il n’y a aucune raison qu’elle soit cantonnée à quelques groupes sociaux. Je préfère insister là dessus que mettre en avant quelques intellectuels qui auraient soi-disant tout compris avant tout le monde. Après, on peut trouver quelques arguments intéressants, chez Illich et Gorz, sur la contre-productivité de certaines technologies et ça doit encore fertiliser nos imaginaires. Il y a plein de technologies qui s’imposent et qui sont contre-productives — pensons à la voiture électrique, en terme de pollution, d’efficacité énergétique. Mais désintellectualiser la critique est fondamental pour avancer.
Il faut aussi faire justice de la décence environnementale commune, pour détourner l’expression d’Orwell. Dans l’affaire des émissions du CO2, on peut imaginer qu’on aurait besoin d’un nouvel objet intellectuel qui serait Gaïa, qui réagirait à nos actions, etc. On peut aussi se dire : n’est-ce pas bizarre d’aller prendre de la matière qui a été putréfiée pendant des millions d’années et d’aller cramer ça au milieu de tout un chacun ? Du XVIIe au XIXe siècle, il paraissait évident que c’était dangereux ! Les Français accusaient même le charbon d’avoir rendu les Anglais hargneux ! Il y a une sensibilité quasiment hygiéniste qu’il faudrait remettre au goût du jour : quand un moteur dégueulasse vous pétarade des fumées noires à la figure, il n’y a pas besoin de changer nos cosmologies pour comprendre que ça pose un problème. On nous a appris à nous méfier des microbes, à avoir peur de la saleté — au XIXe siècle, c’est ce que les institutions ont réussi à faire. Réactiver des bons schèmes hygiénistes séparant le propre du sale, le sain du malsain, c’est le genre d’opération qu’il faut réaliser. Le mouvement anti-extractiviste est aussi un lieu clé : l’important est de ne pas sortir le carbone du sol. Les luttes anti-extractivistes, qui sont d’ailleurs anciennes, sont peut-être la chose la plus importante pour le climat. Au Nigeria, le delta du Niger a complètement été saccagé par l’industrie pétrolière, par Exxon, allié au gouvernement fédéral en particulier. Il y a un mouvement ogoniste, le MEND, qui a réussi à faire reculer les pétroliers : la production a baissé d’un tiers dans les années 2000. Mais c’est une quasi guerre civile, avec des violences et des morts des deux côtés. Après, dans un pays comme l’Arabie saoudite, je ne vois pas trop la lutte anti-extractiviste réussir à s’imposer… Mais en termes simplement logiques, c’est ça qu’il faudrait faire.
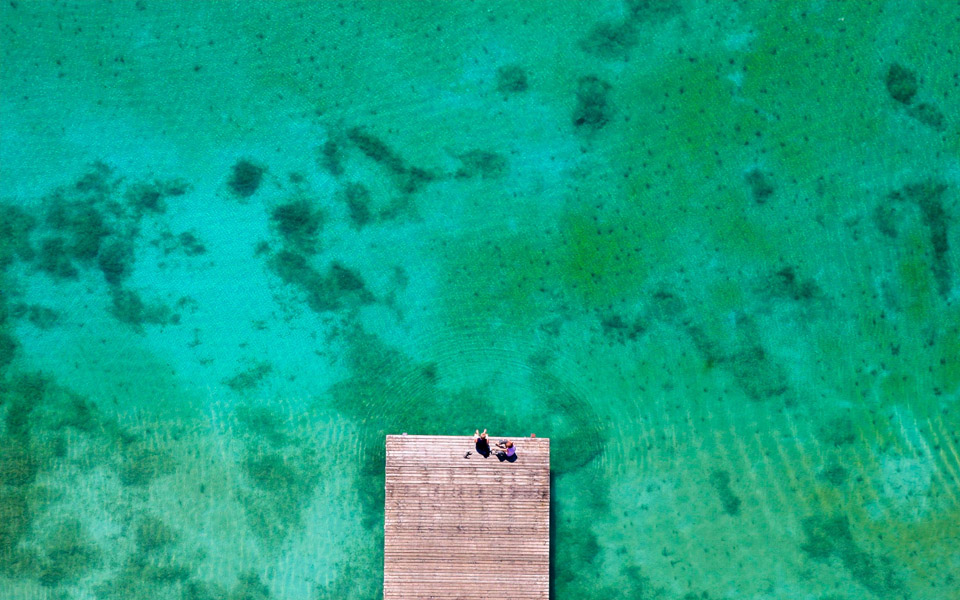
[Klaus Leidorf | www.leidorf.de]
Que pensez-vous des pistes avancées par l’ingénieur Philippe Bihouix, qui propose d’utiliser des low-tech, des « basses technologies » très durables, facilement recyclables, cherchant moins la puissance et la performance que l’efficacité énergétique et la sobriété ?
Le livre de Bihouix — et l’idée de low-tech — est très intéressant car il nous sort du discours convenu de l’innovation verte. Le problème est qu’il développe son argumentation dans la perspective du pic. Il transpose la perspective du pic du pétrole au pic des métaux rares et des terres rares (nécessaires à la production d’énergies renouvelables). Le problème est qu’il est probable qu’on ait le même phénomène sur les terres rares que sur le pétrole. À partir du moment où ça se mettra à coûter cher, on rouvrira des mines, on prospectera, on creusera plus profond, on investira, etc. La question du manque d’énergie a pris une place démesurée alors que celle du changement climatique va se poser bien avant. Il faut laisser les trois quarts des réserves de charbon, de pétrole et de gaz économiquement exploitable pour ne pas dépasser +2°C en 2100. Dire que c’est la nature qui se mettrait à nous imposer des limites, c’est risquer de dépolitiser la question. Il faut qu’on arrive à s’imposer nous même des limites. Le plus déprimant est que le capitalisme extractiviste se porte bien, il peut continuer encore longtemps comme ça, il peut bousiller la planète bien avant de manquer de carburant. La question des limites c’est plutôt des frontières molles qu’on enfonce largement, sans se rendre compte que sur plein de domaines on a déjà passé « des limites » et qu’on continue sur notre lancée, en recevant les effets retours bien plus tard, et de manière différenciée. C’est aussi tout le thème de la collapsologie et d’une certaine décroissance, héritée du choc du pic du pétrole et du Club de Rome. C’est un peu une écologie de « riches », pas forcément au sens négatif du terme ; ce sont les pays riches qui angoissent à l’idée de leur effondrement énergétique. Le pic de certains métaux rares qui empêchera les voitures électriques de rouler, pour un paysan du Bengladesh menacé par la montée des eaux, ce n’est pas très grave. Il ne faut pas faire des querelles de chapelles avec des alliés objectifs, c’est évident, mais c’est important d’avoir une écologie politique qui ne se fonde pas sur des bases fragiles.
Photographie de bannière : Klaus Leidorf
- Bien raconté par Paul Edwards dans A Vast Machine.[↩]
- Voir le livre de Pierre Serna, L’Animal en République sur les réflexions révolutionnaires sur les animaux.[↩]
- Comme le fait Timothy Mitchell.[↩]
- « Anthropocène : mais qu’est-ce que c’est ? », Catherine Larrère, AOC, 10 avril 2018.[↩]
- « Nous jouissons à voir des choses que, bien loin de les occasionner, nous voudrions sincèrement empêcher… Je ne pense pas qu’il existe un homme assez scélérat pour désirer [que Londres] fût renversée par un tremblement de terre… Mais supposons ce funeste accident arrivé, quelle foule accourrait de toute part pour contempler ses ruines. » E. Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, Paris, Pichon, 1803 (1757), p. 85.[↩]
- C’est exactement la même esthétique que la dernière scène de 2001, Odyssée de l’espace, où on voit un embryon voguant dans l’espace orbital contemplant la Terre.[↩]
- C’est ce que raconte très bien Peter Norton dans le cas des villes américaines, voir Fighting traffic, MIT Press, 2008[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Vidalou : « La nature est un concept qui a fait faillite », février 2018
☰ Lire notre entretien avec Michaël Ferrier : « Fukushima, c’est une situation de guerre », octobre 2017
☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale », avril 2017
☰ Lire notre entretien avec Vincent Liegey : « Avoir raison tout seul, c’est avoir tort », avril 2016
☰ Lire notre entretien avec Razmig Keucheyan : « C’est à partir du sens commun qu’on fait de la politique », février 2016

