Entretien inédit pour le site de Ballast
Le Danemark, premier exportateur mondial de peaux de vison, vient d’annoncer que la totalité des visons de ses élevages vont être abattus. Soit 15 à 17 millions de vies. En cause : une mutation du Covid-19 — lequel, à l’origine, a probablement transité via un marché faisant commerce d’animaux — observée dans ces lieux entièrement liés à la production de fourrure. Le titre du dernier livre de Jean-Marc Gancille, Carnage, ne saurait mieux résonner. Son sous-titre, Pour en finir avec l’anthropocentrisme, est une invitation à la lutte : tant que les sociétés humaines continueront d’exploiter les animaux, et avec quelle violence quotidienne, rien ne pourra fondamentalement changer. Et parce que la cause animale est également « la cause de l’humanité », estime l’auteur, le militant écologiste qu’il est invite le mouvement animaliste à s’engager d’un même élan contre le système capitaliste mondialisé.

La diabolisation de l’antispécisme est proportionnelle à sa popularité croissante dans l’opinion. En ce sens, c’est un marqueur important qui confirme que ce mouvement est pris au sérieux dans sa capacité à constituer une menace pour l’ordre établi, à être un contre-pouvoir potentiellement puissant au modèle de marchandisation intensive du vivant, qui dénie aux animaux leur simple droit à l’existence. Que le pouvoir mette la gendarmerie au service de l’agro-industrie est révélateur tant de l’idéologie dominante que des intérêts particuliers bien compris. Cela confirme qu’aucune alternative au modèle productiviste, qui épuise les sols et les écosystèmes, qui asservit et massacre les animaux par milliards, ne saurait être tolérée. La criminalisation des antispécistes en est la conséquence logique. Comme toujours se confirme l’adage selon lequel la légalité est une affaire de pouvoir, pas de justice — laquelle suppose nécessairement un combat, un rapport de force. Celui-ci est clairement enclenché.
Vous rappelez, chiffres à l’appui, l’ampleur du carnage quotidien : élevage, expérimentation scientifique, chasse, pêche… Sur le même mode, on ne cesse d’égrainer les drames liés au dérèglement climatique, et rien ne bouge massivement : auriez-vous, là, davantage confiance en la vertu des faits ?
« Que le pouvoir mette la gendarmerie au service de l’agro-industrie est révélateur tant de l’idéologie dominante que des intérêts particuliers bien compris. »
La lutte contre le dérèglement climatique et celle contre l’exploitation des animaux dénoncent une même matrice systémique de domination. En retour, elles se heurtent aux mêmes puissances conservatrices et aux mêmes déterminants culturels, institutionnels, économiques, qui forment une considérable résistance au changement. Le système spéciste dans lequel nous évoluons s’organise en effet depuis des lustres pour invisibiliser la cruauté indescriptible envers les animaux et légitimer les comportements qui en découlent. Cette violence est institutionnalisée au travers de lois qui légalisent l’exploitation et la souffrance animale, et organisent l’impunité de ceux qui la pratiquent. Cette violence est même financée par des subventions publiques pour quasiment toutes les filières d’élevage, aides sans lesquelles leur modèle économique ne serait pas viable. Mais, surtout, l’asservissement d’êtres vivants sensibles est rendu acceptable par la sédimentation de toute une série de représentations culturelles qui le prétendent nécessaire, naturel, voire juste. C’est une norme sociale intégrée depuis le plus jeune âge. Il est impensable de sortir du spécisme sans déconstruire ce conditionnement culturel. Et pour ce faire, le recours aux connaissances scientifiques, l’appel au raisonnement critique et la mise en visibilité de la réalité des faits s’avèrent indispensables. Si l’exigence est la même en matière de dérèglement climatique, le fait que la menace apparaisse encore comme distante, diffuse et impalpable favorise la controverse sur la réalité des faits, ouvre la porte à tous les relativismes et génère un recours massif à la substitution causale : chacun se dédouane sur l’autre de sa propre responsabilité… Mais sur la question animale, en revanche, pour peu qu’on parvienne à les rendre visibles, les faits sont généralement accablants et à très forte charge émotionnelle. La puissance des images les rend objectivement injustifiables et suscite l’indignation. C’est un avantage considérable que les animalistes ne se privent pas de saisir. Quiconque éprouve un minimum de compassion peut constater — ne serait-ce que dans son assiette — sa part inaliénable de cruauté. Ça fait une différence notable. « On peut tout fuir, sauf sa conscience », disait à juste titre Stefan Zweig.
Vous assurez que « l’homme est bien un primate parmi d’autres » et, dans le même temps, que le refus de la consommation d’animaux est un « choix politique délibéré ». Faut-il réinscrire l’humain-roi dans le règne animal ou insister sur sa singularité — être un agent moral — pour travailler à la fin de l’anthropocentrisme ?
Un primate parmi d’autres ne signifie pas un primate comme les autres. Admettre notre appartenance biologique au règne animal permet de comprendre nos similitudes mais n’interdit pas non plus de reconnaître nos spécificités. L’humain dispose d’une capacité probablement unique à analyser ses propres actes, à développer une conscience et une réflexion sur lui-même, à en rechercher le sens et la vérité. Ces questions existentielles peuvent le conduire à devenir ce qu’il choisit d’être en vertu de considérations morales, éthiques, philosophiques. En ce sens nous sommes des agents moraux et nos actions peuvent être évaluées en termes de bien et de mal. Lorsque nous avons une relation avec un animal, nous avons à son égard une responsabilité sur la manière dont nous le traitons, qui peut être caractérisée comme bonne ou mauvaise. En vertu de ces principes de l’éthique, notre dignité ne peut plus se concevoir indépendamment du sort que nous réservons à ceux qui sont totalement à notre merci. L’exercice d’une véritable humanité suppose de sortir de cet anthropocentrisme séculaire qui, en les considérant comme inférieurs, inflige aux animaux une souffrance permanente et injustifiée. Cette issue s’imposera d’autant plus que l’exploitation des animaux n’est plus vitale à une immense majorité d’humains et qu’elle contribue massivement à dévaster les conditions d’habitabilité de cette planète.
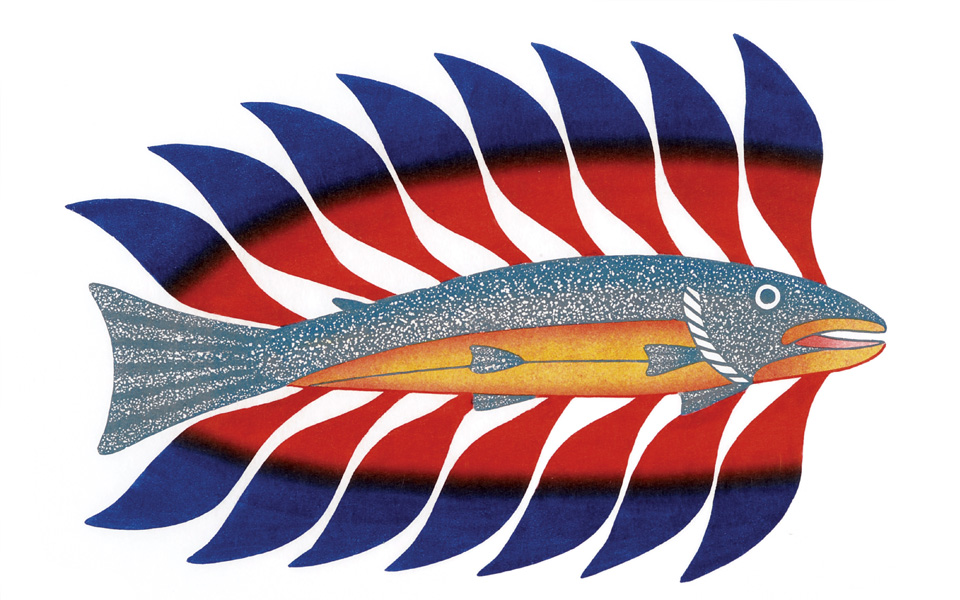
[Kenojuak Ashevak]
Vous parlez de « responsabilité » — et vous écrivez d’ailleurs : « Nous sommes responsables de la nature et des êtres vivants ». En quoi cette proposition n’est-elle pas anthropocentrique ?
Sortie de son contexte, cette phrase peut effectivement prêter à confusion ! J’ai voulu signifier que notre responsabilité est engagée dans notre rapport systématiquement utilitariste au vivant qui découle de cette vision anthropocentrique. La nature n’est pas un garde-manger à notre disposition, pas plus que les animaux (voire la flore) des stocks de ressources à exploiter comme de vulgaires objets inertes. Les autres êtres vivants non-humains ont une valeur intrinsèque indépendamment des « services » qu’ils nous rendent. En disposer comme bon nous semble, en niant leurs intérêts propres, leur porte non seulement gravement préjudice mais contribue également à fragiliser cette toile du vivant dont nous sommes un maillon totalement interdépendant. Comme le disait parfaitement Romain Gary : « Dans un monde où il n’y a de la place que pour l’Homme, il n’y a plus de place, même pour l’Homme. »
Vous décrivez la cause animale comme un « mouvement de justice sociale ». Pourtant, de part et d’autre, d’aucuns ne l’entendent pas ainsi : des animalistes voient d’un bon œil l’appui de grands capitalistes et des partisans de l’émancipation voient la question animale comme secondaire, sinon ridicule. Comment renforcer l’idée que l’émancipation des humains est indissociable de la libération des animaux ?
« La sixième extinction de masse et l’augmentation des inégalités sociales sont liées à une histoire de domination qui se perpétue sur les peuples, les animaux et les plantes. Et qui atteint aujourd’hui son paroxysme avec le capitalisme mondialisé. »
Il est vrai que certains militants des droits des animaux ne subordonnent pas la libération animale à un profond changement de modèle économique et social. De la même façon que certains écologistes militent pour la croissance verte ou pour un Green New Deal qui fait la part belle aux logiques industrielles. Sans doute les uns et les autres n’ont-ils pas pris conscience que les risques d’effondrement de notre société, que cette sixième extinction de masse et que l’augmentation des inégalités sociales sont toutes intimement liées à une longue histoire de domination et de prédation qui se perpétue depuis des siècles sur les peuples, les animaux et les plantes. Et qui atteint aujourd’hui son paroxysme avec le capitalisme mondialisé. Les racines de l’oppression qui s’exerce sur les animaux humains et les animaux non-humains sont les mêmes. La soumission de classes, les discriminations liées à la couleur de peau, au genre ou à l’appartenance à une espèce participent du même système de domination qui ne profite qu’à une minorité en assurant le contrôle de tous les autres et en ravageant la Terre. C’est la raison pour laquelle ce combat ne peut-être que radical (au sens où il s’attaque aux racines mêmes d’une logique systémique) et politique (pour définir une autre matrice culturelle, institutionnelle et économique rendant possible l’émancipation de tous, animaux compris).
Ce qu’il faut viser, écrivez-vous, c’est l’interdiction d’attenter à la vie des animaux. Mais face à l’énormité de la tâche, quels leviers mobiliser : l’éducation, les propositions de loi, l’action directe ?
Tout cela à la fois. Il faut faire feu de tout bois et compter ici aussi sur une diversité des tactiques, de la plus pacifique à la plus agressive. L’enjeu, comme toujours, est de lacérer cette chape culturelle, ce voile d’invisibilité, qui « tient le système » et parvenir progressivement à délégitimer les lois, les activités, les pratiques, les comportements qui se fondent sur l’exploitation animale et la font perdurer. Chacun n’étant pas sensible aux mêmes stimuli, autant multiplier les méthodes pour maximiser les chances de susciter la réflexion et d’enclencher l’action.

[Kenojuak Ashevak]
Les médias aiment à parler de la « violence » de certains militants animalistes — violence plus que minime, en réalité, surtout lorsqu’on la compare à celle que subissent chaque jour les animaux. Quelle position portez-vous ?
Effectivement, il est totalement disproportionné de parler de « violence » pour un bris de vitrine lorsqu’on y exhibe chaque jour des quantités phénoménales d’animaux morts « pour le plaisir », alors qu’on sait pertinemment aujourd’hui que leur chair ne nous est plus indispensable. Il n’est pas illégitime que cette violence indescriptible du système spéciste — 140 milliards d’animaux sont élevés chaque année dans le monde pour être abattus — suscite une contre-violence, qui reste d’ailleurs à ce stade purement symbolique. Je comprends bien que ces formes d’activisme choquent ceux qui ne voient même plus l’ignominie de ce qu’ils cautionnent à force de propagande, d’habitudes et de traditions. Certains animalistes dénoncent d’ailleurs ces agissements militants car ils les considèrent contre-productifs à la cause. Personnellement, je pense que c’est une façon indispensable de rendre visible la banalité du mal qui s’exerce tout au long de la chaîne, y compris chez l’artisan-boucher qui en est un maillon et a sa part de responsabilité. Rappelons une nouvelle fois que ces actions directes n’attentent à la vie de personne, contrairement aux actes qu’elles dénoncent.
Dans un entretien, vous parlez de « créer des réserves intégrales ». Une manière concrète et rapide de « réensauvager » le monde, pour reprendre votre terme ?
« Les animaux sauvages n’ont pas besoin des hommes ; rendons-leur de quoi vivre en paix loin de nos turpitudes. »
Indiscutablement, c’est une piste d’avenir qui ne fait plus débat dans la communauté scientifique. Le naturaliste mondialement réputé qu’est Edward O. Wilson, père de la notion de biodiversité, en a fait son cheval de bataille en appelant au réensauvagement de 50 % de la planète pour assurer à long terme une conservation de la nature et le maintien des fonctionnalités écosystémiques indispensables à tous ses habitants. Les espaces sauvages ne représentent plus que 23 % de la surface terrestre (hors Antarctique), contre 85 % il y a un siècle. En cause, la démographie humaine, l’étalement urbain, les infrastructures, la déforestation, l’exploitation agricole… Il est urgent de sanctuariser de vastes zones où les animaux sauvages restants (ils ne représentent plus que 4 % des mammifères pour ce qui est des animaux terrestres) puissent être protégés de l’expansion humaine et de la destruction écologique. Seules les réserves biologiques intégrales des parcs nationaux ou leurs équivalents privés, qui éliminent toutes les activités dérangeantes comme la chasse, l’exploitation forestière et l’agriculture, permettent aux animaux de revenir et de se développer en harmonie avec leur milieu. Ces espaces représentent aujourd’hui moins de 0,2 % de la surface forestière française.
Comment une telle sanctuarisation des terres pourrait-elle se faire sans déplacer des populations humaines ancrées sur ces territoires, vivant de ses ressources ? Ne risque-t-on pas de rejouer la négation des populations amérindiennes par les environnementalistes étasuniens à la fin du XIXe siècle ?
Il n’est évidemment pas question de traiter une injustice en en provoquant une autre, mais de tout faire pour garantir les conditions d’habitabilité de cette planète pour tous ceux qui y vivent. C’est un impératif vital. Et cet enjeu passe nécessairement par un partage plus équitable des espaces aujourd’hui accaparés par l’élevage et son corollaire : la monoculture intensive destinée au bétail, principale source de déforestation et de destruction des habitats. Cette ambition n’exclut pas les peuples autochtones, bien au contraire. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) reconnaît leur rôle essentiel pour protéger les terres et encourage les États à les considérer pleinement dans leurs stratégies de conservation. Mais cette question demeure anthropocentrée. À partir du moment où on exerce une considération égale pour les besoins essentiels des animaux non-humains et humains, ces derniers — quand bien même certains se sont avérés un peu moins cruels vis-à-vis des animaux — ne peuvent incessamment revendiquer des droits prioritaires sur l’usage des terres. Les animaux sauvages n’ont pas besoin des hommes ; rendons-leur de quoi vivre en paix loin de nos turpitudes. Une certaine façon d’honorer notre dette à leur égard. Il est plus que temps.

[Kenojuak Ashevak]
Dans son ouvrage L’Invention du colonialisme vert, l’historien Guillaume Blanc reproche justement aux organisations comme l’UICN, l’Unesco et WWF de perpétuer l’idée d’un « Éden » africain qui n’a en réalité « jamais existé », et, au nom de l’idée de « conservation de la nature », d’avoir déplacé au moins un million d’Africains…
Guillaume Blanc a le mérite de relever les dérives de certains acteurs de la conservation qui ouvrent des boulevards à la financiarisation de la nature, qui est un risque majeur. Mais il fait aussi nombre d’amalgames fâcheux avec une vision assez datée de ce qu’est la conservation, en mettant toutes les organisations et démarches « dans le même sac » pour appuyer son argumentaire à charge. Plus embarrassant, surtout à mes yeux, il nourrit un mythe tenace (y compris dans le milieu de la conservation !) : celui d’une cohabitation harmonieuse possible entre éleveurs et faune sauvage. Cela n’a jamais existé et cela n’existera jamais, a fortiori dans un monde de presque 8 milliards d’humains. Il faut avoir la franchise d’admettre que les intérêts des humains et ceux des animaux, sauvages ou domestiques, sont antagonistes. L’élevage, quand bien même est-il géré à petite échelle et par des peuples autochtones, n’est jamais développé dans un quelconque souci du bien-être animal : il vise son exploitation. De même qu’il ne préserve pas des espaces ou des écosystèmes mais les appauvrit. Avec son plaidoyer important à l’endroit des peuples opprimés par le capitalisme, je crains que l’argumentaire de Guillaume Blanc ne contribue finalement à alimenter la bonne conscience de ceux pour qui les droits humains vaudront toujours davantage que ceux des animaux non-humains. Perpétuant ainsi une injustice fondamentale.
Vous abordez dans votre livre les conflits profonds qui existent justement entre certaines franges des écologistes et des animalistes. De quelle façon peut-on travailler à la « réconciliation » que vous appelez de vos vœux ?
C’est un sujet important et je ne suis pas certain d’y contribuer moi-même positivement tant certains écologistes m’exaspèrent lorsqu’ils brandissent leurs oxymores d’élevage éthique ou de pêche durable, lorsqu’ils refusent d’admettre qu’une agriculture sans exploitation animale est possible ou encore lorsqu’ils se focalisent excessivement sur le climat, quitte à utiliser les animaux comme de simples variables d’ajustement de stratégies niant totalement leur droit à vivre indépendamment de nos besoins. J’ai, il faut le dire aussi, beaucoup de mal à comprendre la tendance RWAS1 chez les animalistes. En théorie, il faudrait qu’il y ait des concessions de part et d’autre sur les sujets les plus clivants, quitte à les aborder plus tard, lorsque les combats essentiels sur lesquels on peut se rassembler auront été gagnés. Une alliance entre écologistes et animalistes est objectivement envisageable pour lutter contre l’agro-industrie, la pêche industrielle ou le business de la captivité qui portent la plus grande part de responsabilité dans le carnage actuel. Mais dans les formations politiques ou les ONG écologistes classiques, l’animalisme est marginalisé. Alors que dans les courants antispécistes, l’écologie n’est clairement pas une priorité. C’est la raison pour laquelle je m’intéresse à des mouvements nouveaux comme la REV (Révolution écologique pour le vivant), dont la plateforme idéologique est une synthèse intéressante. Tant qu’on n’aura pas compris qu’écologie et antispécisme se renforcent mutuellement bien davantage qu’ils ne s’opposent, voire qu’ils sont absolument indissociables, on ne constituera pas une force véritablement motrice pour sortir de l’anthropocentrisme.
Illustration de bannière : Kenojuak Ashevak
- Reducing Wild-Animal Suffering. Ce courant de pensée suscite de nombreuses polémiques au sein du mouvement animaliste : il aspire à réduire la souffrance au sein du monde sauvage, c’est-à-dire à améliorer les conditions de vie des animaux non domestiqués. Ce courant promeut dès lors l’intervention humaine (« faire la police dans la nature », peut ainsi écrire Tyler Cowen) sous diverses formes : protection ou soin (en cas de feux de forêts ou de maladies, par exemple), assistance aux proies, réduction de certaines espèces, modification génétique, voire mise à mort des prédateurs. Pour mieux saisir les enjeux de ce débat, on lira, par exemple, le livret d’Estiva Reus intitulé Éliminer les animaux pour leur bien : promenade chez les réducteurs de la souffrance dans la nature (2018) et la réponse produite par la revue L’Amorce [ndlr].[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Jérôme Segal : « Qui sont les animaux ? », avril 2020
☰ Lire notre entretien avec Dalila Awada : « Si la justice exclut les animaux, elle demeure partielle », décembre 2019
☰ Lire notre entretien avec Pierre Rigaux : « Gagner contre la chasse », septembre 2019
☰ Lire notre article « Féminisme et cause animale », Christiane Bailey et Axelle Playoust-Braure, janvier 2019
☰ Lire notre entretien avec Sue Donaldson et Will Kymlicka : « Zoopolis — Penser une société sans exploitation animale », octobre 2018
☰ Lire notre entretien avec 269 Libération animale : « L’antispécisme et le socialisme sont liés », décembre 2017


