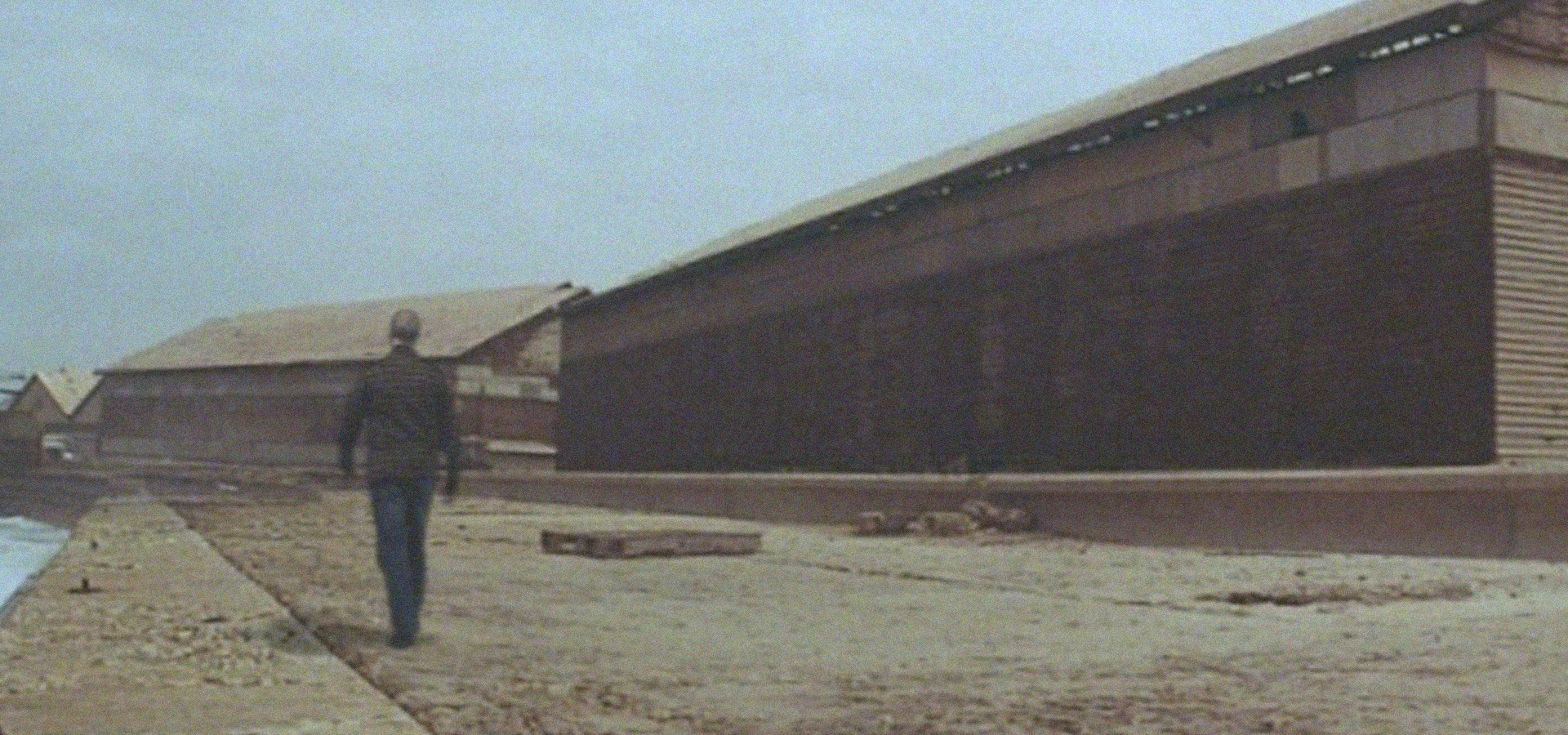Entretien inédit pour le site de Ballast
Nous retrouvons Kamal Aljafari en terrasse d’un café. Il est actuellement membre du jury du festival Palestine Cinema Days, qui se tient entre Bethléem, Jérusalem, Gaza, Naplouse et Ramallah jusqu’au 23 octobre 2018. Sa démarche cinématographique, inspirée de la Nouvelle Vague, déroute : ses images ne sont pas vraiment les siennes. Le Palestinien de 46 ans, auteur de sept films, les dérobe à d’autres films — israéliens, le plus souvent — pour mieux les détourner, les resignifier.

Il m’est très difficile de faire un lien entre mon cinéma et cette expérience de la prison. J’ai commencé à m’intéresser au cinéma trois ans plus tard. Mais ce qu’on apprend en prison, c’est attendre. D’une certaine manière, on vit en dehors de ses pensées. Après quelques mois, il devient de plus en plus compliqué d’imaginer le monde extérieur, de se le représenter : c’est vraiment fou. Le monde devient clos, il ne se résume qu’à la prison. On commence même à éprouver des sentiments pour les hommes car on ne voit plus de femmes, on ne sait plus vraiment que les femmes existent ! Mais ce n’est pas quelque chose que j’ai expérimenté cinématographiquement, même si j’y pense souvent. J’aimerais en faire un film.
La chaîne allemande ZDF n’a pas voulu programmer votre film The Roof : il était trop expérimental, à ses yeux, pour constituer un témoignage du conflit israélo-palestinien. Tout « bon » film sur la Palestine devrait donc être un témoignage de la destruction ?
« Ce qu’on apprend en prison, c’est attendre. D’une certaine manière, on vit en dehors de ses pensées. »
Voilà pourquoi je refuse le concept de « documentaire ». Ce dernier a vraiment changé depuis le jour où la télévision s’en est mêlée. Il y a une incompréhension sur ce que le documentaire devrait être : on ne cherche pas à être un artiste. On peut faire un film sur la Palestine tant qu’on ne prétend pas être un artiste. Voilà le cliché ! Le représentant de ZDF me considérait comme quelqu’un qui avait accès à un lieu, mais il ne voulait pas que je fasse autre chose qu’aller sur le terrain… Je suis réalisateur, je m’intéresse au cinéma ! Ça a été ma première et dernière expérience avec la télévision. En refusant la télévision, je suis complètement libre de réaliser comme je le souhaite. Les gens qui s’intéressent à mes films s’intéressent à mon travail en général, à ma signature. Voilà un petit rêve de réalisateur : revenir à la Nouvelle Vague. Il existe aujourd’hui une industrie du cinéma florissante qui impose des règles qui nous empêchent d’être totalement libres dans nos créations. C’est un peu ma bataille, aujourd’hui : comment créer sans contraintes tout en ayant accès au public, tout en pouvant montrer ses films ? Les spectateurs sont contrôlés par les médias, le cinéma, etc. On peut, de nos jours, voir des films qui n’ont pas été distribués car ils ne sont pas dans les normes — comme les miens. Je ne suis pas en train de cracher sur le cinéma ; je l’adore, j’y vais souvent. Mais le fait est que nous pouvons faire beaucoup plus grâce à la liberté dont nous disposons et aux nombreuses alternatives qui s’offrent à nous.
Vous voyez un film comme « un pays à créer ». Qu’entendez-vous par là ?
Il s’agit de revenir aux origines du cinéma. Capturer quelque chose et le garder pour la vie. C’est très important, surtout quand on sait que les lieux changent constamment d’apparence, sont détruits, reconstruits, etc. Le cinéma permet de garder en vie les lieux et les gens qui s’y trouvent. Il ne s’agit pas seulement de capturer ce qui existe mais de construire, de créer un nouveau pays, un pays que nous n’avons pas aujourd’hui. Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons construire à loisir ! Avec Recollection, c’est ce que j’ai fait : j’ai pris des images d’un film qui existait déjà pour construire un nouvel espace, une nouvelle ville, de sorte que chacun puisse y évoluer — un lieu qui n’existe pas physiquement mais seulement par l’image et à travers elle. On peut se servir de ces images pour avancer dans un projet et créer encore plus de lieux : une Jaffa [ville située au sud de Tel-Aviv, ndlr] future, par exemple, ou n’importe quelle autre ville, n’importe quel pays… qui peuvent être construits à nouveau ! On peut habiter le cinéma et y rester éternellement. Ce travail me permet de donner un véritable sens à la Palestine. Mes films ne sont pas uniquement motivés par des choix esthétiques. C’est une nécessité de travailler sur le monde qui m’entoure : sur la situation en Syrie par exemple, ou sur l’humanité en général. C’est nécessaire pour honorer la mémoire d’un lieu mais, surtout, pour honorer la mémoire du monde entier. Tel lieu ne représente pas seulement la Palestine, mais tous ceux qui subissent une catastrophe — quelle que soit l’ampleur des dégâts. Dans Recollection, tout le monde peut retrouver son passé, ses fantômes. Personne ne s’intéresse jamais aux personnages de second plan dans les films. Dans les fictions, on se focalise sur les têtes d’affiches, les acteurs de premier plan, mais qui va s’intéresser à l’immeuble au second plan ou aux personnes qui marchent au loin ? Qui va raconter l’histoire de ceux qui ne font que passer dans la rue ? C’est pour ça que ça fait sens, en tant que palestinien, d’être un outsider. D’être celui qui ne fait que passer. Je veux parler de celles et ceux dont personne ne raconte l’histoire.

[Extrait du film Port of Memory, 2010]
Vous n’avez réalisé que des documentaires. Pourtant, vous nous l’avez redit, vous refusez d’être considéré comme un réalisateur de documentaires. Pourquoi ?
Je n’ai jamais voulu être catégorisé. C’est très difficile de faire la part des choses entre la fiction et le documentaire. Depuis le début, je suis intéressé par le fait de faire vivre des personnages dans l’espace, de les faire bouger. Je n’ai jamais vraiment songé à ce que signifie « être un réalisateur de documentaires, ou de fiction » : j’ai toujours voulu être un réalisateur. J’avoue toutefois que je préfère regarder des fictions plutôt que des documentaires. Tout ce que j’ai pu apprendre de la manière de faire des films provient de la fiction. Mais on peut voir des films de fiction comme des documentaires ! En Palestine, le documentaire est nécessaire : si on ne capture pas une situation, elle disparaît peu à peu. Je dois évidemment accomplir cette fonction. Ça fait partie de moi. Mais je veux également rêver. Je travaille avec la réalité mais aussi avec le rêve. Une partie de moi souhaite toujours passer outre la réalité, faire un pas de côté par rapport à elle pour créer quelque chose de plus artistique. On ne peut, en somme, pas dire qu’il existe des fictions et des documentaires : il existe des sortes de fictions et des sortes de documentaires. Je ne vois pas de contradiction.
Vous êtes né à Ramla et vivez désormais à Berlin. Comment témoigner de ce qui se passe en Palestine quand on n’y vit plus ?
« En Palestine, le documentaire est nécessaire : si on ne capture pas une situation, elle disparaît peu à peu. »
C’est l’une des choses pour lesquelles je me bats. J’ai d’abord quitté mon pays pour faire des études. Je suis ensuite resté à Berlin — c’était un choix. Je me suis toujours senti outsider même dans mon propre pays. Regarder de l’extérieur m’a beaucoup nourri, m’a permis de voir les choses comme elles le sont, avec un œil neuf et objectif. Cela m’a permis de pouvoir comprendre ce avec quoi j’avais grandi mais que je n’avais pas vraiment remarqué, finalement. Je joue constamment, dans une sorte de schizophrénie, entre l’extérieur et l’intérieur : cette tension crée un imaginaire intéressant à travailler. Attention : je ne suis pas en train de dire que pour faire de bons films, il faut absolument quitter son pays ! Non ! Mais je pense qu’il y a quelque chose de spécial dans l’expérience palestinienne : il faut faire un pas de côté pour vraiment comprendre la Palestine. Un cinéaste est un observateur comme un autre, un artiste qui observe. Et cet artiste doit apprendre à s’asseoir, à prendre de la distance. Peu importe l’endroit où je vais, je collectionne les choses. Lorsqu’on a atteint un certain stade dans la collection, on se dit « Je vais créer mon propre musée, mes propres archives artistiques ».
Pourquoi, justement, ce désir de collectionner des images au lieu de les capturer vous-même sur le terrain ?
Je les crée aussi, en réalité. Je ne pense pas qu’on puisse partir de rien — qu’on collecte l’image ou qu’on la capture. Le rôle principal d’un réalisateur est de capturer la réalité dans les images. En capturant et en collectionnant, on crée toujours du neuf car la création fait partie de soi — on se crée toujours un peu soi-même quand on réalise une œuvre. Il y a une différence entre voir les choses et leur donner un sens en élaborant un agencement d’images. On exprime notre monde et nos émotions en le faisant. Quelqu’un d’autre le fera toujours différemment de nous. Même à partir d’images identiques. Cette expérience de création, si universelle, est propre à chacun, à chaque histoire. Ce n’est pas une expérience réservée aux seuls Palestiniens.
Vous manipulez les images de grandes productions américaines et israéliennes, vous faites disparaître les acteurs qui se trouvent sur ces images pour les remplacer au montage par d’autres personnes — des membres de votre famille, notamment. Est-ce une manière de dénoncer la colonisation des territoires palestiniens par Israël ?
C’est plutôt une manière d’occuper l’espace cinématographiquement — d’occuper les films des autres, et particulièrement les films des Israéliens. Je voulais faire des films avec les images des films des autres. Le fait est que ces personnes mises au second plan, ces lieux qui n’existent pas vraiment, m’attendaient depuis longtemps, attendaient que je les trouve. J’ai rencontré tellement de gens qui ont été relégués au second plan sans raison. Je veux créer un territoire cinématographique dans lequel nous pouvons exister. Je travaille ces archives, ces images, je joue avec, je zoome sur le second plan, je construis une nouvelle histoire. C’est, à mon avis, ce que le cinéma peut faire de mieux.

[Extrait du film Port of Memory, 2010]
Cette approche artistique n’est-elle pas une façon de contourner l’aspect politique ?
Cette manière de travailler est fondamentalement politique ! Dans Recollection, il n’y a aucun indice sur l’endroit où l’on se trouve. En échangeant à propos du film avec les spectateurs, ceux-ci finissent par trouver le nom du lieu, mais il faut leur donner les outils nécessaires. Pourquoi ne pas faire du cinéma comme on fait de la littérature ? Pourquoi se sent-on toujours obligé, dans le cinéma, de mettre des explications, des sous-titres et des génériques ? Qui a dit qu’on devait absolument le faire pour dire où l’on se trouve ? Dans le documentaire classique, le spectateur est pris par la main, tout lui est dévoilé, il sait tout de suite de quoi on parle et à partir de quel endroit on s’adresse à lui. Être perdu est une bonne chose ! Nous sommes perdus dans nos vies, alors pourquoi ne pas nous perdre dans les films ? C’est une expérience universelle : je suis comme vous, vous êtes comme moi. Ce que j’expérimente aujourd’hui, d’autres en ont fait l’expérience hier, que ce soit en France ou en Allemagne, au Liban, ou je ne sais où !
En collectant ces images, c’est aussi une partie de votre passé et de votre enfance que vous rassemblez. Vous dites souvent, néanmoins, que vos films ne portent ni sur le passé ni sur le présent, mais qu’ils anticipent le futur…
« On entend partout dire que certains lieux vont disparaître à cause du réchauffement climatique — et il vont disparaître. Que peut le cinéma face à ça ? »
Je pense que plus nous allons avancer dans la vie, plus nous allons vivre de catastrophes. Depuis Recollection, tant de choses ont été détruites ! Il suffit de songer au changement climatique. On entend partout dire que certains lieux vont disparaître à cause du réchauffement climatique — et il vont disparaître. Que peut le cinéma face à ça ? Imaginer ce qui se passera dans l’avenir et ce qui ne se passera pas, ce qui pourrait se passer ou non. Je ne suis pas prophète, mais j’ai envie de partager avec les spectateurs les pressentiments que j’ai en tant qu’humain. Dans le cinéma, on peut reconstruire, recréer des villes qui n’existent plus. On peut y rêver à nouveau, cauchemarder ; on peut y faire ce qu’on veut selon la façon dont on se positionne dans ce lieu construit ou reconstruit. Et si l’on veut retourner dans des lieux qui n’existent plus car nous les avons ratés, rien ne nous en empêche !
Demandez-vous des autorisations pour utiliser les images d’archives israéliennes ?
Non. Par principe, parce que c’est pour moi un acte politique, je n’ai pas à demander si j’ai le droit ou non de m’en servir. Eux n’ont jamais demandé. Je ne le leur dois rien du tout. D’ailleurs, je ne crois pas que la question du droit à l’image devrait se poser : on devrait pouvoir tout utiliser et réutiliser pour s’exprimer comme on le souhaite. Ce qu’on fait avec les images, ce qu’on veut montrer ne dépend que de nous.
Traduit de l’anglais par Mélanie Simon-Franza, pour Ballast.
Photographie de bannière : extrait du film Port of Memory
Portrait en vignette : Aleks Slota
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Mai Masri : « Sans la caméra, les faits n’existent plus », juillet 2018
☰ Lire notre entretien avec Stefano Savona : « Le cinéma ne raconte pas le quotidien », mai 2018
☰ Lire notre entretien avec Saleh Bakri : « Toute résistance meurt si elle n’est pas aussi culturelle », mai 2018
☰ Lire notre entretien avec Ken Loach, janvier 2018
☰ Lire notre entretien avec Raoul Peck : « Déconstruire pour construire », octobre 2017
☰ Lire notre entretien avec Mohammad Bakri : « Le droit en lui-même est un cri », juin 2017