Entretien inédit | Ballast
Depuis 1945, en France, une loi sur l’immigration est votée en moyenne tous les deux ans. L’année 2024 pourrait bien être celle d’une nouvelle accélération. À peine nommé ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau a annoncé la préparation d’un nouveau texte — quelques mois seulement après le précédent, largement censuré par le Conseil d’État — appelant à rendre plus compliquées encore les conditions d’accueil des exilé·es. Pendant ce temps, les frontières continuent à tuer et les morts en Méditerranée comme dans la Manche s’accumulent. Pour justifier le refus d’accueillir les personnes qui frappent à leurs portes, les États créent des catégories visant à séparer celles et ceux dont l’exil serait « justifié » des autres, dont les raisons de partir ne seraient qu’économiques. Dans cet entretien, la sociologue Karen Akoka, autrice d’un ouvrage de référence sur le sujet, revient sur l’histoire des politiques d’asile en France et leur sombre actualité.

J’étais de plus en plus mal à l’aise avec ces travaux qui disent essayer de « comprendre » les migrants et les réfugiés : pourquoi partent-ils ? quelles sont leurs motivations ? Au lieu, pour ainsi dire, de « disséquer » les individus — sachant qu’il y a deux manières de le faire, l’une académique et l’autre, qui est la pire, celle de l’institution —, j’avais envie d’inverser le regard. Mais mes recherches sont peut-être nées avant tout en réaction au travail que j’ai fait comme jeune professionnelle. J’avais moi-même travaillé dans une institution, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) qui disséquait les individus : je réalisais des entretiens avec les demandeurs et devais enquêter pour aboutir à une proposition qui établissait s’ils étaient des réfugiés ou des migrants1. J’ai voulu faire une thèse, précisément pour retourner l’acte de « dissection » sur l’institution, et essayer de voir, au fond — c’est là ma thèse principale — comment le statut de réfugié en dit beaucoup plus sur ceux qui désignent que sur ceux qui sont désignés. Je voulais donc enquêter sur ceux qui désignent, en inscrivant leur histoire, leurs trajectoires, leurs motivations économiques ou politiques dans le temps long. C’était une manière de sortir à la fois d’une sorte de fascination que peut susciter le migrant, et de l’évaluation bureaucratique froide qu’incarne l’institution, tout en continuant de parler des questions d’immigration et d’asile.
La distinction entre migrants et réfugiés serait donc, selon vous, une fausse évidence. Était-ce le point de départ de votre travail ?
Mon intention première était de questionner le fonctionnement de l’institution. Ce n’est qu’au cours de mes recherches que je suis parvenue à la déconstruire. Lorsque je travaillais au HCR, je croyais à cette distinction. C’était mon boulot, je pensais que je faisais quelque chose de juste, que j’aidais des gens. Et je croyais non seulement à la validité de ces catégories, mais aussi à une certaine hiérarchie entre elles, au fait qu’un réfugié avait un peu plus besoin d’aide, de droits, que les migrants. Lorsque j’ai commencé à travailler au HCR, en dépit du fait que j’étais jeune — comme beaucoup de gens qui travaillent dans ces institutions, c’était un de mes premiers boulots — et politiquement peu structurée, je sentais malgré tout qu’il y avait un problème, mais je n’arrivais pas à le nommer. C’est cet inconfort qui, au fond, et sans que je le sache véritablement au début, a motivé toute ma recherche. Je voulais trouver des réponses aux questions qui me dérangeaient, qui me semblaient les plus complexes, et auxquelles personne ne répondait vraiment.
« Le statut de réfugié en dit beaucoup plus sur ceux qui désignent que sur ceux qui sont désignés. »
Ce qui m’intéresse, ce ne sont donc pas les questions professionnelles classiques que beaucoup de gens se posent dans ce genre d’institutions, telles que : a‑t-on assez de moyens pour réussir à trouver la vérité, savoir si on affaire à des migrants ou à des réfugiés2 ? a‑t-on assez d’autonomie ? de formation ? C’est une question plus fondamentale et sur laquelle j’ai eu du mal à mettre des mots : quel est le sens de cette distinction et de cette hiérarchisation entre réfugiés et migrants, qui fait des premiers des étrangers plus légitimes que les seconds ? Il faut dire qu’il y a quinze ans, quand j’ai commencé mes recherches, ce n’était pas facile de questionner ces deux catégories. Régnait alors l’idée qu’il ne fallait surtout pas toucher à la catégorie de réfugié parce qu’elle permettait de sauver des gens.
Vous n’êtes pas historienne mais revendiquez une démarche sociohistorique. À quel moment de votre recherche ce détour par l’histoire vous a‑t-il paru nécessaire ?
Il m’est apparu que la manière la plus efficace de déconstruire ces catégories consistait à observer leur évolution dans le temps, de les historiciser en somme. C’est le moyen le plus sûr de prendre de la distance vis-à-vis des évidences d’aujourd’hui. C’est donc un double-mouvement qui est au point de départ de mon travail : à la fois passer par l’histoire et déplacer le regard vers l’institution.
Vous proposez ainsi une « histoire par le bas » en analysant « les propriétés sociales et les trajectoires des agents » de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Quelles transformations et quelles continuités cette attention aux agents de l’administration permet-elle de repérer ?
« Dans les années 1920, la plus grande crainte de la Société des Nations était la diffusion de la révolution bolchévique. »
Vous mettez là le doigt sur un troisième pilier de ma réflexion : l’analyse par le bas des pratiques et des profils des acteurs dans la longue durée. De la même manière qu’il est important de comprendre que la catégorie de réfugié hier et avant-hier n’avait pas le même contenu, ni la même définition, il faut voir que les agents de l’Ofpra ne font plus du tout le même travail aujourd’hui. Le métier et les pratiques ont changé. Cela permet de prendre davantage de distance vis-à-vis de cet acte d’étiquetage qu’est la détermination du statut de réfugié. Sur ce point, je m’appuie sur l’idée bourdieusienne de l’illusion de la constance du nominal3 : l’impression fausse qu’une institution demeure la même parce qu’elle conserve le même nom. Ce constat s’applique à merveille à l’Ofpra : la catégorie de réfugié d’il y a 50 ans n’a plus rien à voir avec celle d’aujourd’hui. L’institution est complètement différente de celle des années 1950–1980 : l’activité des agents n’est plus du tout la même, leur profil est complètement différent.
Pour saisir cela, il faut revenir sur le contexte de création de l’Ofpra. Avant la Convention de Genève de 1951, qui définit le réfugié par la persécution, dans l’entre-deux guerres, le réfugié ne renvoyait pas à une personne individuelle mais à des groupes nationaux. C’était la Société des Nations (SDN) qui désignait collectivement des groupes comme réfugiés. La persécution individuelle n’était alors pas du tout un critère. Il suffisait d’appartenir à l’un de ces groupes nationaux ou ethniques prédéfinis pour l’obtenir. En France, il a été accordé aux Arméniens, aux Assyro-Chaldéens, aux Géorgiens, aux Espagnols, etc. Mais le groupe emblématique, celui pour lequel a été mise en place cette catégorie de réfugié dans le droit international, c’est celui des Russes apatrides qui fuyaient la révolution bolchévique, les plus importants symboliquement et numériquement. Qu’ils aient été les premiers à se voir attribuer un tel statut n’est pas dû au hasard : dans les années 1920, la plus grande crainte de la SDN était la diffusion de la révolution bolchévique. Les désigner comme réfugiés était donc avant tout un moyen de dénoncer le communisme et de montrer la supériorité des démocraties libérales.
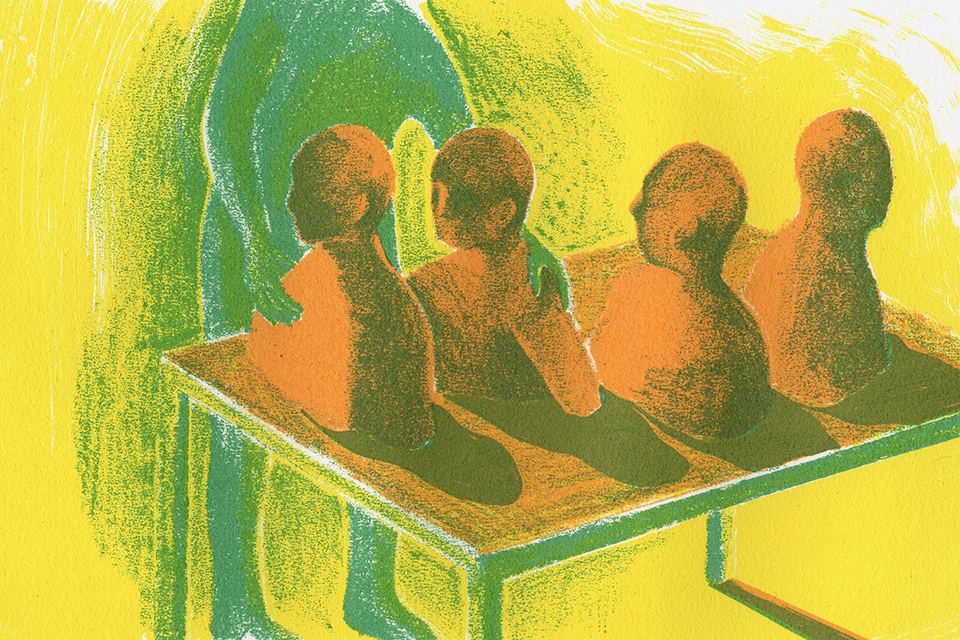
[Claire Le Gal]
Qui attribuait donc ce statut de réfugié ?
Des gens qui étaient devenus réfugiés après avoir eux-mêmes fui leur pays à la suite d’un changement de régime. Ils avaient généralement occupé des positions de pouvoir ou de représentation dans les anciens régimes de leur pays — comme de nombreux diplomates de pays de l’Est —, ou encore combattu contre le nouveau régime — je pense aux Espagnols antifranquistes. C’étaient en quelque sorte les représentants de pays ou de régimes qui n’existaient plus, pour la plupart du fait des invasions soviétiques de l’entre-deux-guerres (Géorgie, Ukraine et Arménie) ou des prises de pouvoir communistes de l’immédiat après-guerre (Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie etc.). Il s’agissait au fond de représenter en France, des régimes qui avaient été déchus. Il ne s’agissait nullement de poser des questions individuelles sur les motivations des gens. Des représentants de régimes disparus donnaient un statut à ceux qui fuyaient le nouveau pouvoir en place, qui les avait eux-mêmes fait partir.
Cela s’apparente quasiment à un système de consulats !
Oui, de consulats de régimes disparus, de pays qui n’existent plus. Mais pas de tous les régimes disparus : seulement ceux pour lesquels la France accepte qu’il y ait un statut de réfugié et une forme de représentation. En général les régimes renversés par un nouveau pouvoir qu’ils ne soutiennent pas.
Cela change-t-il avec la création de l’Ofpra ?
« Des représentants de régimes disparus donnaient un statut à ceux qui fuyaient le nouveau pouvoir en place. »
Au moment de la création de l’Ofpra en 1952, un an après la signature de la Convention de Genève, et dans les années qui suivent, on constate une certaine inertie des pratiques. Ce n’est pas parce que la définition du réfugié a changé que les pratiques changent aussi. Il est intéressant de voir que même une décision de droit international, prise au sein d’une telle institution, ne fait pas tant changer les choses. On continue avec le même personnel, les agents sont toujours d’anciens diplomates ou officiels russes, ukrainiens, polonais, etc., qui font le même travail qu’auparavant, c’est-à-dire qu’ils donnent le statut de réfugié sur la base de l’appartenance nationale des personnes qui viennent des mêmes pays qu’eux. Quand ils partent à la retraite ils sont bien souvent remplacés par la génération suivante, par des enfants de réfugiés.
Lorsque j’ai commencé mon enquête, j’ai parlé avec des agents qui avaient soit connu ou entendu parler de cette époque. Et une chose m’avait interpelée : ils me racontaient tous qu’avant eux, à l’Ofpra, parce que les agents étaient réfugiés ou enfants de réfugiés, ce n’était pas sérieux. C’était perçu comme un manque de professionnalisme. Comme si l’histoire de l’Ofpra était celle d’une institution un peu folklorique devenue sérieuse. J’ai essayé de montrer qu’il ne s’agissait pas du tout d’un manque de professionnalisation, mais que cela s’expliquait par l’intérêt politique à ce les choses fonctionnent ainsi. De même que les changements survenus par la suite, identifiés comme une « professionnalisation », sont liés à d’autres logiques, d’autres intérêts, mais tout aussi politiques.
À l’époque, un intérêt diplomatique, comme vous le dites dans votre livre.
« L’Ofpra ne fait que mettre en application la logique idéologique de la politique d’asile française. »
Oui. Durant les années 1950–1970, l’Ofpra est constitué de plusieurs sections géographiques (russe, géorgienne, tchécoslovaque, espagnole, etc.) et on trouve deux grands cas de figure. À toutes les personnes qui fuient des pays sous domination soviétique, tous les pays de l’Est à l’exclusion la Yougoslavie, parce qu’elle est en rupture avec Staline et entretient des bons rapports diplomatiques avec la France, le statut de réfugié est accordé quasiment automatiquement, suivant en cela la logique d’avant 1951. A l’époque, dans un pays au gouvernement anticommuniste, il y a un intérêt politique et idéologique fort à donner le statut de réfugié à des gens qui fuient les pays sous domination soviétique (comme plus tard, à ceux qui quitteront le Laos, le Cambodge ou le Vietnam). L’Ofpra ne fait que mettre en application la logique idéologique de la politique d’asile française.
Les choses sont en revanche beaucoup plus compliquées pour ceux — moins nombreux — à qui la France n’a pas intérêt à donner ce statut de réfugié, parce qu’ils fuient des pays avec lesquels elle entretient de bonnes relations diplomatiques : l’Espagne, le Portugal, la Grèce et la Yougoslavie. Dans les archives du conseil d’administration de l’Ofpra, dans lequel interviennent plusieurs ministères dont celui des Affaires étrangères, on trouve souvent évoqué le fait que donner le statut de réfugiés à des ressortissants de pays amis de la France pourrait créer des problèmes diplomatiques. En revanche, étant donné qu’à cette époque-là il est facile, surtout pour ces nationalités, d’être régularisé par les procédures d’immigration, il n’y a pas besoin de les rejeter frontalement, en les désignant comme « faux » réfugiés, comme on le fait aujourd’hui. On ne les rejette pas, on les détourne vers les procédures d’immigration au titre du travail. La régularisation par le travail est alors largement ouverte. Il est donc très facile pour les Espagnols et les Portugais, par exemple, d’obtenir des titres de séjour et de travail, même s’ils rentrent clandestinement en France. À ceux qui déposent quand même une demande l’asile, on rétorque que ce n’est pas possible… mais on les oriente vers les guichets de l’immigration. Seuls ceux qui insistent et déposent une demande d’asile se voient opposer un refus, mais cela concerne un nombre relativement restreint d’individus. À cette période, la distinction migrants/réfugiés se fait ainsi largement en amont des histoires individuelles des personnes. C’est davantage un jugement qui se fonde sur les nationalités.

[Claire Le Gal]
Il y a eu depuis un renversement. Aujourd’hui, le jugement porte sur l’histoire individuelle. C’est désormais en fouillant dans les entrailles des gens, en leur posant toute une série de questions pour comprendre leurs motivation profondes (pourquoi ils sont partis, s’ils étaient vraiment obligés ou non, si les raisons de leur départ n’étaient pas plus économiques que politiques, etc), qu’on va chercher à découvrir la « vérité » de leur état — réfugié ou migrant. C’est cette « vérité » que je j’essayais de trouver lorsque je travaillais moi-même au HCR. Et que le travail scientifique m’a permis de déconstruire.
Quand situez-vous cette transformation ?
Au tournant des années 1980. En partie parce qu’on a suspendu puis réduit l’immigration par le travail et qu’il n’est donc désormais plus possible de détourner les nationalités dont on ne veut pas comme réfugiés vers ce type de procédure. De sorte qu’on retourne le problème, voire la faute, contre ces personnes, en disant que ce sont elles qui, par leur histoire individuelle, ne correspondent pas aux critères du « réfugié ». Ce qui est nouveau par rapport aux années 1950–1970, c’est que l’idée de persécution individuelle devient centrale. Tout le monde est persuadé que la Convention de Genève en 1951 marque l’entrée dans l’ère des qualifications individuelles, or ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’on va chercher à voir de manière systématique si la personne est individuellement en danger ou persécutée. C’est là le point de bascule décisif.
« C’est en fouillant dans les entrailles des gens, en leur posant toute une série de questions pour comprendre leurs motivation profondes, qu’on va chercher à découvrir la
véritéde leur état. »
Le système en place des années 1950 jusqu’au début des années 1980, je l’ai appelé « régime des réfugiés ». Les gens sont considérés en amont et collectivement comme réfugiés, ce sont des réfugiés eux-mêmes qui s’occupent de traiter les demandes et on observe une porosité entre les catégories de « réfugié » et de « migrant ». En lisant les archives, on se perd d’ailleurs parfois parce que le terme de « réfugiés » est utilisé pour désigner les demandeurs d’asile : c’est que le mot n’existe même pas, c’est quand même quelque chose d’incroyable ! Au sein de ce régime, le poids de la politique étrangère est très fort.
À partir des années 1980, on bascule dans ce que j’appelle le « régime des demandeurs d’asile ». C’est à ce moment-là que le terme apparaît. Ce régime est principalement subordonné à la logique de réduction des flux migratoires, à la différence du « régime des réfugiés » qui était davantage subordonné aux politiques diplomatiques. Dans le cadre de ce nouveau régime, il faut désormais, pour obtenir l’asile, prouver qu’on est individuellement persécuté. Les agents ne sont plus issus des mêmes groupes nationaux, mieux, on veille à cela au nom du principe selon lequel le jugement sur le parcours individuel nécessite une certaine distanciation.
Vous montrez que tout au long des années 1980, avant que ce régime des demandeurs d’asile ne devienne la norme, les deux logiques coexistent.
Les choses ne changent pas du jour au lendemain en effet, on observe là encore une inertie des pratiques. Dans ces années-là, les gens qui fuient le Laos, le Cambodge et le Vietnam sont sélectionnés dans des camps de réfugiés en Thaïlande par l’armée et les institutions françaises, selon des critères qui n’ont rien à voir avec la convention de Genève – parlent-ils français ? ont-ils rendu des services à la France ? etc. — et acheminés en France. Chaque mois pendant presque dix ans, ce sont 1 000 personnes qui arrivent. Et on les pousse vers la demande d’asile. À l’inverse des Portugais et des Espagnols qui n’étaient pas désirables comme réfugiés pour des considérations diplomatiques, mais l’étaient comme travailleurs immigrés — parce qu’Européens, parce que considérés comme assimilables, etc —, ces populations ne sont pas désirables comme travailleurs immigrés, mais seulement comme réfugiés.
« Ces populations, parce qu’elles sont perçues comme dociles, éloignées des syndicats, apparaissent comme une main-d’œuvre idéale. »
Pourquoi accorder l’asile à autant de personnes de ces pays-là ? D’abord, encore une fois, pour décrédibiliser les régimes communistes, mais aussi parce que quelques années avant, en 1974, le gouvernement a suspendu l’immigration de travail, alors qu’il y a encore un fort besoin de main‑d’œuvre, surtout dans les usines automobiles. Et ces populations, parce qu’elles sont perçues comme dociles, éloignées des syndicats, apparaissent comme une main-d’œuvre idéale, qui permet de répondre à ce besoin et remplacer les travailleurs d’Afrique du Nord qui sont vus comme trop agités, trop politisés.
Au même moment, il y a une augmentation du nombre de demandes d’asile de ressortissants du Zaïre. Et eux vont être considérés comme indésirables, tant comme réfugiés que comme travailleurs immigrés. On leur demande de montrer qu’ils ont été individuellement persécutés, et de produire des preuves. Et le moindre soupçon de motivations économiques se retourne contre eux. Leurs demandes sont ainsi quasi systématiquement refusées. Pourquoi ? D’abord parce que les procédures d’immigration sont officiellement fermées ; aussi parce que l’ancien Zaïre est un pays francophone avec lequel la France essaie de maintenir de bonnes relations — on retrouve donc la logique typique de la Françafrique, de maintien d’une influence politique et économique après la décolonisation ; mais sans doute également parce qu’ils sont Africains, parce qu’ils sont Noirs. C’est difficile à démontrer clairement mais plusieurs indices montrent un traitement discriminatoire des demandeurs d’asile noirs africains.

[Claire Le Gal]
C’est ce que j’appelle l’asile à deux vitesses. Les Vietnamiens, les Laotiens et les Cambodgiens sont les derniers héritiers du « régime des réfugiés ». Après eux, le régime des demandeurs d’asile va s’appliquer à toutes les populations. La recherche d’une persécution individuelle, d’un archétype qui ne correspond à rien de ce qui a jamais existé — une espèce de dissident politique pur — ainsi que les demandes de preuves toujours plus difficiles à rassembler, font que les demandeurs adaptent de plus en plus leurs récits à ces exigences. Ce qui produit en retour une surenchère d’injonctions, qui à leur tour ne laissent d’autres choix aux demandeurs que de s’y conformer. C’est le cercle vicieux dans lequel on se trouve aujourd’hui.
On voit aussi, au même moment, un changement dans les profils des agents de l’Ofpra.
Il s’agit en effet de plus en plus d’agents français, qui n’ont aucune origine commune ni aucun lien avec les demandeurs d’asile. C’est assez incroyable quand on se souvient que ceux qui travaillaient à l’Ofpra dans les années 1950 étaient non seulement des réfugiés, mais n’avaient même pas la nationalité française ! On parlait en russe, en espagnol, en ukrainien, etc. On écrivait aux demandeurs d’asile dans leur langue. Dans la phase de transition des années 1980, les agents étaient français mais avaient soit des origines communes, soit des affinités politiques fortes avec les personnes dont ils s’occupaient. Par exemple, les chefs de division qui s’occupaient des demandeurs d’asile d’Amérique latine, et plus particulièrement du Chili, étaient eux-mêmes des grands militants de la cause chilienne. Aujourd’hui, des entretiens sont menés avec les agents pour s’assurer qu’ils n’ont pas d’origines communes avec les demandeurs d’asile dont ils s’occupent et correspondent à la figure du bureaucrate webérien, neutre et distancié. Et au lieu que ce soient des notables, de grandes personnalités, ce sont le plus souvent des gens très jeunes, qui sortent de l’université. Ils peuvent plus facilement croire aux mythes de l’institution, se soumettre aux injonctions et s’atteler à cette mission impossible dont j’ai déjà parlé, qui les rend par ailleurs malheureux. Le turnover est très important à l’Ofpra.
Ils étaient d’ailleurs en grève il y a quelques mois.
« Les choses sont structurellement organisées pour que les rejets soient la norme. »
Oui. Ils sont régulièrement en grève, et toujours pour la même raison : parce qu’on leur impose un nombre de dossiers à traiter quotidiennement trop important. Cette pression s’explique en partie par le fait qu’on sait que plus les gens attendent longtemps d’avoir leur statut, plus ils ont de temps pour s’insérer par d’autres moyens. Le nombre de décisions à rendre chaque jour par les agents est ainsi inscrit dans un contrat d’objectifs et de moyens — injonction très représentative de l’ère du New Public Management. Pour les pousser à « faire leur chiffre », l’Ofpra a développé un système de primes et de sanctions. Cette logique productiviste pousse à davantage de rejet car cela demande moins d’argumentation et de travail qu’un accord. Jusque dans les années 1970 c’était l’inverse : les accords étaient la norme et les rejets l’exception. J’étais ainsi tombée sur une note du directeur de l’Ofpra datant des années 1960 qui rappelait aux officiers de protection qu’il fallait demander son autorisation avant de décider un refus. Aujourd’hui, il n’y a aucun problème pour rejeter un dossier mais, pour aboutir à un accord, il faut que l’agent plaide auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Il faut qu’il effectue des recherches complémentaires, argumente à partir de critères à la fois géopolitiques et juridiques. Cela prend beaucoup de temps et d’énergie. L’injonction productiviste et l’évaluation des agents — tout comme la recherche de la persécution individuelle pour chaque demande — les poussent à faire des rejets. Les choses sont donc structurellement organisées pour que les rejets soient la norme sans qu’il ne soit besoin de mettre de quota.
Vous montrez que l’Ofpra a même été un laboratoire de ce New Public Management.
Le New Public Management, qui consiste à appliquer les méthodes du secteur privé au secteur public — injonction à la productivité, évaluation quantitative, standardisation, etc.—, vient du monde anglo-saxon. Il a commencé à se déployer dans les institutions françaises à partir des années 1990 et le mouvement s’est accéléré dans les années 2000. L’idée était qu’il fallait réformer en profondeur un État décrit comme lourd, dépensier, en crise, en introduisant des méthodes managériales « efficaces ». La recherche d’efficacité est centrale dans le New Public Management. Cela passe par un recours massif aux cabinets privés, à des audits qui préconisent toujours plus de restructurations et de contrôle. Et j’ai été étonnée de constater que l’Ofpra avait en effet été l’une des premières institutions dans lesquelles ces méthodes, qu’on voit désormais appliquées partout, ont été mises en œuvre.
Pour quelles raisons selon vous ?
« L’Ofpra a été l’une des premières institutions dans lesquelles les méthodes du New Public Management ont été mises en œuvre. »
La première à mon sens est que c’est souvent dans le traitement des étrangers que l’on teste les innovations répressives. L’instauration de la carte d’identité au début du XXe siècle en est un parfait exemple. La seconde est que l’Ofpra était une institution faible, périphérique, où travaillaient encore dans les années 1980–1990 beaucoup de vieux agents étrangers. Il faut dire aussi que la question de l’asile n’était pas encore au centre des discussions publiques. Elle constituait donc un bon laboratoire pour tester ces méthodes. D’abord, c’est à l’institution qu’on a demandé de rendre des comptes, de quantifier le nombre de dossiers traités quotidiennement. Puis la mesure de la productivité s’est progressivement individualisée : ce n’est plus l’Ofpra mais chaque agent qui a été évalué, avec des sanctions pour ceux qui n’atteignaient pas leurs objectifs et des primes pour ceux qui les remplissaient. Tout cet arsenal managérial permet aujourd’hui de faire de la politique sans avoir l’air, au sens où on peut mettre en œuvre la politique de réduction des flux migratoires sans qu’il y ait besoin de donner des orientations claires.
Le profil des agents n’a donc plus rien à voir ?
Non. Ce qu’on leur demande de faire, ce qu’ils font, et la catégorie de « réfugié » qu’ils manipulent ont profondément changé. Pourtant, on entend tout le temps et partout que ce qui a changé, c’est le profil des demandeurs d’asile. Pour certains ils étaient clairement des « vrais » réfugiés hier et sont désormais aujourd’hui plus souvent des « faux ». Pour d’autres les profils étaient plus clairs hier et sont devenus plus flous et difficile à cerner aujourd’hui. En tout cas l’idée que les profils des demandeurs d’asile a changé ne fait aujourd’hui presque plus débat. Alors que, dans les faits, ce qui a changé, c’est tout le reste.

[Claire Le Gal]
Si on regarde les archives, on constate qu’au milieu de tous les changements qu’a connus l’institution, il y a une constante : le discours sur le changement de profil des demandeurs. On a pas cessé au fil des décennies de déclarer que les profils avaient changés. Lorsque la figure idéaltypique du réfugié était le Russe devenu apatride parce qu’il avait quitté la Russie et que sont arrivés des demandeurs qui fuyaient les démocraties populaires comme la Tchécoslovaquie ou la Pologne, on les a appelés « néo-réfugiés » parce qu’ils n’avaient plus rien à voir avec les Russes et notamment n’étaient pas apatrides. Quand sont arrivés les Cambodgiens et les Vietnamiens, on a dit à nouveau que leur profil marquait une rupture avec le passé. C’était une nouvelle figure, celle de la victime pure, qui aurait remplacée celle du dissident. Quand sont arrivés les Yougoslaves dans les années 1990, on a encore dit que cela créait de nouveaux défis parce qu’ils fuyaient des guerres civiles. Je me suis amusée à répertorier cela : la constance du discours du changement de profil et l’aveuglement sur le fait que ce qui en réalité change, ce sont les critères d’attribution, l’organisation du travail et les profils des agents.
Vous dites qu’il ne peut y avoir de politique d’asile ouverte sans un contexte d’immigration ouverte.
Aujourd’hui, l’asile est devenu la caution humaniste de politiques d’immigration restrictives : le fait d’en sauver quelques-uns autorise à rejeter massivement tous les autres. Fermeté d’un côté et, de l’autre, un peu d’humanité, envers ceux qui en auraient « vraiment besoin ». Mais qu’est-ce c’est que ce « vraiment besoin » ? Que signifie des personnes qui le « mériteraient » ? La distinction réfugiés-migrants ne reflète en rien la vie des gens. Ce ne sont pas des catégories sociologiques, ce sont des catégories administratives construites pour ordonner le monde, lui donner un sens politique. Les gens ne correspondent pas à l’une ou l’autre, parce que la réalité sociale est poreuse. À mesure que l’immigration de travail a été délégitimée, l’asile s’est ennobli, le statut de réfugié a été mis sur un piédestal. C’est un piège parce que presque plus personne ne peut y accéder. Brandir l’asile comme une valeur fondamentale est, au fond, la condition même de sa fermeture. Cela devient quelque chose qui se mérite et qu’on ne donne qu’à quelques rares privilégiés.
Vous travaillez actuellement sur le statut des réfugiés en Israël, qu’en est-il des politiques d’asile ?
« La distinction réfugiés-migrants ne reflète en rien la vie des gens. Ce sont des catégories administratives construites pour ordonner le monde. »
On compte aujourd’hui environ 35 000 demandeurs d’asile. Ils sont dans la grande majorité soit érythréens, soit soudanais — deux des nationalités qui obtiennent le plus facilement le statut de réfugié dans tous les grands pays occidentaux —, et sont entrés en Israël entre les années 2005 et 2012 par le Sinaï, la frontière avec l’Égypte. Depuis 2012 et l’achèvement de la construction d’une barrière entre les deux pays, pratiquement plus personne ne peut passer par là. Donc, le nombre de demandeurs d’asile n’augmente plus. Ils ont été jusqu’à 80 000, mais beaucoup ont été renvoyés ou sont partis tant les conditions étaient difficiles. Ceux qui sont restés sont donc là depuis longtemps, souvent 15 ou 20 ans. Ils travaillent, se sont mariés, ont des enfants qui vont à l’école et ne parlent qu’hébreu, mais vivent sous un statut extrêmement précaire et temporaire qu’ils doivent renouveler tous les trois ou six mois et risquent à tout moment de perdre. L’État n’examine même pas leurs demandes d’asile. On ne les rejette pas, car Israël veut apparaitre comme faisant partie des démocraties libérales – qui perçoivent ces nationalités comme très légitimes —, mais, parce qu’on veut les voir partir, on les laisse dans des limbes administratives et on leur impose des conditions d’existence extrêmement difficiles.
Un arsenal très violent et complexe a été mis en place à partir du milieu des années 2000 pour pousser les gens dehors, qui n’a cessé d’être modifié et affiné — mais aussi contesté par les organisations de défense des réfugiés. À certaines périodes ils ont perdu le droit de travailler ; à d’autres ils étaient interdits de travailler dans certains secteurs — ceux précisément dans lesquels ils étaient employés, comme l’hôtellerie ou la restauration ; à d’autres encore on leur a interdit de travailler dans les sept plus grandes villes du pays, celles dans lesquelles la majorité d’entre eux vivaient. Ils ont aussi régulièrement été expulsés ou détenus. En 2014, par exemple, plus de mille demandeurs d’asile soudanais et Erythréen ont été envoyés en Ouganda et au Rwanda. En 2015, un règlement du ministère de l’intérieur a établi que toute personne n’acceptant pas de partir « volontairement » vers un pays tiers serait emprisonnée indéfiniment. Cette décision a été cassée quelques années plus tard par la Cour suprême, mais cela avait conduit des milliers de personnes en prison.
Les tentatives pour contraindre les gens au départ ont été nombreuses et ont pris des formes très diversifiées. Cela a partiellement réussi, puisque plus de la moitié des demandeurs d’asile a quitté le pays. Mais certaines d’entre elles n’ont pas abouti, grâce à la vitalité du réseau associatif de défense des étrangers en Israël. Des associations ont saisi la Cour suprême — cette fameuse Cour suprême qu’aujourd’hui on essaie de démanteler — qui, dans certains cas, a fait tomber des propositions de loi ou de règlement. Israël n’en reste pas moins, avec l’Australie, un des pays qui a les politiques d’asile les plus dures dans le monde dit occidental.
Pourquoi ?
« Le réfugié en Israël, c’est à la fois la figure repoussoir du Palestinien, et celle qui devrait être réservée aux Juifs. Dans ces conditions les
autresn’ont pas leur place. »
C’est pour moi intimement lié à la manière dont est interprétée l’idée d’État juif. Aujourd’hui, en Israël, n’être pas juif est une anomalie. Pourtant, la place des minorités, leur droit à l’égalité, la liberté de culte et à la liberté politique étaient protégés dans les lois fondamentales dont Israël s’est doté lors de sa création comme État juif. Mais dans la pratique l’idée d’État juif a été de plus en plus interprétée et appliquée au sens de l’État des Juifs, comme propriété des Juifs. Le paroxysme de ce processus qui s’est accéléré en 1967 avec la conquête de Gaza et surtout de la Cisjordanie — considérée comme terre biblique des hébreux — a été le vote d’une loi fondamentale en 2018, transformant L’État définit comme « juif et démocratique » en « l’État-Nation du peuple juif » dans lequel « le droit à l’autodétermination nationale est unique au peuple juif ». Les minorités non juives ont été clairement exclues de cette nouvelle définition de la nation, qui a fait disparaître les mots « démocratie » et « égalité » des textes fondamentaux, désormais pétris de l’idée de suprématie juive. Cette loi vient entériner un long mouvement au cours duquel les minorités non-juives sont devenues des anomalies, des indésirables. C’est cela qui explique aussi la situation des demandeurs d’asile. Il est impossible pour les autorités israéliennes de donner à des non-juifs, qu’ils soient Soudanais ou des Érythréens, le droit de rester.
C’est assez vertigineux quand on sait que les Juifs ont symbolisé si longtemps ce statut d’apatrides, de réfugiés.
C’est une autre explication au fait qu’il est si difficile à l’État d’Israël d’accorder le statut de réfugié. C’est une catégorie sur-saturée. Elle est chargée de trop d’histoires : celle des Juifs qui ont fui l’Europe et l’extermination, celle des Palestiniens qui ont été chassés ou qui ont fui leurs terres et leurs maisons en 1948 et qui revendiquent cette identité qu’Israël leur dénie. Le réfugié, c’est donc à la fois la figure repoussoir du Palestinien, et celle qui devrait être réservée aux Juifs. Dans ces conditions les « autres » n’ont pas leur place.
Illustrations de vignette et de bannière : Claire Le Gal
- Ici, le terme de « réfugié » n’est pas utilisé dans son acceptation au regard de la loi française, c’est-à-dire pour désigner une personne ayant obtenu cette qualification suite à une procédure au sein de l’Ofpra [ndlr].[↩]
- Les agents de l’Ofpra sont chargés d’établir la véracité des raisons exposées par les migrants pour demander le statut de réfugié, et de vérifier qu’elles rentrent dans les critères instaurés par l’État [ndlr].[↩]
- Notion développée dans l’article de Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 62–63, 1982.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Émilien Bernard : « Lutter contre l’effacement des visages et des histoires », février 2024
☰ Lire notre article « Le business de l’enfermement d’étrangers », Yanna Oiseau, mai 2020
☰ Lire notre entretien avec Olivier Besancenot et Danièle Obono : « Penser l’immigration », novembre 2018
☰ Lire notre entretien avec Alexis Nuselovici : « Il y a un nouveau sujet politique, c’est le migrant », octobre 2018
☰ Lire notre témoignage « De réfugié à fugitif », novembre 2017
☰ Lire notre entretien avec le Gisti : « Droit d’asile : ça se durcit d’année en année », novembre 2017


