« La vie, la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait à cette loi ? » lançait l’ancienne présidente du Medef, Laurence Parisot. De fait : depuis un certain temps, les pays soumis à la croissance capitaliste connaissent, à l’instar de la France, une montée de la précarité du travail — nombre de CDD en hausse, démantèlement du code du travail, inversion de la hiérarchie des normes, etc. La notion de « précariat » a été avancée pour décrire ces transformations qui affectent les salariés. À l’image des livreurs à vélo et des chauffeurs Uber, les travailleurs précaires constitueraient une nouvelle classe sociale qui, dans l’analyse des rapports de production et d’exploitation, viendrait se substituer au prolétariat. Cette idée sous-entend que l’instabilité spécifique qui touche les précaires serait relativement récente : pourtant, à mieux y regarder, la précarité est historiquement inhérente au capitalisme et au marché du travail. Sa hausse signe d’abord un reflux et interroge le syndicalisme sur la façon de la combattre. ☰ Par Juan Sebastián Carbonell

Il existe aujourd’hui un large consensus autour du fait que le néolibéralisme contribue à la précarité du travail. Depuis une quarantaine d’années, les gouvernements successifs des pays développés ont fait passer différentes mesures de « flexibilisation » du marché du travail. Ces mesures favorisent principalement deux choses : tout d’abord, le recours à des contrats à durée déterminée par les entreprises ; ensuite, la facilité pour les employeurs de licencier la main-d’œuvre. Par exemple, en France, la création du contrat d’intérimaire date de 1972 : censé être un contrat de remplacement exceptionnel, il est devenu au fil des années un véritable outil de « flexibilité » entre les mains des employeurs. Dès qu’une entreprise connaît une baisse de son activité, elle ne renouvelle pas les contrats temporaires, se débarrassant ainsi d’une partie des employés sans avoir recours à une longue et risquée procédure de licenciement collectif.
« La précarité ronge progressivement les rangs des syndicats : dans certaines entreprises, le noyau de travailleurs stables est progressivement remplacé par des travailleurs temporaires. »
Dans son célèbre livre, Le Précariat — Les dangers d’une nouvelle classe, l’économiste Guy Standing conclut que la division de la société entre travailleurs et capitalistes n’est plus d’actualité au vu de l’émergence du précariat comme classe située en dessous du prolétariat. Tout semblerait donc indiquer que les jours où la majorité de la main-d’œuvre des grandes entreprises était employée pour une durée indéterminée sont révolus. L’apparition dans les rues des grandes métropoles de livreurs à vélo travaillant pour Deliveroo ou Foodora, de chauffeurs Uber ou Lyft — dépendants des plateformes pour leur travail mais juridiquement indépendants1 — semble confirmer l’effritement du salariat et la montée de la précarité. Comme l’ont montré un grand nombre de travaux, la précarité a des effets néfastes sur la vie des individus : non seulement ces derniers ont du mal à subvenir à leurs besoins à cause de la succession de périodes d’activité et de chômage, mais ils ont du mal à se projeter dans le futur, à louer un logement, à suivre des formations, etc. Enfin, la précarité du travail affaiblit les organisations syndicales. Les travailleurs temporaires sont réticents à se syndiquer par peur que leur contrat ne soit pas renouvelé. Dans le même temps, la précarité ronge progressivement les rangs des syndicats : au sein de certaines entreprises, le noyau de travailleurs stables se voit progressivement remplacé par des travailleurs temporaires. Les conflits de travailleurs précaires ne sont pas inexistants, mais ils sont rares.
L’extension de la précarité n’est pas sans danger. Pour certains, comme Guy Standing, la montée des populismes d’extrême droite en Europe ou aux États-Unis en est une conséquence directe. En l’absence d’une véritable alternative, la déstabilisation des familles des classes populaires les pousserait à chercher des coupables chez les précaires parmi les précaires : les migrants, les chômeurs, les LGBT, etc. La division des travailleurs en une multitude de statuts n’a pourtant rien de nouveau : elle a existé sous diverses formes dans l’histoire du capitalisme — on pourrait même dire qu’elle est fonctionnelle aux dynamiques du capitalisme. Quelle que soit la période que l’on considère, il y a toujours eu une coexistence entre permanents et temporaires.

[Benoist Van Borren]
Permanents et temporaires
Sous le capitalisme, la précarité est en quelque sorte contenue dans la nature même du contrat du travail. En principe, sur le plan du droit, un travailleur est libre de négocier le prix de sa propre force de travail à pied d’égalité avec son futur employeur. Cette conception libérale veut que la relation de travail — qu’elle prenne la forme d’un contrat ou non — soit une transaction commerciale entre sujets formellement égaux. Naturellement, cette égalité dans le droit ne se traduit pas par une égalité dans la vie réelle. Marx a fait de la critique de ce droit « bourgeois » un des axes du Capital : le droit qui consacre la « liberté du travail » — liberté du salarié de vendre sa force de travail et liberté de l’employeur d’employer quiconque — penche toujours en faveur du capitaliste, lequel peut rompre à tout moment le contrat commercial qui l’unit à ses ouvriers. Par exemple, en France, au moins jusqu’en 1890, tous les contrats étaient à durée déterminée. Les patrons avaient le droit de licencier leurs salariés sans aucune indemnité. Ce qui change à partir de cette période est la création, pour la première fois, des contrats « sans détermination de durée » et des indemnités de licenciement.
« Le droit qui consacre la
liberté du travailpenche toujours en faveur du capitaliste. »
Ce n’est que plus tard, au cours du XXe siècle, que le contrat de travail a été associé à un statut protecteur. D’un côté, les employeurs ont vu un avantage économique à fidéliser une partie de la main-d’œuvre (rationaliser sa gestion peut être une manière de réduire des coûts pour les entreprises, stabiliser la main-d’œuvre et ne pas avoir constamment à rechercher de nouveaux travailleurs leur est ainsi utile) ; de l’autre, le mouvement ouvrier a conquis de haute lutte de nombreux acquis sociaux, dont une relative stabilité de l’emploi. Bien sûr, cela a pris du temps. En France — souvent perçue à l’étranger comme la patrie du mouvement ouvrier et de l’État providence —, en matière de protection face aux licenciements collectifs, il faut attendre les années 1960 pour que soient mises en place des mesures de protection des travailleurs. En 1966 est ainsi instaurée l’information-consultation des comités d’entreprise dans le cas de restructurations d’entreprises, et, trois ans plus tard, sont introduites trois mesures importantes visant à limiter les effets des restructurations, les reclassements, les pré-retraites et les compensations économiques aux licenciements. Celles-ci cherchent à orienter l’employeur vers des alternatives aux licenciements « secs ».
On voit bien que l’idée d’un emploi stable et de longue durée est relativement nouvelle dans l’histoire du capitalisme. Ces mesures n’ont été possibles que grâce à un rapport de force favorable au mouvement ouvrier et un contexte économique spécifique, celui de la croissance d’après-guerre. Une fois ces conditions disparues, l’existence d’emplois à durée indéterminée est apparue plutôt comme une « parenthèse » de courte durée. Le contrat de travail est, en effet, de moins en moins associé à une protection face aux aléas du marché. Aujourd’hui, les gouvernants et les employeurs reprennent le vocabulaire de la « mobilité » et de la « liberté » des individus à changer d’emploi pour justifier les réformes de flexibilisation du marché du travail. Le plus souvent, les syndicats érigent les Trente Glorieuses comme période où la précarité était marginale. Pourtant, l’emploi était-il si stable que cela ? Les théoriciens de la « dualité du marché du travail » Peter B. Doeringer et Michael J. Piore ont montré que les choses étaient plus compliquées, et que même dans les sociétés de plein emploi, certains secteurs du salariat n’échappaient pas à la précarité2. Dans cette analyse, le marché du travail est divisé en (au moins) deux segments, entre un marché du travail primaire et un marché du travail secondaire. Dans le premier, les salaires sont plus élevés, les emplois sont qualifiés et la stabilité de l’emploi est importante ; dans le second, au contraire, les salaires sont faibles, les emplois nécessitent peu de qualifications, si ce n’est aucune : il n’y a pas de stabilité et le turnover de la main-d’œuvre est élevé.

[Benoist Van Borren]
Certaines industries sont plus exposées que d’autres à la précarité. Par exemple, l’industrie automobile connaît un fonctionnement saisonnier : pendant les périodes de crise, des centaines de travailleurs intérimaires (souvent jeunes et fils d’immigrés) sont « renvoyés » d’un jour à l’autre, pour revenir seulement quelques mois plus tard, une fois la vente de voitures repartie à la hausse. À l’usine, tout le monde — des employeurs aux syndicats, en passant par les ouvriers eux-mêmes — considère que cet état de fait est normal. De plus, les nouvelles industries, comme celles du secteur logistique, dépendent aussi d’une main-d’œuvre « flottante ». Parfois, les conditions de travail sont si difficiles, et les salaires si bas, que les employeurs sont conscients qu’aucun intérimaire ne restera au-delà de quelques mois. La barrière entre les deux marchés du travail est plutôt étanche et le passage d’un marché à un autre relativement difficile. Cette dualité du marché du travail — certains parlent même de « balkanisation3 » — veut donc que stabilité de l’emploi et précarité coexistent de manière normale au sein de l’économie de marché. Cette idée n’a rien de fondamentalement contre-intuitif. En France, on estime aujourd’hui que sur 32 millions de personnes ayant occupé un emploi sur l’année, environ sept millions appartiennent au marché du travail secondaire4. Sans surprise, il s’agit le plus souvent de jeunes, de femmes et d’immigrés.
Différentes formes historiques de précarité
« La précarité n’a donc rien d’exceptionnel sous le capitalisme. Elle n’a rien de nouveau non plus. »
Dans les années 1930, le contrat de travail n’était toujours pas une protection contre le licenciement dans le secteur de la vente en magasin. L’historienne française Anne-Sophie Beau rappelle que le droit du travail naissant ne s’était intéressé qu’aux ouvriers, et non aux employés5. Elle montre que jusqu’en 1936, les contrats des salariées du Grand Bazar de Lyon pouvaient être rompus du jour au lendemain, sans préavis ni indemnité. Deux types d’emplois se côtoyaient : les « titulaires », qui bénéficiaient d’un salaire mensualisé et de huit jours de préavis en cas de licenciement ; les « auxiliaires », largement majoritaires, et dont la rémunération était journalière. La précarité n’est limitée qu’à partir de 1936 avec les premiers contrats collectifs, mais elle ne disparaît pas pour autant, notamment parce que le patronat élabore des stratégies de contournement du droit du travail6.
On peut remonter plus tôt dans l’Histoire pour constater d’autres formes de précarité. Au XIXe siècle, alors que le travail du fer était encore au cœur de l’activité de certains villages, forges et exploitations agricoles fonctionnaient ensemble. Cela instituait une division entre ouvriers « externes », nombreux, souvent paysans, employés seulement l’hiver aux tâches les plus simples, et ouvriers « internes », minoritaires, forgerons, puddleurs, lamineurs, etc., ayant un métier et employés tout au long de l’année7. On peut remonter encore plus loin, à l’aube même de la société industrielle : il y a toujours eu division entre permanents et temporaires. La société issue de la Révolution française n’oppose pas binairement ouvriers et patrons ; elle met en place un cadre juridique en faveur du marchandage (putting out system), où un ouvrier « entrepreneur » engage d’autres ouvriers, souvent de sa propre famille (mais pas exclusivement), pour participer à la réalisation d’un ouvrage. Autrement dit : si, d’un côté, on retrouve des manufactures où un fabriquant possède des machines et des matières premières, de l’autre, on retrouve l’ouvrier-entrepreneur qui reçoit les matières premières et sous-traite le travail à « ses » ouvriers afin de les faire travailler chez lui ou chez le fabricant.
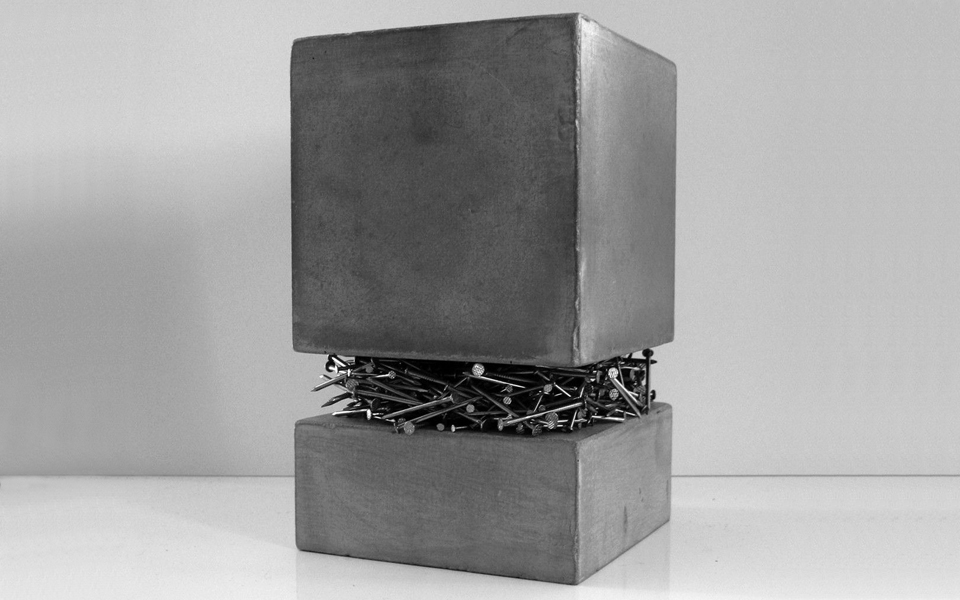
[Benoist Van Borren]
Comme le rappelle le sociologue Claude Didry, le marchandage a eu une longue vie et il est très présent dans les mines jusqu’à la fin du XIXe siècle8. On le trouve décrit dans Germinal, célèbre roman d’Émile Zola. Un « chef de marchandage » embauche Étienne Lantier, héros du livre, avec d’autres ouvriers pour le travail dans la mine. Le chef de marchandage se trouve en concurrence avec d’autres chefs sur le prix de la berline de charbon, poussant les ouvriers au rendement et faisant pression sur le salaire.
Plateformes numériques : des incubateurs de précarité
« Les luttes de précaires étonnent souvent par leur détermination, ou parce qu’elles apparaissent là où on ne les attend pas. »
Les pétitions et les grèves se succèdent pour demander l’abolition du marchandage. Il est officiellement aboli par la révolution de 1848 ; pourtant, comme on l’a vu, le marchandage et l’entre exploitation ouvrière perdurent jusqu’à la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Plus d’un chercheur a établi un parallèle entre le marchandage et le travail pour Uber, Deliveroo ou Amazon Mechanical Turk9 : un contrat formel ou informel est conclu par l’intermédiaire d’une plateforme numérique ayant pour objet un travail (la livraison d’un repas, la conduite d’une voiture, une traduction, etc.). Si, autrefois, c’était un autre ouvrier-entrepreneur qui organisait le travail des autres ouvriers, aujourd’hui, c’est la plateforme numérique.
Le fait que la précarité ne soit pas un phénomène nouveau ne veut pas dire qu’elle ne progresse pas, ou que rien ne doive être fait pour l’endiguer. Les luttes de précaires étonnent souvent par leur détermination, ou parce qu’elles apparaissent là où on ne les attend pas. Si elles sont souvent menées sans la présence ou le soutien des syndicats, elles finissent par trouver en eux un appui précieux. En France, les chauffeurs Uber se sont d’abord organisés dans des associations professionnelles, puis ont rejoint différents syndicats. Il en va de même pour les livreurs de repas, syndiqués au terme de plusieurs grèves. Plutôt que de considérer le précariat comme un statut qui pourrait opposer les travailleurs entre eux, il convient, dès lors, de comprendre comment les précaires sont, aujourd’hui, en train de contribuer à recomposer le paysage syndical.
Ce texte a également paru sur le site de Jacobin en avril 2020, traduit en anglais pour l’occasion.
Phototographies de bannière et de vignette : Benoist Van Borren
- Début mars, la Cour de cassation a toutefois requalifié le contrat d’un travailleur Uber en contrat de travail, considérant comme « fictif » son statut de travailleur indépendant. Cette décision pourrait remettre en cause le modèle de la plateforme.[↩]
- P. B. Doeringer et M. J. Piore, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Lexington, 1971.[↩]
- A. Perrot, Les Nouvelles théories du marché du travail, La Découverte, 1992.[↩]
- C. Picart, « Trois segments pour mieux décrire le marché du travail », Insee Références, 2017.[↩]
- A.-S. Beau, « Les salarié-e-s du grand commerce : des “employé-e-s” ? Les parcours professionnels des salarié-e-s du Grand Bazar de Lyon aux 19e et 20e siècles », Travail, genre et sociétés, vol. 8, n° 2, p. 55-72, 2002. [↩]
- Voir aussi : A.-S. Beau, Un siècle d’emplois précaires — Patron-ne-s et salarié-e-s dans le grand commerce (XIXe–XXe siècles), Payot, 2004.[↩]
- G. Noiriel, « Du
patronage
aupaternalisme
: la restructuration des formes de domination de la main-d’œuvre ouvrière dans l’industrie métallurgique française », Le Mouvement social, n° 144, pp. 17-35, 1988.[↩] - C. Didry, L’Institution du travail — Droit et salariat dans l’histoire, La Dispute, 2016.[↩]
- Plateforme de micro-travail lancé en 2005 par Amazon : des « travailleurs du clic » effectuent des micro-tâches répétitives pour analyser, produire et fournir de l’information utilisée par les entreprises high tech et pour le développement de l’intelligence artificielle.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Claude Didry : « Le salariat, une classe révolutionnaire ? », avril 2020
☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « La gauche est inaudible parce qu’elle ne politise pas le travail », juin 2019
☰ Lire notre entretien avec Maud Simonet : « Travail gratuit ou exploitation ? », février 2019
☰ Lire notre entretien avec Philippe Martinez : « Qui est moderne et qui est ringard ? », décembre 2016
☰ Lire notre article « Associations : faire face à l’offensive des entrepreneurs sociaux », Pablo Sevilla, mai 2016


