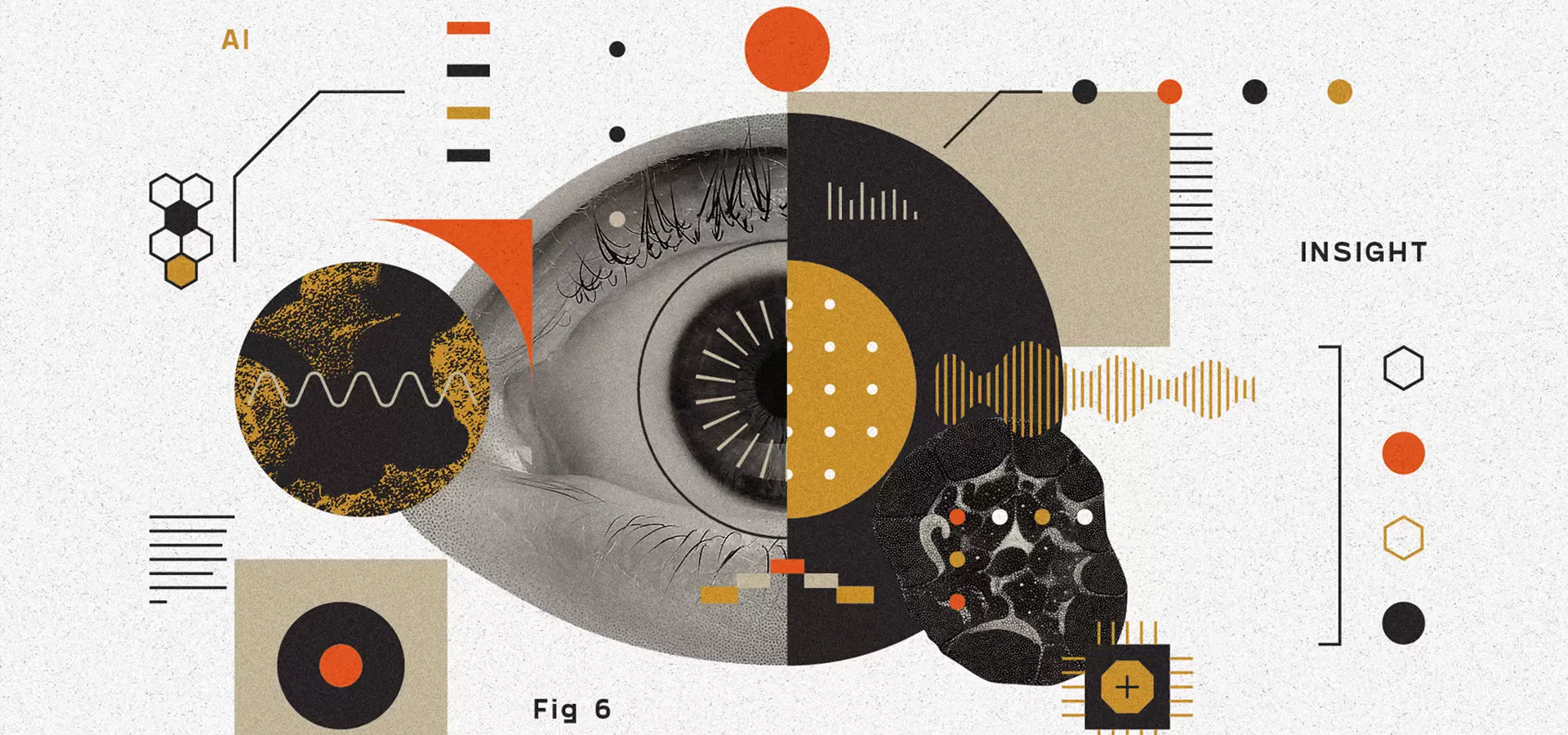Entretien inédit pour le site de Ballast
Il s’agit là d’une rencontre double. D’abord, avec le sociologue Laurent Jeanpierre : nous avions croisé sa route lors de la sortie de son ouvrage In Girum, dans lequel il tirait quelques leçons politiques pour l’avenir à partir du mouvement des gilets jaunes. Puis, à travers l’auteur, la rencontre avec le sociologue Erik Olin Wright : marxiste étasunien né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et disparu en 2019, l’intéressé s’est engagé en faveur de ce qu’il nommait des « utopies réalistes » — à chercher quelque part entre deux voies qu’il tenait pour autant d’échecs avérés : le pas à pas réformiste et le grand plongeon révolutionnaire. Si Laurent Jeanpierre n’est pas le porte-parole de Wright, il s’avance toutefois comme l’un de ses introducteurs dans le champ francophone. Il publie et signe ainsi la postface de Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle, dans la collection qu’il dirige aux éditions La Découverte. En prolongeant sa pensée, Jeanpierre invite à réinvestir la notion matricielle de « socialisme » en vue d’en finir avec la domination capitaliste. Le socialisme comme lieu de cohabitation, fût-elle houleuse, et de combinaison des trois courants historiques de l’émancipation : le communisme, l’anarchisme et la social-démocratie originelle.

Si j’ai employé cette phrase dans le commentaire que j’ai proposé en postface de son ouvrage, c’est en effet parce que les élaborations de Wright depuis 20 ans tranchent avec une constellation mentale ou affective qui me semble pesante dans la gauche anticapitaliste — et qui s’est, donc, parfois manifestée en empruntant à Cap au Pire de Samuel Beckett. Cette méditation sur l’échec est effectivement apparue ces dernières années sous diverses plumes, pourtant assez éloignées idéologiquement les unes des autres : aussi bien, par exemple, chez Slavoj Žižek qu’autour du Comité invisible. Wright ne part pas de ce fond commun partagé de la « mélancolie de gauche », qui entrave bien souvent, même si elle a aussi sa puissance, la possibilité d’une réflexion stratégique au sujet des conditions actuelles et réelles, et non pas idéales ou passées, d’un dépassement bénéfique du capitalisme.
Mais cette « mélancolie » n’est-elle pas compréhensible, au regard des nombreuses défaites que le camp de l’émancipation a connues ?
« Contrairement à ce qu’espéraient plusieurs intellectuels organiques de l’anticapitalisme, la crise sanitaire et économique mondiale actuelle ne démentira pas vraiment ce sombre constat. »
Certes, elle l’est. Elle est adossée à un profond sentiment politique de blocage, aux défaites accumulées successivement par les gauches depuis bientôt un demi-siècle. De crise en crise, d’alternance en alternance, de changement de régime en changement de régime, le mouvement contre-révolutionnaire néolibéral parvient en effet à vaincre ou à se maintenir et à accroître son emprise. Contrairement à ce qu’espéraient il y a quelques mois encore plusieurs intellectuels organiques de l’anticapitalisme, la crise sanitaire et économique mondiale actuelle ne démentira pas vraiment ce sombre constat. Disparu il y a deux ans, Wright n’ignorait pas ce problème. C’est même la conscience précise de ce déclin politique de l’anticapitalisme qui motive le tournant « réaliste » singulier avec lequel il entend infléchir l’utopisme traditionnel : dans cet alliage fragile entre deux types d’intelligence d’ordinaire opposés se tient le noyau dur de sa pensée stratégique anticapitaliste. D’où, aussi, ses réserves vis-à-vis des plans, des programmes, des utopies de papier, des scenarii de « monde d’après » — autrement dit des espérances détachées d’une analyse empirique du présent, qui ne sont d’ailleurs bien souvent que la traduction de nostalgies arrimées à un passé idéalisé. Poser à nouveau, en critique radical du capitalisme, la question stratégique, exige désormais, selon lui, de s’interroger scientifiquement sur les conditions de possibilité, les voies historiques précises du socialisme — en s’écartant avec méthode du fond de religiosité, de croyance, de foi, positive ou négative, un peu inconditionnelle dans l’avenir que portent les différentes traditions socialistes et leur volontarisme transformateur.
Ce contre-pied se retrouve également dans le renversement que Wright opère de cette autre phrase célèbre, signée Romain Rolland et popularisée par Gramsci : allier pessimisme de l’intelligence et optimisme de la volonté.
Wright affirme en effet qu’il serait bon de transformer cette formule, qui lui semble être la ligne de conduite implicite de la plupart des anticapitalistes d’aujourd’hui. Cette disposition éthique et stratégique ambivalente qui allierait « l’optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison » se retrouve dans ce qu’il faudrait appeler le discours du socialisme. Cette disposition est traversée d’oscillations — chez un même auteur, parfois —, entre le constat du caractère implacable de la domination capitaliste ou de ses formes diverses d’assujettissements et l’affirmation d’une nécessité ou bien d’une évidence de résistance, de radicalité, de subjectivité révolutionnaire ou transformatrice. Cette polarisation produit une tension ou une discontinuité difficile à éviter, entre le versant descriptif et le versant normatif de l’écriture socialiste. Car on ne peut pas à la fois tenir que la domination est massive et que la révolution — ou en tout cas la résistance, la sortie — est possible voire garantie… Cette position de pensée n’est pourtant pas rare.
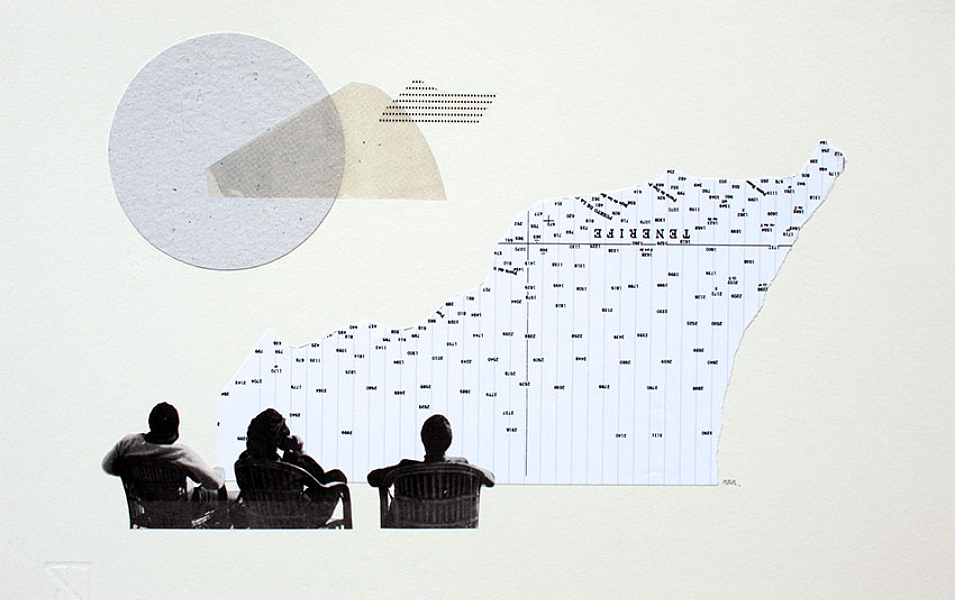
[Raul Lazaro]
D’une certaine manière, Wright nous dit : « Le pessimisme de la raison, on a donné. » On connaît déjà suffisamment les modalités de la domination et de l’exploitation capitalistes ; on connaît moins les voies de sa transformation. D’autant moins, d’ailleurs, qu’une forme de religion de l’Histoire a traversé toutes les traditions socialistes. Il faut désormais, dit Wright, nourrir et développer le raisonnement le plus rationaliste possible sur la transition menant du capitalisme actuel à un socialisme (ou un communisme, un éco-socialisme, une écologie sociale, etc.) futur : un raisonnement à la fois informé des sciences sociales, mais conservant une visée théorique. Articulant, autrement dit, une perspective philosophique à des observations empiriques. Et portant sur les modalités de sortie désirables de la formation sociale présente. Il faut donc substituer au pessimisme de la raison ce que Wright appelle « un optimisme de l’intelligence ».
Qu’impliquerait cette disposition d’esprit non pessimiste ?
« Pouvons-nous vraiment faire comme si 1917 n’avait pas échoué pour des raisons non seulement extrinsèques, mais intrinsèques ? »
Un effort pour penser concrètement les voies d’accès à un plus grand épanouissement collectif avec leurs chances d’aboutir. Mais l’exercice n’a rien de béat : Wright s’en prend, entre les lignes, dans la plus pure tradition du marxisme, à l’inanité et à la faiblesse d’intellectuels et de militants de gauche qui se plaignent en permanence du caractère totalement achevé de la domination capitaliste tout en n’ayant aucun problème pour dessiner, mois après mois et luttes après luttes, des plans tous plus extravagants les uns que les autres… La philosophie politique est pleine d’utopies de papier. Les traditions socialistes ont déjà écrit leurs premières mesures révolutionnaires et leurs figures du communisme. Wright propose au contraire de réfléchir, par l’enquête empirique sur le passé et le présent, à ce qu’on appelait autrefois dans la tradition marxiste la « transition socialiste » : une transition qu’il faut désormais pluraliser dans ses visées, dans ses chemins, car le dernier siècle nous y a contraints.
Qu’entendez-vous précisément par là ?
Eh bien, ça signifie que 1917 n’a pas suffi et qu’il ne suffit pas non plus de se détacher du stalinisme, ou même du léninisme, pour reprendre la question de la sortie du capitalisme. Pouvons-nous vraiment faire comme si 1917 n’avait pas échoué pour des raisons non seulement extrinsèques, mais intrinsèques ? S’agira-t-il de recommencer la révolution bolchevik, mais autrement, selon des voies encore inconnues, comme l’ont souvent défendu les trotskystes ? Bien entendu, toute une réflexion stratégique s’est développée après 1917, dans le marxisme et dans les autres familles du socialisme, en tenant compte de l’échec de 1917. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Il faut y revenir, sans doute, mais surtout aller au-delà. La collection « L’horizon des possibles », aux Éditions La Découverte, que j’anime avec Christian Laval, se donne à nouveau les possibilités transformatrices pour objet, spéculatif ou savant. Récemment, Jérome Baschet et Étienne Balibar y ont instruit cette problématique du passage au socialisme. Et si Wright y est publié depuis son grand ouvrage Utopies réelles, c’est parce qu’il renouvelle, selon moi, avec un certain courage de pensée, cette même question classique, mais en l’adaptant aux coordonnées actuelles du capitalisme et en récusant le catéchisme doctrinal et l’opposition stérile entre credos socialistes.
Mais, avant d’aller plus loin dans la discussion : c’est qui, ou plutôt c’est quoi, Erik Olin Wright ?
Un sociologue nord-américain qui a fait ses études à Harvard et s’est formé politiquement durant les années 1960 américaines — une période intense, comme vous le savez, en matière de luttes antiracistes, sociales, étudiantes. Il a séjourné un an à Paris, parlait français, mais est resté malgré tout peu connu dans le monde francophone. En Amérique latine, en Europe du Nord, au Portugal — il a dialogué par exemple avec le grand sociologue Boaventura De Sousa Santos —, dans le monde anglo-américain, ses travaux sont diffusés et discutés. Même si c’est un auteur très occidental, il a donc eu un large écho international. Wright s’est d’abord fait connaître en renouvelant en profondeur l’analyse empirique et quantitative en termes de classes sociales aux États-Unis et au plan international, au point même qu’il a eu accès à des données soviétiques et aurait été en mesure, dans les années 1980, de commencer une enquête inachevée sur la structure de classes en Union soviétique. Un travail tout à fait singulier. L’analyse de classes n’était pas non plus la chose la plus à la mode aux États-Unis dans ces années, pour des raisons idéologiques évidentes : le tournant néolibéral venait de prendre corps. Et puis Wright est un marxiste, ce qui est d’autant plus singulier dans ce pays où le mot suffit à effrayer les foules… C’est même l’un des rares sociologues marxistes de sa génération, avec Michael Burawoy. Et ce n’est pas simplement un sociologue marxiste dans un pays « anti-rouge », c’est un sociologue empirique marxiste dans un contexte où la sociologie marxiste n’existe pas ou plus ! Et ce, à l’échelle mondiale.
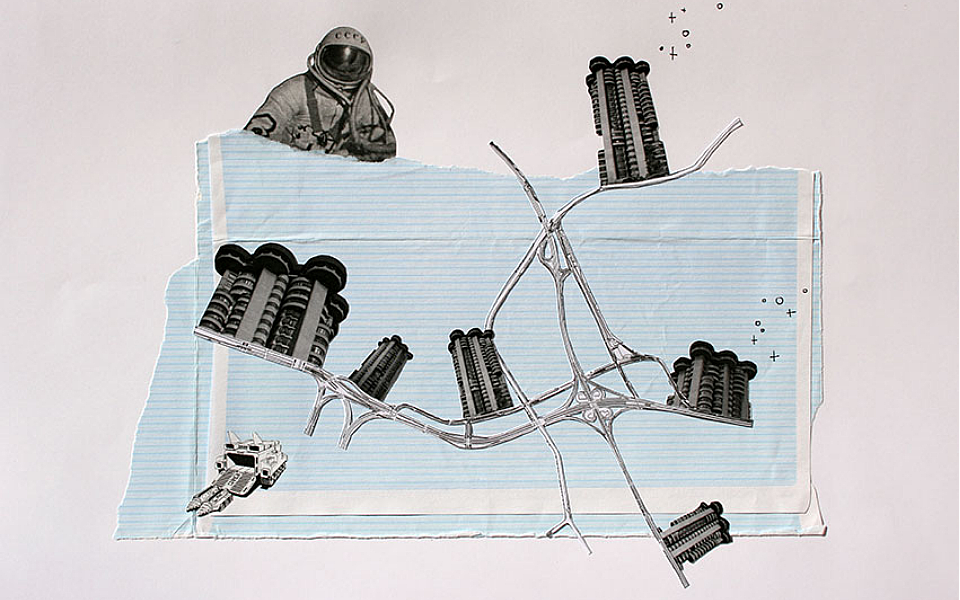
[Raul Lazaro]
Vous dites qu’il n’y avait pas de sociologues marxistes ?
Certains sociologues sont marxistes, mais la sociologie marxiste peine à exister. Jusqu’à récemment, la sociologie empirique marxiste était peu représentée dans la discipline. Le travail, la culture, la littérature, la ville, notamment, ont, certes, attiré jusqu’à l’orée des années 1980 des sociologues inspirés par le marxisme, mais cette tradition s’est éteinte. Il y a aussi, bien sûr, une théorie sociologique marxiste dont les frontières peuvent être discutées, mais qui pourrait comprendre une partie des grands noms de la théorie critique allemande : des personnalités comme Goldmann, Lefebvre, Poulantzas, Löwy et d’autres après eux. Il y a certainement beaucoup de sociologues en France qui se pensent ou se disent marxistes — certains publient aujourd’hui dans des revues comme Contretemps —, mais leur engagement et leur appareil théorique sont généralement séparés.
Comment expliquez-vous ce faible développement de la sociologie empirique marxiste ?
« Wright appelle à réintégrer la question utopique comme une interpellation interne au marxisme — congédiée par Engels plus que par Marx, d’ailleurs. »
Ça a à voir avec de nombreux facteurs, dont certains viennent de l’histoire de la pensée marxiste, de l’hostilité des pays marxistes vis-à-vis de la sociologie empirique, d’une part, ainsi que de l’impossibilité, dans les pays où la norme de la recherche empirique était forte, comme aux États-Unis, de l’articuler au paradigme marxiste, d’autre part. Dans le cas français, l’œuvre de Bourdieu a servi, parmi les sociologues critiques des dernières décennies, de substitut ou d’alternative au marxisme. Wright et Burawoy sont les seuls chercheurs récents, à ma connaissance, à avoir développé récemment un programme complet de redéfinition de la sociologie marxiste avec des principes et des tâches qui pourraient faire école. Ils proposent des terrains d’enquête, des objets, des manières de travailler, des types de problèmes à des sociologues qui aspirent à mettre à l’épreuve leurs convictions marxistes ou leur intérêt pour Marx et pas simplement à s’afficher comme des sociologues qui épousent le marxisme politiquement tout en ayant des difficultés à le faire exister scientifiquement.
Quels sont donc les apports de Wright dans ce contexte ?
Il est aussi un théoricien. Il a une formation de philosophie sociale et politique solide, bien qu’elle soit sans doute assez peu continentale. Certains s’étonneront peut-être, par exemple, que son programme autour des « utopies réelles » — qui a été pour moi le point d’accroche central avec son œuvre — fasse si peu référence au traitement de la question utopique dans la tradition critique européenne, et notamment à l’œuvre de Bloch, mais aussi aux développements de Mannheim, Lukács, Adorno, Horkheimer et de nombreux autres. Mais c’est aussi une force, car Wright s’épargne ainsi toutes les impasses théoricistes de ce que Perry Anderson a appelé le « marxisme occidental ». L’ancrage du sociologue étasunien dans le marxisme est, d’une certaine manière, opposé à cette tradition puisqu’il a pris part à partir des années 1980 au Groupe de Septembre, en quête de « non-bullshit marxism » : il rejetait l’idée de dialectique et est à l’origine de ce que l’on appelle aujourd’hui le « marxisme analytique ». Ce courant1 a été très peu reçu et discuté en France — ce qui a eu des effets sur la réception et la lecture de l’œuvre de Wright lui-même.
Pourquoi ce manque d’intérêt français ?
Ça tient sans doute à la place longtemps marginale de la philosophie analytique en France, à l’hostilité que lui vouent la plupart des intellectuels critiques. À l’abandon du marxisme par une partie des membres du Groupe de Septembre, aussi. Mais Wright n’est pas de ceux-là. Comme les autres marxistes anti-bullshit, c’est d’abord un lecteur d’Althusser, qui, dans les années 1970, pensait lui être fidèle en travaillant à reconstituer la scientificité de l’œuvre marxienne — c’est-à-dire aussi à identifier les points de polarisation ou d’incohérence internes à l’œuvre. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que ce programme marxiste et scientifique a tendu, chez Wright, à réintégrer la question utopique. Il y a, dans ce projet intellectuel, une tension interne extrêmement forte. Car le discours du marxisme sur l’utopie a longtemps été hostile, même si le rapport de Marx et Engels aux utopies socialistes de leur temps est en réalité complexe et évolutif. Wright appelle à réintégrer la question utopique comme une interpellation interne au marxisme — congédiée par Engels plus que par Marx, d’ailleurs — tout en renvoyant dos à dos l’objectivisme de la science marxiste de l’Histoire et le subjectivisme de la politique marxiste du parti.

[Raul Lazaro]
Mais l’anticapitalisme peut-il être une utopie en lui-même, sachant que des courants fascistes reprennent parfois cette lutte à leur compte ?
D’un point de vue politique ou scientifique actuel, il faut certainement poser la question des utopies fascistes et de leur essor. Mais, pour Wright, elles peuvent rester en dehors d’une enquête sur la sortie du capitalisme car il a forgé, pour orienter l’enquête, une définition normative de ce qu’il appelle « socialisme ». Elle renvoie à l’épanouissement de tous, à l’augmentation du bien vivre, aux valeurs d’égalité, d’autonomie et de solidarité. Mais il est vrai qu’une manière de prolonger et peut-être d’enrichir son programme de recherche consisterait à penser les « utopies réelles » en général, et les alternatives anticapitalistes en particulier : elles ne sont pas, il est vrai, sur le terrain de l’Histoire effective, uniquement « socialistes » — même au sens large où il entend ce qualificatif. Penser, aussi, qu’un travail sur ce qu’il identifie comme le mode de transformation « interstitiel » du capitalisme — c’est-à-dire sur ce changement graduel et de petite échelle en direction de certaines valeurs socialistes dans les interstices des institutions dominantes, notamment économiques — doit prendre en compte des utopies qui nous sembleraient indésirables : utopies pour d’autres, mais dystopies pour nous… Si l’on observe, comme je le fais depuis quelque temps, les utopies communautaires écologiques, il n’est pas impossible de « tomber » sur des propositions de type nativiste ou néofasciste. Comment interagissent-elles avec les communautés écologiques plus fidèles aux valeurs socialistes ? Espérons ne pas avoir à nous poser vraiment la question…
On le sait : le mot « socialisme » n’a pas la même charge en Europe et aux États-Unis.
« Il y a un accord minimal sur le fait que le socialisme, c’est la recherche de trois valeurs : égalité, liberté et solidarité — ou bien égalité, autonomie et entraide. »
Oui. Même s’il existe un parti socialiste américain, ce terme suscite là-bas une hostilité et une peur spontanées : il évoque immédiatement, pour beaucoup de ceux qui vivent en dehors des campus, le goulag. Mais ce mot est englobant : il renvoie à un état des idées et des pratiques anticapitalistes dans lequel le marxisme n’est pas encore autonomisé. De même pour l’anarchisme. Il y a un effet d’illusion sur les divisions du socialisme, sans doute dû à l’historiographie et aux militants du XXe siècle, qui ont reconstruit des généalogies et des traditions inventées selon lesquelles il y aurait eu un anarchisme pur, une social-démocratie pure et un marxisme pur dès le XIXe siècle. Entre 1830, où le mot « socialisme » se déploie sur la scène de l’Histoire, et 1914, il y a des socialismes dans lesquelles toutes ces traditions, et d’autres, se mêlent. Des individus circulent entre les courants. Des conflits sont présents — comme dans la Première Internationale, où ils ont été hautement discutés —, mais il y a malgré tout beaucoup de visées communes.
Cette perspective socialiste pluraliste, où communistes, anarchistes et réformistes se « mêleraient », est perdue, aujourd’hui, non ?
En effet. Il serait bon de retrouver un tel horizon… C’est, je crois, ce que pensait Wright. C’est la raison pour laquelle, dans ce livre, il tente de circonscrire ce socle commun aux socialismes historiques. D’abord, bien sûr, c’est la critique du capitalisme, même si celle-ci s’effectue selon des modalités qui pouvaient varier, mais avec un accord minimal sur les méfaits, les destructions opérées par le capitalisme sur l’être humain et la nature. Le thème anti-industriel de la destruction de la nature est, certes, resté minoritaire au XIXe siècle, mais il n’est pas absent2. Donc il y a un accord sur le fait que le capitalisme est la source cardinale de nos malheurs, même si d’autres éléments, d’autres forces participent bien entendu aux maux du monde. Et, d’autre part, il y a un accord minimal sur le fait que le socialisme, c’est la recherche de trois valeurs : égalité, liberté et solidarité — ou bien égalité, autonomie et entraide. Mais les faiblesses issues de la fragmentation interne des socialismes, non pas au niveau des valeurs, mais au niveau des tactiques, des idéologies, des formes politiques, doivent être inversées en force d’alliance et de combinaison. C’est, d’une certaine manière, tout le projet de Stratégies anticapitalistes.
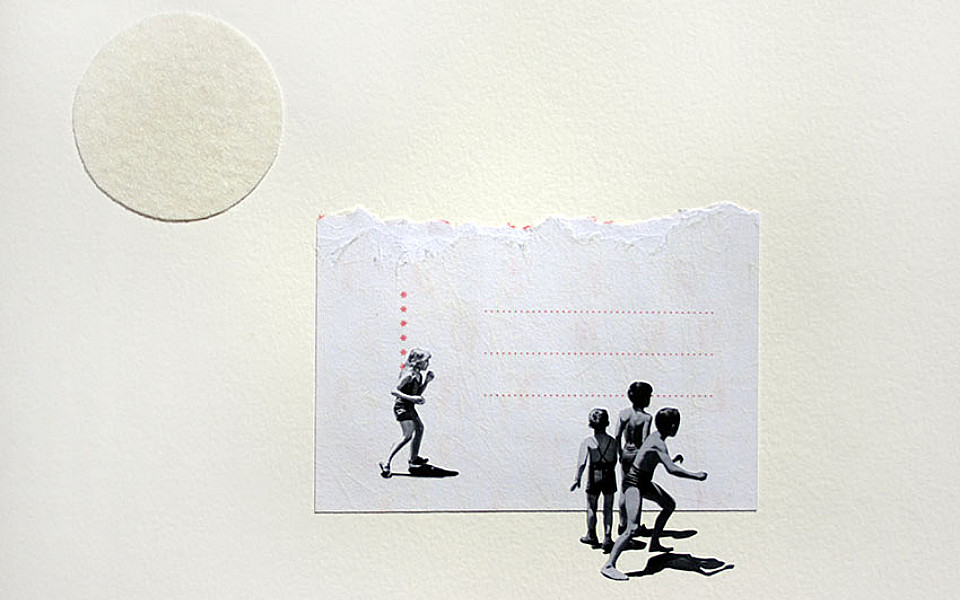
[Raul Lazaro]
Wright théorise une « érosion » du capitalisme qui s’inscrit dans un temps long, ou à tout le moins indéfini. Mais, comme charriait Keynes, « à long terme, nous serons tous morts » ! Alors ne nous faut-il pas renverser au plus vite le pouvoir capitaliste ?
Il faut d’abord rappeler que Wright entend dépasser l’opposition réformisme-révolution, à quoi est restée trop souvent réduite la réflexion stratégique des anticapitalistes. Trois modes de transformation sont envisagés, plutôt que deux : la rupture, le changement symbiotique et la transformation dite « interstitielle », dont nous avons déjà parlé. Ces types de changement existent à toutes les échelles du politique. Dès lors, l’enjeu stratégique est d’imaginer, localement, nationalement, internationalement, des combinaisons entre ces trois modalités d’avancée du socialisme qui finissent par être susceptibles d’éroder le capitalisme. Il est donc important de revenir sur ce terme d’« érosion ». Son mérite, ce n’est pas nécessairement d’apporter des réponses définitives à la question de la transition mais d’interroger les théories tacites de l’Histoire portées par les anticapitalistes. Peut-on croire au caractère immédiatement bénéfique ou absolument possible des ruptures révolutionnaires ? La réponse à ces questions devrait aller de soi.
« Wright dessine une réflexion métapolitique sur la stratégie socialiste en se plaçant par-delà les oppositions héritées du dernier siècle entre anarchistes, marxistes et sociaux-démocrates. »
Qu’on partage ensuite tout ou partie de ses attendus, la démarche de Wright est là pour indiquer que si je suis anticapitaliste et révolutionnaire, par exemple, il faut que je sois un peu plus au clair sur les conditions de possibilité des révolutions, sur les coordonnées historiques des révolutions passées, sur les modes de transformation des révolutions politiques en formation historique socialiste ou communiste. Sur tous ces points-là, l’historiographie et la théorie, sans même parler des discours partisans, n’ont pas de réponses assez robustes. Wright ne privilégie pas un mode de transformation socialiste sur un autre, il appelle à ce que nous pensions mieux leurs interactions. Contrairement à ce que certains lui ont reproché, il n’aurait donc aucun problème avec des gens qui rejetteraient les changements interstitiels, les expériences communalistes, coopératives ou communautaires, qui mépriseraient aussi le réformisme de gauche au gouvernement et qui diraient qu’ils ne s’intéressent qu’à la révolution socialiste. Mais il leur répondrait : « Encore un effort (de connaissance) si vous voulez être révolutionnaire ! » Il n’y a donc pas d’exclusion a priori du mode révolutionnaire de transformation historique dans son schéma. Il y a une analyse historique qui dit que des révolutions dans des pays démocratiques, aujourd’hui, il n’y en a pas eu.
Analyse que vous partagez ?
Oui. Tout un travail reste à faire sur les conditions de possibilité révolutionnaire, une tâche immense que d’autres travaux historiques et sociologiques que ceux de Wright permettent tout de même d’envisager.
Voilà qui nous amène au cœur du problème : comment, concrètement, va-t-on réussir à instaurer une société socialiste ?
Pour Wright — dont je simplifie ici les leçons —, on ne peut pas penser le changement vers le socialisme exclusivement en termes binaires, manichéens, en laissant accroire que tout ce qui n’est pas rupture révolutionnaire n’est que poussière politique ou bien ruse de la raison historique et capitaliste. Wright est anti-hégélien, comme tous les marxistes analytiques. Il n’y a pas de ruse de la raison capitaliste a priori. Il y a des rapports de force, une micropolitique et une macropolitique des agencements et des pouvoirs, sociaux, économiques, politiques, qui donnent des résultats plus ou moins favorables au socialisme et dont il faut étudier règles et résultats. Avec Stratégies anticapitalistes, et Utopies réelles auparavant, Wright dessine une réflexion métapolitique sur la stratégie socialiste en se plaçant par-delà les oppositions héritées du dernier siècle entre anarchistes, marxistes et sociaux-démocrates. Nous héritons, dit-il, de ces trois traditions dont la combinaison synchronique et diachronique doit être pensée et pratiquée. Comment ce qu’il appelle la transformation « symbiotique » du capitalisme (qui renvoie surtout à la social-démocratie du premier XXe siècle et de l’après 1945), sa transformation « interstitielle » (défendue par les anarchismes et relevant des politiques préfiguratives) et la transformation par la « rupture » (qui s’exprime dans les moments révolutionnaires) peuvent-elles former un engrenage socialiste à l’intérieur des institutions du capitalisme ? Mais, pour envisager ceci, une fois de plus, il faut pouvoir renoncer au rêve d’un Grand Soir, qui offrirait toutes les solutions, et s’abandonner à la pensée de la transition. Avec son modèle d’analyse, Wright ne fait que poser un programme d’enquête et ses coordonnées. Il n’en a ni les clés, ni le terme. C’est à nous de poursuivre.

[Raul Lazaro]
La combinaison de ces trois grandes stratégies passerait donc par l’érosion ?
Elle en est le résultat éventuel. Le nom de la transition différentielle, incrémentale vers l’après-capitalisme. Pour qu’il y ait un processus d’érosion, a fortiori d’érosion croissante, il faut, soulignons-le une fois encore, qu’il y ait des hybridations entre socialismes et pratiques issues des traditions critiques du capitalisme. Mais si l’on suit Wright avec précision, l’érosion dispose déjà d’appuis : dès que l’on envisage les choses non plus de manière molaire, mais moléculaire, comme disait Guattari, il y a du socialisme, en petite dose, dans beaucoup d’endroits, d’institutions, de secteurs d’activité. D’une certaine manière, l’ouvrage de Wright donne une réelle consistance, une formalisation, à ce que l’on appelait « révolution moléculaire » dans les années 1970 — même si le sociologue nord-américain parle une tout autre langue que celle du clinicien français et de cette période. Mais il va, en quelque sorte, plus loin, car la notion de révolution moléculaire, chez Guattari, n’était en définitive qu’une rupture avec le fétichisme de la rupture qui dominait les mouvements des années 68 : la mise au jour et la mise à jour des seules stratégies interstitielles.
Nous parlions d’urgence. Il en est une que les socialismes ont souvent et longtemps négligée : l’écologique. La stratégie de l’érosion est-elle encore tenable face au dérèglement climatique — donc au bouleversement politique radical qu’il devrait provoquer ?
« Chacun brandit ses pratiques militantes, ses fétichismes politiques, comme une identité figée, et finit par faire de la morale plutôt que de la politique. »
La catastrophe écologique est déjà là. Les maux du capitalisme s’intensifient et le tournant autoritaire actuel du néolibéralisme, à l’échelle mondiale, ne devrait pas favoriser les résistances futures. Face à ça, l’alternative est peut-être la suivante : ou bien on dit que le temps court relève de la tactique et le temps long, de la stratégie (c’est une réponse classique et, d’une certaine manière, de facilité : les tactiques des socialismes s’élaborent dans l’horizon de l’urgence, mais ça laisse entier la question de leurs effets à plus long terme, dont la connaissance relève de la pensée stratégique) ; ou bien — mais c’est peut-être la même chose — on sépare l’horizon analytique proposé par Wright, qui implique, en effet, un travail de longue haleine et une réflexion difficile, collective, sur l’Histoire passée et présente, et l’horizon de l’engagement politique. Il faut souligner qu’il n’y a aucune prescription militante chez Wright, aucun appel à la conversion, aucune prédilection affichée entre les manières d’être socialiste. C’est comme ça que je le lis. Chacune et chacun de ses lecteurs déjà anticapitalistes peut rester dans son milieu ou sa « famille » politique tout en intégrant les vues que propose l’ouvrage. En définitive, le livre propose d’ajouter à l’expérience militante ou intellectuelle anticapitaliste une exigence supplémentaire de réflexivité et de tolérance vis-à-vis des autres traditions héritées du socialisme. Sans une telle évolution au sein des gauches, le risque de leur décomposition augmentera. Comme c’est le cas aujourd’hui, chacun brandit ses pratiques militantes, ses fétichismes politiques, comme une identité figée, il ou elle y trouve un confort subjectif et finit par faire de la morale plutôt que de la politique. Pour fréquentes qu’elles soient, de telles attitudes définissent ce que nous pourrions appeler un « semi-socialiste ».
Mais Wright était attentif à la question de la morale, des valeurs. Ce qui n’est d’ailleurs pas toujours très bien vu dans nos rangs : l’accusation de morale (bourgeoise), le rejet des valeurs (républicaines)…
Ce n’est pas parce qu’il y a un usage instrumental et néfaste de certaines valeurs que le mot « valeur » est à bannir. Le discours que propose Wright sur les valeurs socialistes n’a rien d’idéaliste. Il vient au contraire d’un raisonnement qu’autrefois on aurait qualifié de « matérialiste ». Wright observe de manière empirique et réaliste, comme nous, que les socialismes sont divisés malgré l’échec historique du communisme étatique. Un regard sur l’histoire politique nous enseigne par ailleurs que plus les socialistes perdent, plus ils se divisent. Regardez par exemple, même si c’est sans doute anecdotique, comment les individus de gauche les plus visibles passent un temps fou à s’invectiver sur les réseaux sociaux : ils sont certains de leurs certitudes, accrochés à leurs croyances comme à des totems. En France, certains critiquent ce qu’ils appellent les « gauches identitaires », mais ne sont-ils pas tout aussi « identitaristes » vis-à-vis d’abstractions idéologiques ou programmatiques et fétichistes de certains noms propres et de leurs appartenances ? Peut-être est-ce une exagération. Mais je ne le crois pas. Autrement dit, le problème de Wright quand il parle des valeurs socialistes, que j’ai évoquées au début de notre entretien, ce n’est pas de penser une unité a priori mais les conditions de possibilité d’une unité, non pas ex ante, mais ex post, des traditions socialistes.

[Raul Lazaro]
Pour lancer cette interrogation, son réflexe initial n’était pas de commencer par les « valeurs », mais par l’analyse de classes. Wright a commencé avec des recherches qui, d’une certaine manière, reposaient la question du « sujet historique » susceptible de porter la flamme du dépassement de l’Histoire. Mais il en a conclu, après plusieurs décennies d’observation, que la fragmentation des exploités est devenue trop grande pour qu’une telle subjectivation émerge, que les conditions sociales d’un partage de l’expérience vécue au travail ne sont pas ou plus remplies. Dès lors, se demande-t-il, quelles sont les autres conditions éventuelles de formation d’une force sociale anticapitaliste ? Pour lui, et c’est peut-être discutable, c’est dans l’ordre de l’imaginaire et surtout de l’éthique que cette unité peut apparaître. C’est-à-dire autour d’un système de valeurs et de dispositions partagé. Pas de recherche, donc, d’un « signifiant-maître » qui, comme chez Laclau et Mouffe, par exemple, aurait pour fonction d’unifier des groupes dominés autour du mot « peuple », avec un leader en plus… Pas de fantasme, non plus, du « programme commun » qui viendrait réconcilier les gauches et les porter au pouvoir. Pour moi, ces valeurs communes des socialistes relèvent plus précisément d’un ethos. Le mot est sans doute moins trompeur que celui de « valeurs ».
Comment se manifeste cet ethos socialiste qui pourrait permettre la constitution d’un bloc, d’un front ?
« Égalité, liberté, solidarité : ce ne sont pas tant des valeurs à revendiquer que des valeurs qui sont déjà là et qu’il est possible, nécessaire, de faire grandir. »
Ce sont des dispositions incarnées qui existent dans le monde social. Elles sont le produit d’une très longue histoire, dont les victoires anciennes ou pas toujours apparentes des gauches au siècle dernier ont fourni, à travers certaines politiques, les conditions de possibilité. Il y aurait aujourd’hui, autrement dit, grâce à cet héritage historique de longue durée des gauches, et malgré les décennies de néolibéralisme, plus de dispositions à l’égalité, à l’autonomie et à l’entraide dans le monde social qu’il y a un siècle — et ce même si celles-ci sont distribuées socialement de manière tout à fait inégale. La sociologie du socialisme passe donc par une sociologie des dispositions éthiques. Ce serait, en tout cas, une manière de prolonger le programme de Wright en adjoignant à une enquête sur les utopies réelles, une recherche sur l’ethos socialiste.
Il ne s’agit pas de brandir ces valeurs sur une pancarte…
Égalité, liberté, solidarité : on les fera grandir en les incarnant, en les pratiquant, là où chacun est situé. C’est aussi comme ça qu’il faut comprendre l’image de l’érosion du capitalisme.
Il y a chez Wright une logique de concaténation, d’enchaînement, d’effet domino. Ça peut partir de choses parfois minimes : la gratuité des transports en commun, par exemple. Malgré toutes vos mises en garde, en quoi n’est-ce pas… du réformisme ?
Il y a chez lui une attention aux changements que j’ai appelés « incrémentaux », aux petites différences historiques. Il propose de comparer les mécanismes de la transition socialiste à ceux qui ont prévalu lors d’une autre des transitions historiques thématisées par le marxisme : le passage du féodalisme au capitalisme. En utilisant les catégories de la transformation historique qu’il a proposée — interstitielle, symbiotique, rupturiste — et en essayant de voir comme elles ont interagi pour provoquer cette mutation qui ne s’est pas faite en un jour, qui est une somme de petites différences accumulées, de réformes, et aussi de moments de rupture. Pensons aussi à Max Weber. C’est quoi, l’éthique protestante ? Des petites sectes qui ont modifié quelques règles dans leur vie collective par rapport à celles de l’Église romaine. Weber n’a jamais eu la folie de penser que ces transformations avaient produit à elles seules le capitalisme. Il disait que c’était un paramètre — interstitiel ! Un changement moléculaire et extra-économique qui se fait suivant une temporalité à peine perceptible. Quoi qu’on pense de la validité empirique des thèses de Weber, c’est un exemple de théorisation, semblable à celle de Wright, où des changements incrémentaux se combinent pour produire des changements structuraux. La sortie du capitalisme ne se fera pas en trois jours. Si elle peut se faire…
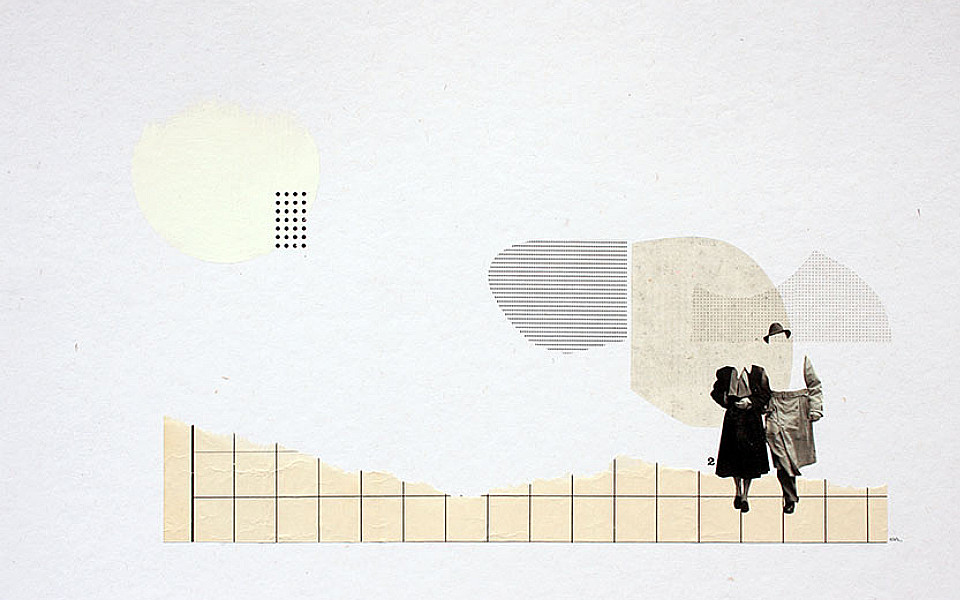
[Raul Lazaro]
Il n’y a donc pas de « petits » changements voués à rester… petits ?
On peut toujours dire : « l’économie sociale et solidaire, c’est l’idiot utile
du capitalisme », « les réformes social-démocrates de la fiscalité ou des conseils d’administration des entreprises, ce ne sont que des rustines », etc. Tout ceci est à la fois vrai et faux. Le problème, pour Wright, est de mieux connaître les effets anticipables de telles mesures et, d’une manière plus générale, la nature exacte des agencements sociaux afin d’apprendre à les faire basculer du côté du socialisme. On peut, selon lui, augmenter la part de socialisme dans tous les contextes. Par l’État, la révolution et les alternatives. Petites — les coopératives, l’économie sociale et solidaire —, ou plus à l’écart du monde capitaliste. Il n’y a pas de raison d’avoir un jugement a priori négatif sur ces expérimentations interstitielles : il faut qu’il y en ait plus, qu’elles se relient plus, qu’elles s’acceptent plus, qu’elles soient plus socialistes. C’est un programme minimal et pourtant exorbitant. C’est pour ça que je suis sceptique envers les constats hostiles aux alternatives existentielles, communautaires ou utopiques qui fleurissent chez des néoléninistes ou des paléo-communistes. Ça ne me paraît pas seulement une erreur analytique, du point de vue des sources du changement historique, mais aussi une erreur politique, du point de vue de l’attrait que peuvent rencontrer aujourd’hui ces pratiques alternatives, qu’elles soient socialistes ou écologiques.
Nous avons beaucoup parlé de classe, de capitalisme, mais on sait que d’autres facteurs d’oppression existent…
« On peut, selon Wright, augmenter la part de socialisme dans tous les contextes. Par l’État, la révolution et les alternatives. »
Si la question de l’unité des dominés, des exploités, de celles et ceux qui aspirent au socialisme, est la question sociologique première en vue d’une réflexion empirique sur la sortie du capitalisme, alors, dit Wright, oui, il y a plusieurs candidats, et pas que les ouvriers d’usines ou le prolétariat plus large. Son raisonnement est en substance le suivant : s’il y a des luttes de plus en plus grandes sur le thème du racisme, des violences policières, des discriminations, c’est parce que c’est une expérience non seulement commune, mais partageable, plus, peut-être, que ne le sont devenues d’autres expériences de domination pourtant centrales pour la théorie critique du capitalisme. On peut aussi faire l’hypothèse, en prolongeant Wright, qu’à partir du tournant autoritaire du néolibéralisme que nous traversons actuellement, ces expériences risquent bien d’être de plus en plus importantes.
Dans votre postface, vous amenez une réflexion singulière, qui postule que Wright, par son refus d’une avant-garde éclairée, est un remède au « point de vue viriliste » qui peut perdurer dans les courants socialistes !
Si le léninisme n’est plus la stratégie située au centre de gravité de la politique de sortie du capitalisme, s’il y en a plusieurs, ainsi que Wright le propose, alors effectivement il n’est pas nécessaire de se représenter l’Histoire avec des gens qui sont aux avant-postes et d’autres qui suivent. Ce qu’il en ressort du point de vue du rapport genré au monde, c’est une détermination orthogonale ou opposée à ce que la subjectivation masculine a incarné dans les mouvements d’émancipation anticapitaliste : un doute envers la domination masculine et toutes les traductions tactiques et stratégiques du virilisme, un doute envers la définition même de la stratégie comme affaire guerrière ou quasi-militaire et donc essentiellement masculine. C’est une très bonne nouvelle.
Illustration de bannière : Israel. G Vargas
Photographie de vignette : Jean-François Robert | Télérama
- Qui comprend des théoriciens comme Gérald Allan Cohen, John Roemer, Jon Elster, Philippe Van Parijs, Adam Przeworski [nda].[↩]
- On peut penser, entre autres, au socialisme romantique de William Morris, aux anarchistes naturiens de la fin du XIXe siècle et à plusieurs autres socialistes : les derniers livres de Serge Audier l’ont fort bien démontré [nda].[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Gustav Landauer : un appel au socialisme », Renaud Garcia, 13 janvier 2020
☰ Lire notre entretien avec Frédéric Lordon : « Rouler sur le capital », novembre 2018
☰ Lire notre entretien avec Christian Laval : « Penser la révolution », 16 mars 2018
☰ Lire notre entretien avec Miguel Benasayag : « Il ne faut pas traiter les gens désengagés de cons », avril 2018
☰ Lire le texte inédit de Daniel Bensaïd, « Du pouvoir et de l’État », avril 2015
☰ Lire notre article « Le socialisme de Victor Serge », Susan Weismann, novembre 2014