En 1991, l’essayiste étasunienne Janet Biehl faisait paraître son livre Rethinking Ecofeminist Politics : une critique résolue du mouvement écoféministe. Bien que consciente de la diversité des courants qui traversent ce dernier, l’autrice y perçoit un renoncement global à certains des idéaux du féminisme. Dans l’extrait que nous traduisons ici, Biehl dénonce tout particulièrement la réhabilitation de l’oikos — la maison —, du « foyer » et du « care » pour mieux louer la Cité, la chose publique, bref, la politique, entendue sous sa plume comme radicalement démocratique et écologique. Face à ce qu’elle perçoit comme des « replis mystiques régressifs » et un « dénigrement direct ou indirect de la raison », l’écologiste sociale enjoint à travailler à « un ensemble d’idées antihiérarchique, cohérent, rationnel et démocratique ».

« Pour l’essentiel, les écrits écoféministes sont remarquablement dépourvus de références à la démocratie. »
Mais contrairement à l’idéologie du XIXe siècle, la plupart des écoféministes ne cherchent pas à confiner littéralement les femmes dans la sphère domestique au sens de l’oikos, de « la maison ». Elles cherchent plutôt à étendre le concept de « sphère féminine » comme foyer, pour englober et absorber la communauté dans son ensemble. Selon l’écoféministe Cynthia Hamilton, « les femmes sont plus susceptibles que les hommes de s’occuper des affaires [de la communauté] précisément parce que le foyer a été défini et prescrit comme un domaine réservé aux femmes2 ». Ainsi, l’une des clés de voûte de l’analyse écoféministe est que le foyer et la communauté — comme lieu de la lutte écologique — sont particulièrement appropriés pour les femmes. […] Bien que le mot grec oikos signifiait à l’origine « maison », il faut rappeler que le ménage seul ne constituait pas davantage la communauté grecque que la polis seule. La communauté grecque s’est formée par la fusion de la polis avec l’oikos, dans laquelle la première reposait sur la seconde, tout en la méprisant. Ainsi, les écoféministes ne peuvent pas passer si facilement de l’« oikos » à la « communauté ». Toute communauté doit avoir un domaine public — où les questions générales sont prises en compte — ainsi qu’un domaine plus intime d’éducation des enfants et de relations familiales. Par conséquent, l’écoféministe Cynthia Hamilton a tout à fait raison d’appeler à une « démocratie participative directe ». Sans ce cadre général de démocratie participative directe, la vie de la communauté court le risque de devenir aussi oppressante qu’elle a pu l’être autrefois, quand bien même elle serait intimement liée et intégrée au tissu du monde naturel.
Mais, pour l’essentiel — à l’exception de voix isolées comme celle de Hamilton —, les écrits écoféministes sont remarquablement dépourvus de références à la démocratie. L’approche la plus courante ignore complètement la question de la polis et se focalise sur les présumés « valeurs féminines » de l’oikos. Ainsi, bien que ces écrits soient remplis de discussions sur l’« unité », la « vitalité », les « déesses », et l’« interconnexion », ils n’offrent qu’une vision très limitée des processus démocratiques qui peuvent empêcher ces nouvelles valeurs « écologiques » de transformer les communautés en tyrannies, comme elles ont pu le faire historiquement […], ou d’empêcher la vie en communauté de se dégrader en esprits de clocher oppressifs, comme cela a aussi été le cas historiquement3. Des institutions démocratiques clairement établies et distinctes, en tant que « formes de liberté » spécifiquement humaines (pour reprendre l’expression de Bookchin), sont essentielles à une communauté émancipatrice — plutôt que répressive. […]
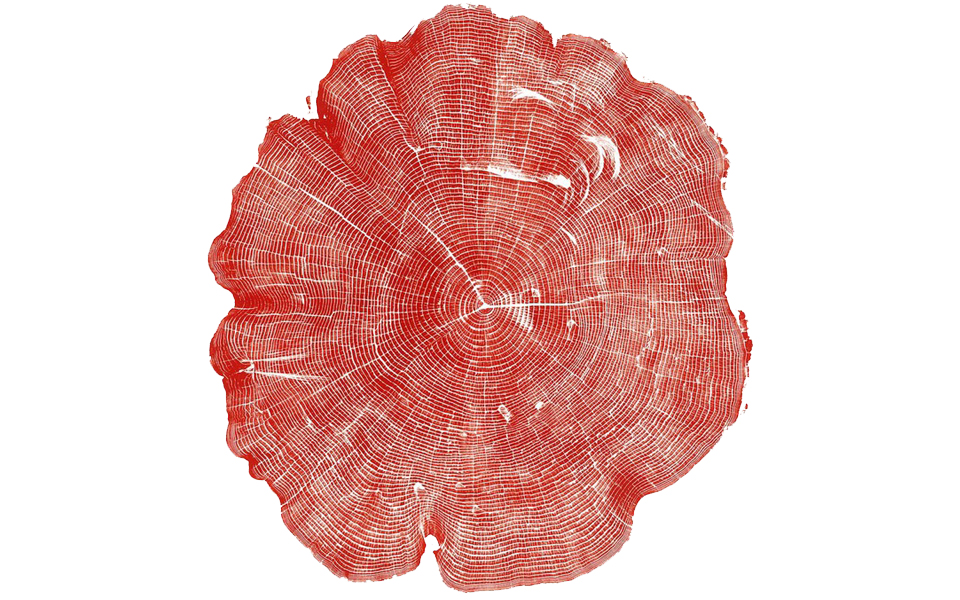
[Bryan Nash Gill | www.bryannashgill.com]
Les nombreuses écoféministes qui ignorent complètement le sujet de la démocratie semblent penser que les « valeurs féminines » de « care et d’éducation » constituent une alternative pleine d’empathie naturelle à l’idéal démocratique, supposé froid, abstrait, individualiste et rationaliste — voire carrément « masculin ». Par exemple, l’ethos de la maternité constitue un « paradigme » pour l’écoféministe Arisika Razak, puisque « la naissance est le premier événement sacré ». Pour Razak, « la naissance est un aspect central et tellement universel de l’existence humaine qu’elle peut servir de noyau autour duquel bâtir un paradigme pour une interaction humaine positive… Si nous commencions par prendre soin des jeunes avec amour et que nous étendions cela à une sollicitude sociale pour tous et à une préoccupation individuelle pour la planète, nous aurions un monde différent. Si nous comprenions et célébrions la naissance, nous… retrouverions l’importance de l’amour, de la chaleur et de l’authentique interaction humaine ». Nous pourrions apparemment atteindre l’idéal écologique d’une communauté plus humaine et plus solidaire en revalorisant l’ethos de la sphère domestique, de l’oikos, plutôt qu’en nous consacrant à une polis supposément impersonnelle. Il semblerait que l’ethos de l’oikos puisse en quelque sorte transcender le besoin même d’une polis, comme si valoriser le « care » et « l’éducation » rendait l’arène politique inutile […]. On pourrait finalement supposer que si l’oikos constitue la communauté, la vie politique n’est pas nécessaire.
« L’oikos a fourni un foyer non seulement aux chasseurs, aux cueilleurs et aux fermiers, mais aussi aux guerriers, aux rois et aux tyrans patriarcaux. »
Le fait que les écoféministes se réfèrent souvent à la tradition démocratique occidentale de manière péjorative s’avère pour le moins inquiétant. Au regard de la bureaucratisation massive de ce qui passe aujourd’hui pour la « vie politique » — l’État-nation —, il est compréhensible que les écoféministes plaident pour une approche plus personnelle et « attentionnée » de la vie en communauté. Peu d’écologistes radicaux — et certainement pas les tenants de l’écologie sociale — seraient en désaccord avec cet appel en faveur d’une approche bienveillante. Mais leur glorification de l’oikos et de ses valeurs en tant que substitut de la polis et de sa politique peut facilement être interprétée comme une tentative pour dissoudre le politique dans le domestique, le civil dans le familial, le public dans le privé. Tout comme certaines institutions étatiques bureaucratiques semblent se dresser devant nous, mettant en péril notre liberté, il y a un risque que l’oikos se dresse devant nous, mettant en péril notre autonomie. L’oikos, ou le foyer, n’est en aucun cas le talisman magique qui fournira le cadre d’un monde bienveillant. Non seulement il est souvent borné, replié sur lui-même et incestueux, mais il peut aussi produire — comme il l’a fait dans l’Histoire — des sentiments opposés à ceux que les écoféministes prônent. L’oikos n’a en effet pas uniquement été le domaine des femmes, mais aussi celui des hommes : il a fourni un foyer non seulement aux chasseurs, aux cueilleurs et aux fermiers, mais aussi aux guerriers, aux rois et aux tyrans patriarcaux.
En mystifiant l’oikos, en ignorant ou critiquant, comme elles le font, la tradition démocratique occidentale, les écoféministes laissent penser qu’elles ignorent certains des terribles aspects sociaux que l’oikos a historiquement produit. D’autres féministes ont compris depuis longtemps que l’oikos était le monde de l’enfermement, de l’économie domestique, contre lequel elles ont âprement et courageusement lutté, cherchant à échapper au locus classicus [« modèle classique »] du patriarcat, au même titre que l’oikos grec lui-même. Elles recherchaient un monde allant au-delà de l’éducation des enfants, de la préparation des repas et du « bonheur » conjugal. En bref, elles voulaient devenir des participantes à part entière de la société — des citoyennes — et non rester des robots domestiqués. L’une des caractéristiques les plus régressives de l’écoféminisme en général est peut-être que même s’il condamne le patriarcat, il cherche à ramener la société à l’oikos d’une manière qui ignore ses dimensions oppressives et asphyxiantes, et avec quelle facilité les hommes ont fait de l’oikos leur propre domaine souverain. […]

[Bryan Nash Gill | www.bryannashgill.com]
Le public et le privé dans l’Histoire
[À] la lumière de l’Histoire, glorifier la sphère domestique des femmes comme celle du care et de l’éducation sans souligner à quel point elle pouvait facilement être exploitée par les hommes ou, pire, devenir un refuge pour le guerrier fatigué, revient à mystifier la relation du domestique au public — supposément du « monde des femmes » à celui des hommes. Car si les sociétés de lignage s’occupent des leurs et peuvent donc être considérées comme bienveillantes, rien dans l’ethos des systèmes de parenté — ou dans la sphère familiale, d’ailleurs — n’empêche l’émergence de systèmes de classification biologique selon l’âge, le genre et les liens du sang. Même « l’éthique du care » néolithique4 n’a pas pu empêcher ce développement […]. Paradoxalement, le care est d’ailleurs remarquablement compatible avec la hiérarchie. Une éthique du care maternelle ne constitue donc pas en soi une remise en cause de la hiérarchie et de la domination.
« Malgré les limites qui l’ont gravement entachée, la polis démocratique athénienne s’est constituée comme une réponse relativement égalitaire à de nombreuses hiérarchies. »
L’émergence de la famille patriarcale — dans laquelle le père, et non la mère, dirige — a précisément eu lieu au sein du domaine domestique. Dans l’Athènes antique, c’était bien sûr le père, et non la mère, qui régnait dans l’oikos. Les premiers esclaves étaient peut-être des femmes « tisseuses » et des servantes, que les patriarches mettaient au service de leurs épouses et de leurs familles. Et ce sont les classifications biologiques de la société tribale organique qui ont servi de justification à la hiérarchisation et au renforcement du pouvoir, comme dans beaucoup de sociétés du monde antique. L’Égypte, par exemple, n’était pas un État « politique » au sens où on l’entend aujourd’hui — c’était un oikos étendu et surdimensionné. Le mot même de « pharaon » signifie « grande maison » et, dans cette « grande maison », la hiérarchie établie par la société tribale a non seulement été conservée mais encore exacerbée, et mystifiée dans une théocratie en devenir. Par ailleurs, comme la richesse était en général accumulée dans les sociétés premières, elle était conservée dans les oikos domestiques du fait de sa transmission par les liens de parenté. C’est le lien du sang qui sous-tendait alors et continue de sous-tendre les lignées aristocratiques — gardant la richesse dans le foyer de familles privilégiées. […] Ainsi, le mot oikos a au moins deux sens : il peut bien sûr signifier le foyer — la sphère domestique —, comme le soutiennent les écoféministes ; il peut aussi signifier l’économie. C’est l’« oikos » des intérêts privés du capital qui a libéré d’immenses forces productives et qui est maintenant utilisé pour causer les ravages que l’on connaît dans la biosphère et dans la société. Ironiquement, l’« oikos » de l’économie est en train de détruire l’« oikos » de l’écologie.
Le domaine public
Si le domaine privé a des sens différents — allant du « foyer » à la fortune familiale des capitalistes —, le domaine public a lui aussi un double sens : « l’État » et « le régime démocratique ». L’intervention de l’État dans le domaine public a produit les énormes bureaucraties centralisées auxquelles nous sommes habitués aujourd’hui, lesquelles déshumanisent les gens et protègent les intérêts privés du capital. Bien que, de nos jours, nous associions le domaine public exclusivement à l’État, ce dernier n’est qu’une forme particulière de domaine public. En outre, une autre forme de domaine public peut légitimement être qualifiée de politique, dans le sens démocratique qu’elle avait à l’origine en grec, à savoir la gestion de la polis. C’est en effet ce type de domaine politique qui a émergé, en particulier à Athènes, pour remettre en cause les intérêts des privilégiés et du pouvoir, et non pour les protéger. Malgré les limites qui l’ont gravement entachée — patriarcat, esclavage —, la polis démocratique athénienne s’est constituée comme une réponse relativement égalitaire à de nombreuses hiérarchies qui s’étaient établies dans les domaines public comme privé avant elle. Pour les philosophes grecs classiques, l’oikos sur lequel reposait et dépendait le corps civique était le domaine du particulier, tandis que la polis était, comparativement, le domaine de l’universel, de la législation publique et des procès jugés équitablement entre pairs. Le domaine politique — réservé aux hommes — était considéré comme étant plus universaliste que l’oikos, s’intéressant aux affaires de la communauté dans son ensemble. La polis démocratique athénienne considérait dès lors les intérêts privés comme particularistes, qu’il s’agisse des riches aristocrates ou des revendications de l’oikos domestique lui-même.
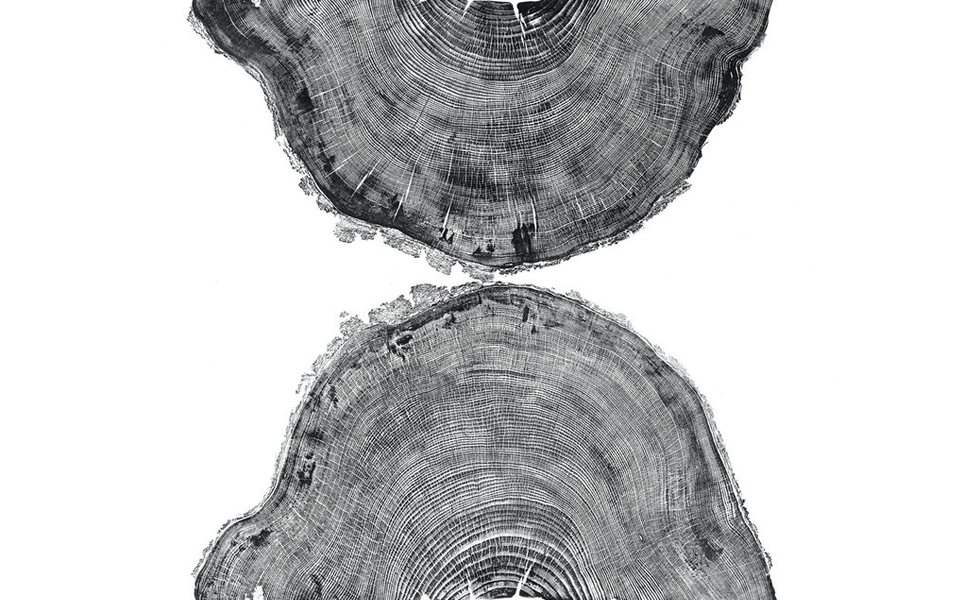
[Bryan Nash Gill | www.bryannashgill.com]
De toute évidence, la polis démocratique athénienne n’a pas remis en cause la hiérarchie qui existait au sein de ses propres oikoi et n’a donc pas réalisé tout le potentiel de sa propre innovation. Elle excluait également des personnes de la citoyenneté — pas seulement les femmes, mais aussi les esclaves, les hommes grecs d’autres cités et les résidents étrangers. Mais ce que les Athéniens considéraient comme universel, transcendant la parenté entre tous les peuples étaient les mêmes attributs qui selon eux rendaient les citoyens politiquement égaux : la capacité humaine de la raison. Il faut d’ailleurs souligner que la possibilité d’inclure tout le monde dans la citoyenneté était présente dans le cadre démocratique élaboré par les Athéniens, même si elle n’a pas été réalisée. […] À l’inverse, l’émotion du « care » n’est pas quelque chose que l’on peut véritablement étendre à « tous », comme Razak l’affirme. Même les êtres humains les plus attentionnés ne peuvent étendre le care à tout le monde. En tant qu’émotion, le care ne peut être universalisé pour servir de base à une organisation sociale au-delà du cercle social restreint et propre à chacun, qu’il soit fondé sur la parenté ou non. La sollicitude qu’une mère (ou un père) porte à un enfant ne peut pas non plus être universalisée — que l’on « pense comme une montagne » ou que l’on « s’autorise à être un arbre5 ». Les individus peuvent certainement parvenir à une reconnaissance universelle de leur humanité commune — comme en témoignent nos préoccupations quant au sort des personnes qui subissent des catastrophes de par le monde. Mais ils ne peuvent guère connaître tous les êtres humains du monde ou se soucier personnellement de toutes les personnes inconnues de la même façon qu’une mère prend intimement soin d’un enfant ou de membres de sa famille. Vouloir prendre soin de « tout le monde » ferait du care un concept si large qu’il en deviendrait flou et perdrait son sens.
« En tant qu’émotion, le care ne peut être universalisé pour servir de base à une organisation sociale au-delà du cercle social restreint et propre à chacun. »
Le care n’est pas anti-hiérarchique en soi, pas plus que les systèmes de parenté ne l’étaient. L’idéal de l’« amour maternel » n’est pas intrinsèquement démocratique, comme l’a souligné Mary Dietz, et ne favorise pas davantage la liberté. « Il n’y a pas de raison de penser que l’amour maternel implique nécessairement un engagement dans les pratiques démocratiques », remarque-t-elle, « et il n’y a pas non plus de bonnes raisons d’affirmer qu’un principe comme “le souci pour la vulnérabilité de la vie humaine”… inclue par définition une défense de la citoyenneté participative. Un despotisme éclairé, un État providence, une bureaucratie à parti unique et une république démocratique peuvent respecter les mères, protéger la vie des enfants et faire preuve de compassion envers les personnes vulnérables6. » Non seulement le care est compatible avec la hiérarchie, quand bien même il serait lié d’une manière ou d’une autre à la « nature féminine » — ou masculine d’ailleurs — mais il est dépourvu de toute forme institutionnelle. Il repose simplement sur l’espoir fragile que tous les individus seront disposés à « prendre soin ». Mais les individus peuvent tout aussi facilement se mettre à s’occuper d’autrui et cesser de le faire. Ils peuvent pratiquer le care à leur guise. Ils peuvent ne pas le faire suffisamment. Ils peuvent se soucier de certains mais pas d’autres. Dépourvu de forme institutionnelle et dépendant de la volonté individuelle, le care est un fil bien ténu sur lequel fonder une vie politique émancipatrice.
Créer une nouvelle sphère politique
L’écologie sociale fait une distinction entre d’une part l’appareil d’État, en tant que système de gestion du domaine public au moyen d’administrateurs professionnalisés et leur monopole légal de la violence, et d’autre part, la politique comme gestion de la communauté sur des bases démocratiques en relation directe avec des instances citoyennes. Le municipalisme libertaire relevant de l’écologie sociale offre un cadre propice à la reconstruction de la vie politique en tant que processus démocratique participatif. Ce faisant, la sphère politique est non seulement préservée et largement étendue, mais le concept de politique est redéfini pour que la prise de décision soit aussi proche que possible du peuple — c’est-à-dire au niveau le plus élémentaire qui soit politiquement accessible, comme les assemblées populaires. La lutte contre les intérêts privés qui détruisent la biosphère doit être une lutte politique en ce sens. Elle doit être organisée autour de la création de ce nouveau champ politique agonistique qu’est la démocratie participative directe. On ne saurait minimiser l’importance d’une sphère publique dynamique pour les politiques écologiques. Seule l’élimination du capitalisme et de l’État-nation — en définitive, la restructuration de la société dans des communes décentralisées et coopératives — rendra possible une vie publique et privée saine et engagée. Le champ politique démocratique — par opposition au domaine public d’État — est le seul ayant le pouvoir de combattre à la fois les intérêts privés qui détruisent la biosphère et les hiérarchies politiques qui dégradent et instrumentalisent les êtres humains. En retirant la polis de la communauté au profit de l’oikos, les écoféministes semblent éliminer la seule sphère qui peut sérieusement remettre en cause la hiérarchie à la fois dans les domaines public et privé : la politique démocratique participative. […]
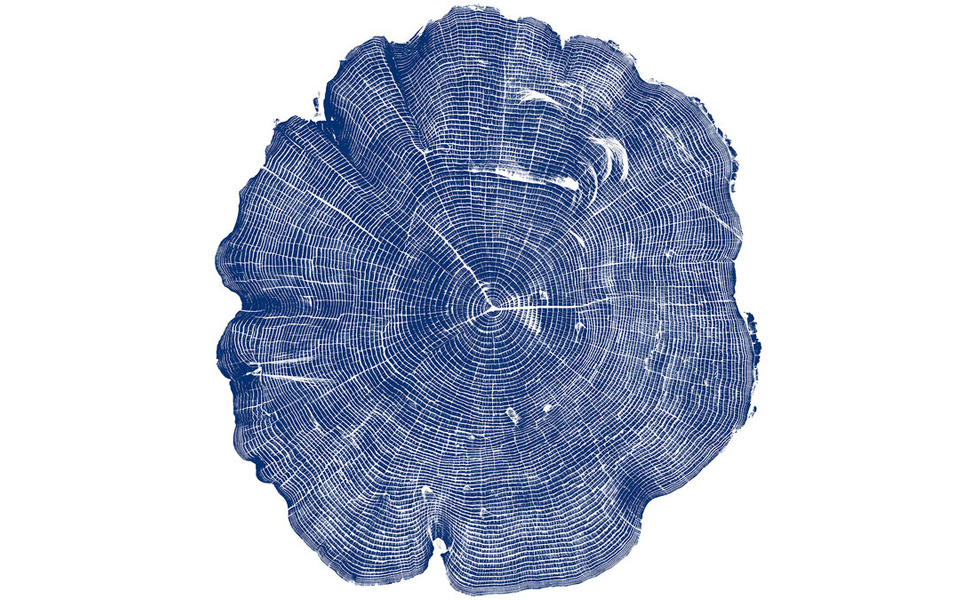
[Bryan Nash Gill | www.bryannashgill.com]
Les valeurs, relations et pratiques nécessaires à la démocratie participative ne sont pas « mâles » ou « masculines » mais humaines. En tant que créatures politiques, les êtres humains peuvent gérer les affaires de la communauté de manière à ce que les individus qui la composent puissent s’épanouir. Les actions politiques dépendent de la volonté de citoyens lucides, critiques, et déterminés à se battre pour des principes — parfois au-delà de leurs besoins personnels. Au lieu de chercher à remplacer les valeurs de la polis par celles d’un oikos qui les a historiquement opprimées, les femmes des mouvements écologistes doivent s’impliquer en politique dans une perspective véritablement libératrice et y revendiquer leur citoyenneté. Elles doivent enfin sortir de l’oikos — qu’il s’agisse de l’oikos au sens littéral du foyer ou de l’oikos au sens figuré des « valeurs féminines » — et s’efforcer de développer l’éventail complet de leurs aptitudes humaines. Cela ne signifie pas que les femmes cessent d’être des femmes, leur singularité et leurs qualités propres étant pleinement reconnues, mais qu’elles dépassent les restrictions étouffantes que la société patriarcale a longtemps fait peser sur le développement de leurs capacités en tant que personnes.
L’Histoire réfute clairement toute allégation selon laquelle les femmes seraient inadaptées à la vie politique, ou que l’idéal démocratique occidental serait irrémédiablement compromis du fait qu’il est issu d’une culture sexiste. En réalité, la logique même de la démocratie nécessite l’inclusion des femmes, en dépassant toute opposition d’un oikos « féminin » à une polis « masculine ». L’implication décisive et massive des femmes dans les mouvements sociaux, dans le travail politique de terrain et dans les révolutions — comme dans la Révolution française et la Commune de Paris de 1871 — a depuis longtemps étendu le périmètre de leur inclusion dans le domaine politique. Nous devons préserver ces héritages de révolte politique et chercher à les étendre avec la pleine participation non seulement des femmes, mais aussi des personnes de couleur et tous les autres groupes auparavant exclus. Les pratiques et les valeurs démocratiques ne sont intrinsèquement ni liées au genre ni à la race. En fait, leur logique même exige une communauté d’être humains plus inclusive que toutes celles que nous avons connues par le passé […] Les « formes de liberté » locales, ô combien nécessaires dans une société écologique qui aurait mis fin à toute domination (assemblées de quartier, réunions municipales ou associations confédérales), perdent toujours plus de terrain, ceci au profit des gouvernements étatiques centralisés. Les gouvernements européens et américains s’étant de plus en plus centralisés au cours du dernier siècle, la vitalité de la vie politique locale n’a cessé de se réduire. Il faudra se battre pour que survivent des institutions démocratiques de base, ou même pour les créer là où elles n’existent pas. Dans cette période de privatisation massive, nous ne pouvons pas permettre que ce qui subsiste de la sphère politique démocratique soit souillé par des penchants privatistes, particularistes, ou repliés sur l’oikos. Nous devons nous réapproprier la tradition politique de la démocratie radicale, nous battre pour la préserver et la généraliser.
Traduit de l’anglais par Lora Mariat et Léonard Perrin, pour Ballast.
Photographies de bannière et de vignette : Bryan Nash Gill | http://www.bryannashgill.com
- Judith Plant, « Searching for Common Ground: Ecofeminism and Bioregionalism », I. Diamond and G. F. Orenstein, Reweaving the World, p. 160 ; Catherine Keller, « Women Against Wasting the World : Notes on Eschatology and Ecology », I. Diamond and G. F. Orenstein, op. cit., p. 262.[↩]
- Cynthia Hamilton, « Women, Home, and Community: The Struggle in an Urban Environment », I. Diamond and G. F. Orenstein, op. cit., p. 217. Biehl souligne [ndlr].[↩]
- Dans un passage précédent, Biehl écrit : « Une communauté décentralisée, conçue abstraitement et sans égard pour la démocratie et le confédéralisme, peut aussi bien devenir régressive […]. L’homophobie, l’antisémitisme, le racisme peuvent, tout autant que le sexisme, faire partie d’une ethos
communautaire
et d’un esprit de clocher qui ne s’oppose en rien à l’histoire problématique des prescriptionsnaturalistes
d’infériorité
ou deperversion
qui sont appliquées à certains groupes de personnes. Ainsi, l’ethos communautaire a une histoire répressive et excluante qui ne peut pas être ignorée. Étant donnée cette histoire de la communauté, il est donc nécessaire que le mouvement écologiste en général se pose sérieusement la question de la manière dont il va construire une communauté au sens libératoire du terme. » [ndlr][↩] - Pour Biehl, de nombreuses écoféministes voient dans le début de la période néolithique un « âge d’or », celui d’une société tournée vers les femmes, pacifique, où règnerait l’égalité entre les genres et le respect de la nature. Biehl critique et réfute cette position dans le chapitre « The Neolithic Mystique » [ndlr].[↩]
- L’expression, citée dans un chapitre précédent du livre de J. Biehl, est de Deena Metzger (« Invoking the Grove », dans J. Plant, Healing the Wounds: the Promise of Ecofeminism, 1989, p. 124) [ndlr].[↩]
- Mary D. Dietz, « Context Is All: Feminism and Theories of Citizenship », Daedalus (Fall 1987), p. 1–24, 15.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « L’écoféminisme : qu’est-ce donc ? », Game of Hearth, mars 2020
☰ Lire notre article « Écologie : socialisme ou barbarie — par Murray Bookchin », mars 2020
☰ Lire notre entretien avec Daniel Tanuro : « Collapsologie : toutes les dérives idéologiques sont possibles », juin 2019
☰ Lire notre entretien avec Pierre Charbonnier : « L’écologie, c’est réinventer l’idée de progrès social », septembre 2018
☰ Lire notre entretien avec Janet Biehl : « Bookchin a été marginalisé », octobre 2015


