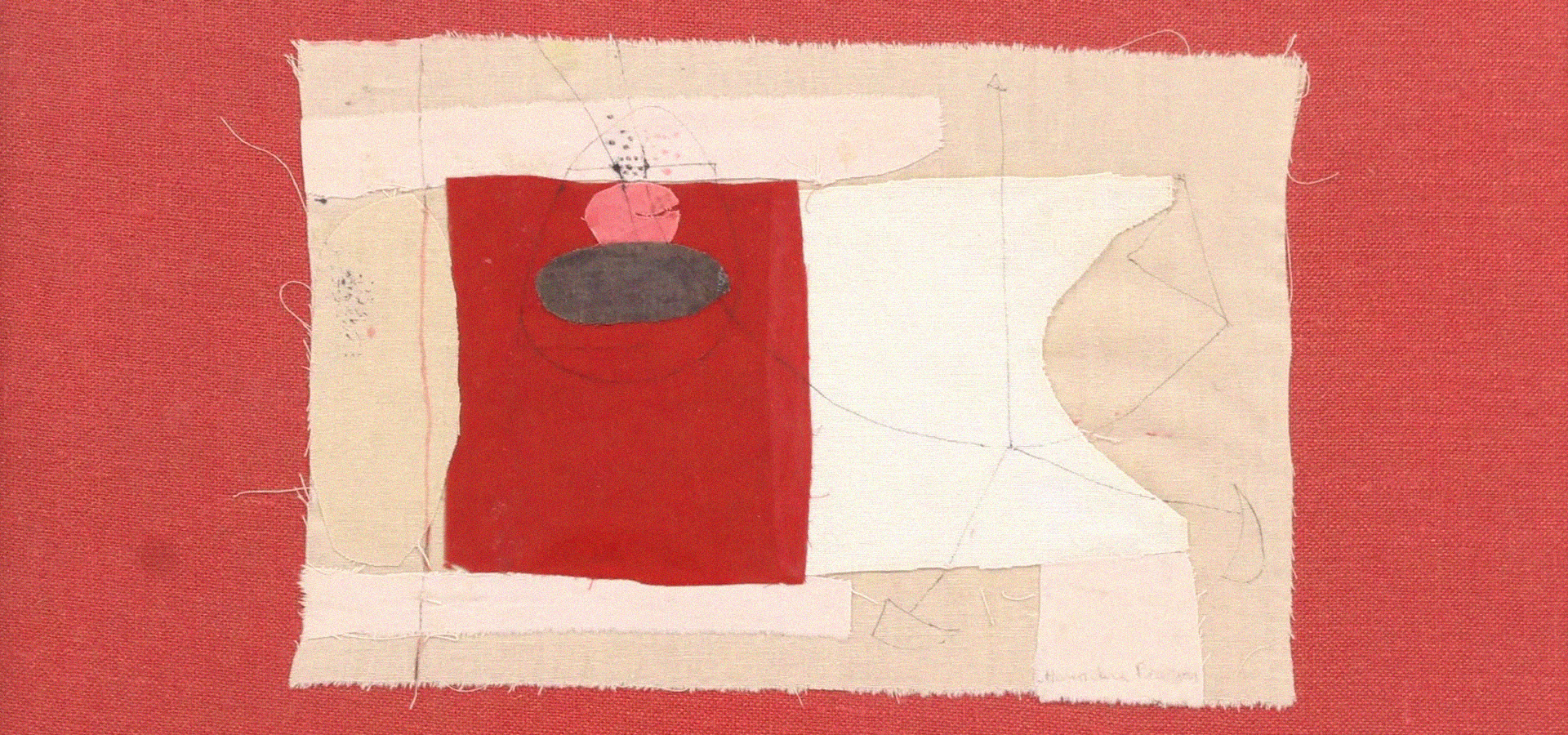Texte inédit pour le site de Ballast
Quatre ans avant que n’éclate la Commune — ou, devrait-on bien plutôt dire, les Communes —, Paule Minck fonde la Société fraternelle de l’ouvrière. L’an 1871 venu, elle ouvre une école, anime des clubs révolutionnaires et prend sa part dans l’organisation des services ambulanciers. Elle a 31 ans ; elle est socialiste et féministe, ou féministe et socialiste ; c’est tout comme. « [A]vec [l’idée socialiste] marche l’émancipation de la femme », dit-elle ainsi. Du moins en théorie… Versailles fond sur la Commune de Paris et la communarde s’exile. Elle disparaîtra en 1901, après s’être engagée au sein du Parti ouvrier français. De son vivant, un périodique suisse évoqua, pour déplorer « la révolution des femmes », « deux mégères de distinction : Louise Michel et Paule Minck ». Si la première a aujourd’hui tout de la légende, la seconde n’a pourtant l’attention que des spécialistes. Peut-être cela changera-t-il : en 2021, à l’occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris, un jardin public a pris son nom dans la capitale. Portrait de la militante et journaliste. ☰ Par Élie Marek
11 décembre 1880. Observons les menus événements du jour. Et, comme si l’on prenait un journal à l’envers, commençons par les nouvelles littéraires — la politique suivra. Dans Le Figaro, sur trois larges pages, Émile Zola exhibe ses souvenirs de Gustave Flaubert, décédé quelques mois plus tôt1. Dans les premières lignes, le romancier se souvient d’une visite récente faite à l’écrivain en compagnie de quelques amis — Goncourt et Daudet, leur éditeur Charpentier. Sans doute ces hommes-là ont-ils eu un mot, sur la route ou devant une grande cheminée normande, pour l’amnistie que certains députés demandent depuis quelque temps à accorder aux communard·es, neuf années après l’écrasement de l’insurrection ; sans doute ont-ils moqué ou déploré l’entreprise, la voix de l’un plaidant mollement la cause sociale pour mieux soutenir la République bourgeoise enfin achevée2 ; sans doute sont-ils rapidement passés à autre chose, eux qui n’ont su écrire que des injures durant l’insurrection3.
« Une foule s’est déplacée pour écouter les deux communardes de retour, elles et l’infatigable Blanqui qui les accompagne, quelques mois avant sa mort. »
Laissons ces messieurs et penchons-nous sur les politiciens en question. Ferry et Gambetta jouent aux chaises musicales dans les institutions républicaines. Alors, le premier préside le Conseil des ministres et le second la Chambre des députés ; portefeuilles et strapontins s’échangent chaque mois entre les mêmes barbes brunes ou grises ou blanches. Parmi les récentes mesures, Gambetta a pris le temps de se prononcer en faveur de l’amnistie au seuil de l’été et, depuis peu, les insurgé·es de la Commune reviennent à Paris4. Avec eux, revient la crainte du désordre, car on rentre de Suisse, d’Angleterre et de Belgique, où les gouvernements libéraux ont fait mine d’ignorer la couleur politique des exilé·es dix années durant, comme on rentre de Nouvelle-Calédonie ou plutôt de ses bagnes, où plus de quatre mille hommes et femmes ont été déporté·es. Le retour de quelques femmes, surtout, anime les passions : deux d’entre elles, nous le verrons, n’ont pas fini de faire parler.
La politique, encore — mais bien autrement. Ce même samedi de décembre, au 3 rue d’Arras, dans le Ve arrondissement de Paris, on se presse pour écouter certain·es de ces agitateurs et agitatrices enfin de retour d’exil, de déportation ou de prison. Une photo bien connue, qui a peut-être été prise ce jour, montre trois participantes. À gauche, assise, Marie Ferré, compagnonne dévouée de Louise Michel et révolutionnaire aguerrie. Il ne lui reste que deux années à vivre et ce soir-là, c’est elle qui tient la caisse à l’entrée de la salle. À ses côtés, debout au centre de l’image, le regard posé hors du cadre, voici Louise Michel, justement. À droite, une main posée sur l’épaule de sa voisine, aussi connue que cette dernière alors — mais aujourd’hui oubliée — c’est Paule Minck5. De ces deux dernières, un journaliste écrira trois ans plus tard : « Si la révolution se fait, on pourra bien l’appeler la révolution des femmes, car elle aura été conduite par deux mégères de distinction, Paule Minck et Louise Michel6. » Une foule s’est déplacée pour écouter les communardes de retour, elles et l’infatigable Blanqui qui les accompagne, quelques mois avant sa mort7. Dans un coin, un agent de police prend des notes et rapporte que la salle est comble. Les interventions s’enchaînent, ponctuées d’applaudissements, de cris, tout cela au son des fanfares. Vient enfin le tour de Paule Minck. L’objet de son discours : « L’émancipation de la femme ». Un extrait d’une semblable prise de parole quelques années plus tard laisse deviner la teneur des propos : « L’idée socialiste fait de grands progrès dans les masses et avec elle marche l’émancipation de la femme, et nous espérons que le XIXe siècle ne s’éteindra pas sans que nous ayons obtenu satisfaction sur tous ces points et, pour cela, nous comptons sur la société future dont vous êtes ici les représentants8. » Un souhait, un appel, une exhortation, appelons cela comme on le veut, l’oratrice n’aura que faire des jugements : elle dédiera sa vie à plaider la cause des plus faibles, des salles parisiennes aux jardins du Nord, des rues marseillaises aux places du Var — partout où on la demande et ce sans craindre l’opprobre.
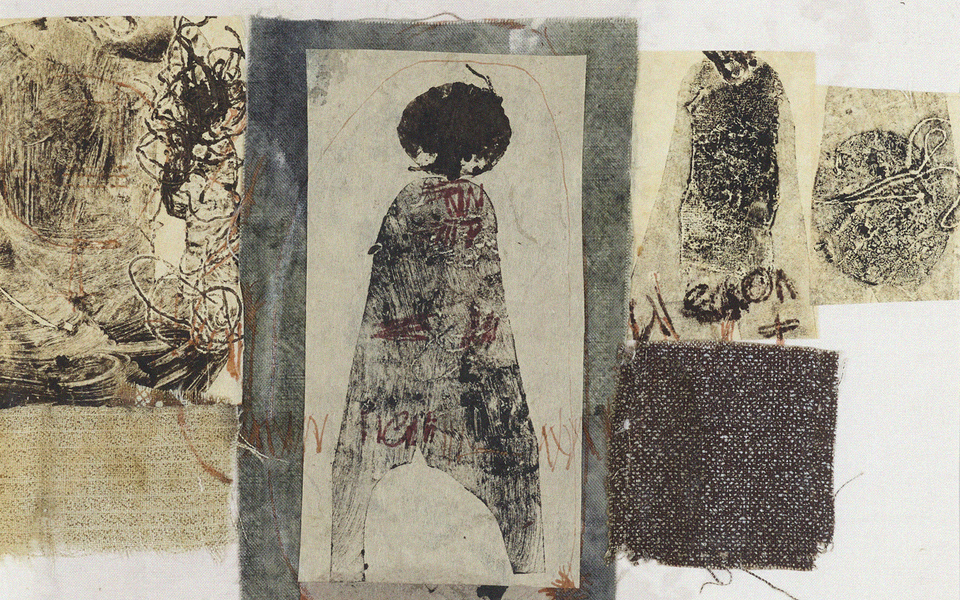
[Hannelore Baron]
Inépuisable propagandiste du socialisme, instigatrice d’un féminisme révolutionnaire, figure de la Commune : pourquoi a‑t-on oublié Paule Minck ? Un de ses contemporains, le bibliophile Firmin Maillard, peu amène à l’égard de l’émancipation des femmes, a consacré plusieurs pages à la révolutionnaire. Il y note : « Si Louise Michel est une planète dans le ciel flamboyant de la Commune, Paule Minck est une étoile de première grandeur ; comme écrivain, comme institutrice et comme conférencière, elle ne me paraît pas inférieure à Louise Michel ; même rouge bon teint, mêmes doctrines, mêmes théories et surtout même enthousiasme, seulement elle est plus vivante et donne moins dans le vague que sa compagne. Cependant, sa popularité est moindre… pour des causes diverses que je ne veux point analyser ici9. » Un siècle plus tard, l’historien Alain Dalotel reprend là où Maillard s’était arrêté, et tente d’élucider les causes de cet oubli : « Peut-être parce qu’elle ne pouvait être rattachée au marxisme. Peut-être parce que son côté insurgé paraissait dépassé. Ou tout simplement parce qu’elle était une femme10. » L’argumentaire, néanmoins, reste léger ; les précautions affleurent à chaque mot. À explorer plus avant le parcours de la communarde, les intuitions de l’historien se confirment mais méritent d’être précisées. Le socialisme de Minck était indépendant et teinté d’anarchisme, oui ; la colère de la militante n’a jamais faibli malgré les attaques, certes ; son statut social, conditionné en partie par son genre, l’a contrainte à élever la voix plus que l’aurait fait un autre, c’est certain. Mais pour autant, est-ce que ce sont des raisons suffisantes pour justifier de l’avoir perdue de vue si longtemps ? Posons à nouveaux frais la question : pourquoi donc Paule Minck fut-elle oubliée ?
*
« On remarque surtout la citoyenne Paule Minck, petite femme très brune, un peu sarcastique, d’une grande énergie de parole. »
Si elle voit le jour en novembre 1839 à Clermont-Ferrand, son acte de naissance politique date quant à lui de l’année 1868. Les commentateurs de l’époque — journalistes, agents de police, révolutionnaires — en ont laissé quelques traces. Cette année-là, cinq interventions commencent à la faire connaître. Depuis peu, en effet, le droit de réunion a été assoupli et l’on se rassemble en nombre pour parler d’idées nouvelles qui, écriront plus tard les historien·nes, portent la Commune sur leur dos11. La salle de Tivoli-Vauxhall, dans le Xe arrondissement, est l’un des lieux privilégiés où républicain·es et socialistes de tous bords se retrouvent pour discourir. Dans ses mémoires, Gustave Lefrançais se souvient des prises de parole de nombre de participant·es qui se sont exprimé·es à l’occasion d’une série de réunions sur le travail des femmes. Parmi eux, parmi elles, « on remarque surtout la citoyenne Paule Minck, petite femme très brune, un peu sarcastique, d’une grande énergie de parole. La voix est un peu aigre, mais elle s’exprime facilement. Elle raille avec esprit ses contradicteurs plutôt qu’elle ne les discute et ne paraît pas, jusqu’alors, avoir des idées bien arrêtées sur les diverses conceptions qui divisent les socialistes. Mais elle est infatigable dans sa propagande. Professeur de langues ou lingère, suivant les circonstances, on la dit aussi habile à l’aiguille qu’à donner des leçons12. » Un portrait en demi-teinte d’une femme dont on ne cessera de décrire le physique ou la voix avant de se pencher sur les idées. Pourtant, elle avance ces dernières dans de nombreuses causeries et touche un large public, non seulement celui de Tivoli-Vauxhall : en tout, elle aurait fait soixante-seize interventions entre 1868 et 1870, principalement sur le mariage et le divorce, le travail des femmes, l’héritage, le peuple et la misère, ou encore l’éducation13. À cela, elle ajoute l’écriture d’un pamphlet contre l’empereur et la bourgeoisie qui paraît dans une publication hebdomadaire qui n’aura que deux numéros. Son nom : Les Mouches et les araignées. Les premières figurent le peuple, « paysans et prolétaires » ; les secondes ne sont autres que « tous ceux qui vivent à nos dépens, nous foulent à leurs pieds et se rient de nos souffrances et de nos vaines récriminations14 ».
Malgré cette intense activité, il n’était pas simple d’être prise au sérieux devant un auditoire composé de révolutionnaires et de libres penseurs, certes, mais dont beaucoup sont également de fervents adeptes de Proudhon, misogyne notoire. Les textes de ce dernier sont ainsi parmi les premiers à être commentés, critiqués et invalidés par des femmes qui, à l’instar de Juliette Adam ou Jenny d’Héricourt, ont accès à la presse ou aux éditeurs. Ailleurs, d’autres hommes, moins péremptoires, professent l’égalité en public tout en manquant de l’appliquer au foyer. Un événement parmi d’autres illustre ce climat conservateur : en 1866, une motion hostile au travail des femmes a été votée au congrès annuel de l’Internationale, organisé à Genève — ce qui n’empêche pas Paule Minck d’adhérer à l’organisation trois ans plus tard. Devant ces résistances, des femmes se rassemblent et créent des sociétés, des ligues, des associations : ainsi, en Suisse, Marie Goegg fonde l’Association internationale des femmes, en faveur d’un suffrage féminin et d’une éducation laïque, tandis qu’André Léo15 et Noémie Reclus créent, en 1868 à Paris, la Ligue en faveur des droits des femmes qui deviendra, l’année suivante, la Société de revendication des droits de la femme16. D’autres, on l’a vu, donnent de la voix lors de réunions où leur place n’est pourtant pas souhaitée. D’autres, encore, créent des journaux ou écrivent, parfois sous pseudonyme, dans ceux de camarades sympathisants, parmi lesquels Le Droit des femmes, hebdomadaire que dirigent le journaliste Léon Richer et la féministe républicaine Maria Deraismes. Ensemble, ils cherchent autant à « rallier les femmes à l’idée républicaine » qu’à « rallier les républicains à l’égalité des droits entre hommes et femmes17 ».
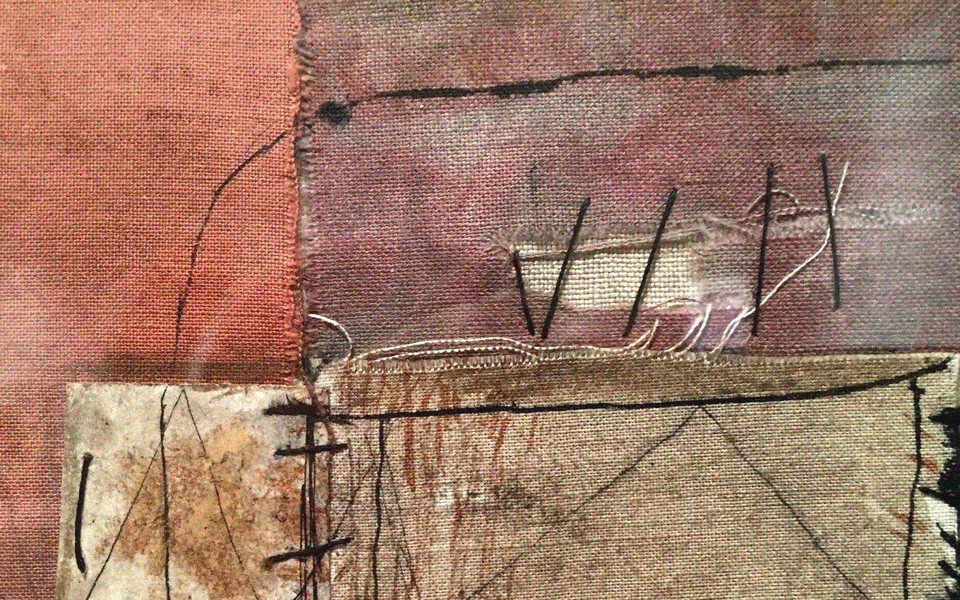
[Hannelore Baron]
Paule Minck, lorsque le temps le lui permet, participe à chacune de ces initiatives. L’historienne Édith Thomas, la première à proposer un tableau de l’action des femmes durant la Commune, commente les activités de la future communarde : « Professeur de langue, lingère, un peu journaliste », tout cela « car aucun de ces métiers ne lui permet de vivre18 ». Un début d’explication, point : plus que celles de Deraismes, de Léo ou, plus tard, de Louise Michel, les mains de Paule Minck sont calleuses et tachées. Ses mains ont tenu le corps de jeunes enfants, du fil et des épingles, des draps humides et la hampe d’un drapeau rouge, « l’étendard du peuple et de la révolution sociale19 » ; ses mains ont servi de porte-voix, de porte-plume et, lorsque le poing se refermait afin d’être lancé haut vers le ciel, de mot d’ordre. Née dans un milieu bourgeois, « à l’époque de sa jeunesse, une privilégiée de la vie20 », Minck peinera pourtant à trouver les ressources nécessaires pour mener de front le travail de mère, la pratique du journalisme et la propagande révolutionnaire. Elle sera néanmoins de tous les événements révolutionnaires de son temps.
*
« Le soulèvement polonais, le dernier du siècle en ces lieux, a été écrasé. Il faudra attendre les secousses de 1905, en Russie, pour que le pays se relève. »
Reprenons. On a dit le mois, l’année et la ville de naissance. Il nous faut dire quelques mots de sa généalogie, car cette dernière importe. La mère, Jeanne Blanche Cornélie Delaperrierre, fait partie d’une famille de comédien·nes de la petite bourgeoisie auvergnate. Le père, Jean Népomucène Mekarski, est issu de la noblesse polonaise. C’est un parent de Stanislas II, le dernier roi de Pologne, pays alors sous tutelle russe. Comme de nombreux compatriotes, le père émigre en France après la défaite des insurgé·es polonais·es en 1831 et échoue à Clermont-Ferrand la même année. Cette ascendance comptera pour Paule et plus encore pour l’un de ses deux frères, Jules. C’est en tant que « polonaise » que Minck se dépeindra souvent21 ; c’est avec un homme de même origine qu’elle se marie d’abord et c’est en Pologne qu’elle assiste à sa première insurrection. Elle et Jules partent à l’Est en 1863 pour soutenir le soulèvement indépendantiste qui a éclaté en janvier. Certaines sources indiquent une arrivée plus précoce, mais on ne saurait dire avec précision tous les faits et gestes de Minck à cette période. En Pologne, Jules et Paule sont accompagnés de Paul Bohdanowicz, compagnon qu’elle a rencontré à Paris où elle a passé les années précédentes. Un enfant naît bientôt de cette union. Le terme qui approche et la défaite qui vient les pousse à repartir. C’est à Paris qu’Anna, leur première fille, voit le jour l’année suivante. Le soulèvement polonais, le dernier du siècle en ces lieux, a été écrasé. Il faudra attendre les secousses de 1905, en Russie, pour que le pays se relève.
Compagnons et enfants seront nombreux dans la vie de Paule Minck. Après Paul Bohdanowicz, mort au cours de la guerre de 1870, ce sera le peintre communard Jean-Baptiste Noro, puis l’anarchiste Maxime Negro ; après Anna, viendront Wanda, puis Henna et Mignon, avant que les biens nommés Lucifer Blanqui Vercingétorix et Spartacus Blanqui Révolution ne naissent d’une dernière union22. Longtemps mère célibataire comme a pu l’être Nathalie Le Mel et certainement beaucoup de communardes, partagée, à l’instar d’André Léo, entre plusieurs relations au cours de sa vie, Minck n’a pas, selon Carolyn J. Eichner, « cette pureté qui faisait de Michel une icône révolutionnaire23 ». Suivant les intuitions d’Alain Dalotel et d’Édith Thomas, l’historienne étaie cette piste qui expliquerait sa postérité moindre : « Bien que l’une comme l’autre [aient] mené une vie publique, l’univers de Mink comprenait aussi hommes, mariages, séparations et enfants. […] Longtemps restée mère célibataire, Minck lutta en permanence pour parvenir à joindre les deux bouts. Partageant son temps et son énergie entre les soucis financiers, le travail, les relations amoureuses et les enfants, elle ne put s’offrir entièrement à la cause24 ». Si l’on prend en compte le travail domestique qui lui échoit, l’activité révolutionnaire de Minck a, plus encore, de quoi impressionner. Bien que les traces écrites qu’elle a laissées soient peu nombreuses et éparpillées, son action pendant la Commune et après celle-ci est remarquable et n’a pas manqué d’être remarquée : jusqu’à sa mort, l’insurgée fera l’objet d’une surveillance policière permanente.

[Hannelore Baron]
*
C’est à Auxerre, dans l’Yonne, que Paule Minck pressentit la Commune et c’est là, quelques mois plus tard, qu’elle trouvera refuge pour fuir la répression. Au cours de l’été 1870, elle a gagné la ville bourguignonne avec son deuxième frère, Louis, afin de s’abriter pendant l’occupation prussienne et, aussi, de mieux participer à l’effort patriotique. Si Minck décrira plus tard le drapeau tricolore comme « une guenille souillée de la boue de Sedan et du sang des Parisiens19 », la déroute française est toute fraîche encore et les Parisien·nes bien vivant·es. Minck prend les armes, fait passer des missives de part et d’autre de la ligne de front et clame tout haut dans La Liberté, le journal local dont elle a reçu la charge, la nécessité de poursuivre la guerre. Quelques mois plus tard, le conflit terminé, elle appelle dans les mêmes pages les habitant·es de la ville à se soulever afin de suivre les Parisien·nes dans leur initiative. Nous sommes le 18 mars 1871 : Paule Minck quitte ses quartiers provinciaux, gagne une capitale qui s’anime et plonge dans la défense de la ville aussi bien que dans le bouillonnement des clubs socialistes. Le déroulement des soixante-douze jours d’insurrection est bien connu : les canons de Montmartre, les sorties désordonnées des troupes en avril, les manifestations de femmes, la naissance des journaux et la liberté de parole, le Comité central et les groupes indépendants qui fleurissent, la colonne Vendôme mise à terre, le palais des Tuileries incendié et les 20 000 morts de la dernière semaine. Toutefois, quelle fut la Commune de Paule Minck ? Quel rôle fut le sien, elle qui, les trente années suivantes, n’aura de cesse d’appeler à un nouveau soulèvement armé ?
« Tandis qu’on raille volontiers la bigoterie des femmes jusque dans les rangs révolutionnaires, les voix qui résonnent sous les nefs sont d’une violence rarement entendues à l’encontre de l’Église. »
Carolyn J. Eichner qui, dans Franchir les barricades, s’est intéressée aux trajectoires de plusieurs communardes avant, pendant, et après l’événement, met en évidence la marginalité dans laquelle s’inscrit l’action de Minck durant la Commune. Ce qui intéresse la militante, ce sont les assemblées qui gagnent les salles publiques, les églises, les places. Selon l’historienne étasunienne, « le militantisme de Mink est la manifestation d’une approche horizontale du socialisme privilégiant l’action et l’organisation25 », approche qui laisse bien peu de traces dans les archives car faite pour l’essentiel d’interventions orales. La perte du dossier qui servira à son jugement dans un incendie n’a fait que renforcer ces carences. Là où divers courants s’affrontent dans le Comité central, là où des associations de femmes sont en passe de se structurer, Paule Minck n’a que faire des querelles internes et entend agir auprès de celles qui débattent hors des institutions. Tandis qu’on raille volontiers la bigoterie des femmes jusque dans les rangs révolutionnaires, les voix qui résonnent sous les nefs sont d’une violence rarement entendue à l’encontre de l’Église. Alors que les décrets du Comité central se font attendre pour réformer l’éducation, Minck les devance et fonde une école gratuite pour filles dans l’un des bâtiments réquisitionnés. Enfin, si des appels sont lancés par voie de presse en direction des campagnes, Minck se charge d’en diffuser le contenu elle-même, avec son frère Jules, dans les départements qu’elle parvient à rejoindre — une entreprise que commente en des termes simples Édith Thomas : « elle prêchait dans le désert26 ». Malgré un enthousiasme qu’on devine, on sait peu de choses de la communarde entre mars et mai 1871. À l’inverse, Élisabeth Dmitrieff fut prolixe durant le soulèvement par l’intermédiaire de l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, laissant une empreinte certaine, et Louise Michel a su s’emparer de sa propre légende après la répression, la relatant abondamment dans ses écrits. En ce sens, Minck paraît plus proche que ses comparses des femmes qui n’ont pris la parole qu’à quelques reprises dans les réunions ; qui, parfois, n’ont fait qu’y assister ; qui, ailleurs, ont appelé aux meurtres des prêtres ou à leur protection ; qui, finalement, ont fait l’événement mais dont les figures ont été recouvertes par d’autres, plus visibles. Aussi, après la Semaine sanglante, retrouve-t-on celle de Paule Minck en fuite, à Auxerre, avant qu’elle ne rejoigne la Suisse, échappant ainsi à une condamnation certaine.
*
11 mai 1872. À Porrentruy, aux confins de la Suisse, un des nombreux observateurs qui a eu un jour à suivre Paule Minck rapporte à ses supérieurs : « le jour où un mouvement se préparer[ait], c’est à Porrentruy que partir[aient] les armes27 ». Rien ne laisse présager que ce bourg frontalier pourrait être sujet à pareil événement. Pourtant, l’informateur a vu juste : des armes passent depuis quelques mois d’un pays à l’autre, un réseau de contrebande s’organise et l’une de ses principales instigatrices n’est autre que Paule Minck. Durant la décennie qu’elle passe en exil, elle entreprend de nombreux voyages clandestins en France, jusqu’à Paris, pour participer à des réunions ou à la coordination entre les groupes qui ont échappé à la déportation et les proscrit·es. Une action fort éloignée des quelques mots glissés par le romancier anarchiste Lucien Descaves dans son récit Philémon. Vieux de la vieille à propos des femmes exilées : « Elles gagnèrent à la proscription deux choses indispensables : l’estime et l’intérêt. Légitimes ou non, les ménages échoués en Suisse y méritèrent généralement, par leur conduite, le droit d’asile. Les enfants allèrent à l’école, les femmes furent couturières, modistes, corsetières, piqueuses de bottines, blanchisseuses28… » Paule Minck n’aurait été capable que « [coudre] des chapeaux de paille », tandis qu’André Léo n’aurait rien fait d’autre que « la cuisine elle-même, dans la petite chambre que des amis lui avaient meublée à Montbrillant29 ». L’une et l’autre, Minck et Léo, ne sont pas épargnées par le romancier, qui escamote leur importance durant la récente insurrection : selon lui, elles « ne jouèrent, pendant la Commune, qu’un rôle effacé. Si elles s’exilèrent, ce fut surtout probablement afin de suivre, l’une Benoît Malon, et l’autre le peintre Noro29. » « Réductions exemplaires30 », remarque Alain Dalotel : jugement définitif qui nous dispense d’en formuler d’autres.

[Hannelore Baron]
Il semblerait que les contemporain·es aient fait peu de cas du rôle de certaines femmes dans l’animation des réseaux révolutionnaires, leur reconnaissant seulement quelques compétences qui seraient propres à leur genre. De même que leurs mots avaient du mal à être entendus avant la Commune, que leurs droits peinaient à être considérés pendant celle-ci, les suites de l’insurrection ne sont pas plus favorables à leur participation aux diverses organisations au côté des hommes. Si Minck participe à la Société des proscrits républicains en Suisse, elle ne le doit qu’à sa pugnacité et ne peut envisager d’y obtenir une place trop élevée. Ainsi, une de ses prises de parole, lors du Congrès de la Paix et de la Liberté de Lausanne, quelques mois après le massacre parisien, est commentée par un participant en des termes peu amènes : « Madame Minck se prodigua un peu trop dans la discussion, oubliant que la modestie est la première qualité d’une femme qui aborde la tribune31. » Cet homme-là n’avait peut-être pas apprécié que les premiers mots de l’intervention soulignent le genre de l’oratrice, et par là, la particularité de son éducation politique : « Citoyennes et citoyens, malgré mon titre de femme, peut-être à cause de ce titre, je me permets d’aborder la question la plus redoutable de ce temps, la question sociale32. » Minck n’est pas la seule à être ainsi attaquée : de semblables reproches sont faits à André Léo lors du même événement. Toutefois, alors que cette dernière se retire dans l’écriture romanesque, Minck, elle, persévère. Ses conférences, il est vrai, lui procurent un revenu plus que nécessaire. Jonglant de nouveau entre divers métiers, élevant une, puis deux, puis trois filles, elle fait face aux mêmes difficultés qu’à Paris. Toutefois, son nom continue de résonner dans les salles genevoises et elle entend bien amplifier son écho jusqu’en France. Alors, en même temps que ses camarades, mais pour d’autres raisons, la police française s’alarme de son activité. Car si on ne lui accorde pas autant de considération qu’elle l’aimerait à Genève, d’autres réseaux s’ouvrent peu à peu à elle. Durant ces années, elle se lie avec un dénommé Jules Guesde, dont l’importance dans la formation du mouvement ouvrier français s’avèrera déterminante.
*
« Je poursuis modestement, mais non sans fatigue, le but que je me suis donné : socialiser et révolutionner la province. »
Là où l’activité politique de nombreuses communardes, à l’instar d’Élisabeth Dmitrieff ou d’Anna Jaclard, s’est radicalement réduite avec la répression, celle de Paule Minck n’a pas faibli, bien au contraire. Après son retour, sitôt l’amnistie proclamée, elle entame une série de conférences, tantôt accompagnée de Louise Michel, tantôt seule. Firmin Maillard rend compte de cette période dans les pages qu’il consacre à la militante dans La Légende de la femme émancipée : « De retour en France, […] elle file sur la province où elle organise des conférences et se livre à une propagande des plus actives et des plus bruyantes ; on n’entend plus parler que de la citoyenne Paule Minck33. » Aussi est-ce seule qu’elle intervient au congrès ouvrier du Havre ou, du moins, qu’elle tente de le faire, composant à son arrivée avec un accueil glacial. Seule, elle chemine un mois dans le Var, chaque jour dans un village différent, haranguant les badauds. Seule, elle déjoue la filature d’un agent dans un bourg du Nord. Il faut s’imaginer alors la verve de l’oratrice, sa répartie et son sens de la dérision face à cet homme qui l’empêche de réserver une chambre dans quelque auberge et la harcèle de questions dans l’espoir de la faire coucher en prison plutôt que dans un lit. Une lettre à son amie Louise résume le contenu de ses voyages : « [J]e poursuis modestement, mais non sans fatigue, le but que je me suis donné : socialiser et révolutionner la province34. » Si le socialisme de Minck a pu sembler impur ou hétérodoxe à certains, elle a visé juste quant à ses lieux d’intervention : les réunions publiques d’abord, puis les clubs durant la Commune et, enfin, toutes les salles à même de l’accueillir partout en France, loin d’une capitale où l’ambiance est moribonde.
Pour Alain Dalotel, « Paule Minck n’a pas de modèle, mais des principes dont l’histoire lui fournit des exemples35 » — exemples qu’elle trouve sur sa route, lors de ses tournées en France, ou à l’étranger, par le biais des réseaux militants. C’est l’époque où, selon l’historienne Carolyn J. Eichner, Minck effectue un « virage blanquiste » qui la fait défendre « un révolutionnarisme conspirateur et hautement centralisé36 ». À ces mots, on songe à la lutte qui fit s’affronter Bakounine et Netchaïev dix ans auparavant, aux sociétés secrètes et aux coups d’éclat qu’appréciaient les deux hommes. Ça n’est pas un hasard si Minck défendra le meurtre du tsar Alexandre II en mars 1881 perpétré par des membres de l’organisation Narodnaïa Volia qui s’inspire précisément de Netchaïev. Quelques jours après avoir appris le régicide, elle salue le geste de ses camarades russes, à l’occasion d’un défilé dans les rues de Toulon qu’elle organise en commémoration de la Commune. L’événement semble avoir régénéré son désir insurrectionnel : « La propagande par le fait tant prônée et pratiquée par notre vénéré maître Blanqui, commence à être comprise ; le peuple s’aperçoit de plus en plus que pour conquérir ses droits, il lui faut de l’énergie, et que ce n’est que par la suppression de ses maîtres divers qu’il pourra s’affranchir37. » Cette manifestation et ce soutien lui valent toutefois un mois d’enfermement à Marseille. Le jugement qui la condamne ne manque pas de la faire réagir : loin de regretter son engagement, loin, aussi, de contester la peine, c’est la mention de circonstances atténuantes qui la mobilise. « C’est une atteinte portée à ma dignité », indique-t-elle à Louise Michel, avant de poursuivre, excédée : « que l’on m’applique la peine entière, mais que l’on ne m’insulte pas38 ». Elle qui, avant le procès, avait osé défier les autorités en apparaissant sur fond rouge et noir dans une réunion publique, à Lyon, aux côtés de Louise Michel et d’Édouard Vaillant, refuse tout traitement de faveur, quel qu’en soit le motif.

[Hannelore Baron]
Si Minck parcourt le pays pour diffuser les idées socialistes, elle consacre beaucoup de son temps et de son énergie à défendre des motions en faveur des femmes à l’intérieur des organisations auxquelles elle participe. Il convient d’informer les citoyens et les citoyennes sur la question sociale, oui, mais également d’éduquer des révolutionnaires peu enclins à se voir chahuter par une femme. C’est auprès de Jules Guesde, au sein du Parti ouvrier français (POF) crée en 1882, que Minck s’investit avec le plus d’ardeur — une adhésion qu’Alain Dalotel croit un peu hâtivement « essentiellement motivée par un souci d’efficacité39 ». L’organisation, lit-on ailleurs, demeure « une plateforme pour le socialisme féministe tout au long de la décennie40 » et, de même qu’elle l’a fait pour l’anticléricalisme41, contribue à fonder une voie médiane à propos des femmes. Entre le refus conservateur de la participation féminine aux institutions politiques, ancré pour de longues années encore dans les milieux socialistes comme républicains, et un combat pour l’acquisition de droits politiques que mène, entre autres, Hubertine Auclert, Minck et le POF abordent le statut des femmes par le biais du travail, de l’indépendance et de la liberté42. Guesde maintiendra ce cap jusqu’à la fin du siècle : en 1898, il s’étonnera encore que ses camarades puissent refuser aux femmes l’accès à un travail rémunérateur, accusant ceux-ci de « vouloir faire de la femme le prolétaire de l’homme43 ». Une détermination qui rappelle celle de Paule Minck, qu’importent les obstacles ou les tentations.
« La militante se montre telle qu’elle le restera jusqu’à la fin de sa vie : pour une union ouvrière derrière la bannière socialiste, en faveur de l’égalité des sexes dans tous les combats sociaux. »
Voyons deux exemples qui ont fissuré la gauche antiparlementaire : la crise boulangiste et l’affaire Dreyfus. Le premier événement a vu une partie des militant·es blanquistes se ranger derrière un général belliqueux et démagogue, le second a fait ressurgir un antisémitisme latent au nom d’un antimilitarisme de façade. Si Minck ne cesse de pourfendre « l’honneur de l’armée et le culte de la patrie44 », elle rompt avec les guesdistes, trop équivoques à son goût à l’égard du Général Boulanger, puis soutient Zola dans sa défense de Dreyfus. Lors de ces deux événements, elle se montre telle qu’elle le restera jusqu’à la fin de sa vie : pour une union ouvrière derrière la bannière socialiste, en faveur de l’égalité des sexes dans tous les combats sociaux, indépendante dans ses jugements et autonome, malgré la misère, dans la conduite de sa vie.
Ces années, en effet, sont parmi les plus âpres qu’eut à vivre la communarde. Trop remuante au goût des autorités, on la menace d’expulsion. Née d’un père polonais, mariée en premier lieu à un compatriote, elle ne peut légalement revendiquer la nationalité française. En guise de réponse, elle se marie avec l’ouvrier Maxime Negro, et ajoute des mots définitifs à cette décision : « Mon socialisme a décidé d’user du mariage45. » Le couple s’installe à Montpellier où, bientôt, naissent deux enfants. Bien vite, cependant, Minck décide de retourner à Paris, avec ses deux filles plus âgées. L’agitation politique y est plus forte qu’ailleurs et lui manque. D’un quartier à l’autre de la ville, elle déménage sans cesse, le plus souvent avant le terme afin d’éviter de payer un loyer qu’elle n’a pas toujours les moyens d’assumer. Si elle accepte ce rythme épuisant, c’est qu’elle a trouvé dans la capitale de nouveaux groupes auxquels s’associer. En retrait du POF depuis que celui-ci ne soutient plus la grève générale, mais toujours affiliée à ce dernier, Minck se tourne vers de nouvelles organisations féministes. Parmi elles, Solidarité des femmes, fondée par Eugénie Potonié-Pierre et Maria Martin, qui lui propose d’être candidate aux élections municipales de 1893. Là où d’autres, dont Deraismes et la journaliste Séverine, ont refusé, Minck accepte. Après des années passées à rejeter toute forme d’élection, elle se retrouve candidate à son tour pour défendre le rôle politique des femmes. Elle s’en explique : « [S]oldat discipliné du parti ouvrier, auquel j’appartiens depuis douze ans, je crois de mon devoir de mettre en pratique les décisions de nos congrès, qui, tous, ont affirmé l’égalité de la femme, aux divers points de vue économique, civil, et politique46 ». Ailleurs, elle précise : « Ce n’est pas une candidature féminine […] que j’ai voulu poser, mais bien une candidature socialiste révolutionnaire. Je ne suis pas portée comme femme, mais comme militante47. » Elle qui refusait de suivre Auclert et d’autres suffragettes dans leur engagement la décennie précédente, change ainsi d’avis afin de mieux servir la cause socialiste. Malgré cette justification, malgré, il est vrai, des motions en ce sens, le POF ne la soutient pas ; un désaveu qui la conduit à rompre et à se ranger derrière le seul mouvement qui lui paraît mériter ses efforts : le mouvement ouvrier. Pendant huit ans encore elle accepte candidatures et conférences, elle se déplace où on veut l’entendre, jusqu’à l’épuisement. Elle meurt une nuit d’avril 1901.

[Hannelore Baron]
*
Les unes enterrent les autres et les éloges funèbres se clament avec une douce colère. Ce fut Louise Michel qui prit la parole pour Anna Jaclard, cette « intelligente et brave Russe48 » qui compta au nombre de ses amies. Plus tard, la même Louise sera célébrée par Séverine au cimetière de Levallois-Perret par ces mots : « Le populaire se mirait en elle comme une glace au tain terni, craquelé, un miroir de pauvre49 ! » Mais pour l’heure, ce 1er mai 1901, ça n’est pas une figure unique qui se détache pour prendre la parole en l’honneur de Paule Minck. Depuis la maison mortuaire, sise rue de Billancourt, jusqu’au columbarium du Père Lachaise où l’on dépose les cendres de la révolutionnaire, c’est un cortège immense, assorti d’un dispositif policier démesuré, qui accompagne la dépouille50 : « […] plus de six cents agents de police, cinq cents soldats d’infanterie et cent cavaliers51 » s’ajoutent à la foule. Alain Dalotel résume ainsi le déroulement de la journée : « Rien n’y manque : le peuple, le drapeau rouge, l’Internationale et la Carmagnole, les cris séditieux antimilitaristes, les discours enflammés pour la Commune prochaine
et l’émancipation des femmes, et, en face, les forces de l’ordre agressives, comme il se doit ; des bagarres éclatent même devant le mur des fédérés et porte de Bagnolet, entre ouvriers et policiers, clôturant en beauté
la cérémonie52. » Que la cérémonie ait été belle, oui, cela ne fait pas de doute.
*
Un matin de décembre, même lieu, cent vingt années plus tard. Le columbarium du Père-Lachaise a bien changé depuis qu’on y a déposé les cendres de Paule Minck : désormais, plus de quarante mille cases entourent la sienne. On la cherche. Elle serait au numéro 1029. Mais les concessions sont périssables et, à la place de celle de la communarde, on lit un nom différent et d’autres dates que celles qui bornent sa vie. Là aussi, l’oubli. À droite, cependant, une case est vide. Ce serait la sienne. Mais le vide retient bien peu l’attention et, déjà, les yeux se perdent sur les niches alentour. Un mètre plus bas, sur la gauche, l’une accroche le regard. « Louise Michel », née en 1888. Pas celle que l’on connaît, non, mais bien une autre. La correspondance fait sourire. Elle aurait plu, sûrement, à deux femmes heureuses, peut-être, de se trouver non loin dans la mort.
Illustration de bannière : extrait d’une toile de Hannelore Baron
- Émile Zola, « Mes souvenirs sur Gustave Flaubert », Le Figaro, 6e année, n° 50, 11 décembre 1880.[↩]
- Si la IIIe République est proclamée en septembre 1870, les élus républicains à la Chambre des députés ne sont majoritaires qu’en 1876, tandis que ceux au Sénat remportent les élections en 1879, année où le président MacMahon, légitimiste et boucher de la Commune, cède sa place à Jules Grévy. Après neuf années d’existence, la République est enfin tenue par ses défenseurs. Aussi, pour l’historien libéral François Furet, ça n’est qu’à cette date que « la Révolution française entre au port » (dans La Révolution II (1814–1880), Pluriel, p. 467).[↩]
- Paul Lidsky, Les Écrivains contre la commune (1970), La Découverte, 2021.[↩]
- Laure Godineau, « L’amnistie des communards : autour du discours de Léon Gambetta, 21 juin 1880 », Nineteenth-Century French Studies, vol. 49, n° 3–4, 2021.[↩]
- Plusieurs orthographes de son nom coexistent. Nous préférons écrire ici Minck plutôt que Mink, car son utilisation est plus courante. Pour les citations nous respectons le choix d’origine.[↩]
- Tribune de Genève, 13 mars 1883, dans Daniel-François Ruchon, « Georges Favon et les réfugiés de la commune à Genève », Revue européenne des sciences sociales, vol. 11, n° 29, 1973.[↩]
- On retrouve un extrait de cette soirée dans le recueil de textes écrits par Louise Michel et à son propos, À mes frères, Libertalia, 2019, p. 113–114.[↩]
- Réunion publique du 5 mai 1893, dans Alain Dalotel, Paule Minck. Communarde et féministe, 1839–1901, Syros, 1981, p. 165.[↩]
- Firmin Maillard, La Légende de la femme émancipée, Librairie illustrée, 1886, p. 317–318.[↩]
- Alain Dalotel, op. cit., p. 8.[↩]
- Alain Dalotel, Alain Faure et Jean-Claude Freiermuth, Aux origines de la Commune. Le mouvement des réunions publiques à Paris (1868–1870), François Maspero, 1980.[↩]
- Gustave Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, 1902, p. 323.[↩]
- Pour plus de détails, on peut lire l’article de Michèle Audin, « 1868–1870, un policier suit Paule Minck dans les réunions publiques », 4 juin 2018.[↩]
- Les Mouches et les araignées, 1869, dans Alain Dalotel, op. cit., p. 49.[↩]
- Élie Marek, « André Léo : toutes avec tous », Ballast, n° 11, 2021.[↩]
- Alice Primi, « La Ligue en faveur des droits des femmes (1868–1870) : un humanisme universaliste et socialiste », dans Frédéric Chauvaud, François Dubasque, Pierre Rossignol et Louis Vibrac, Les Vies d’André Léo, Presses universitaires de Rennes, 2015.[↩]
- Alban Jacquemart, « Engagements féministes masculins dans le dernier XIXe siècle (1869–1900) : de la centralité à la marginalité », dans Frédéric Chauvaud et al., op. cit., p. 158.[↩]
- Édith Thomas, Les « Pétroleuses » (1963), L’Amourier, 2019, p. 59.[↩]
- Lettre à Louise Michel du 14 décembre 1880, dans Alain Dalotel, op. cit., p. 98.[↩][↩]
- Albert Goullé, « Paul Mink », L’Aurore, 5e année, n° 1290, 1er mai 1901.[↩]
- Depuis la prison des Feuillantines où elle se trouve enfermée pendant un mois, elle écrit par exemple en juin 1881 : « Nous avons défendu Jessa Helfmann, une femme malheureuse, que j’aime comme mère et comme Polonaise » (dans Alain Dalotel, op. cit., p. 60).[↩]
- Le choix de ces prénoms conduit à une polémique que Minck choisit de rendre publique par une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur, publiée dans la presse.[↩]
- Carolyn J. Eichner, Franchir les barricades, Éditions de la Sorbonne, 2020, p. 250.[↩]
- Ibid.[↩]
- Carolyn J. Eichner, op. cit., p. 176.[↩]
- Édith Thomas, op. cit., p. 185.[↩]
- Cité dans Carolyn J. Eichner, op. cit., p. 244.[↩]
- Lucien Descaves, Philémon. Vieux de la vieille, La Découverte, 2019 [1913].[↩]
- Ibid.[↩][↩]
- Alain Dalotel, op. cit., p. 20.[↩]
- Alain Dalotel, op. cit., p. 20–21.[↩]
- Discours prononcé le 27 septembre 1871 au Congrès de la Paix et de la Liberté de Lausanne, dans Alain Dalotel, op. cit., p. 82.[↩]
- Firmin Maillard, op. cit., p. 318.[↩]
- Lettre à Louise Michel, 9 avril 1881, dans Alain Dalotel, op. cit., p. 77.[↩]
- Alain Dalotel, op. cit., p. 77.[↩]
- Carolyn J. Eichner, op. cit., p. 241. À noter qu’Alain Dalotel, quelques années avant l’historienne étasunienne, refusait de qualifier Minck de blanquiste car cette dernière ne participait pas aux groupes se réclamant de ce courant, essentiellement parisien, quand la militante privilégiait le reste du pays.[↩]
- La Révolution sociale, 3 avril 1881, dans Alain Dalotel, op. cit., p. 73.[↩]
- Lettre à Louise Michel, 5 juin 1881, dans Alain Dalotel, op. cit., p. 63.[↩]
- Alain Dalotel, op. cit., p. 28.[↩]
- Carolyn J. Eichner, op. cit., p. 263.[↩]
- Robert Stuart, « Marxism and Anticlericalism : The Parti Ouvrier Français and the War against Religion, 1882–1905 », The Journal of Religious History, vol. 22, n° 3, 1998.[↩]
- Robert Stuart, « Gendered Labour in the Ideology Discourse of French Marxism : The Parti Ouvrier Français, 1882–1905 », Gender & History, vol. 9, n° 1, 1997.[↩]
- Jules Guesde, « La femme et son droit au travail », Le Socialiste, 9 octobre 1898.[↩]
- Alain Dalotel, op. cit., p. 40.[↩]
- Le pays, 19 juillet 1881, dans Carolyn J. Eichner, op. cit., p. 258.[↩]
- Germinal, 7 avril 1893, dans Carolyn J. Eichner, op. cit., p. 264.[↩]
- La petite république, 19 août 1893, dans Carolyn J. Eichner, op. cit., p. 265.[↩]
- Louise Michel, À travers la mort. Mémoires inédits 1886–1890, La Découverte 2015.[↩]
- Cité dans Évelyne Le Garrec, Séverine (1855–1929) — Vie et combats d’une frondeuse, L’Archipel, 2015.[↩]
- De nouveau, plus de détails sont disponibles dans un article de Michèle Audin, « Paule Minck, deux ou trois choses que l’on sait d’elle (4) », 1er mai 2020.[↩]
- Carolyn J. Eichner, op. cit., p. 239.[↩]
- Alain Dalotel, op. cit., p. 44.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre traduction « Élisabeth Dmitrieff : féministe, socialiste, communarde », Carolyn J. Eichner, juillet 2021
☰ Lire notre semaine thématique consacrée aux 150 ans de la Commune, mars 2021
☰ Lire notre entretien avec Kristin Ross : « Le passé est imprévisible », novembre 2020
☰ Lire notre entretien « Michèle Audin raconte Eugène Varlin », avril 2019
☰ Lire notre article « Zola contre la Commune », Émile Carme, mars 2019
☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais », juin 2017
☰ Lire notre abécédaire de Louise Michel, mars 2017