Texte paru dans le n° 11 de la revue papier Ballast (mai 2021)
Près de la moitié de la population française est concernée par l’obésité et le surpoids. La grossophobie — entrée dans Le Robert en 2019 — est l’attitude discriminatoire à l’encontre des personnes grosses. Cette déconsidération a des conséquences importantes au quotidien, qu’elles soient psychologiques, sociales et professionnelles. La Ligue contre l’obésité a rappelé que la grossophobie frappe d’abord dans la rue, à l’école et au travail. Si l’apparence constitue un critère interdit à l’embauche, il reste difficile de prouver le rejet d’une candidature à cause d’un jugement physique. En l’espèce, les femmes grosses, déjà sujettes au sexisme, sont l’objet d’une double discrimination : une étude a ainsi montré en 2016 que, pour 52 % des hommes interrogés, il était acceptable que le poids puisse être un critère pour refuser l’embauche d’un candidat ou d’une candidate. 34 % des femmes obèses déclaraient quant à elles avoir été discriminées à l’embauche pour ce motif. Contre une approche seulement préventive, moralisatrice et stigmatisante — autrement dit centrée sur l’individu —, l’autrice de cet article propose, aux côtés de femmes et de collectifs militants, de penser cette question dans ses implications politiques. ☰ Par Élise Sánchez
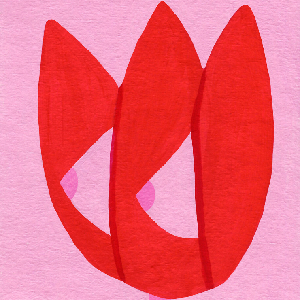
Ce terme, pourtant, peine à se faire (re)connaître, ressent Fanny, ébéniste dans le Sud-Ouest et travailleuse dans une recyclerie pour payer les factures. « C’est une discrimination dont on ne parle pas beaucoup, et quand on en parle c’est souvent pour expliquer que c’est une fausse discrimination, que les gens comme moi devraient faire un effort plutôt que de se plaindre. » Ce sentiment est également partagé par Sophie, qui s’habille le plus souvent de noir afin d’éviter les regards : « On a envie que cette parole soit libérée, on a envie que les gens soient au courant. Mais les gens ne savent pas. Quand j’en parle, ils tombent des nues. » Force est de constater que la littérature sur le sujet est quasi inexistante, tant d’un point de vue théorique qu’au niveau des ressources empiriques.
« Il n’existe pas de consensus sur la notion de
grosseur, c’est une norme historique mouvante. »
D’après la littérature scientifique, le surpoids et l’obésité sont des réalités purement statistiques. Le premier correspond à un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 25, la seconde à un IMC supérieur à 302. Mais ce critère d’évaluation établit les différences de corpulence de façon arbitraire : c’est sur la base d’un simple chiffre que l’on distribue les poids « normaux » et les poids « pathologiques ». Aucune différence n’est faite entre tissus adipeux et tissus musculaires, comme le relève le professeur de sociologie Dieter Vandebroeck3 ; l’indicateur doit donc être considéré avec prudence. Et Solenne Carof, autrice de Grossophobie, sociologie d’une discrimination invisible, de préciser qu’il n’existe pas de consensus sur la notion de « grosseur », dont la définition peut varier d’un individu ou d’un pays à un autre : c’est une norme historique mouvante4.
Le poids des discours
Dans les discours publics, tout est fait pour dépolitiser la question. Les personnes grosses sont systématiquement rendues responsables de leur poids et doivent trouver des solutions seules. Les slogans sont bien connus : « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré » ; « Mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ; « Évitez de grignoter entre les repas » ; « Pratiquez une activité physique régulière ». Ces opérations de prévention, sous couvert de « responsabiliser » la population, participent en réalité d’une approche moralisatrice et stigmatisante, dans laquelle l’accent est mis uniquement sur les comportements individuels. De telles campagnes publicitaires s’appuient volontiers sur des stéréotypes attachés aux personnes considérées comme « irresponsables ».

[Kissi Ussuki]
Marielle Toulze, maîtresse de conférence en anthropologie de la communication, fait ainsi remarquer que ces publicités mettent bien souvent en avant des femmes en situation de pauvreté, avec un faible capital culturel5. L’idée véhiculée ? Que les personnes obèses se nourrissent mal, mangent des produits gras et sucrés tous les jours et ne prennent pas soin d’elles-mêmes. À croire, donc, que l’obésité ne serait affaire que de mauvaise volonté.
En ce sens, la grossophobie peut également prendre des formes « bienveillantes ». « C’est terrible d’être traitée d’une manière un tantinet différente par les gens qu’on aime », résume Fanny. En faisant un parallèle entre grossophobie et infantilisation, il est ainsi courant de retrouver le préjugé selon lequel un·e gros·se ne saurait pas se prendre en charge, ni savoir ce qui est le mieux pour sa personne. Il faudrait donc la conseiller pour changer ses habitudes supposées malsaines — une forme de grossophobie « bienveillante ». Lucie a subi les séquelles de cette infantilisation et raconte que les propos de ce genre « ont fortement contribué au développement de mon trouble du comportement alimentaire qui, lui, a contribué à ce que je devienne une adulte grosse. Et je ne suis pas la seule à avoir ce genre de vécu. En voulant nous éviter d’être gros, on nous rend gros. C’est tragiquement ironique ».
« Les enfants d’ouvriers sont quatre fois plus touchés par l’obésité que les enfants de cadres. »
Or les causes de l’obésité ne sont ni binaires, ni simplistes. Comme le rappelle Andrea Sagni, doctorant en philosophie, « bien que la littérature scientifique souligne les composantes multifactorielles et l’hétérogénéité de dimensions qui touchent à ce que l’on appelle obésité, le discours préventif paraît avoir réduit cette condition à un problème d’hygiène nutritionnelle6 ». En somme, il ne suffit pas de gérer son corps comme une machine bien huilée, en optimisant la nourriture ingérée et en se maîtrisant constamment, pour échapper à l’obésité. Fanny, très sportive et pourtant obèse, approuve : « On rencontre tellement de personnes actives, dynamiques, fortes et toniques qui sont grosses… Mais elles apparaissent toujours comme des exceptions dans cette masse de gros·ses dégoulinant·es de gras. » En se focalisant sur le facteur alimentaire et sur l’activité physique, les discours publics en négligent quantité d’autres, et notamment le lien existant entre l’obésité et des antécédents de violences psychiques, physiques ou d’abus sexuels. Les femmes obèses rapportent ainsi dix fois plus d’antécédents d’abus sexuels et quatre fois plus de violences physiques comparé à des femmes de corpulence normée.
Selon les mots du psychiatre et cofondateur du GROS7, Gérard Apfeldorfer, la minceur « 1) peut s’hériter, si on a la chance d’avoir reçu en héritage les gènes adéquats ; 2) peut s’obtenir par le labeur, c’est-à-dire le contrôle mental de ses comportements alimentaires ; 3) peut s’acheter et permettre l’émergence d’un fat-business8 ». Tout cela vient appuyer les concepts de développement personnel et d’écoute de soi, aujourd’hui centraux dans la question de la perte de poids : « [L’] obésité n’est plus perçue comme une insuffisance de capital-minceur, mais comme une dysharmonie, une faute de goût, le signe d’un ratage de l’existence tout entière. Si bien que la minceur apparaît plus désirable et plus nécessaire que jamais9. » Et les conditions d’accessibilité à ce corps mince portent bien le sceau des inégalités sociales : les enfants d’ouvriers sont quatre fois plus touchés par l’obésité que les enfants de cadres10.

[Kissi Ussuki]
La construction sociale du corps gros
Ces catégories schématiques, érigées en normes, divisent symboliquement les corps en deux classes : ceux qui méritent d’être montrés aux yeux de tous et ceux qui devraient être cachés. Synonyme de laideur, le corps gros est rendu tabou : la graisse est associée à une chose molle, inutile et embarrassante ; il faut en avoir honte et tout mettre en œuvre pour la faire disparaître. Et, de fait, elle disparaît des espaces publics. Les personnes grosses sont absentes de bon nombre de représentations médiatiques, lesquelles confondent beauté et minceur ; elles sont absentes des cabines d’essayage, qui proposent rarement de grandes tailles ; elles sont absentes des salles de spectacle, les sièges étant trop étroits.
Bien que l’obésité touche autant les hommes que les femmes en France, la grossophobie, elle, n’est pas indifférente au critère du genre. L’injonction à la minceur est tellement forte pour les secondes que le rapport à leur corps s’en trouve modifié. On pense au body shaming : qu’il s’agisse de discussions privées entre ami·es ou au sein de la famille, d’échanges sur le lieu de travail ou chez le médecin, les jugements et conseils sur le corps des femmes grosses sont banalisés. Rose, vingtenaire aux cheveux bouclés, en fait régulièrement l’expérience : un innocent « Toi, au moins, tu es une belle grosse » ou un simple « C’est dommage, tu serais tellement mieux avec quelques kilos de moins » en sont des exemples criants. Il est socialement accepté de donner son avis sur le corps des femmes, de les conseiller sur la manière dont elles devraient s’en occuper, voire de critiquer la façon dont elles le montrent ou le cachent, le valorisent ou l’exposent.
« Vous dites être pleine de bonne volonté et bosseuse, pourtant votre corps dit le contraire. »
L’une des conséquences de cette pression sociale sur les corps gros, qui répand l’idée qu’un tel corps ne saurait être beau ou en bonne santé, est l’explosion du nombre de chirurgies bariatriques (qui a quadruplé au cours des deux dernières décennies11). Or, comme le souligne Gabrielle Deydier dans son livre On ne naît pas grosse, il s’agit de femmes dans 80 % des cas.
Au même titre que le greenwashing ou le feminism washing, on voit ponctuellement apparaître des corps gros dans les publicités : une caution marketing sur fond de body positivism qui permet aux entreprises de promouvoir leur image de marque. Mais la conscience d’appartenir à ce qui est socialement constitué comme la mauvaise classe corporelle est profondément ancrée chez les femmes en surpoids et obèses : « Je crois que j’en ai toujours eu conscience », se rappelle Fanny. « Mon corps et celui de ma sœur obsédaient ma mère, qui voulait à tout prix qu’on ne soit pas grosses (même si elle l’était également). Quand j’avais neuf ou dix ans, elle m’a emmenée chez une diététicienne et c’est à ce moment-là que j’ai pris la mesure de ma différence
», ajoute-t-elle.
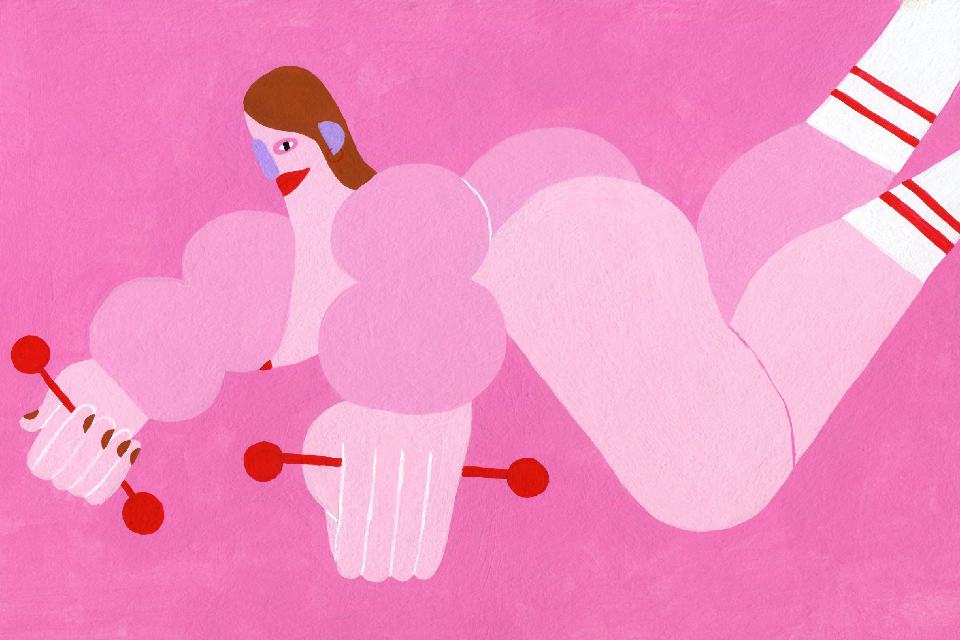
[Kissi Ussuki]
La grossophobie s’exprime dans toutes les sphères de la vie personnelle. Mais les relations professionnelles ne sont pas épargnées. Selon le dernier rapport du Défenseur des droits, à la question « Selon vous, quels étaient les critères de la discrimination ou du harcèlement dont vous avez été témoin dans le cadre de vos activités professionnelles ? », la réponse qui revient avec la plus forte occurrence est celle de l’apparence physique12. Fanny nous précise que son travail à la recyclerie est « très physique, avec beaucoup de mouvements ». « On a tous des jours où on est plus mous, et quand c’est mon tour, j’ai toujours la pression et l’impression de devoir en faire plus que les autres pour mériter ma place, alors que je suis plus sportive, plus vaillante et plus motivée que certains de mes collègues… » Le monde du travail offre en effet moins d’opportunités aux personnes obèses. Ces dernières s’y déclarent plus discriminées sur leur apparence physique qu’une personne normo-pondérée : trois fois plus pour les hommes obèses et huit fois plus pour les femmes obèses13. La dernière fois que Jasmine, la quarantaine, spécialisée dans la logistique, a passé un entretien d’embauche, on lui a rapidement annoncé : « Vous dites être pleine de bonne volonté et bosseuse, pourtant votre corps dit le contraire. » Encore une fois, le simple fait d’être gros∙se sous-entend un laisser-aller volontaire.
Se confronter au monde médical
Le milieu médical n’est pas en reste. Outre les violences obstétricales — rendues visibles sur Internet via les milieux féministes par le hashtag #BalanceTonGyneco —, les remarques verbales grossophobes sont monnaie courante de la part des médecins et personnels soignants. Louise, trentenaire aux cheveux courts, nous raconte que, lors de sa première consultation chez une nouvelle gynécologue, son physique est rapidement arrivé dans la conversation : « Par contre, ce poids-là, il va falloir le perdre, ma bonne dame. » Cette humiliation se double en fin de rendez-vous d’une menace de refus de prise en charge : « La prochaine fois que vous revenez, il faut que vous ayez maigri ou je ne veux plus vous voir. »
« Les patient·es obèses sont 1,65 fois plus susceptibles que le reste de la population d’avoir des problèmes de santé importants non diagnostiqués. »
Une femme grosse doit se démener davantage qu’une femme de corpulence normée pour trouver un·e médecin qui saura la prendre en charge correctement. Le parcours d’Eurydice, qui tenait à partager ses déboires avec le corps médical, le démontre : « J’ai fait cinq médecins généralistes avant d’en trouver une qui me fasse passer un IRM pour mes genoux, et que l’on découvre que j’avais une lésion du ménisque. Les quatre médecins précédents ne m’ont pas écoutée et m’ont seulement dit de perdre du poids. L’une d’entre elles m’a même conseillé avec beaucoup d’insistance d’aller nager, malgré mes protestations lui indiquant que mes genoux se bloquaient régulièrement et que j’avais peur de me noyer. Elle était odieuse. » Une autre rhumatologue lui conseillera de prendre quatre comprimés de Tramadol14 par jour, sans lui en expliquer les risques ni lui laisser le choix. Elle finit par trouver un rhumatologue qui l’écoute et trouve la cause de son problème. Elle conclut : « Je ne sais pas si ça a joué, mais il était lui-même en surpoids. »
Fanny poursuit : « Il y a cinq ans, j’ai fait une grosse dépression durant laquelle j’ai quasiment arrêté de manger, peut-être parce que je voulais me supprimer ou, en tout cas, réduire mon existence. C’était très compliqué dans ma tête. Du coup, comme je perdais beaucoup de poids (que j’ai repris, bien entendu…), tout le monde me félicitait pour les efforts que je faisais. J’étais littéralement en train de couler dans mon seau de merde et tous ces gens trouvaient que j’avais l’air d’aller très bien. Un jour j’ai répondu que non, que ça n’allait pas, que j’étais en pleine déprime, et la personne m’a répondu que ça m’allait très bien, la déprime. Autant dire que ça a été une pilule très difficile à avaler… »

[Kissi Ussuki]
D’après une étude s’appuyant sur 311 rapports d’autopsie, il apparaît que les patient·es obèses sont 1,65 fois plus susceptibles que le reste de la population d’avoir des problèmes de santé importants non diagnostiqués15 (par exemple des cancers, parmi lesquels le carcinome pulmonaire). Quel que soit leur motif de consultation, les obèses sont systématiquement renvoyé·es à leur poids. Celui-ci devient un critère quasi exclusif d’identité pour des personnes réduites au seul chiffre apparaissant sur la balance. « J’ai l’impression de devoir sans cesse compenser en étant très renseignée, et prête à débattre, quand je vais consulter quelqu’un que je ne connais pas. C’est épuisant », nous confie Lucie, illustratrice parisienne. Alors qu’une bonne prise en charge fait une vraie différence : Rose, lycéenne, et Jasmine ont connu des consultations médicales où une soignante a su les écouter et les accompagner — à la fin du rendez-vous, les larmes de joie et le soulagement remplacent alors la colère et le dégoût.
Lutter contre l’individualisme apolitique
Les moyens à mobiliser pour lutter contre l’oppression grossophobe n’ont rien d’évident. Sophie essaie de rendre visible le phénomène à un niveau institutionnel : « Je ne connaissais pas l’existence du Défenseur des droits, c’est une amie sociologue qui m’a proposé cette option. Je l’ai fait pour que tout ce harcèlement subi soit entendu et pris en compte par un acteur de la vie politique. Que plus haut on se saisisse de cette question. D’ailleurs, la première déléguée du Défenseur des droits que j’ai rencontrée a fait remonter [mes témoignages] à sa supérieure, qui m’a demandé une liste détaillée de toutes ces agressions grossophobes. Exposer ce harcèlement m’a aussi permis de le mettre à distance pour moins souffrir. » De même, suite au harcèlement de rue qu’elle subit, elle envisage d’écrire à la maire de sa ville ; elle ne pense pas « que ça changera grand-chose », mais Sophie veut au moins alerter l’élue sur « ce qui peut arriver quand on est grosse dans les rues de sa commune ».
« À trop vouloir porter l’attention sur l’individu, on néglige la dimension politique et systémique qui fait le quotidien grossophobe. »
En 2016, Daria Marx et Eva Perez-Bello ont fondé Gras politique. Aujourd’hui très présent sur les réseaux sociaux, le collectif, qui ne revendique aucune organisation hiérarchique, publie des articles et témoignages anonymes afin de mettre en avant différents combats et expériences, notamment contre les violences domestiques. Des listes de soignant·es safe et non safe (ayant fait preuve d’une attitude éthique envers leurs patient·es ou ayant au contraire eu des comportements grossophobes), exerçant sur tout le territoire français, sont également publiées sur leur site Internet, développant ainsi l’entraide au sein de la communauté. En donnant de la visibilité à leurs luttes, les personnes grosses se voient parfois reprocher de « cautionner » la prise de poids, voire d’encourager l’obésité. Une accusation que Daria Marx et Eva Perez-Bello réfutent : « La lutte contre la grossophobie n’est pas la promotion de l’obésité16. » Les revendications sont claires : la fin de la culpabilisation des gros·ses, une égalité de traitement réelle et l’arrêt d’une discrimination perpétuant des injustices.
Gras politique s’est aussi adapté à la crise sanitaire : des cours de yogras17 sont proposés à distance, de même que des groupes de parole. En décembre dernier, l’atelier portait sur les fêtes de fin d’année et comment y faire face, entre pandémie et grossophobie. Pour Sophie, cette présence collective sur les réseaux sociaux est un moyen de lutte important : « Je suis beaucoup de militantes grosses et féministes sur Instagram, je participe aux groupes de parole de Gras politique, ça me permet de ne pas me sentir seule ou isolée. Même si une agression est toujours violente psychologiquement parlant et qu’au début on se sent seule, après je pense à toutes ces femmes tellement puissantes, comme les femmes de Gras politique ou d’autres, et ça me redonne de l’énergie. »

[Kissi Ussuki]
Pour autant, Lucie ajoute qu’il existe un réel danger à dépolitiser ces questions et à les réduire à un problème d’« amour de soi » à conquérir face à l’adversité. « Je peux m’aimer tant que je veux, je serai quand même discriminée à l’embauche, dans l’accès aux soins et dans l’espace public. Il est crucial de faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’être body-positive
et de bien s’habiller. Ça va bien au-delà du développement personnel. » Ce discours d’amour de soi, largement répandu, néglige le fait que notre rapport au corps en général et au corps propre en particulier est déterminé par des représentations sociales. Tant que l’image des chairs — et notamment des chairs féminines — se limitera aux carcans individualisants (et culpabilisateurs) promus par le néolibéralisme, l’acceptation des gros·ses ne pourra être totale. À trop vouloir porter l’attention sur l’individu, on néglige la dimension politique et systémique qui fait le quotidien grossophobe.
C’est ce que résume justement Solenne Carof : « La richesse, la beauté et la minceur vont être trois éléments associés et valorisés dans une dimension très morale de réussite. […] Dès que l’on atteint un certain milieu social, c’est très compliqué d’être gros, c’est d’autant plus stigmatisé que dans votre milieu personne ne l’est, et c’est considéré comme une vraie faute morale de l’être4. » Cette norme de minceur étant principalement portée par les classes supérieures, les personnes issues de milieux populaires ne sauraient donc atteindre cette « excellence morale » — elles sont l’exemple à ne pas suivre. On retrouve là, selon la sociologue, une forme de mépris de classe qui s’entremêle avec la grossophobie. La dénoncer et la combattre, c’est donc reconnaître collectivement le caractère systémique de cette discrimination. Mais c’est aussi, en tant que personne grosse, refuser d’être assignée aux marges, refuser de voir sa voix constamment confisquée. Et Fanny d’ajouter : « J’ai décidé d’exister plus fort face à des personnes qui commentent une chose qui ne les regarde pas. »
Photographie de bannière : Kissi Ussuki
- Elle est également la fondatrice de l’association Allegro Fortissimo.[↩]
- Avec ce mode de calcul, on aboutit au résultat suivant : selon le Comité interministériel pour la santé, la moitié des adultes et 17 % des enfants sont en surpoids ou obèses en France.[↩]
- Dieter Vandebroeck, « Distinctions charnelles. Obésité, corps de classe et violence symbolique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 208, n° 3, 2015.[↩]
- Dans l’émission du podcast Sortir du capitalisme : « Grossophobie, sexisme et capitalisme néo-libéral ».[↩][↩]
- Marielle Toulze, « Représentations de l’obésité et corps de l’obèse », in A. Meidani et A. Alessandrin, Parcours de santé. Parcours de genre, Presses universitaires du Midi, 2018.[↩]
- Andrea Sagni, « L’obésité et la lutte contre le poids : enjeux médicaux et sociaux », Corps, n° 17, 2019.[↩]
- Groupe de réflexion sur l’obésité et le surpoids, créé en 1998.[↩]
- Gérard Apfeldorfer, « De manque de capital-minceur en faute esthétique, le corps de l’obèse est une honte », in Julia Csergo et André Rauch, Trop gros ?, Autrement, 2009.[↩]
- Ibid.[↩]
- 16 % des premiers sont en surcharge pondérale et 6 % sont obèses, contre respectivement 7 % et 1 % des seconds.[↩]
- Voir Jean Gugenheim, « Le développement de la chirurgie bariatrique en France, enjeux et défis », Diabète & Obésité, vol. 12, n° 105, février 2017.[↩]
- 13e édition du Baromètre du Défenseur des droits et de l’Organisation internationale du travail sur la perception des discriminations dans l’emploi, décembre 2020.[↩]
- 9e édition du Baromètre du Défenseur des droits et de l’OIT sur la perception des discriminations dans l’emploi, février 2016.[↩]
- Un antalgique qui comporte notamment de la codéine et des extraits d’opium.[↩]
- Simon Gabriel et al. « Impact of BMI on Clinically Significant Unsuspected Findings as Determined at Postmortem Examination », American Journal for Clinical Pathology, vol. 125, n° 1, janvier 2006.[↩]
- Daria Marx et Eva Perez-Bello, « Gros » n’est pas un gros mot, Librio, 2018.[↩]
- Cours de yoga adaptés pour tous les corps et en priorité pour les personnes grosses.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre témoignage « Marina, sur la route du rugby », mars 2023
☰ Lire notre entretien avec Martine Delvaux : « Je veux défendre les adolescentes », juin 2022
☰ Lire les bonnes feuilles « Handicap et féminisme : luttes contre le validisme », Mélina Germes, décembre 2021
☰ Lire notre témoignage « Fanny : une histoire de la grossophobie ordinaire », février 2021
☰ Lire notre entretien « Boxer contre les stéréotypes de genre », Yann Renoult, février 2020
☰ Lire notre entretien avec Mona Chollet : « Construire une puissance au féminin », septembre 2018

