Dossier « Que faire ? » | Entretien inédit pour le site de Ballast
On croise, de nos jours, le mouvement autonome français en tête des cortèges de manifestation, sur les murs des villes ou les étals des librairies, dans les squats ou au cœur des ZAD, dans les appels au blocage, à l’insurrection, à la sécession ou à la destitution. Dans la revue lundimatin, noyau dur des théories autonomes, on peut lire : « L’autonomie est la forme d’anti-gouvernement qui permet à la fois le surgissement révolutionnaire anti-vertical et l’inscription horizontale d’une forme de vie commune qui dure ». Dos aux élections, aux partis, aux syndicats et à l’État, l’autonomie refuse toute « nouvelle distribution des organes d’exercice du pouvoir, même réformés, même démocratisés, même réappropriés, mêmes égalisés » : c’est l’affranchissement ici et maintenant qu’elle vise ; c’est n’être jamais gouverné. La sociologue Sylvaine Bulle a publié Irréductibles — Enquête sur des milieux de vie autonomes ; l’historien Alessandro Stella, ancien militant de l’Autonomie ouvrière exilé en France depuis le début des années 1980, est l’auteur d’Années de rêves et de plomb : des grèves à la lutte armée en Italie. Dans le cadre de ce dossier entièrement consacré aux différentes stratégies de rupture avec l’ordre dominant, nous sommes allés à leur rencontre.
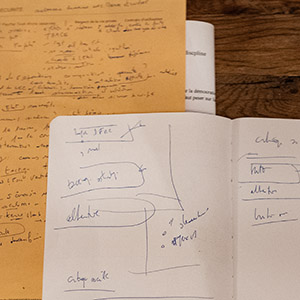
Alessandro Stella : Pas du tout. La revue lundimatin et les gens qui gravitent autour, qu’ont-ils fait depuis vingt ans en France ? Ils se sont inspirés des idées de l’autonomie italienne des années 1970, ils les ont développées et les ont retravaillées par-delà l’approche marxiste-léniniste traditionnelle. Mais l’autonomie ouvrière, comme concept et pratique, vient de loin — et a un bel avenir. Il suffit de voir les événements auxquels on assiste depuis quelques années, en plusieurs endroits du monde : en France avec notamment les gilets jaunes, au Chili, en Équateur, aux États-Unis, en Syrie… Autant de mouvements qui refusent toute autorité. L’autonomie ouvrière a commencé à la fin du XIXe siècle. Il s’agissait de l’autonomie par rapport au capital, de l’indépendance des ouvriers vis-à-vis de l’argent des patrons. Puis le concept a évolué, comme il continue de le faire aujourd’hui — jusqu’à intégrer, désormais, l’écologie. En Italie, ces idées étaient portées dans les années 1960 par Mario Tronti, Romano Alquati, Asor Rosa ou encore la revue Quaderni Rossi : autant de personnes critiques à l’endroit du Parti communiste italien. Elles demandaient à revenir au sujet même de la lutte des classes : les ouvriers. L’autonomie ouvrière italienne vient de groupes extra-parlementaires, après 1968 — Il Manifesto, Potere Operaio… Ils étaient autonomes vis-à-vis des partis et des syndicats. Puis l’autonomie est allée plus loin et les groupes se sont dissous : dispersion, auto-organisation locale, construction de situations1… Parallèlement, des changements structurels sont survenus : on est passés de l’ouvrier spécialisé à l’ouvrier-masse. Je me souviens être allé distribuer des tracts dans une usine, il y avait dix mille ouvriers là-bas ! Des ouvriers interchangeables. On n’avait plus besoin de spécialisation ; la mécanisation s’était imposée… La composition de classe a ainsi changé partout en Occident. Toni Negri a désigné ce phénomène par la formule d’« ouvrier social », qu’on pourrait dire « dispersé », « précarisé »… C’est sur ces précaires que l’autonomie ouvrière s’est appuyée en Italie.
Depuis, un changement s’est opéré dans la sociologie des militants autonomes. Les ouvriers ne sont plus du tout en son cœur.
« L’autonomie est une ontologie, une manière de penser sa vie plus ou moins en dehors des cadres, avec des règles et un imaginaire qui montrent que la société peut s’auto-instituer. [Sylvaine Bulle] »
Sylvaine Bulle : L’autonomie actuelle est plus proche de la première autonomie ouvrière du XIXe siècle, au sens quasiment proudhonien de scission et de circulation des savoirs ouvriers. L’opéraïsme2, par contre, a représenté un moment charnière dans la mesure où l’on a posé la question de la centralité ouvrière, où l’usine est devenue un lieu de réappropriation du corps ouvrier. Mais on trouvait dans l’autonomie italienne la forme-parti extrêmement verticale, organisée, avec une velléité d’hégémonie culturelle de classe — ce qui ne serait pas possible aujourd’hui.
Alessandro Stella : Il n’y avait pas seulement cette verticalité, et pas partout !
Sylvaine Bulle : C’est vrai, c’était très hétérogène. Aujourd’hui, il y a des traces de l’autonomie italienne dans cette volonté d’occuper des lieux, de se les réapproprier, de montrer qu’il peut y avoir une relation entre résistance et exploitation. Ce qu’ont permis l’autonomie historique ouvrière et l’autonomie italienne, c’est ce rapport extrêmement fort, parce que conflictuel, entre insurrection et institution — rapport qui pourrait être, s’il faut en donner une, la définition de l’autonomie. Effectivement, on ne peut plus parler d’ouvrier-masse ou de prolétariat désormais. On est face à un salariat précarisé et, surtout depuis 1990, soit la fin du post-fordisme, on assiste à une montée généralisée des subjectivités : précariat, minorités racialisées, femmes… C’est peut-être par là, comme avec l’écologie ensuite, que l’autonomie s’est recomposée. À partir du moment où des subjectivités qui n’étaient pas conglomérées dans le prolétariat se sont croisées, elles ont pu trouver des lieux de résonance. L’autonomie italienne articulait ce que le philosophe Tronti appelait la « composition de classe ». Maintenant, ça n’est plus possible : on a une autonomie relationnelle — il s’agit de penser la relation entre les subjectivités. Contrairement à ce que tu suggérais, Alessandro, je ne crois pas qu’on gagne à faire tendre ces héritages vers les luttes actuelles, à voir l’autonomie dans les gilets jaunes. Ce qui soutient l’autonomie, c’est une pensée de l’auto-organisation, au sens qu’en donne Castoriadis : un imaginaire et des espaces-temps qui sont ceux de sociétés qui se pensent elles-mêmes, dans un lien très distendu avec l’hétéronomie — ce que ne font pas les gilets jaunes. L’autonomie n’est pas une cause : c’est une ontologie, une manière de penser sa vie plus ou moins en dehors des cadres, avec des règles et un imaginaire qui montrent que la société peut s’auto-réguler, s’auto-rythmer, s’auto-instituer.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Alessandro Stella : L’autonomie ouvrière que j’ai vécue en Italie, dans les années 1970, est née à l’écart des partis et des syndicats. Puis elle a mué en une multitude de formes. Ceux qui ont fait 19773, ce sont des gens comme moi : les petits frères de ceux qui ont fait 1968, de Toni Negri, Oreste Scalzone, Franco Piperno… Des petits frères qui se sont répondu et qui ont refusé la forme-parti, l’autonomie ouvrière organisée — quoi qu’il en dise, Toni Negri est toujours resté un peu léniniste. Le sommet de l’autonomie ouvrière, ça a été les milliers de personnes dans la rue : les ouvriers, les féministes, les homosexuels… Il faut parler d’autonomies au pluriel : chez les jeunes activistes, aujourd’hui, les questions de genre, par exemple, sont fondamentales. L’autonomie se construit de plus en plus par rapport à toute forme d’autorité, quelle qu’elle soit. En France, d’abord, autour du collectif et du journal Marge, puis en Italie, est né dans les années 1970 ce qu’on a appelé l’« autonomie désirante ». Un mouvement inspiré par Guattari, Deleuze, l’antipsychatrie, le désir comme moteur de l’humanité. Des ponts ont été jetés avec les courants contestataires venant des situationnistes, des surréalistes — c’est cette autonomie-là qui a gagné, notamment dans la langue. Prenez lundimatin et le Comité invisible : on met la poésie à l’ordre du jour et on arrête avec les pavés bien concentrés et dogmatiques ! Du mouvement des squats, dans les années 1990, aux ZAD françaises, on prône désormais la sécession. En Italie, après la débâcle des mouvements insurrectionnalistes au milieu des années 1980, l’autonomie s’est déportée dans les centres sociaux créés une décennie plus tôt.
Qu’est-ce qui se jouait, dans ces centres ?
« En face, tu as l’État : depuis trente ans, il mène la guerre aux squats. Faire sécession, c’est un beau concept : mais on nous en empêche. [Alessandro Stella] »
Alessandro Stella : Il s’agissait d’occuper des espaces et de vivre d’une autre façon : s’autogérer, vivre en coopérative, se débrouiller. Un exemple : le centre social Forte Prenestino, créé à Rome dans un ancien fort en 1986, au milieu des années de plomb, lorsque la répression était très forte, brutale, totale. Le slogan de la première occupation, le 1er mai 1986, était le suivant : « On fête le refus du travail ! » Ce slogan reprend complètement les idées des mouvements autonomes des années 1970. C’est comme ça que, pendant vingt ans, sous forme de squats et d’occupation, l’autonomie s’est reconstruite. Le problème, c’est que ces acteurs antagonistes ne jouent pas seul. En face, tu as l’État : depuis trente ans, il mène la guerre aux squats. Aujourd’hui, en ville, c’est devenu très compliqué d’en ouvrir. Faire sécession, c’est un beau concept, mais on nous empêche de le réaliser.
Sylvaine Bulle : Les traces des autonomies aujourd’hui, italiennes en particulier, se trouvent dans la critique artistique, sociale, langagière, post-situationniste ; c’est la question des appropriations, comme dans les usines ou squats. Sauf que les lieux ont changé. C’est sa principale évolution : là où la nouvelle autonomie s’exprime, c’est dans l’appropriation de la terre. Ces traces, aussi, sont la marque d’un certain désenchantement. La sécession ne peut plus donner lieu à un projet révolutionnaire, messianique, téléologique, comme le portaient le Comité invisible et la revue Tiqqun avant lui. Par ailleurs, l’État n’est plus à conquérir, tandis que l’autonomie italienne, elle, l’a souhaité : elle a voulu poser une hégémonie, il y avait des stratégies. Aujourd’hui on n’a plus de stratégie ; on a des tactiques. Ce qui a énormément changé, c’est l’essor de ce que Luc Boltanski a appelé avec Ève Chiapello le « nouvel esprit du capitalisme4 ». Les nouveaux autonomes en ont bien conscience : le capitalisme avale ou intègre jusqu’aux capacités de résistance. Un « bon anar » ou « un bon punk » et même les « utopies » sont entrés dans le capitalisme, ils y sont même tout à fait solubles. Negri, Deleuze et Tiqqun l’ont mis en avant : nous sommes devenus des entreprises numéraires, sans visage… Ce « nouvel esprit du capitalisme » introduit à la fois une défaite du mouvement autonome et un réarmement de celui-ci. Un réarmement moins dans l’usine et l’antagonisme avec l’État que dans quelque chose de relationnel, par des regroupements affinitaires en fonction de subjectivités, d’où émerge une nouvelle critique sociale beaucoup plus radicale. On peut le dater de Tiqqun et du Comité invisible et, surtout, des années 2009–2010, des nouvelles grèves, des mouvements des sans-papiers et des réoccupations. C’est ce que j’ai voulu montrer théoriquement et sociologiquement avec ce que j’ai appelé la « forme-occupation », dans mon livre Irréductibles : il y a à la fois une horizontalité et une verticalité de la critique par les nouveaux autonomes. Pas la verticalité de Mario Tronti — tout le monde unis derrière le prolétariat à la conquête de l’État — mais une verticalité qui s’appelle la critique radicale : porter une critique des institutions en extériorité, la reprendre de l’extérieur du système. C’est en cela qu’il y a une relance de l’autonomie. Un certain nombre de militants comprennent que ça n’est pas avec des petits mouvements sociaux alternatifs qu’ils pourront faire scission ou critiquer le capitalisme. Le capitalisme peut englober tous les mouvements sociaux alternatifs — on le voit avec Alternatiba. Si on peut parler d’autonomie, c’est d’abord en rappelant cette trace historique, soit l’idée de penser une auto-organisation qui irrigue toutes les sphères de l’existence ; c’est, aussi, en montrant qu’il faut critiquer en étant totalement à l’extérieur de la critique sociale « classique », de la critique réformiste et, évidemment, des partis de gauche.
Alessandro Stella : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec toi, notamment sur les gilets jaunes. Je pense qu’ils ont exprimé ça : l’auto-organisation sur les ronds-points, sur Internet, le refus de tout, des syndicats comme des partis. C’est, sans le savoir, une reprise des idées de l’autonomie par les prolétaires. Ils n’ont pas lu Mario Tronti, Toni Negri ni Julien Coupat, ni que dalle en fait, mais pourtant ils sont autonomes ! De manière composite, certes : il y a eu de tout. Mais les gilets jaunes demeurent l’expression d’un flux de classe. Je suis allé à 90 % des manifestations depuis trois ans, celles des gilets jaunes, celles contre le pass sanitaire — du bon côté, avec les gauchistes. À chaque fois, ça met en grosse difficulté l’État français, pour ne pas dire en crise. Mais le problème, tu l’as dit, c’est la réabsorption de la révolte par le système. Je pense au mouvement techno, sur lequel j’ai dirigé une thèse. C’est parti des ouvriers licenciés de Détroit après 1968, puis ça s’est répandu aux États-Unis, en Angleterre et en France sous une forme libertaire, de refus : on est tous artistes, on danse, on s’embrasse, on nique les gendarmes. Ça a été récupéré. Le système a cette horrible capacité de récupération et je ne sais pas comment on fait pour ne pas se faire aspirer…

[Stéphane Burlot | Ballast]
Sylvaine Bulle : On ne gagne pas à mettre dans le même panier différents mouvements. Les gilets jaunes n’ont jamais été anti-étatistes. Ils veulent l’État social, une réorganisation de l’État. Cela a commencé avec des bons d’essence, ça s’est poursuivi avec des cahiers de doléances : c’est avant tout un mouvement pour la démocratie. Tu parles de récupération : les gilets jaunes ont terminé dans le grand débat avec Emmanuel Macron ! Ce qui est commun avec les autonomes, c’est que le socle des gilets jaunes est fait de nouveaux prolétaires, issus du précariat. Mais ils n’ont pas les mêmes demandes politiques. Un autonome veut l’auto-organisation contre l’État, contre les institutions de pouvoir ; les gilets jaunes n’ont jamais dit qu’ils étaient contre l’organisation de la justice, de l’école, des transports. Ils ont demandé la réorganisation de la démocratie, des moyens à disposition de l’État social et, enfin, une démocratie beaucoup plus fraternelle, relationnelle. À l’inverse, une ZAD reprend cet ethos autonome. Il y a des individus venant du précariat, dotés d’une culture politique et souhaitant vivre en autogestion, voire en autonomie selon la définition de Castoriadis — instaurer ses propres normes d’existence. Mais ils ne pensent plus les occupations d’usine, ni même de ronds-points ; il s’agit de se mettre à l’écart et d’entrer dans une relation antagoniste avec le système par la réappropriation de la terre. C’est la marque de l’autonomie au XXIe siècle : là où les gilets jaunes sont une forme de doléance pour améliorer la démocratie, une zone occupée pose comme préalable un anti-étatisme, un anti-autoritarisme et un antifascisme. Chacune de ces formes revendique la non-domination. À partir d’un petit problème, on repense l’ensemble des modes de domination — économie, patriarcat, genre, relation enfants-adultes, école, justice… Le retour de cet anti-autoritarisme, très fort dans l’autonomie actuelle, ne l’était pas autant chez les gilets jaunes.
« Il s’agit de se mettre à l’écart et d’entrer dans une relation antagoniste avec le système par la réappropriation de la terre. C’est la marque de l’autonomie au XXIe siècle. [Sylvaine Bulle] »
Alessandro Stella : Les gilets jaunes sont des autonomes dans la pratique, à défaut de l’être dans les références — contrairement aux zadistes, oui. Même les gilets jaunes les plus gauchistes ont eu des carences par rapport au patriarcat, par exemple, ce qui n’est pas sans poser problème. Ça fait des années, aussi, que je fréquente les jeunes autonomes et j’ai vu les difficultés que peut causer l’actuelle prédominance des questions de genre. Ça fait partie des contradictions qu’il faut appréhender. C’est même primordial. Les féministes autonomes en Italie sont nées de la même manière, en réaction à la domination des hommes dans les groupes révolutionnaires. Depuis quelques années, la contestation à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ce sont les filles qui la tirent ; les mecs sont derrière.
L’autonomie « désirante » a gagné, donc. Et la ZAD a remplacé l’usine, le monde ouvrier et salarié ?
Sylvaine Bulle : Le statut de la jeune génération autonome va dans le sens de l’autonomie désirante, c’est certain. Mais on a des réarmements critiques très forts. Surtout, ce qu’il ne faut pas négliger, je le répète, c’est la reprise de la terre comme lieu d’émancipation ; la souveraineté sur la propriété ; le lien entre écologie et autonomie — en ce sens, je parlerais désormais volontiers d’autonomie paysanne. Théoriquement, Gorz et Castoriadis se rejoignent. La première ZAD à Notre-Dame-des-Landes a réussi à montrer qu’on peut à la fois instituer des espaces-temps autonomes et les faire irriguer dans toutes les sphères d’existence. Là où je pense à Gorz, c’est sur la redéfinition de l’écologie qu’il permet : assumer sa propre vitesse de vie, parvenir à un ralentissement à l’échelle individuelle et à celle de tout ce qui nous entoure. La ZAD — la première, en tout cas jusqu’en 2018 — combine à mon sens parfaitement autonomie et écologie.
Alessandro Stella : Pendant dix ans, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes était le cœur d’où partaient les idées autonomes qui ont irrigué le reste de la France. L’idée est de proposer d’autres formes de vie. Est-ce qu’au lieu de travailler 40 heures, on ne pourrait pas travailler 20 heures et faire autre chose ? Ce sont bien d’autres formes de relations sociales ou sexuelles qui sont inventées dans les ZAD. Et c’est tout ce qui compte : l’État, les partis, on s’en fout ! Mais il est vrai que les zadistes ont dû accepter un bail individuel avec l’État oppressif5. Il ne serait pas possible d’exiger un bail collectif alors même qu’il y a toujours eu des communaux, que du point du vue juridique il est possible d’avoir des propriétés collectives ! Les copains et les copines de Notre-Dame-des-Landes ont dû accepter ; ils ont institutionnalisé des conquêtes, oui, mais ce sont tout de même des conquêtes ! Bon an mal an, les camarades de la ZAD se sont adaptés, mais ça continue de fonctionner. Pour avancer dans la conquête du système il faut avoir des bases, des lieux où se rencontrer. Si tu es dispersé c’est impossible, et c’est pour ça que le système gagne. Les usines permettaient ça ; la ZAD le permet d’une certaine manière. Aujourd’hui, comment organiser, par exemple, une grève de livreurs à vélo ?

[Stéphane Burlot | Ballast]
En dehors de la ZAD, quels autres cas d’autonomie avez-vous observés en France ?
Sylvaine Bulle : Il y a des collectifs autonomes dans le 93, avec lesquels je travaille. Dans un réseau de petits squats, on arrive à cette autonomie tacticienne qui ouvre des fronts, qui ne lâche pas grand-chose sur les grands principes — auto-institution, indépendance à l’égard des structures de pouvoir — et qui essaie de mieux penser la question sociale. Comment, par exemple, penser l’autonomie alimentaire ? la reprise des terres en tant que collectif organisé ? comment instaurer une discussion sur ce que sont les minorités ? sur ce qu’est, aujourd’hui, la précarité ? Ce sont des collectifs qui partent de la ressource paysanne et alimentaire, par l’écologie et par un autre rapport à la société. Ils sont dans une tradition proudhonienne : toujours dans la discussion, le conflit, le rapport au commun. Mais en s’inscrivant également dans la décroissance : ne pas seulement vivre en dehors du capitalisme, mais dire que l’écologie est, justement, le contraire du capitalisme. C’est une jonction qu’on n’avait pas, évidemment, dans les années 1960, dans l’autonomie historique. Au fond, il s’agit de penser que l’écologie, c’est l’autonomie, et que le contraire est également vrai.
« Évidemment, le communisme a été trahi par tous les PC du monde. Mais je ne vois pas d’autre idéal possible ou désirable que d’être tous égaux. [Alessandro Stella] »
Alessandro Stella : Mais il faut voir de quelle écologie on parle. Un ancien camarade, membre de Potere Operaio, est devenu député Vert ; des copains anarchistes espagnols sont devenus écologistes : il y a eu une évolution dans cette génération. Oui, il y a désormais un mélange entre écologie et idéal communiste. Mais l’écologisme comme idéologie est devenu consensuel dans tout l’Occident. C’est une idéologie de citadins avant tout : un paradoxe complètement aberrant !
Sylvaine Bulle : On ne parle pas des « rabhistes » ou des « colibris », c’est évident. Ce qu’on peut retenir de l’autonomie aujourd’hui, c’est cette sorte de révolution « écoumènale » : l’écoumène, soit la part habitée de la Terre, et la crise climatique changent les conditions d’existence de tout le monde, mais également celle des groupes radicaux. L’écologie telle qu’on l’entend dans ces groupes est une façon de renouer avec des milieux, de retrouver des conditions de vie acceptables, démonétarisées, et ce dans toutes les sphères de l’existence. C’est une écologie qui peut être sociale — mais pas au sens idéologique qui, parfois, fait montre de beaucoup de classisme ; c’est une nouvelle appréhension du territoire, de l’alimentation, de la propriété ; c’est une nouvelle composition des mondes humains et non-humains, qui ne fait toutefois pas l’impasse sur les rapports de production et de reproduction — pas ce que l’on voit chez les auteurs à la mode du tournant non humain et du vivant, qui pensent avant tout une critique esthétique, de la même manière que l’« utopie » tend à le devenir. Penser l’écologie ainsi c’est, comme dit Gorz, avancer qu’elle est un anticapitalisme qui affecte toutes nos sphères de vie. C’est un projet d’émancipation collective et individuelle à l’échelle d’une collectivité. Là où de nos jours il y a une promesse pour l’autonomie, c’est que l’écologie permet de penser les communautés affinitaires, comme en Italie dans les années 1970, en acceptant de se répandre et de s’ouvrir, en ayant autant de fronts offensifs que de bases de repli, en pensant les questions sociales — je pense aux brigades de solidarité en Seine-Saint-Denis.
Alessandro Stella : Les groupes autonomes qui animent les luttes ont ce même esprit de solidarité, de faire communauté, qu’il y a cinquante ans. Souvent, dans des squats, l’enjeu est simplement de faire ensemble, de construire dans l’action. Je pense par exemple à des copains et des copines qui ont participé au Fouquet’s le 16 mars 2019 [incendie de la brasserie de luxe durant un « acte » des gilets jaunes, ndlr]. Certains peuvent être zadistes ou « buriens6 », dans les Black Blocs, mais beaucoup sont aussi animateurs de cantines populaires à destination des pauvres pendant les confinements. Ce sont des personnes qui réalisent l’esprit de base du communisme. Et pour moi, l’avenir de l’humanité, c’est le communisme. Évidemment, le communisme a été trahi par tous les PC du monde. Mais je ne vois pas d’autre idéal possible ou désirable que d’être tous égaux. Ces trente dernières années, les idées — évidemment et heureusement — ont évolué. Avant, c’était « pas de patron », maintenant c’est « pas de patriarche » : ça reste un idéal communiste.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Ne pourrait-on pas imaginer une alliance entre autonomie locale et changement révolutionnaire macroscopique, national ? Au Chili, le MIR se situait à la gauche d’Allende et, tout en menant des expériences radicales, il a appuyé l’Unité populaire…
Alessandro Stella : J’ai pris les armes après le coup d’État de Pinochet au Chili. Je pensais qu’on ne pouvait pas prendre le pouvoir par les urnes. Allende, lui, l’a fait, et ça a été le coup d’État. Les armes semblaient préférables aux urnes, alors s’il fallait prendre les armes, je les prenais. Depuis, j’ai abandonné cette idée.
Pourquoi ?
Alessandro Stella : C’est une voie impossible, maintenant que l’État est sur-armé. Il n’y a pas d’avenir possible ni par les urnes, ni par la révolution de type bolchevik : tout ça, c’est fini. Le seul avenir possible, c’est d’auto-construire des situations d’autonomie où l’on vit de façon différente, avec d’autres rythmes, d’autre formes de relations. Même dans les États les plus pauvres du monde, la révolution armée est devenue impossible. En 1960, on pouvait encore prendre le pouvoir, comme à Cuba ; c’est fini. Donc que faire ? Développer une culture d’autonomie — ce qui est facile dans les campagnes, mais plus compliqué en ville…
« Les occupations (Notre-Dame-des-Landes, Bure), ce sont des tentatives d’auto-institution, mais aussi une façon de se désencastrer complètement du système marchand. [Sylvaine Bulle] »
Sylvaine Bulle : Ce n’est pas possible en ville, pour la raison qu’il y a aliénation foncière. En ville, il y a des contre-cultures mais ce qui se produit de déterminant, au niveau politique, se fait en dehors des métropoles. Des formes d’autonomie compactes en métropole sont impossibles car c’est dans ces espaces que l’État est le plus fort, le plus présent et le plus aliénant. En termes de stratégie, ou plutôt de tactique, on a intérêt à aller à l’écart. C’était, semble-t-il, la stratégie des « néoruraux » du plateau de Millevaches dès le début : trouver des îlots-refuges où il soit possible de réarmer des formes de critiques, d’actions, qui ne sont plus possibles en ville. Il est difficile de tenir un squat plus de trois jours et il est impossible d’échapper aux lois sur l’état d’urgence ou le Covid… Dans des collectifs en Ariège, par exemple, avec qui nous sommes en contact, il n’y a pas ce même maillage coercitif du système marchand et politique qu’on a en ville. Aussi, il est important de voir comment la crise climatique crée des affects particuliers chez les autonomes, dans les nouveaux collectifs s’organisant — mais pas seulement —, lesquels impliquent un redimensionnement de l’action politique. Des personnes qui étaient peu ou pas politisées sentent la nécessité de faire autrement, de se délier du système marchand dans toutes les sphères de l’existence. L’autonomie permet d’articuler à la fois agriculture, production, santé, soin, etc. Si l’on prend le cas de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en 2012, nous n’étions pas dans le schéma actuel : il y avait quelques anarcho-autonomes et libertaires qui n’étaient pas vraiment tournés vers l’écologie, mais ils ont vu dans l’opposition à un grand projet inutile l’occasion d’inventer de nouvelles choses. Si la réappropriation de ce qui a été dégradé par la technique, par le capitalisme est au cœur de l’autonomie, c’est parce qu’elle permet ensuite de déployer des praxis, des formes d’occupation — parce que ça implique d’aller très loin dans la non-domination, en pensant toujours le rapport individu-collectif. C’est une chose qui est au cœur de la pensée de Gorz : qu’est-ce qui bénéficie aux autres lorsque je décide de ne plus travailler ? comment je redistribue mes acquis ? comment je pense production et pas seulement reproduction ? Au fond, les occupations (Notre-Dame-des-Landes, Bure), ce sont des tentatives d’auto-institution, mais aussi une façon de se désencastrer complètement du système marchand. C’est cela qu’on appelle « écologie ».
Alessandro Stella : Ceci dit, la sécession et le fait de prendre possession d’une terre ou d’un lieu, ce n’est pas nouveau. Ça a été pratiqué par les serfs qui fuyaient les seigneurs, au Moyen Âge, ou par les esclaves qui fuyaient les plantations en Amérique. Mais il y a eu des esclaves qui se sont rendus et des serfs rattrapés : pour faire sécession d’une société esclavagiste, pour couper avec les plantations, les esclaves marrons se réfugiaient dans les montagnes, où la vie est difficile. Certaines communautés se sont rendues aux autorités parce qu’elles ne parvenaient plus à y vivre. Donc la notion de refuge ou d’îlot-refuge est compliquée ; elle ne fonctionne pas si on est sur des terres arides ou dans les montagnes. D’où le problème de la sécession, qui implique que le pouvoir et le système restent à leur place.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Sylvaine Bulle : Il ne faut pas être obsédé par la sécession. Je parlerais plutôt de désertion ontologique, parce que, oui, c’est extrêmement difficile de faire sécession. Quant à l’État, on n’en a pas forcément besoin.
Alessandro Stella : Vraiment pas ! On n’a besoin ni d’État, ni de gouvernement ! En Italie, depuis l’après-guerre, aucun gouvernement n’a duré plus d’un an et demi.
Sylvaine Bulle : Il ne faut pas sous-estimer la fragilité de l’État. Ne pas sous-estimer la possibilité, sur un certain nombre de questions (par exemple les communs), d’ouvrir des brèches depuis l’intérieur de l’État — notamment sur les questions de droit, de propriété. Reste à savoir ensuite s’il est possible de conquérir ces petits espaces pour qu’ils ne se referment pas immédiatement et ne deviennent pas un prétexte pour une nouvelle gouvernance économique urbaine, à l’image de la ville de Paris. L’État macronien est capable d’absorber un certain nombre de dispositifs, mais d’autres (les communaux, le droit d’affouage7) peuvent être pérennisés et conduire à une sortie momentanée de l’État. En ce sens, les gilets jaunes sont beaucoup trop liés à l’État, à l’État social, pour avoir une pérennité.
Quel regard portez-vous sur l’expérience communaliste qui se mène au Rojava, sur fond de compromis avec l’État ?
« Le Rojava et le Chiapas sont l’une des manifestations de ces nouvelles cultures autonomes. Dans le monde entier on se réfère à ces zones de libération. [Alessandro Stella] »
Alessandro Stella : Le Rojava et le Chiapas sont l’une des manifestations de ces nouvelles cultures autonomes. Dans le monde entier on se réfère à ces zones de libération, de construction de modes de vie, d’administration différents. Le Rojava est un exemple magnifique de zones où les femmes sont en première ligne, où elles sont beaucoup plus respectées et ont plus de liberté qu’ailleurs. Le Chiapas aussi, évidemment. Mais comment faire en sorte que ces foyers de résistance ou de révolution puissent faire tache d’huile et se développent ? Tu as raison Sylvaine, et ces exemples le montrent : comme disait Mao, l’État est un château de cartes, il peut tomber d’un jour à l’autre — en témoigne l’État soviétique qu’on pensait dur comme fer. Certes, il n’y a plus d’usines en Occident, mais en Chine il y a cinq cents millions d’ouvriers ; dans certaines usines il y a encore des milliers d’ouvriers à la chaîne. Et même si on ne le perçoit pas ici, il y a des milliers de grèves et de lutte ouvrières, comme dans les années 1950, 60, 70 en Europe. L’État le plus totalitaire au monde, l’État chinois, pourrait tomber comme un château de cartes.
Sylvaine Bulle : Il faut faire attention à ne pas fantasmer le Rojava et le Chiapas. Ce sont des contextes géopolitiques et contre-nationalistes très particuliers. Nous n’avons pas du tout cette tradition en France. Mais, travaillant de plus en plus dans le milieu rural, je crois beaucoup à la force des territoires, à une forme de biorégionalisme, où on retrouve une somme de dimensions qui s’articulent : les ressources naturelles, les assemblées citoyennes, le refus de la division du travail, l’autosuffisance, les communautés qui vivent non plus fermées sur elles-mêmes mais redistribuent, des communautés qui se maillent entre elles de façon anti-léniniste.
Pourquoi préférez-vous parler de « tactiques » plutôt que de « stratégie » ?
Sylvaine Bulle : James C. Scott ou Michel de Certeau ont fait une différence entre stratégie et tactique. La stratégie, c’était l’autonomie italienne : la volonté de conquête d’une hégémonie. La tactique, c’est la petite chose qui n’amène pas à un plan d’organisation général, qui relève du bricolage, de l’opacité, qui privilégie les moyens sur les fins. Il y a une immanence dans cette forme d’autonomie de la tactique, sans plan de conquête verticale ou organisation quasi militaire. L’erreur de ceux et celles qui portent un idéal de sécession, c’est de penser que l’autonomie est contre l’hétéronomie. C’est absurde de penser les deux en opposition. Même au Rojava, on est toujours englobé par quelque chose d’autre. Il y a toujours de l’hétéronomie. Même à la ZAD première version il y a une hétéronomie relative — le droit d’avoir une boîte aux lettres, le droit à la Sécurité sociale, le RSA, etc. La question est de faire en sorte que cette hétéronomie ne devienne pas rapport de force. C’est là où on retrouve les tactiques et l’opacité, ce qu’a su faire magnifiquement la première ZAD — alors qu’aujourd’hui, les institutions extérieures sont plus présentes. Quand, dans une petite ZAD, vous avez la Chambre d’agriculture, la FNSEA, la préfète ou le préfet, le Conseil général, on ne peut prétendre être stratège. Un certain nombre de terres de la ZAD sont en voie d’être régularisées, c’est bien la preuve que face à un État-stratège, il faut inventer d’autres modes d’action. Il y a des institutions du social qui sont légitimes (l’école, l’hôpital) en tant que forme de reconnaissance du collectif extérieur — l’autonomie, c’est aussi faire partie d’une société. Et il y a des institutions qui peuvent être créées.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Alessandro Stella : Je pense qu’il vaut mieux éviter de raisonner en stratège. La plupart du temps, ça foire. Je vois mal comment on peut se libérer des contradictions que tous les autonomes ont : ceux qui ont occupé ou fréquenté la ZAD depuis plus de dix ans étaient au RSA tout en étant contre l’État. Je suis prof de fac et c’est avec mon salaire que j’arrive à être contestataire. C’est compliqué d’être absolument en dehors du système. Ou alors on devient ermite.
Sylvaine Bulle : Il y a une chose sur laquelle il faut insister quand on parle d’autonomie : l’autonomie part de l’expérience (Gorz aurait dit « du monde vécu »), mais il faut faire attention à ne pas affirmer qu’on peut maintenir un niveau critique dans sa pratique alors qu’on est déjà absorbé par l’État et par le capitalisme. On peut avoir un certain nombre de petites ZAD ou de collectifs qui pensent œuvrer pour l’écologie, ou être radicaux politiquement, mais qui, en fait, ont déjà été plus ou moins « absorbés », ou ne savent pas montrer la différence entre ce qu’ils font et ce que fait le système marchand. Ça vaut pour le greenwashing, pour des jardins collectifs, voire dans certains cas pour les assemblées municipales. On pourrait citer plein d’exemples de projets qui se disent autogérés, qui pensent qu’ils sont devenus le symbole de l’autonomie politique, alors que ce ne sont que des petites alternatives sans effet critique. Donc l’expérience, oui, bien sûr, mais ce que demande l’autonomie c’est la réflexivité. Ça a été le travail de la ZAD : toujours réarmer, savoir ce qu’est le droit, ce qu’est la propriété et ce qu’elle signifie économiquement, philosophiquement, savoir ce qu’est une armée, ce qu’est la police, ce qu’est le capitalisme néo-libéral. L’autonomie italienne aura appelé cela « un front vertical ». Suivant Luc Boltanski, on appelle cela une « critique en extériorité » : on ne peut plus se satisfaire d’une critique en intériorité (un petit jardin par-ci, une petite assemblée par là) qui, au fond, n’est que de la gouvernance urbaine.
« On peut avoir un certain nombre de petites ZAD ou de collectifs qui pensent œuvrer pour l’écologie, ou être radicaux politiquement, mais qui ont déjà été plus ou moins
absorbés. [Sylvaine Bulle] »
Alessandro Stella : Il faut s’attaquer aux gros morceaux des institutions d’oppression : la police, l’armée, la prison.
Sylvaine Bulle : Il faut savoir les nommer. Les juristes spécialisés sur l’environnement le font, à leur manière. Ils posent des questions comme : que veut dire l’État aujourd’hui ? qu’est-ce qu’on remet en cause ? la propriété, l’appropriation, l’aliénation ? Ce qui amène à penser les moyens de production et de reproduction, etc. Outre l’expérience, c’est ce réarmement théorique qui est important pour savoir ce que sont l’hétéronomie et le pouvoir. Surtout pour l’écologie. Il y a un gros travail à faire sur ce que veut dire la propriété.
Alessandro Stella : Et qu’est-ce que sont les communaux ? Après la chute du mur de Berlin, on a parlé non plus de communisme mais de « communaux ». Sauf que aujourd’hui, on désigne comme « communaux » chaque potager ou jardin urbain ! C’est un peu pauvre… On a oublié qu’il y a cinquante ans, un certain nombre de biens qui, aujourd’hui, sont privatisés et font la fortune des grands capitalistes étaient considérés comme des biens communs : le téléphone, l’électricité, l’eau. Si tu veux faire une révolution demain, alors décrète que les énergies, la téléphonie, Internet sont des biens communs gérés de façon collective. En faisant ça, tu niques tous les capitalistes du monde.
Parlons des syndicats, qu’on a évoqués tout à l’heure. On a tous et toutes à l’esprit l’image d’un mouvement autonome en franche opposition avec eux : tout compagnonnage est impossible ?
Alessandro Stella : Le constat, c’est que dans l’Italie des années 1960 et 70, l’autonomie ouvrière s’est construite par rapport aux partis et aux syndicats. Peu de gens le savent, mais l’historien Arnaud Dolidier a clairement mis en lumière la prise de distance d’avec les syndicats en Espagne aussi, et notamment avec le Comisiones obreras, le syndicat d’affiliation communiste. Parce que, sous le franquisme, le Comisiones obreras avait joué le jeu et pactisé en envisageant le syndicat comme une protection sociale qui, par exemple, gère la mutuelle. On a alors assisté à la formation d’assemblées ouvrières autonomes. Cette autonomie vis-à-vis des syndicats, c’était fondamental. Aujourd’hui, ça s’exprime dans les manifs. Je me souviens d’une manif de rentrée de syndicats : on a réussi à former un cortège de tête qui, immédiatement, a été empêché par le service d’ordre de la CGT. C’est incroyable que les cégétistes jouent les pompiers par rapport aux mouvements sociaux ! En Italie et en Espagne, il y avait des assemblées ouvrières dans les années 1970, des Conseils ouvriers qui faisaient contrepoids aux syndicats. Aujourd’hui il n’y a plus ça. Ceci posé, j’apprécie que SUD et Solidaires existent car ils sont véritablement des syndicats de lutte. J’apprécie qu’il y ait des groupes locaux CGT qui soient contestataires. Mais si on s’en tient à la Centrale… Il n’y a malheureusement pas de Conseils ouvriers.

[Stéphane Burlot | Ballast]
Mais comment imaginer une transformation émancipatrice, révolutionnaire, sans liens étroits avec le monde du travail, largement majoritaire ?
Alessandro Stella : C’est vrai, et c’est terrible. En 2018, il y avait l’occupation des universités, de Tolbiac, et les cheminots bougeaient aussi. Mais c’est resté une mobilisation syndicale : il n’y a pas eu la formation de Conseils d’usine indépendants. Les meilleurs, c’était SUD-Rail, mais ça restait un syndicat.
Sylvaine Bulle : Il y a un vrai talon d’Achille des nouvelles formes d’autonomie, qui est de ne pas prendre en compte l’histoire des caisses ouvrières, des caisses de solidarité, de la solidarité proudhonienne, et d’en être resté, en termes de tactique, à « cortège de tête, tête de cortège ». C’est oublier qu’il y a une histoire des Conseils ouvriers, des formes d’associationnisme ouvrier qui est très importante. En même temps, l’époque n’est plus la même. SUD a par exemple beaucoup de mal à prendre en compte une sociologie des nouveaux salariats, de la flexibilité. Ils le font, mais ce n’est pas encore aussi abouti que lorsque l’autonomie italienne parvenait à articuler une forme de compositionnisme8. Aujourd’hui, il y a le fantasme de l’insurrection à travers les Black Blocs, très esthétique, qui fragmente l’unité syndicale. Mais les enjeux sont de penser une conflictualité avec les syndicats qui ne soit pas seulement antagonique. Il s’agit de savoir s’il peut y avoir un nouveau compositionnisme, de nouvelles formes de rencontres entre les individus qui ne soient pas seulement issues du territoire, de la ZAD, du local, mais qui soient aussi liées aux nouvelles formes de travail (le travail ubérisé, notamment). Si on prend les livreurs Uber, sans avoir une culture politique autonome, ils s’auto-organisent pour certains en dehors des syndicats. C’est assez proche des petits partis libertaires qui posaient la question des moyens de survie, de l’auto-organisation. Voilà l’écueil qu’on peut percevoir dans le mouvement des collectifs autonomes : parti des usines et des conditions de travail, il se retrouve aujourd’hui très loin de ces questions. Même si le salariat est beaucoup plus flexible, il y a toujours des formes de travail encadrées par des syndicats, et la jonction ne se fait pas avec celles-ci.
« Il serait souhaitable de voir surgir des propositions de création de Soviets dans tous les lieux de travail. C’est un concept fondamental. C’est à remettre sur la table. [Alessandro Stella] »
Alessandro Stella : Il serait en effet souhaitable de voir surgir des propositions de création de Soviets dans tous les lieux de travail, qu’ils soient concentrés ou dispersés. C’est un concept fondamental. C’est à remettre sur la table. Mais avec la restructuration, la dispersion du travail d’usine, la précarisation à outrance des travailleurs, c’est de plus en plus difficile de réunir les gens. Restent Internet et ses liens, qui permettent de se raccrocher aux réseaux d’amitié, affinitaires.
Sylvaine Bulle : Attac a bien compris la nécessité d’articuler ce qu’on pourrait appeler de « nouveaux Conseils d’usine à l’ère de la globalisation ». L’altermondialisme fait qu’il y a énormément de petits collectifs de salariés « flexibles » qui sont invisibilisés. Ils commencent à s’organiser mais n’ont pas encore pu monter en généralité. Attac le prend en compte — en voulant, bien sûr, rassembler toutes ces populations derrière la bannière d’un parti. Mais à l’ère des GAFAM, comment peut-on envisager que de tels modes d’organisation soient possibles ? Attac a bien perçu qu’il y a une nouvelle classe flexible, un nouveau prolétariat numérique, mais cela ne dit rien de la façon de s’organiser. Cette idée de Conseils ouvriers est une vraie source de réflexion.
Alessandro Stella : Au XXe siècle, les patrons capitalistes ne pensaient pas que les ouvriers allaient se révolter. Aujourd’hui, on ne pense pas que les travailleurs des GAFAM puissent le faire. Mais que ce soit un informaticien dans la Silicon Valley ou un manutentionnaire dans un hangar Amazon en région parisienne, s’ils ont un jour envie de se révolter, ils se révolteront. Dans quelques années, on pourrait imaginer une désertification de La Défense, qui a pourtant seulement cinquante ans, avec la généralisation du télétravail. On ne sait pas où la révolution peut surgir.
[lire le deuxième volet | Anasse Kazib et Laura Varlet : « Affronter et déposséder le système »]
Photographies de bannière et de vignette : Stéphane Burlot | Ballast
- Référence à la proposition de Guy Debord, à l’origine de l’Internationale situationniste : construire des situations, c’est « la construction concrète d’ambiances momentanées de la vie, et leur transformation en une qualité passionnelle supérieure » (Guy Debord, Rapport sur la construction de situations, 1957).[↩]
- Courant marxien hétérodoxe né dans les années 1960 en Italie, autour de la revue Quaderni Rossi. L’opéraïsme, de operaio (ouvrier), met en avant la centralité de la classe ouvrière dans le développement capitaliste, conduisant à revendiquer le refus du travail et non plus seulement sa réappropriation par les travailleurs et travailleuses. Structurellement, le sujet révolutionnaire passe de l’ouvrier spécialisé à l’ouvrier-masse, souvent contraint à émigrer à l’intérieur du pays pour trouver du travail. Enfin, la stratégie mise en avant est l’autonomie à l’égard des organisations représentatives, notamment syndicales. La création de comités ou Conseils ouvriers autonomes est encouragée.[↩]
- Mouvement politique spontané né, d’une part, hors des partis et syndicats et, d’autre part, hors des organisations extra-parlementaires qui animaient la contestation depuis 1968. Les composantes féministes et homosexuelles du mouvement s’affirment, certains groupes choisissent la lutte armée, plusieurs villes font l’objet de manifestations et d’émeutes de grande ampleur.[↩]
- Le Nouvel Esprit du capitalisme est un ouvrage des sociologues Luc Boltanski et Ève Chiapello qui met en évidence, notamment, une neutralisation de la critique traditionnelle du capitalisme en raison d’un redéploiement de celui-ci. Par « esprit », il faut entendre une « idéologie qui justifie l’engagement dans le capitalisme », idéologie qui a connu plusieurs formes jusqu’à celle qui domine aujourd’hui, centrée sur la sécurité et l’autonomie.[↩]
- Après la répression qui a fait suite à l’échec du projet d’aéroport, en 2018, des concertations ont été menées par certains militants et militantes avec l’administration et les représentants syndicaux des agriculteurs. Une régularisation de la propriété des terres occupées a été demandée, débouchant sur l’octroi de baux précaires, puis de baux ruraux, à une partie des actuels habitants et habitantes de l’ancienne ZAD.[↩]
- Militants et militantes mobilisés à Bure contre le projet Cigéo qui projette d’enfouir des déchets nucléaires.[↩]
- Droit de prélever du bois en forêt communale après un tirage au sort et l’attribution d’une quantité à couper.[↩]
- Terme employé par une partie des théoriciens de l’opéraïsme. Ainsi que l’a expliqué Gigi Romero dans la revue Période : « Regarder vers la composition de classe, co-rechercher et agir à l’intérieur d’elle pour la plier vers une direction antagoniste, signifie centrer continuellement l’initiative politique sur le rapport entre processus et sujet. » Il s’agit de faire place aux subjectivités à l’intérieur du sujet révolutionnaire que serait le prolétariat.[↩]
REBONDS
☰ Lire l’abécédaire d’André Gorz, mai 2021
☰ Lire notre article « L’Espagne après Franco : le mouvement ouvrier pendant la transition démocratique », Arnaud Dolidier, octobre 2020
☰ Lire notre entretien avec Anne Steiner : « Ce qui m’intéresse, ce sont les vies minuscules », octobre 2020
☰ Lire les bonnes feuilles de L’Hypothèse autonome, Julien Allavena, septembre 2020
☰ Lire notre article « La souveraineté contre l’autonomie », Édouard Jourdain, juin 2020
☰ Lire notre reportage « Vendée : une ZAD contre un port de plaisance », Roméo Bondon et Léon Mazas, octobre 2019


