Entretien inédit pour le site de Ballast
L’arbitrage international ? Un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Des enjeux finalement moins techniques — malgré, avouons-le, les apparences — que politiques. C’est précisément quand on nous présente des figures du droit comme « indépassables » qu’il nous faut nous interroger sur leur généalogie et leurs effets. Nous avons rencontré Renaud Beauchard, avocat, qui a publié cet automne L’Assujettissement des nations aux éditions Charles Leopold Meyer. Il décrypte pour nous l’histoire de l’arbitrage d’investissement, aboutissement de la logique néolibérale au service des entreprises transnationales.
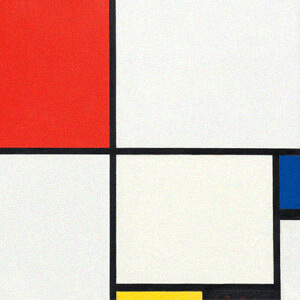
Par un concours de circonstances. D’abord, je réside à Washington D.C., où la principale institution d’ISDS (Investor State Dispute Settlement) — RDIE en français — a son siège, au sein du groupe Banque mondiale. Ayant moi-même été consultant dans d’autres secteurs de ce groupe, je me suis vite rendu compte que l’ISDS était un maillon central de tout le système mis en place par les institutions de Bretton Woods et les organisations travaillant dans le secteur du développement. L’ensemble est regroupé sous l’expression anglaise de « leveling the playing field », c’est-à-dire d’aplanissement du monde pour les investisseurs. L’aspect qui m’intéressait tout particulièrement était l’idée que des arrangements institutionnels décidés localement (les codes d’investissement ou les lois nationales de prévention de la corruption) ou contenus dans des traités internationaux, puissent être pensés comme des signaux à envoyer à des investisseurs afin de capter des flux de capitaux sous la forme d’investissements directs étrangers. Les instances de la gouvernance mondiale amalgament l’ensemble de ces phénomènes sous le vocable d’« amélioration du climat des affaires » ou d’« attractivité des systèmes juridiques ». Travaillant à la fois sur ces questions et étant particulièrement attentif à la réflexion menée sur le sujet par l’Institut des Hautes Études sur la justice, j’ai peu à peu acquis la certitude que l’ISDS, participant d’une logique de sanctuarisation des droits des investisseurs, c’est-à-dire de garantie d’un investissement sans risque, était au centre de ce dispositif et qu’il s’agissait d’un phénomène majeur dans l’économie mondialisée qui méritait d’être sorti de sa gangue technicienne et exposé dans toute sa dimension systémique. L’augmentation du nombre d’affaires au cours des dix dernières années et les débats suscités par l’insertion de dispositions sur l’ISDS dans les grands accords dits « de nouvelle génération », comme le CETA ou le JEFTA, n’ont fait que renforcer ce sentiment.
Vous faites remonter très loin les origines de l’ISDS et de ce que vous appelez la « sanctuarisation des droits des investisseurs » — jusqu’à l’origine du droit international moderne, même !
« Il s’agissait de fournir un habillage juridique à l’usage de la force par des nations qui possédaient un avantage militaire. »
La généalogie de l’ISDS et du droit international de l’investissement est très importante. Comme pour tout phénomène, il faut se situer dans le temps long pour bien comprendre la situation actuelle. Je fais même remonter ses origines à l’avocat et juriste Grotius. Invité à la table des négociations du traité de Westphalie en 1648, conseiller de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales — une des premières grandes sociétés par actions —, Grotius a fortement contribué à façonner l’idée que la propriété et les obligations contractuelles étaient des règles de droit sans frontières devant être reconnues partout dans le monde, mais aussi que le commerce avait besoin de règles communes afin de garantir aux marchands le droit de commercer librement au-delà de leurs frontières. Or, qui dit droit dit recours à la violence légitime lorsque celui-ci est bafoué, et on peut ainsi raisonnablement dire que le droit international moderne est né de la nécessité de trouver des ententes entre les États afin de solder les affrontements armés entre les grandes compagnies de navigation, qui exerçaient au loin, rappelons-le, des fonctions d’administration des territoires conquis.
Traditionnellement, les conflits nés de spoliations véritables ou alléguées à l’encontre des marchands en terre étrangère étaient donc réglés par la protection diplomatique de l’État hôte. Dans le contexte de l’essor des nations européennes, il s’agissait de fournir un habillage juridique à l’usage de la force par des nations qui possédaient un avantage militaire considérable sur les pays hôtes de ces investissements. Le meilleur exemple de cette situation est reflété par la conclusion de traités inégaux, dont le plus célèbre, le traité de Nanqing, mit fin à la guerre de l’opium et inaugura plus d’un siècle d’humiliation pour la Chine. Ces traités instituaient une sorte de libre-échange forcé par la menace des armes qui créaient des zones dans lesquelles les ressortissants des nations militairement puissantes jouissaient de privilèges extraterritoriaux régis par les règles de la puissance militairement dominante. Un des moyens utilisés sous l’empire de la protection diplomatique afin de dépolitiser la question de l’investissement était celui des commissions mixtes, composées d’arbitres choisis par les parties et présidées par un « surarbitre » provenant d’une nation tierce. Mais ces commissions mixtes avaient pour objet de trancher un différend entre États afin de trouver une solution alternative à la guerre, le plus souvent sous la forme d’accords d’indemnisation forfaitaire conclus entre les deux États engagés dans le conflit. Elles devaient fournir une solution juridique permettant la résolution d’un conflit interétatique. C’est donc dans ce cadre interétatique qu’ont été réglées rien de moins que les conséquences de la révolution mexicaine, la révolution russe, la réforme agraire au Mexique et même, plus près de nous, les expropriations de ressortissants américains dans le cadre de la révolution iranienne.

Extrait de Composition II de Piet Mondrian
Quand le changement se produit-il, selon vous, entre un règlement interétatique des conflits en matière d’investissement et la situation actuelle où les entreprises transnationales peuvent directement poursuivre les États ?
Sur le plan des principes, c’est en pleine guerre froide, dans la décennie 1950, au moment des troubles, puis des vagues d’expropriations et de nationalisations accompagnant la décolonisation, qu’a germé l’idée d’une sorte de juridiction internationale traitant des questions d’investissement afin de dépolitiser les relations tendues entre les nouvelles nations indépendantes et les anciennes puissances coloniales. L’ISDS est inséparable du contexte de la guerre froide et de celui de la contestation naissante dans les nations du Sud. Il est donc né d’une volonté de trouver une solution empêchant l’embrasement des troubles sociaux et politiques contre les investisseurs des anciennes puissances coloniales et de limiter au maximum le risque d’affrontement direct entre les deux grandes puissances dans les nations nouvellement émancipées de la tutelle coloniale. L’ISDS, dont la véritable naissance coïncide avec la création du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) en 1966, permettait à un investisseur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’investissement avec l’État hôte, de prévoir le recours directement par l’investisseur devant un tribunal arbitral rendant sa décision en dernier ressort, et dont la sentence serait exécutoire presque partout dans le monde en raison du réseau de reconnaissance et d’exécution des sentences de l’arbitrage commercial international, c’est-à-dire du mode de règlement des différends entre les marchands. Toutefois, dans un premier temps, l’ISDS est demeuré une institution assez confidentielle. La première affaire a été introduite en 1974, à la suite de quoi on comptabilise une petite poignée de plaintes. Par exemple, une seule affaire a été enregistrée entre 1987 et 1992, puis on comptabilise de nouveau l’introduction d’une instance arbitrale en 1993, puis respectivement deux en 1994 et 1995. On assiste ensuite à une véritable explosion du contentieux dans les décennies 2000 et 2010. Par exemple, sur les quelques 823 affaires répertoriées depuis 1987, 449 l’ont été entre 2010 et 2017 et 325 l’ont été au cours de la décennie précédente.
Qu’est-ce qui a été l’élément déclencheur de cette explosion du contentieux arbitral dans les décennies 2000 et 2010 ?
« L’ISDS est inséparable du contexte de la guerre froide et de celui de la contestation naissante dans les nations du sud. »
C’est l’affaire AAPL v. Sri Lanka engagée en 1987 et tranchée en 1990 qui a inauguré la « révolution silencieuse » de l’ISDS. Cette affaire est doublement intéressante dans la mesure où, d’une part, son contexte factuel est parfaitement représentatif des considérations qui ont conduit à concevoir le système de l’ISDS dans l’esprit de ses architectes dans les années 1950, et où, d’autre part, elle transforme l’ISDS en une arme non plus défensive mais offensive pour les entreprises transnationales. Rappelons brièvement les faits de cette affaire. La société AAPL était une société britannique de droit de Hong Kong qui avait pris une participation minoritaire dans le capital d’une entreprise du Sri Lanka, Serendib Seafood Ltd, pour la réalisation d’un projet d’aquaculture (élevage de crevettes) dans ce pays. AAPL demandait une indemnisation au Sri Lanka après que le centre d’élevage qu’elle exploitait ait été incendié en janvier 1987 au cours d’une opération militaire montée par les forces sri-lankaises contre des rebelles qui s’y étaient réfugiés. Traditionnellement, l’intervention du CIRDI n’aurait été justifiée que s’il avait existé une clause d’arbitrage dans un contrat d’État liant AAPL au Sri Lanka, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque AAPL s’était bornée à conclure un accord de joint-venture avec une société sri-lankaise. Dès lors, le seul recours théoriquement disponible, dans l’état du droit avant AAPL v. Sri Lanka aurait été, pour AAPL, de saisir les juridictions sri-lankaises et/ou de demander la protection diplomatique britannique.
Mais AAPL a choisi une autre voie en saisissant le CIRDI en juillet 1987, fondant la compétence du centre sur l’article 8 du traité de protection des investissements qui avait été conclu en 1980 entre le Sri Lanka et le Royaume-Uni. Imputant aux autorités sri-lankaises la responsabilité de la perte de son investissement, AAPL fondait sa réclamation tant sur les dispositions du traité que sur les règles du droit international qui établissaient, à ses yeux, l’obligation qu’a l’État de réparer les dommages que l’investisseur avait subis du fait de l’action ou de l’inaction de celui-ci. Le CIRDI s’est déclaré compétent sur la base du seul traité bilatéral et a condamné le Sri Lanka à indemniser AAPL en se fondant sur une norme de traitement des investisseurs internationaux par l’État d’accueil de « protection et sécurité complète » (« full protection and security »), c’est-à-dire un régime mettant à la charge de l’État la responsabilité de protéger l’investissement, en assurant une protection militaire ou policière.
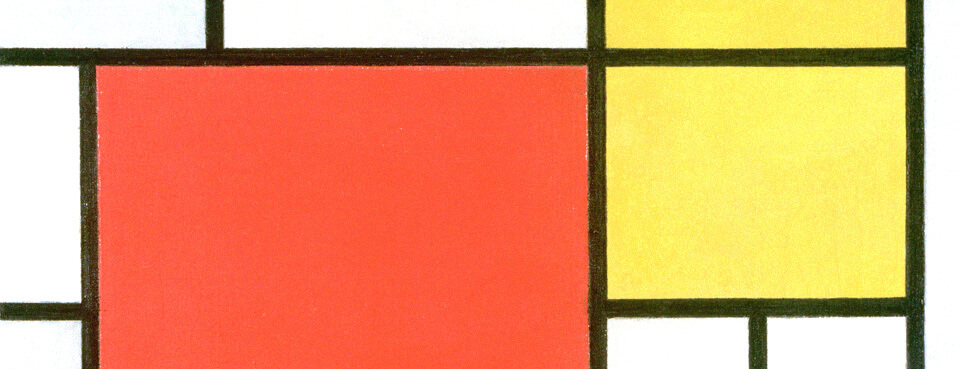
Extrait de Composition en rouge, jaune, bleu et noir de Piet Mondrian
Je pense qu’AAPL v. Sri Lanka est véritablement l’une des décisions juridictionnelles les plus importantes jamais rendues, car elle nous fait basculer de l’ère du droit international, c’est-à-dire interétatique, à celle d’un droit global qui place en position de surplomb le droit commercial international et donne un avantage décisif aux entreprises transnationales. C’est en effet la première décision, à ma connaissance, qui reconnaît à une personne juridique autre qu’un État la qualité de sujet de droit international public. Ceci devait avoir des conséquences très profondes. C’est en effet à partir de 1990 qu’on constate une augmentation massive du nombre de traités bilatéraux et accords internationaux d’investissements (contenant une clause d’ISDS), dont les conclusions ont atteint un pic en 1997 (249 traités conclus au cours de cette année). Et nul doute que cette affaire a aussi pesé lourd dans les négociations (alors en cours) de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui, en introduisant l’ISDS dans un traité mêlant libre-échange et investissements, constituent véritablement la matrice des accords dits « de nouvelle génération » dont le CETA est la dernière incarnation.
Vous parlez de la « sanctuarisation des droits de l’investisseur », au-delà même de sa seule protection. Le droit d’investir serait-il devenu une fin en soi, quelles que soient ses conséquences ?
« D’une préoccupation d’assurer la sécurité de l’étranger, nous sommes passés à la garantie de la rentabilité de l’investissement. »
La sentence rendue dans l’affaire AAPL v. Sri Lanka et la vague de traités conclus dans son sillon représentent véritablement le moment décisif où l’on passe de la protection à la sanctuarisation des droits des investisseurs. En inaugurant la possibilité pour des investisseurs de se prévaloir des dispositions concernant l’ISDS dans un traité, les arbitres du CIRDI ont ouvert le champ pour ce que j’appellerais une responsabilité de l’État hôte du fait de l’exercice de sa souveraineté, même lorsque l’État hôte ne se livre à aucun excès de pouvoir (du type des spoliations qui ont été conduites au moment de la zaïrianisation sous Mobutu). C’est en effet à partir d’AAPL que les arbitres et les rédacteurs de traités ont commencé à multiplier les concepts comme la doctrine des attentes légitimes1, qui peu à peu transformaient la nature du droit international des investissements, le faisant passer d’un bouclier contre l’abus de puissance étatique en une arme destinée à donner aux investisseurs des droits extraterritoriaux exécutoires, n’importe où dans le monde.
C’est en effet, également, sous couvert de la doctrine des attentes légitimes qu’un certain nombre de formations arbitrales ont reconnu, par exemple, un droit des investisseurs à un « système stable » garantissant à l’investisseur la possibilité de réaliser des bénéfices pendant toute la durée de l’investissement. Certaines formations arbitrales ont même jugé que la doctrine des attentes légitimes donnait lieu à une obligation des États de garantir aux investisseurs un taux raisonnable de retour sur investissement. Comme le dit l’auteur d’un manuel reconnu dans la matière2 : d’une préoccupation d’assurer la sécurité de l’étranger, nous sommes passés à la garantie de la rentabilité de l’investissement. Ceci est, du reste, aggravé par les interprétations (pour le moins tirées par les cheveux) des principes d’indemnisation inspirés du droit des contrats anglo-américain. Interprétant à la lettre, et sans les tempéraments reconnus par les juges anglo-américains, le principe que les dommages dus dans le cas d’une inexécution contractuelle constituent une exécution par équivalent (c’est-à-dire qu’ils allouent à la partie victime de l’inexécution l’avantage économique espéré du contrat), les tribunaux arbitraux ont eu tendance à adopter une jurisprudence très libérale sur les gains manqués. C’est ainsi, par exemple, qu’un tribunal arbitral ad hoc a accordé à un investisseur koweïti une indemnisation correspondant à 90 années de profits espérés pour un projet immobilier annulé à la suite du Printemps arabe avant la pose de la première pierre. Et dans une affaire en cours, un petit investisseur minier dans le domaine aurifère réclame une indemnisation de 16,5 milliards de dollars à la Colombie (ce qui correspond à 25 % du budget national colombien !) après que l’État colombien a classé comme réserve naturelle la zone d’extraction et que les juridictions colombiennes ont en conséquence annulé son permis d’exploitation.

Extrait de Composition avec du rouge, du bleu et du jaune de Piet Mondrian
C’est cela que j’entends par la notion de sanctuarisation des investisseurs qui, dans les deux cas cités en exemple, s’apparente à un racket institutionnalisé. Il s’agit d’autant plus d’une sanctuarisation que seul l’investisseur étranger dispose d’un droit d’action devant un tribunal d’ISDS, à l’exception des investisseurs nationaux. Par exemple, dans l’affaire Vattenfall, les investisseurs allemands ont dû se contenter de la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a jugé que la sortie accélérée du nucléaire décidée par le gouvernement était en violation de certains points de la législation mais n’avait pas les caractéristiques d’une expropriation, n’ouvrant dès lors qu’un droit à une indemnisation raisonnable qui devrait se chiffrer tout au plus en centaines de millions d’euros. En revanche, la société suédoise Vattenfall, qui est un investisseur étranger, dispose d’une autre voie procédurale et continue à se prétendre victime d’une expropriation par l’État allemand devant le CIRDI, réclamant un montant de plus de quatre milliards d’euros de dommages-intérêts. Si le tribunal arbitral du CIRDI lui donne raison, il s’agira alors d’une remise en cause au profit d’un seul acteur économique de la décision de la Cour constitutionnelle allemande.
Vous faites de la sanctuarisation des droits des investisseurs un phénomène si important que vous la voyez comme une manifestation d’un renversement du principe de souveraineté. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ?
« D’un instrument au service du développement des nations, les investissements directs étrangers sont devenus une finalité, privant ainsi les États souverains de la possibilité de choisir quel type de capital ils entendent associer à leur développement. »
Repartons de la naissance de l’ISDS dans les années 1950 pour préciser le contexte dans lequel ce renversement s’opère. La période au cours de laquelle le concept d’ISDS apparaît est un monde en reconstruction où le capital était rare et les débouchés presque illimités et où les surplus de capitaux étaient essentiellement concentrés aux États-Unis qui recherchaient, dans la projection de leur puissance à l’échelle du monde, à assurer à leur industrie et à leur protection militaire les moyens de son approvisionnement. Mais l’ISDS connaît son essor dans un contexte radicalement différent, qui est celui de la financiarisation de l’économie mondiale. Les États-Unis n’y sont plus le principal créancier de la planète mais son principal débiteur depuis que, lors de la contre-révolution monétariste engagée vers 1978–1979, ses autorités monétaires et économiques ont choisi de recycler la totalité des surplus de capital du reste du monde, plutôt que de chercher à faire face à la concurrence par des gains de productivité. À l’inverse de la période précédente (les décennies 1950 et 1960), ce contexte est caractérisé par une abondance de capital, qui plus est très concentré, et des débouchés limités. Ce nouvel environnement est le théâtre d’une recomposition très profonde des États et de la question de l’investissement. D’un instrument au service du développement des nations, les investissements directs étrangers sont devenus une finalité, privant ainsi les États souverains de la possibilité de choisir quel type de capital ils entendent associer à leur développement. C’est ce qu’on a pu voir notamment au Japon où la pression des marchés financiers a contraint le gouvernement japonais à libéraliser l’industrie des jeux de hasard malgré une franche et nette opposition de la population. Dans ce « marche ou crève » à l’échelle mondiale, les États qui cherchent la croissance doivent offrir aux investisseurs des garanties en nombre de plus en plus important, y compris en leur promettant un régime d’exception (qui n’est pas sans rappeler les privilèges extraterritoriaux dont jouissaient les puissances coloniales au XIXe siècle) et en les mettant à l’abri de la concurrence locale. Dans cette course au moins-disant, c’est-à-dire au partage le plus inégal des risques entre l’État hôte et l’investisseur, les États sont souvent prêts à violer le tabou suprême, c’est-à-dire à sacrifier le principe de la loi commune en donnant aux investisseurs le moyen, via une instance de véridiction située en surplomb par rapport à toutes les institutions locales ou nationales, d’appliquer des principes assurant la mobilité absolue du capital et de remettre en cause des choix souverains qui viendraient diminuer la rentabilité de l’investissement.
C’est cette transformation de la stratégie d’attraction des investissements étrangers en une finalité nécessaire à la survie dans l’économie mondiale qui induit ce que j’ai appelé un renversement de souveraineté. Le cercle vicieux institué par la dégradation du droit en instrument d’attractivité renverse fondamentalement le rapport du droit au souverain. Dans le modèle de souveraineté, depuis Jean Bodin, le droit était envisagé depuis l’intérêt général, dont la personne du souverain était tenue pour le garant. Dans le type de relations juridiques mises en lumière par le droit international de l’investissement, c’est, pour citer Antoine Garapon, « le consommateur de droit qui devient l’arbitre ultime, et non plus le souverain3 ». L’ISDS est une illustration parfaite de ce renversement de souveraineté. La structure en réseau de reconnaissance et d’exécution des différends commerciaux entre marchands, sur laquelle il est fondé, est constituée par l’arbitrage commercial international qui confère au détenteur d’une sentence arbitrale une sorte de passeport international qui lui permet d’en rechercher l’exécution un peu partout dans le monde sans grande difficulté. Ainsi, l’ISDS est avant tout concerné par les objectifs d’exécution des obligations contractuelles et la protection des droits de propriété, ces droits sans frontières chez Grotius. Il n’est nullement conçu pour accorder la moindre considération aux questions sociales, environnementales, éthiques et de Droits de l’homme qui peuvent se poser à l’occasion des différends entre États et investisseurs.
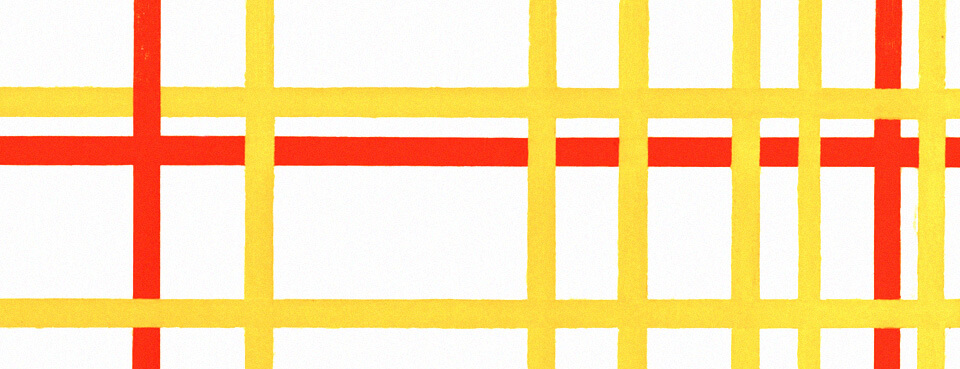
Extrait de New York City de Piet Mondrian
Parmi les facteurs favorisant ce renversement de souveraineté, vous accordez une place de premier plan à la personnalité juridique des entreprises transnationales, qui leur permet une mobilité sans limite sur la planète, tout en préservant la possibilité d’invoquer les droits de l’Homme — donc, de se présenter en « victimes » des États. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce « droit de l’hommisme des entreprises transnationales » ?
J’ai évoqué plus tôt l’idée, déjà en germe chez Grotius, que le droit de commercer au-delà de ses frontières est un « droit » dont la protection justifie l’usage de la force. Mais compte tenu de la nature hybride des anciennes sociétés par actions, outils de propagation de la puissance des grandes nations européennes, il s’agissait alors d’habiller juridiquement un rapport de force entre États. La situation est radicalement différente aujourd’hui. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les entreprises transnationales se sont progressivement constituées, comme l’écrit Giovanni Arrighi, en « un réseau mondial de production, d’échange et d’accumulation qui n’[est] soumis à aucune autorité étatique et a le pouvoir de soumettre à ses propres lois tous les acteurs du système interétatique, y compris les États-Unis ». Devenues véritablement globales, les entreprises transnationales jouent de leur nature hybride de personne juridique non-humaine — à laquelle la marche vers le marché mondial unique accorde des privilèges de mobilité considérables — et en même temps abusent de l’anthropomorphisme qu’induit leur personnalité juridique pour se voir reconnaître des droits « humains ». Comme certaines personnes à gros patrimoine, elles veulent être à la fois des citoyens de partout (pour les privilèges et les profits) et de nulle part (pour les devoirs civiques et les impôts).
« Les entreprises transnationales veulent être à la fois de partout (pour les privilèges et les profits) et de nulle part (pour les devoirs civiques et les impôts). »
S’agissant tout particulièrement de la question de l’investissement, ce qui me frappe est la façon dont les investisseurs jouent sur le registre émotionnel en faisant l’amalgame entre n’importe quelle action gouvernementale susceptible de diminuer leur retour sur investissement et le type d’expropriations souvent accompagnées d’actes de violence d’épisodes associés à la décolonisation (comme la vague de pillage des ressortissants européens installés de longue date au Zaïre de Mobutu au moment de la zaïrianisation, au début de la décennie 1970). Ainsi, les entreprises utilisent le ressort des droits de l’homme en assimilant la figure de l’investisseur étranger à celui du demandeur d’asile qui a entrepris un voyage périlleux au-delà des mers pour se heurter à un gouvernement replié sur des considérations étriquées, voire carrément xénophobes, au moment où les États déroulent à ces mêmes investisseurs le tapis rouge (y compris des taux d’imposition de 0,005 % d’impôt sur les sociétés). C’est tout de même un comble que l’acteur incontestablement le plus puissant sur la scène globale, l’entreprise transnationale, puisse en quelque sorte jouer sur le registre de l’anti-racisme pour justifier les privilèges extraterritoriaux dont il jouit !
Vous expliquez que l’ISDS contribue à l’établissement d’un marché et d’un État mondial unique : quel est son rôle dans cet aplanissement du monde ?
J’analyse l’ISDS comme un véritable droit administratif global dans la mesure où il constitue une sorte de responsabilité des États du fait de l’exercice de leur pouvoir souverain au profit — n’oublions pas de le rappeler — d’une seule catégorie de plaignants. Mais comme je l’ai expliqué, on voit qu’au fil du développement de l’ISDS, tous les acte du souverain sont considérés comme des excès de pouvoir donnant lieu à un droit de réparation intégrale à leur encontre, au profit des investisseurs étrangers. Par exemple, des investisseurs n’ont pas hésité à prétendre que des décisions comme le classement d’une zone géographique en réserve naturelle, une loi sociale plus protectrice des travailleurs4 ou l’adoption de mesures environnementales5 sont des mesures équivalentes à une expropriation. En outre, contrairement au droit administratif national qui permet de faire annuler des actes de l’administration ou de rendre celle-ci responsable de certains actes dommageables envers des administrés, le droit administratif global que représente l’ISDS permet de rendre l’État responsable du fait de l’adoption d’une loi par le parlement ou même d’une décision des juridictions nationales qui aurait pour effet de réduire le retour sur investissement de l’investisseur.
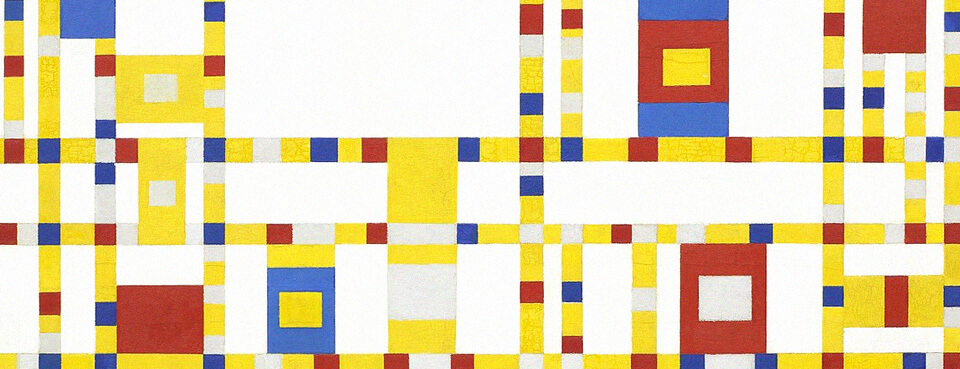
Extrait de Broadway Boogie Woogie de Piet Mondrian
Enfin, il s’agit d’un véritable droit administratif global dans la mesure où, grâce à la structure de reconnaissance et d’exécution forcée de l’arbitrage commercial international sur lequel il repose, l’ISDS permet à un investisseur d’exécuter une sentence directement, n’importe où dans le monde, sans médiation des États. Même les décisions de la Cour internationale de justice de La Haye ne peuvent être exécutées aussi facilement, puisque le concours du Conseil de sécurité de l’ONU est nécessaire. C’est assurément un paradoxe parce que, à ma connaissance, il n’existe pas de constitution mondiale. Dans ces circonstances, quel peut donc bien être le fondement de cette autorité sans frontière, presque illimitée de l’ISDS ? C’est ce que j’ai appelé la norme sociale objective, qui est la marche vers le marché mondial unique et son corollaire, l’État mondial homogène. Le néolibéralisme, ne l’oublions jamais, apparaît au moment de la contre-révolution monétariste engagée vers 1978–1979, au moment où la suraccumulation de capital née de la constitution de marchés extraterritoriaux comme le marché des eurodollars et la perte de crédibilité de la puissance militaire américaine après la guerre du Vietnam font peser un risque très important sur l’un des deux piliers essentiels du système mis en place en 1945 : la suprématie du dollar. Selon Giovanni Arrighi, les États-Unis ont tenté de résister au déclin en se transformant en État mondial, c’est-à-dire en poursuivant par d’autres moyens et dans des conditions radicalement différentes, le projet rooseveltien d’institutionnalisation d’un gouvernement mondial par un New Deal planétaire.
« Contrairement à la situation de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne sont plus du côté de l’offre de capital, mais de celui de la demande. »
Contrairement à la situation de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne sont plus du côté de l’offre de capital, mais de celui de la demande. Tous les ressorts de la puissance états-unienne (y compris les institutions de Bretton Woods qui ont supplanté l’ONU en tant qu’instances légitimantes de la puissance américaine) sont utilisés afin de garantir que la totalité des surplus d’épargne de la planète soient recyclés en dollars. Dans un tel environnement, la maîtrise des standards juridiques garantissant la complète circulation des capitaux est vitale pour les États-Unis et les institutions associées à la maîtrise de ce statu quo. C’est ce qui explique que toutes les hautes sphères de l’administration publique et de l’administration managériales aient en quelque sorte fusionné depuis la décennie 1970 et que l’on assiste à la transformation des systèmes juridiques en instruments d’assujettissement des nations aux marchés financiers, voire — comme en atteste le third party funding — directement en marchés financiers.
Vous vous référez à la fin de votre ouvrage aux œuvres de Castoriadis, de Graeber mais aussi de Dardot et Laval pour envisager des espaces de démocratie directe permettant de politiser la question de l’investissement international hors des systèmes juridiques existants. Comment envisagez-vous une telle stratégie ?
Il est fort à craindre que le renversement de souveraineté que je me suis employé à décrire ne soit parachevé et que, sauf dans le cas d’un effondrement du marché mondial (hypothèse qui n’est pas à exclure), toute tentative d’infléchir la marche en cours via les représentations nationales ne soit vouée à l’échec. En atteste de façon éclatante le climat de fait accompli qui caractérise la négociation et l’adoption de traités comme le CETA, qui est en grande partie applicable provisoirement avant la ratification par les États membres. Ce que je propose est donc un dégagement de la marche vers le marché mondial unique et l’institutionnalisation d’un État mondial, et d’envisager des espaces préfiguratifs de démocratie afin de donner un exemple performatif d’un monde post-néolibéral. Dans le domaine de l’investissement, cela impose de questionner un certain nombre de vaches sacrées que les juristes, enfermés dans un savoir technique autoréférentiel ne risquent pas de remettre en cause d’eux-mêmes. Parmi celles-ci, j’ai identifié les droits de propriété rabattus sur leur exclusivité par la law and economics, qui n’ont plus rien à voir avec le « modeste, mais universel droit de propriété » dont Christopher Lasch faisait le « fondement véritable d’une République stable et solide ». Il s’agit aussi de revisiter la notion de personnalité morale des sociétés et autres groupements afin de réinstituer un primat de la personne humaine sur ses créations et d’en finir avec l’anthropomorphisme dont jouissent les entreprises transnationales.
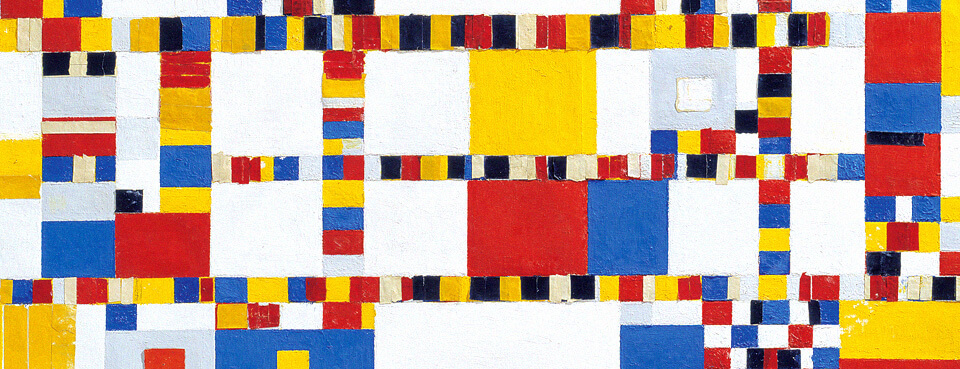
Extrait de Victory Boogie Woogie de Piet Mondrian
Parmi les pistes envisagées, j’ai été très intéressé par la réflexion très dense de Dardot et Laval sur les communs et par leur idée d’institutionnalisation d’une fédération des communs qui permettrait de dépasser la crise des États-nations en instituant des communs politiques ancrés territorialement et des droits socio-économiques sans frontières. L’autre piste, plus recentrée sur le sujet de l’ISDS, est de prévoir des jurys citoyens d’arbitrage démocratique qui pourraient s’inspirer de ce qui fait la force de l’ISDS (un réseau de reconnaissance et d’exécution forcée sans frontière) mais en inversant la hiérarchie des normes ou tout au moins en rééquilibrant la balance entre les droits individuels et collectifs. Ces tribunaux d’arbitrages, constitués hors de tout cadre étatique, mais ménageant néanmoins à l’État la possibilité de s’y faire entendre, pourraient ainsi jouer un rôle performatif en montrant la capacité de la société civile auto-organisée à refonder un nouveau droit international coutumier abandonné par ces mêmes États dans le maillage de traités conférant des privilèges exorbitants aux entreprises transnationales.
- Doctrine selon laquelle la justice devrait se préoccuper des espérances financières légitimes des contractants, liées au degré de confiance qu’ils devraient placer en un système juridique stable, aussi bien que des termes exacts du contrat.[↩]
- Dominique Carreau et Patrick Julliard, Droit international économique, Paris, Dalloz, 2010.[↩]
- Antoine Garapon, La Raison du moindre État — Le néolibéralisme et la justice, Paris, Odile Jacob, 2010.[↩]
- Dans une affaire en cours, la société Véolia réclame une indemnisation à l’Égypte du fait de l’adoption d’un salaire minimum.[↩]
- C’est le cas de la première affaire Vattenfall, qui attaquait l’adoption, par la ville d’Hambourg, d’une mesure visant à limiter la pollution causée par l’exploitation des usines de charbon.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Castoriadis ou l’autonomie radicale », Galaad Wilgos, juillet 2017
☰ Lire notre article « Repolitisons la monnaie ! », Ilias Alami, Vincent Guermond et Caroline Metz, juillet 2016
☰ Lire notre article « Emmanuel Faber et le capitalisme du bien commun », Pablo Sevilla, octobre 2016
☰ Lire notre article « Les tribunaux d’arbitrage contre les peuples », Sarah Kilani, septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Yanis Varoufakis : « Que voulons-nous faire de l’Europe ? », septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Cédric Durand : « Les peuples, contres les bureaucrates et l’ordre européen », juillet 2015


