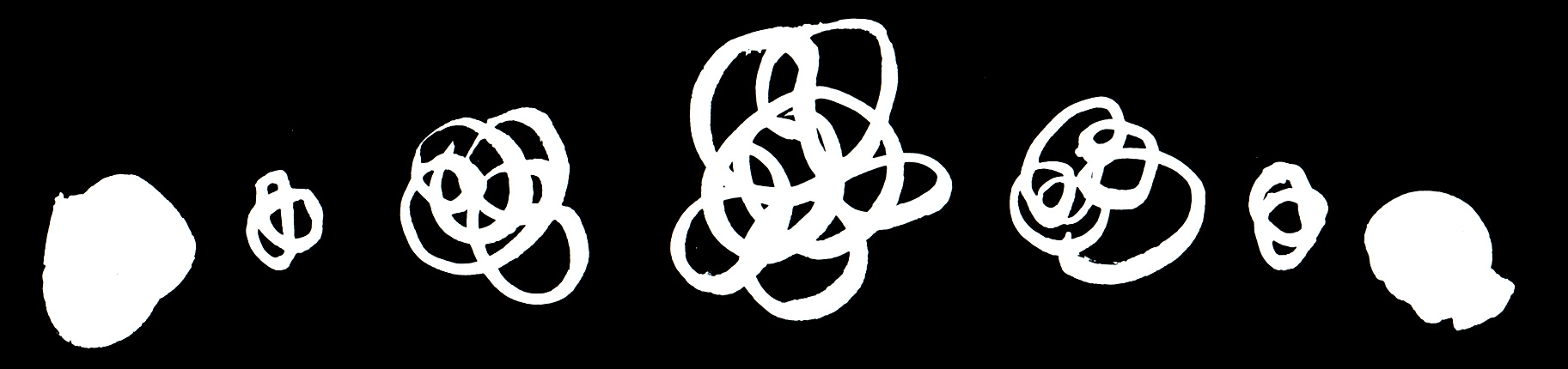Entretien inédit pour le site de Ballast
Reza Afchar Naderi est docteur en littérature iranienne, poète et journaliste. Il vient de publier une anthologie de sept poètes libertaires persans contemporains1. L’occasion pour nous d’une plongée passionnante dans l’univers poétique iranien, d’une modernité foisonnante et loin des clichés orientalisants. Vivante et vivace, libre et lyrique, populaire et subtile, la poésie iranienne aurait réussi ce tour de force de ne renoncer à rien : ni à son héritage le plus ancien, ni à l’exigence d’une adaptation au siècle où nous vivons.
Toutes les illustrations sont d’Archibald Apori, pour le présent article.

La poésie accompagne les Iraniens dans leur quotidien depuis plus d’un millénaire. Ferdowsî, le chantre de l’iranité, né au Xe siècle, a composé une épopée nationale en 60 000 distiques (120 000 vers) ; les Iraniens se sont emparés de cette somme poétique, rédigée en « pur parler persan », pour marquer leur différence face à l’envahisseur arabe et la domination islamique. Aujourd’hui encore, les vers de Ferdowsî sont sur toutes les lèvres persanes — toutes générations confondues. La persistance de la forme poétique dans l’âme perse s’explique peut-être par le besoin d’un ciment artistique réfractaire à travers les siècles, puisé dans un patrimoine considérable, afin de résister à des siècles de tyrannie. Si, comme l’affirme André Gide, « l’art naît de contrainte », les despotismes successifs n’auront pas manqué d’affûter sans cesse l’art persan de la poésie… par la force des choses. Il me semble que la « persistance » de cette « passion » poétique que vous évoquez provient de ce que la poésie, étant immatérielle, cryptée, concise, insaisissable, s’installe mieux que toute autre forme d’art dans les maquis artistiques de la résistance.
Vous expliquez aussi que la traduction de la poésie persane « ne saurait faire l’économie d’un décryptage systématique de sa charge politique et sociale ». La figure de Simine Behbahani est sans doute la plus inspirante de ce point de vue, dans la galerie que vous présentez. La poésie persane est-elle donc fondamentalement engagée ?
La figure de Simine Behbahani, de même que les personnalités d’Ahmad Shamlou, Mehdi Akhavan-Sales ou encore Houchang Ebtehadj, emploient toutes le recours au sens caché. Les Iraniens qui rencontrent, dans leurs écrits, les vocables « hiver » ou « rose » savent bien que la référence est politique, qu’elle renvoie à des événements et à des dates bien précises de l’Histoire contemporaine, à des traumatismes et à des soubresauts qui ont marqué l’époque. La poésie persane ne souffre pas les jeux formels. Car elle est un viatique sur le chemin de la survie mentale et physique de ceux qui la composent, la lisent, la partagent. Là où les pays démocratiques ne voient plus l’importance vitale de cet art et en font usage ludique dans leurs bacs à sable culturels, comme un loisir parmi d’autres. Je dirais donc que la poésie persane, celle incarnée par la pléiade présente dans cette anthologie, est essentiellement engagée. Mais j’ai employé, plus précisément, le terme « libertaire » car l’engagement politique n’est pas toujours porteur d’indépendance et de lucidité humaniste pour ceux qui le pratiquent. Quant aux poètes persans s’adonnant aux prouesses esthétisantes, s’il en existe, ils demeurent invisibles pour la grande majorité des lecteurs. De même qu’au plus fort de la tempête, on fixe du regard l’homme qui tente de redresser la barre, plutôt que celui qui dépose des fleurs dans votre cabine.
Deux grandes tendances interprétatives s’affrontent souvent à propos des grands poètes classiques persans : certains les ramènent à une forme de mystique symbolique et considèrent qu’en parlant d’ivresse ou d’amour ils n’emploient, en fait, que des métaphores pour signifier le rapport au divin (dans une interprétation soufie) ; d’autres défendent au contraire une vision résolument épicurienne et matérialiste de cette poésie. Où se situent aujourd’hui les poètes contemporains que vous présentez ?
J’ai envie de vous répondre que leur rapport avec la poésie est inévitablement matérialiste, ancré dans l’immanence. Même si Chafii Kadkani a établi une édition critique du Langage des oiseaux du mystique Farid ed-Din Attar — ce qui ne l’empêche pas de faire revivre les vers de Saadi, de Chiraz, à travers ses propres poèmes. Le rapport à l’autre, immanent et social, est toujours là. Chamlou, lui, fait revivre Hafez à travers une édition portant son empreinte. Quant à Khayyam, il est omniprésent à travers tout poème amoureux rendant justice aux bienfaits de ce monde, à travers le séjour transitoire qui est le nôtre. Je pense en premier à Forough Farrokhzad, la plus sulfureuse et la plus passionnée. Simine Behbahani, toute poétesse nationale qu’elle soit, fait la part belle à la séduction et à la joie de vivre (« Ah j’ai aimé »), et ce jusqu’à l’âge le plus avancé qu’il soit permis de vivre (« La vieille Ève »). La forme antique du ghazal, poème lyrique par excellence, est toujours à l’honneur — d’un poète à l’autre. Il existe, bien entendu, comme vous le mentionnez, une tendance mystique et une tendance matérialiste dans la poésie persane. La première mieux connue, hélas, que la seconde… Cette dernière est pratiquement inconnue en France, où une caste d’éditeurs et d’universitaires se complaît surtout à promouvoir la vieille tradition soufie, sur fond de méditation transcendantale et de danses extatiques de derviches tourneurs… Nous avons là affaire à une sorte de tourisme orientalisant dans un ailleurs atemporel. Comme si la modernité poétique devait demeurer du seul ressort de l’Occident alors que la mystique, sous son jour poétique, serait issue essentiellement d’un Orient que l’on voudrait hors du temps, occupé aux pratiques méditatives. Aussi, je souhaite que cette anthologie aide à déciller quelque peu les regards de ceux et celles qui nourrissent ici, en France, des représentations toutes faites de la poésie persane. Et qu’elle montre le chemin de la vraie modernité dans le champ poétique. Celle qui s’appuie sur les acquis patrimoniaux.
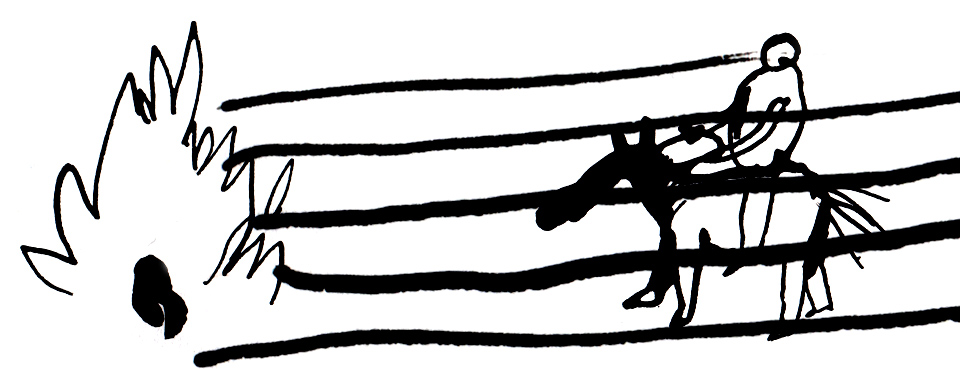
Vous retournez régulièrement dans votre pays de naissance et connaissez bien sa « scène artistique ». Dans quelles mesures est-il possible d’écrire, de dire et de publier de la poésie librement en Iran ?
La poésie, dès qu’elle touche des privilèges, des dogmes, des valeurs établies, devient une menace pour son auteur, en Iran comme en France. Toutes proportions gardées, certes. Mais il suffit qu’un poème « balance » un nom ou un statut synonymes d’abus ou d’injustice, pour que le poète se retrouve dans la ligne de mire des détenteurs du pouvoir. La poésie libertaire d’Iran a vécu et vit toujours des moments difficiles. Il existe dans ce pays des lieux pour la poésie officielle et d’autres espaces, tolérés, attirant un public considérable. Naturellement, les médias qui s’en font l’écho sont ceux de la Toile. Les pages Facebook et le site YouTube en premier. Mais, en tant que citoyen ayant choisi la nationalité française depuis un bon nombre d’années, je ne peux vous répondre sur ce point sans pointer en même temps l’indigence de la poésie dans mon pays d’adoption, dès que l’on touche la sphère sociale et politique. En effet, au pays de Molière — ce Charlie avant la lettre —, les poètes brillent désormais par leur silence face aux abus de l’État et de ses institutions. Ils se tiennent dans les limites des grandes déclarations de principes et annoncent tous les jours qu’il faut « décréter l’état d’urgence poétique » ! Étant moi-même héritier, de par mes origines, d’une tradition poétique de luttes pétrie de chair et de sang, je trouve ces accents déplorables dans leur répétition et leur vacuité.
Vous vous intéressez beaucoup à la question de la forme poétique, considérant qu’il doit y avoir une « survie dynamique d’un patrimoine antique à l’intérieur d’une révolution formelle » : ce qui fait pour vous la force des poètes persans qui connaissent littéralement par cœur les grands classiques, avant même de se permettre des libertés avec la métrique. Vous citez Aragon comme le dernier des poètes français qui aurait réussi ce tour de force d’incarner l’esprit d’un peuple et d’une langue tout en réinventant la sienne. Mais quelle leçon en tirez-vous pour la poésie française ? Comment se réapproprier une tradition évanouie ? Les Iraniens disent du Hafez quand personne, en France, ne rêve plus de la poésie de Villon…
En effet. Les Français n’ont pas fait le travail qu’ils auraient dû faire il y a un demi-siècle, quand Aragon portait encore le flambeau. Facilité ? Paresse ? Sentiment de supériorité culturelle ? Certitude que tout a déjà été dit et qu’on se repose sur un héritage qui, aujourd’hui, a sombré dans les manuels d’histoire littéraire ? Fascination pour une (fausse) modernité qui fait de l’art une discipline cultivée « hors-sol » ? Dans son Crève-cœur, Aragon disait qu’il « n’est pas vrai qu’il n’est point de rimes nouvelles dans un monde nouveau ». Or nous assistons, dans cette deuxième décennie du XXIe siècle, à une absence totale de règles poétiques s’inscrivant dans la continuité de la grande poésie française — celle de Villon, de Boileau ou de Baudelaire. La règle est devenue celle de la non-règle. Avec son cortège d’absurdités, de jeux formels vides de sens, de mots d’ordre sans conséquences et d’ennui mortifère. Vous me demandez comment se réapproprier la tradition évanouie, cultivée jadis par les grands noms de la poésie française ? Écoutez plutôt ce qui se dit en ce moment autour de nous, dans les médias et sur les forums de discussion depuis les attentats du 7 janvier 2015. Jamais la nécessité d’une appartenance à l’identité française n’a semblé aussi sensible. Peut-être que ce traumatisme national donnera enfin le coup d’envoi (bien cher payé, il est vrai) d’une adéquation entre les racines culturelles de la France et la production artistique contemporaine — celle-ci s’avérant profondément gangrenée. Peut-être que ce pays auquel je tiens tant saura éviter de sombrer encore plus (je pèse mes mots) dans la décadence culturelle où il est bien engagé.
On connaît mieux, en France, le cinéma iranien que la poésie ou la littérature contemporaine iraniennes. Mais ce cinéma lui-même n’est-il pas porteur d’une charge à la fois poétique et contestataire ? C’est bien le vers d’un poème de Forrough Farrokhzad qui donne son titre à un film de Kiarostami, Le Vent nous emportera…
Le cinéma iranien, mondialement connu, est en effet un modèle de subversion, qui emploie les ressorts du registre poétique. Mais la poésie demeure en Iran le genre majeur, loin devant toutes les autres formes d’expression artistique. Si elle est moins connue que le cinéma, c’est parce que les traductions en français de la poésie persane sont souvent de facture moyenne. Pour ne pas dire médiocre. De surcroît, le cinéma, art visuel, peut se permettre une certaine économie du langage écrit ou parlé. Cependant, le langage poétique ne manque pas de prendre ses aises dans le cinéma iranien, car les réalisateurs issus du pays de Saadi et de Hafez ne sont pas moins imprégnés de poésie que le reste de la population. Je pense en particulier à Dariuch Mehrdjouï, icône du cinéma iranien, dont les réalisations campent régulièrement des personnages au verbe haut et coloré déclamant des poèmes d’un bout à l’autre de ses films. Pour l’apprécier, je vous suggère de regarder Le Poirier, Monsieur le Benêt ou encore Téhéran, Téhéran.
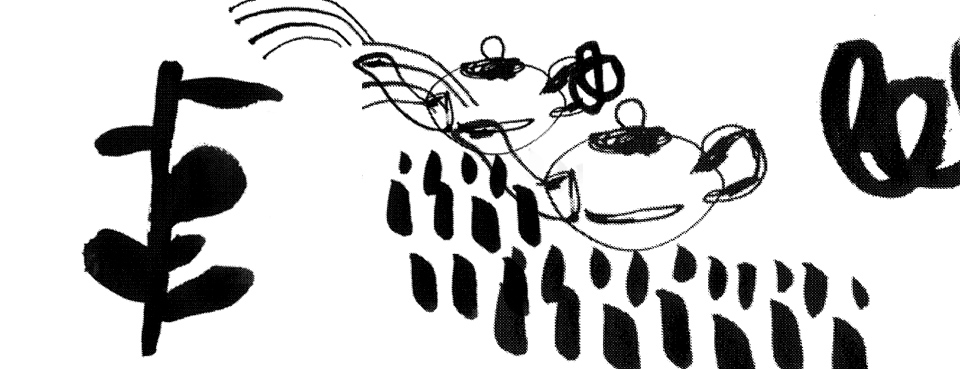
Éternelle question posée au traducteur : peut-on traduire sans trahir ? Comment procédez-vous pour préserver la charge de contestation politique qui peut se loger dans les jeux de mots ?
La traduction peut devenir trahison, en effet. Mais de quelle trahison parlons-nous ? Faut-il restituer en français les équivalents exacts des vocables persans ? Je ne le pense pas. Le passage d’une langue à l’autre doit se soumettre avant tout aux exigences d’une transition poétique. À ce titre, il est accordé aux mots choisis pour la traduction une tolérance et une latitude dès lors qu’ils servent une nouvelle musique dans la « langue d’arrivée » : ici, le français. La trahison serait de produire un propos sec, dépourvu d’allure, vidé de charge affective, sacrifié sur l’autel d’une « fidélité » au texte de départ. Le poète traduit ne le supporterait pas et il préférerait de loin une traduction poétique, même légèrement « décalée », qui le fasse vibrer à son tour. Là réside une vraie fidélité à l’esprit du poète. Je l’affirme dans les dernières pages de l’anthologie en posant comme tout préalable à l’entreprise que le traducteur prouve qu’il est lui-même un poète. Et pour appuyer mes dires, j’ai fait figurer, comme dernier poème de ce recueil, une de mes compositions. Un hommage à Ahmad Chamlou. Certains vers m’ont donné du fil à retordre ; je pense particulièrement à un poème d’Ahmad Chamlou (« Je t’aime »), qui commence ainsi :
Il n’est pas de nuit du côté de chez nous
Ils ne font pas la paix la voix et le silence
Les mots sont dans l’attente
Je ne suis pas seul avec toi
Personne n’est seul avec personne
La nuit plus seule que les étoiles
Le pari étant de restituer le rythme, la mélodie et les images du texte d’origine, tout en employant des mots d’une grande simplicité. Il s’agit d’être soi-même à la fois musicien et poète.
René-Guy Cadou écrivait que « la poésie est inutile comme la pluie ». N’est-ce pas, en Iran, une idée très oxymorique : inutile comme tout ce qui est indispensable… Qu’en diriez-vous ?
En Iran, on ne cherche pas à « définir » la poésie. Je sais que la France, par contre, ne manque pas de théoriciens de la poésie. Le propos poétique, en Iran, reste direct. Pour peu que l’on sache décrypter les images qui le représentent, et ceci est une affaire d’usage et de culture. Je dirais que les poètes iraniens sont des guerriers. La poésie est en eux, indispensable à leur survie comme peut l’être une arme dont on ne se sépare jamais, à quelque heure du jour ou de la nuit. En France, on prend la poésie sous le bras comme un attaché-case, à l’heure des tables rondes, des festivals et des colloques. C’est pour cela qu’elle est, dans ce pays, en ce siècle, si mortellement ennuyeuse, coupée de l’homme. Et c’est pour cela que les Français — je veux parler du peuple français — se sentent si peu concernés par ce qu’elle représente : un être décharné dont les mots s’évanouissent aussitôt que proférés.
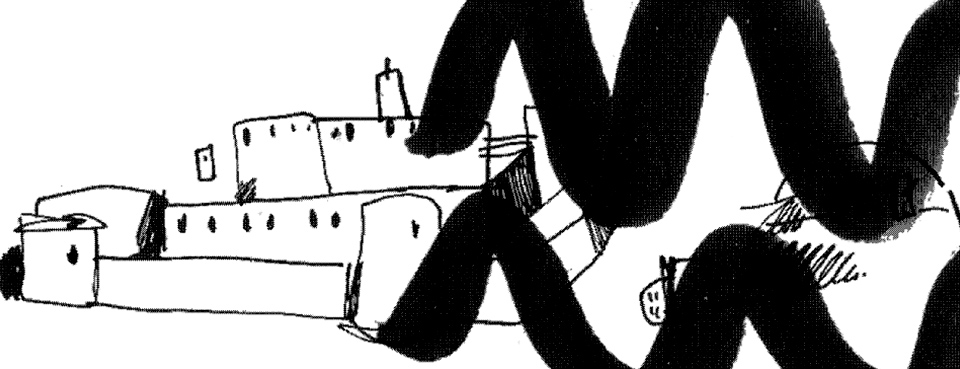
Vous consacrez quelques pages à Phil Donny, l’illustrateur de l’ouvrage. Son travail, imprégné des grands moments de la peinture classique européenne — dont les maîtres ont pour nom Le Titien, Botticelli ou Véronèse — viendrait en résonance avec votre approche de la poésie. Vous le présentez comme un « peintre de l’incarnation ». Pourriez-vous nous en dire plus sur cette disposition partagée entre vous et lui ?
Phil est un ami de longue date, avec qui je partage nombre de valeurs, autant humaines qu’artistiques. De ses illustrations ressort la nécessité fondamentale de raconter, de mettre en commun, de faire ressentir. Il est fasciné par le legs des grands illustrateurs tel que Gustave Doré, et cela se ressent dans son travail. Le « concept », si cher à un certain art dit « conceptuel », n’a aucune place, ni dans ses créations, ni dans les miennes. L’œuvre se doit de tout dire par elle-même. Et le peintre, tout comme le poète, se doit d’y déposer, au terme d’un long et laborieux parcours — ponctué d’extases — la quintessence de son expérience. À ce titre, nous menons, lui avec le pinceau, moi avec la plume ou le clavier, un combat suivi et déterminé contre l’art dit « contemporain » dès lors qu’il relève de la spéculation conceptuelle et financière. Mais ceci est une autre histoire.
- Aube nouvelle. Poètes libertaires d’Iran, Le Temps des Cerises, 2016.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Jean-Pierre Siméon : « La poésie comme force d’objection radicale », décembre 2015
☰ Lire notre article « André Laude, poète anarchiste », André Chenet, octobre 2015
☰ Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015
☰ Lire notre entretien avec Tristan Cabral : « J’ai la chance de n’être pas dans le milieu soi-disant littéraire », mai 2015
☰ Lire notre article « Poésie, anarchie et désir », Adeline Baldacchino, décembre 2015