Entretien inédit pour le site de Ballast
« Je m’enfonce sous votre système en apnée / Dans la crasse, les cris et les crises quotidiennes », lance le rappeur Rocé, qui naquit à Bab El Oued l’année de la mort d’Andreas Baader, meneur de la bande éponyme, et de l’indépendance de Djibouti. Le verbe coupe et trace, depuis quinze ans, son chemin dans les marges de la scène hip-hop hexagonale. « C’est de ses ecchymoses que peut se construire la France », poursuit le fils du résistant Adolfo Kaminsky, qui quitta l’Algérie à l’âge de quatre ans pour le Val-de-Marne. L’artiste tient au doute autant qu’au pluriel : la course à l’ego occulte ces anonymes et ces militants sans lumière — le rap, comme art du grand nombre, tente réparation. Du moins le sien.

Oui, j’ai toujours été attiré par les expériences décalées : il n’y a que du beat sur le début de « On s’habitue » et l’instru’ de « Changer le monde » est particulière, aussi — la rythmique n’est pas renforcée. L’album Identité en Crescendo est presque entièrement du hors-piste. Parfois, j’ai besoin d’être là où on ne m’attend pas et, d’autres fois, j’ai juste envie de rapper de manière plus classique.
Votre angle de création, bien souvent politique, repousse-t-il d’autres territoires, d’autres envies ?
Non. Je n’ai pas ce problème. J’ai un côté rigoureux dans les textes, autant qu’un côté « rien à faire » dans la musique et sur scène : je peux me mettre à danser ou sortir une guitare. En quatre albums, j’ai abordé des thèmes assez variés, comme l’amertume dans une relation d’amitié, la folie, la haine de la foule, l’aliénation des petits chefs dans le monde du travail. En revanche, si ce que vous voulez dire, c’est que le ton que j’adopte est toujours piquant ou critique, c’est ma cohérence, pas ma limite.
« Cela montre un mépris de classe dans ce pays, très flagrant dans le monde de la culture. »
Le regard que vous portez sur le rap, en tant qu’art, a‑t-il évolué depuis les années 1980 ?
C’est un vaste sujet. Notre société n’évolue pas, en terme de mentalités. En ce qui concerne la perception du rap, pratiqué en grande majorité par les gens issus des quartiers populaires, il y a énormément de mépris et de rejet. Okay, tout le monde a compris, maintenant, que le rap n’est pas un phénomène de mode et, surtout, que cette musique constitue un immense marché. Ainsi, les gens les plus mercantiles, comme les maisons de disque, s’y intéressent. Mais la musique la plus « consommée » en France — et la plus pratiquée — est aussi la plus méconnue, la plus méprisée par les élites et les gros médias généralistes. Il y a deux poids deux mesures dans le traitement médiatique du rap par rapport aux autres genres musicaux. Je ne désire pas que le rap rentre au musée ou au conservatoire, je ne lutte pas pour que les élites le respectent ou le médaillent — ce genre de combats ne me passionne pas. Mais je constate que la musique du plus grand nombre est aussi la plus mal traitée — ce qui en dit long sur l’état de notre société. Cela montre un mépris de classe dans ce pays, très flagrant dans le monde de la culture. Ça traduit aussi la rupture générationnelle, le mur invisible qui sépare « culture de jeunes » et « culture de vieux ». Dans d’autres pays, le rap est intergénérationnel : c’est une musique du peuple, pas seulement des jeunes.
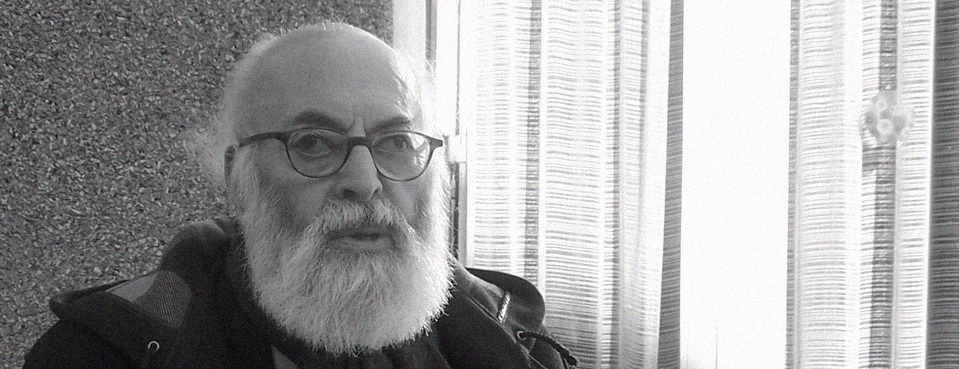
Adolfo Kaminsky © O. Quéruel - 2011
Parlant de votre père, Adolfo Kaminsky, vous avez ajouté : « Les Mesrine ou les Che, les révolutionnaires de la cause du bout de leur nez, pleins de testostérone et de belles phrases hystériques, ne me touchent pas. Je ne suis sensible qu’aux combats discrets construits sur le long terme, et où la lumière est posée sur une idée plutôt que sur la personne qui en parle. » Que vous a‑t-il transmis ?
Mon père a été interné à Drancy en 1943. Vu qu’il avait la nationalité argentine, le consulat argentin est intervenu et il est sorti du camp de justesse. À 17 ans, ayant travaillé chez un teinturier, et passionné de chimie, il est le seul à savoir effacer certaines encres sur les cartes d’identité. Il intègre alors un réseau de résistance et devient rapidement spécialiste en faux papiers. Il en fabriquera jusqu’à la Libération. Ensuite, il rejoint le FLN algérien, fabriquant toujours des faux papiers et même de la fausse monnaie pour faire pression sur l’inflation. Il forme des faussaires aux quatre coins du monde dès qu’il s’agit de lutte décoloniale, de mouvements de libération de pays d’Amérique du Sud (comme l’Uruguay, le Pérou, la Colombie, le Chili) et d’Afrique (comme en Angola, en Guinée-Bissau et en Afrique du Sud pendant l’apartheid). Il a toujours refusé d’être payé pour ça, considérant qu’il n’avait pas de patron. C’est pourquoi il a passé la majeure partie de sa vie dans la clandestinité. Ce n’est que très tardivement qu’il a fait son dernier faux papier pour enfin commencer une vie normale.
« Cette époque qui consomme et consume les révoltes a besoin de mettre en avant des révoltés au bord de l’hystérie, plutôt que des militants de l’ombre. »
Ce que je retiens, c’est d’abord qu’il ne s’est jamais fait repérer — sa prudence et sa discrétion étant aussi remarquable que son travail de faussaire. C’est aussi cette discrétion qu’il transmettait aux autres. Ma sœur a écrit un livre qui retrace son parcours : c’est précis et passionnant. Ce qu’il m’a transmis, c’est peut-être cette retenue — même si, dans mon domaine, celui de l’événementiel, je gagnerais à ne pas l’être. Ce qui me désole, c’est que cette époque qui consomme et consume les révoltes a besoin de mettre en avant des révoltés au bord de l’hystérie plutôt que des militants de l’ombre. On mettra en avant un Mesrine au même niveau que des personnages qui ont placé l’humanisme, ou une préoccupation politique, avant leurs intérêts personnels. Ces personnages ont pourtant souvent des parcours encore plus trépidants et courageux. Je parle de mon père, mais je découvre tous les jours des personnages qui mériteraient qu’on fasse des blockbusters hollywoodiens sur eux ; je pense notamment à George Mattei, à Ahmad Rahmad et Olympe de Gouges. Mais on nous propose sans cesse des films de coléreux apolitiques. Le monde de la culture rate quelque chose et c’est dommage. On est en train de construire l’Histoire sur des personnalités individualistes alors qu’elle est faite d’un tas de personnages passionnants par leur générosité, leur humanisme, leur conscience politique.
Vous moquez les révolutionnaires de façade dans « Le savoir en Kimono ». Un produit de notre époque, cette consommation de folklore ?
C’est toute la force du capitalisme que d’accepter les énergies dissidentes pour les vendre avec l’emballage du divertissement. Le capitalisme n’a pas d’ego : tu peux lui cracher dessus, l’insulter ; il validera l’insulte et en fera même un film, sachant que c’est ça qui le nourrit. Il transforme de l’événement militant en événementiel. Quand tu regardes le point commun de tous ces films, c’est qu’ils ne parlent que d’un homme providentiel qui vient sauver le monde. On préfère nous vendre le « superhéros militant », personnage individualiste, au-dessus de la masse, l’image d’un Rocky Balboa qui se dépasse lui-même sans l’aide de personne, qu’un militantisme rigoureux et solide, porté par la solidarité d’un réseau, d’une dynamique de groupe — qui n’a rien d’individuelle. Aujourd’hui, le militantisme est complètement contaminé par cet individualisme à l’américaine, avec une sorte de starification des porte-parole, des gens qui finissent par lutter de plus en plus en leur nom personnel, qui offrent un rêve, plutôt que de s’effacer au nom d’une cause. Dans une époque où on met notre militantisme en scène à coup de selfies et de poses héroïques le poing levé, j’aime regarder de l’autre côté, à la manière d’un blogueur, vers des gens de l’ombre. Ce sont eux qui ont changé le monde sans que personne n’en sache rien — traçant leur route loin des ragots et des chamailleries qui les entouraient.

Rocé (DR)
Après, il ne faut pas voir une critique trop sévère dans mon morceau : je questionne. Dans le rap, on fait plein de namedropping, on parle de nos héros et, la rime d’après, on contredit leur conception. Mais il y a aussi du positif : parler de nos héros, c’est les garder dans la culture populaire — et c’est clair qu’on en a bien besoin. Je pense qu’il y a surtout une confusion entre militant et artiste engagé. L’un crée du rapport de force politique, l’autre de l’événementiel culturel. Un artiste, à son niveau, peut faire prendre conscience de causes justes, peut accompagner des luttes, peut redonner force et dignité à celles et ceux qui en ont besoin, mais l’artiste n’est pas à l’initiative des rapports de force. Bref, nous, les artistes, rendons hommage. Nous prenons position. Les plus populaires d’entre nous peuvent même éclairer un sujet précis et raviver le débat. Mais ce sont des combats qui ont déjà été engagés par les militants.
Sur le morceau « Identité en Crescendo », vous avez côtoyé Archie Shepp, une légende du jazz. Pourquoi lui ?
« Le capitalisme n’a pas d’ego : tu peux lui cracher dessus, l’insulter ; il validera l’insulte et en fera même un film, sachant que c’est ça qui le nourrit. »
Archie Shepp a accompagné les luttes des Black Panthers en musique. Il a une conscience politique qui m’intéresse beaucoup et qui est ultra actuelle, plus actuelle que celle de beaucoup de jeunes militants. Sa vision des identités, de la musique, est très intéressante. Je l’ai sollicité pour participer à mon album parce que sa musique me plaît et que c’était l’ambiance dans laquelle je baignais à cette époque.
La question identitaire semble vous travailler, en effet. Vous la traitez de long en large sur votre deuxième album. Dix ans et des débats sur « l’identité nationale » et la « déchéance de nationalité » plus tard, la crispation est à son comble…
J’ai résumé ce que je pensais de tout ça à l’époque. Je n’aime pas trop revenir là-dessus. La France est un pays figé dans le temps : je pourrais refaire le même album tous les ans et j’aurais l’impression de me figer avec le pays. Maintenant, je veux parler d’autres choses. Pour voir à quel point les problèmes d’aujourd’hui sont ceux d’hier, il suffit de lire les écrits de Frantz Fanon, d’Edward Saïd — on constate à quel point les livres d’hier parlent mieux d’aujourd’hui que ceux d’aujourd’hui. Valls vient de dire que « la question des valeurs et de l’identité sera au cœur de la campagne » : c’est dire à quel point ça arrange les politiques de relancer la même carotte, de noyer le poisson dans l’identité — un sujet qu’ils ne maîtrisent pas mais avec lequel il est facile d’endormir tout le monde et de créer la confusion à gauche. Sur la notion des identités, j’aime beaucoup Édouard Glissant. Et sur un terrain plus concret d’autodéfense, parce qu’on en est là, malheureusement, il y a des gens qui réagissent, qui s’organisent ; je pense au travail fait par le CCIF, entre autres. Les débats sur l’identité en France sont voués à être réac’. Les universitaires sont en avance sur ces sujets, mais ce ne sont pas eux qu’on convient, ce ne sont pas eux qui donnent le ton politique. C’est un débat purement artificiel, politique et médiatique. Les conséquences sont bien réelles, par contre… Merci aux associations qui luttent jusqu’en justice pour défendre un peu d’humanité.

Edward Saïd (DR)
Dans votre dernier album, vous exprimez le manque de temps pour se construire et réfléchir : tout doit aller vite. La faute aux médias et à la vitesse de communication croissante ?
Non, la faute à un système qui subit de manière globale un capitalisme de plus en plus violent et direct. L’« uberisation » de la société, comme on dit aujourd’hui… Dans ce morceau, « La vitesse m’empêche d’avancer », j’ai voulu prendre deux angles inédits, celui de l’artiste et celui de l’école. Deux domaines dont on pourrait penser qu’ils sont hors de portée de tout ça, qu’ils sont protégés, encore purs. Mais pas du tout, malheureusement : ils ne sont pas hermétiques à la capitalisation du temps.
Avec « Habitus », vous développez un concept de Bourdieu. Serions-nous dans un temps de régression intellectuelle ?
Les gens sentent que la télé fait du forcing avec des têtes pensantes qu’ils ne veulent plus voir. À la télé, les invités et les présentateurs se ressemblent, ont les mêmes lunettes, les mêmes cheveux poivre et sel, les sourcils qui réfléchissent et même l’air très intelligent. Ils ont tous écrit un livre. Pourtant, ils disent tous n’importe quoi. Les débats suivent la volonté de Valls et se placent sur des thèmes que le peuple n’a pas vraiment choisis, imposés par quelques faits divers ou par une actualité subjective. Pourtant, non, je ne pense pas que nous sommes à une époque de régression : bien au contraire. Il y a plein de chercheurs, de penseurs, de gens très intéressants, aujourd’hui. Il y a un décalage entre les débats des gros médias officiels qui invitent toujours les mêmes personnes et, par exemple, le monde universitaire, les Cultural Studies, qui invitent à des réflexions beaucoup plus ancrées dans l’époque, en avance sur ce que les médias nous bégaient dans un souci d’audimat. Les choses se passent ailleurs. Avec « Habitus », je suis content d’avoir réussi à être à ce point explicite sur un morceau de trois minutes. C’est jubilatoire, lorsque je le fais sur scène devant un public qui le découvre et acquiesce aux paroles — des paroles qui constituent du vécu pour l’auditeur, également. Merci Bourdieu, pour le coup ! C’est là que j’ai l’impression, à mon humble niveau, de faire du bien, de faire avancer les choses.
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Marc Nammour : « S’ériger contre la division », janvier 2016
☰ Lire la traduction du texte de Booby Seale : « Black Panthers — pour un antiracisme socialiste », décembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Serge Teyssot-Gay : « Les marchands ont pris tout l’espace », octobre 2015
☰ Lire notre entretien avec Médine : « Faire cause commune », septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Lino : « Tout est fait pour que le peuple n’ait jamais la parole », juillet 2015
☰ Lire notre entretien avec Brav : « Je pourrai dire à mes enfants : on a essayé », janvier 2015


