Entretien inédit avec le site de Ballast

Vous citez Thorez, appelant les chrétiens à intégrer le PCF, et le philosophe Emmanuel Mounier, aspirant à lier le corpus chrétien aux « zones vives de l’espérance communiste ». Est-ce un sillon que vous creusez en affichant votre soutien au candidat Mélenchon, en mars 2017 ?
Pierre-Louis Choquet : Dans la première partie de notre livre, nous avons tenté de faire une « généalogie » de la crainte des catholiques français vis-à-vis de la gauche et, a fortiori, de la gauche radicale. Force est de constater, à travers les statistiques électorales2 ou les unes des journaux catholiques dans les semaines qui ont précédé la dernière élection présidentielle en France, que les candidats de gauche n’ont pas la faveur des catholiques pratiquants. Pourtant — l’idée est presque devenue un lieu commun —, les Évangiles recèlent de nombreux appels à une radicalité sociale et économique en faveur des plus pauvres et des exclus : autant de combats que mènent les hommes et femmes engagés à gauche, depuis longtemps, et qui résonnent aujourd’hui avec les interpellations et les exhortations incessantes du pape François, au sujet des réfugiés, du changement climatique, etc. C’était d’ailleurs tout l’enjeu de la tribune que nous avons publiée : défendre, en tant que chrétiens interpelés par la radicalité de l’humanisme évangélique, l’idée que les candidatures de Benoit Hamon et de Jean-Luc Mélenchon devaient être réellement prises au sérieux. Le geste qui consiste à mettre en lumière les convergences entre le message évangélique et les valeurs de la gauche radicale n’est d’ailleurs pas nouveau : Charles Péguy, Emmanuel Mounier, Simone Weil, et tant d’autres, l’ont réactualisé en leur temps !
Il existe un courant anarchiste chrétien. La militante libertaire Emma Goldman n’en écrivit pas moins, en 1913, que « la religion chrétienne et la morale prônent la gloire de l’Au-delà et restent, dès lors, indifférentes aux horreurs de la Terre ». Elle ajoutait que Jésus était « parfaitement inoffensif » puisqu’il n’a jamais appelé à la résistance ici-bas contre les Romains. Vous estimez pourtant que cette même religion permet d’« agir collectivement sur nos conditions d’existence »…
« Les Évangiles recèlent de nombreux appels à une radicalité sociale et économique en faveur des plus pauvres et des exclus : autant de combats que mènent les hommes et femmes engagés à gauche. »
Anne Guillard : Avant le concile Vatican II, en 1965, l’emphase des sermons religieux était en effet portée sur l’espérance de la vie après la mort et sur la vie bonne à mener ici-bas, dans le but d’être accueilli par Dieu. De ce fait, on ne peut pas dire que la religion chrétienne ait été indifférente aux horreurs de la vie terrestre, dans la mesure où cette vie était l’espace dans lequel notre action pouvait se déployer en vue du salut. Les hospices, le soin des pauvres, et le choix même de la pauvreté volontaire, représentaient une vie authentiquement évangélique avant que ne s’épanouisse le puritanisme protestant qui considéra la pauvreté comme un signe de non-élection divine. Auparavant, le christianisme en son entier reconnaissait dans les lieux d’indigence et le soin des souffrances la figure du Christ, qui lui-même s’était mis au service des laissés-pour-compte. Servir Dieu, c’était servir les plus pauvres, et être pauvre, c’était imiter le Christ. Si Jésus était perçu comme quelqu’un d’inoffensif pour les colonisateurs romains, il était considéré comme un élément subversif à éliminer par le pouvoir religieux de l’époque puisqu’il critiquait l’hypocrisie et la collusion des chefs religieux avec le pouvoir politique romain. D’une certaine manière, Jésus invite à prendre conscience de l’importance d’une distinction des ordres et des réalités du monde, tout en montrant leur interdépendance. Cela ne signifie pas le désinvestissement d’une sphère au détriment d’une autre !
Dès ses débuts, le christianisme a été une force de résistance politique refusant catégoriquement de souscrire au culte de l’empereur romain — réclamant ainsi implicitement la séparation des pouvoirs spirituels et temporels. En vertu de son origine théologique (on ne rend de culte qu’à Dieu), cette foi devient politiquement pertinente. Les rois d’ici-bas ne sont pas Dieu : ils sont faillibles et peuvent être contestés. En outre, une telle distinction était essentielle car elle empêchait le christianisme de se constituer en Églises nationales liées à un culte civique spécifique qui signerait sa mort future, concomitamment à celle des États auxquels elles se seraient liées. Or si le christianisme se fonde sur une séparation des ordres, c’est dans un souci porté au bien du commun en vue d’une communion. Le pape Léon XIII considère ainsi que le bien commun constitue « après Dieu, dans la société, la loi première et dernière3 ». Il ne s’agit donc pas d’une démarche dont l’horizon serait strictement politique, une sorte de telos [cause finale, ndlr] politique, mais bien plutôt comme un ethos [us, manière d’être, ndlr] et un moyen indispensables pour une visée plus grande, celle d’une communion du vivant en travail dès maintenant. L’action collective sur nos conditions d’existence représente donc le lieu de vérification empirique en même temps que le lieu de réception de notre foi. Agir pour le bien commun constitue le lieu, l’indice et l’épreuve de l’expérience de l’amour de Dieu pour le monde.

[Kenzo Okada]
Quelle est cette force de résistance politique que vous évoquez en parlant des débuts du christianisme ?
Pierre-Louis Choquet : L’entretien entre Pilate et Jésus dans l’Évangile de Jean — chapitre 18 — est magnifiquement analysé par l’historien italien Aldo Schiavone. Celui-ci montre bien que lorsque Jésus dit que « son Royaume n’est pas de ce monde », il dénude, si l’on peut dire, le pouvoir temporel en lui retirant toute prétention à une légitimité dernière. Cela pourrait être interprété comme un « droit à la fuite » (qui consisterait à dire que, de toute façon, « tout se joue ailleurs »), mais cela peut aussi être extrêmement stimulant si l’on part du point de vue que, pour le chrétien qui s’engage à la suite de Jésus-Christ, on peut dire en quelque sorte que « tout est déjà gagné ». Cela ne signifie pas, bien au contraire, que cela ne coûte rien de s’engager et que la foi serait une assurance-vie ! Disons que si le ou la chrétien⋅ne a une claire conscience que le tragique est au cœur de la vie morale, il ou elle espère en même temps recevoir la profonde confiance que le bien et l’amour, jusqu’au sacrifice de soi, sont victorieux — et ce, quelle que soit la cruauté des « mâchoires » de l’Histoire. Des personnes singulières comme Martin Luther King Jr. ou Desmond Tutu portent le signe de cette réalité. Mais si l’on revient au contexte romain, et à la résistance dont les chrétiens ont pu faire preuve à cette époque, il faut noter que la crise militaire et économique qui a frappé l’empire à partir du milieu du IIIe siècle a eu un rôle important dans le déclenchement des persécutions : elle a conduit l’empereur Aurélien à introduire un culte public — le Sol Invictus — afin de restaurer l’unité morale et religieuse. Évidemment, comme l’a dit Anne, les chrétiens eurent bien du mal à prendre tout cela au sérieux ; c’est leur opposition à une forme forte de religion publique qui les amena à être persécutés, notamment sous Dioclétien, au début du IVe siècle. Depuis, cette tension entre les deux royaumes n’a eu de cesse de se reposer dans des termes toujours nouveaux, au gré des différents contextes historiques et politiques…
Vous pensez à un évènement en particulier ?
« Beaucoup de chrétiens congolais ont le courage et l’aplomb de manifester contre le régime Kabila depuis plusieurs mois. Parfois au risque de leur vie. »
Pierre-Louis Choquet : Ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo est à cet égard très intéressant. Il ne s’agit pas de porter aux nues l’Église catholique congolaise, qui est, à n’en pas douter, pleine d’imperfections, mais seulement de rappeler que beaucoup de chrétiens congolais (pour la grande majorité regroupés au sein du Comité de coordination des laïcs, le CLC) ont le courage et l’aplomb de manifester contre le régime Kabila depuis plusieurs mois. Parfois au risque de leur vie. On pourrait citer aussi bien l’exemple du Mexique, où de nombreux chrétiens jouent un rôle important pour dénoncer la violence des cartels, ou encore celui de la République centrafricaine, où plusieurs membres du clergé jouent un rôle incontournable pour tenter de rétablir la paix entre les communautés chrétiennes et musulmanes dans un pays en proie à la guerre civile — et ce, bien loin des caméras occidentales.
La doctrine chrétienne suppose de « désacraliser » le pouvoir temporel au nom de l’existence d’une autorité d’ordre supérieur. Pour autant, à travers l’Histoire, l’Église catholique a fait preuve d’un centralisme très marqué, au point d’instituer un pouvoir terrestre particulièrement puissant. Cet autoritarisme est-il compatible avec l’essence « résistante » du christianisme, à laquelle vous venez de faire allusion ?
Pierre-Louis Choquet : Il est important de se rappeler que l’Église n’a pas toujours été aussi centralisée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Si la parole du pape a vu son importance se consolider depuis environ 200 ans, il ne faut pas oublier que le mode de fonctionnement de l’Église est, à l’origine, synodal : ce sont les évêques et leurs communautés qui se saisissent des questions qui émergent et tentent de discerner les chemins qui « mènent vers le Christ ». Sur le plan théologique, il est clair que le cœur du dogme chrétien a été stabilisé lors des grands conciles du IV‑Ve siècle et n’est plus rediscuté depuis. Cependant, de nombreux points très importants de pastorale4 restent du ressort des diocèses — comme ce qui concerne la façon dont peuvent être accompagnés les divorcés remariés. Mais les questions qui peuvent être discutées lors d’un synode peuvent être toutes autres ! Dans l’encyclique Laudato Si, le pape François se réfère ainsi à de nombreux travaux de commissions épiscopales locales des pays du Sud, qui expriment la nécessité d’agir contre le changement climatique. En les ressaisissant dans un document romain, il tente de leur donner un accès à l’universalité, qui doit en retour interpeller les assemblées de croyants dans les pays du Nord. Ce mode de fonctionnement n’empêche pas des décisions et des prises de parole typiquement descendantes (on connaît bien le si décrié dogme de l’infaillibilité pontificale), qui a priori interdisent toute résistance. Mais si on contextualise cet autoritarisme, on remarque qu’il émerge au moment de la révolution industrielle — c’est-à-dire dans une période où la puissance de l’Église catholique romaine s’affaisse. Il faut néanmoins reconnaître que la culture du débat au sein de l’Église catholique est encore à travailler : les conditions de production du discours ecclésial restent encore trop confinées dans les structures institutionnelles.

[Kenzo Okada]
L’écologiste Paul Ariès estime que « les milieux d’affaires n’ont strictement rien à craindre » du pape François et que son anticapitalisme demeure un leurre tant il « utilise les gros mots de la théologie de la libération mais pour mieux les vider de leur charge émancipatrice ». Comprenez-vous cette méfiance ?
Pierre-Louis Choquet : Je suis tout à fait d’accord pour dire qu’il y a, dans le monde contemporain, un évidement de la parole publique tenue par les grands dirigeants (chefs d’État, dirigeants d’entreprise, etc.). Ce qui a bien entendu des répercussions sur l’ensemble de la société. Pourtant, je pense que la parole du pape est beaucoup moins sujette à cette dégradation. En fait, une parole se « décompose » à partir du moment où l’institution dont elle émane (l’État, une multinationale, etc.) a perdu, ou est en train de perdre, son autorité, et que celle-ci se transforme en pouvoir. Là où l’autorité suscite l’obéissance, le pouvoir la décrète en s’appuyant, bien souvent, sur des moyens coercitifs. De façon schématique, on pourrait dire que la parole papale n’est pas investie d’un pouvoir (en tout cas, beaucoup moins que par le passé) mais, qu’en revanche, la source de son autorité reste très forte : c’est le message évangélique. La parole papale n’a au fond que deux objectifs : guider le/la croyant·e au cœur de sa foi chrétienne et inviter l’autrement-croyant·e à méditer, s’il le souhaite, la vie éthique exemplaire de Jésus de Nazareth. Ainsi, quand le pape use des « gros mots de la théologie de la libération », c’est surtout pour reconduire chacun·e à s’interroger : qu’est-ce que je fais, concrètement, avec les autres pour que s’annonce ici même une communauté humaine qui préfigure le monde de justice auquel nous aspirons ? Nous sommes là à la jointure de la vie spirituelle et de la vie pratique. Si plus de chrétien·ne·s osaient davantage quitter leurs peurs (bien humaines !) pour s’aventurer vers ces lisières, nous pourrions être surpris… Paul Ariès ferait donc peut-être mieux de laisser le bénéfice au doute ! Mais ce qui est important, ici, c’est de bien comprendre la spécificité de la parole papale par rapport à celle d’autres dirigeants du « temporel ». Elle vise à reconduire chacun à ses propres sources morales et spirituelles plus qu’à ordonner à des sous-fifres d’appliquer un programme.
Revenons au « puritanisme protestant » que vous avez évoqué. Le protestantisme, dans sa version luthérienne initiale, s’est constitué en réaction contre le faste de l’Église catholique, le commerce des indulgences ! Il a prôné un retour à la lecture des Évangiles et à l’exemplarité de la vie simple et modeste de Jésus. Tous les catholiques ne sont pas François d’Assise…
« Dans cette économie, la pauvreté est une libération en même temps qu’une liberté : elle est processus et fin, risque et promesse. »
Anne Guillard : En effet, tous les catholiques ne le sont pas. Les chemins que prennent les vocations de chacun sont singulières à l’appel particulier que Dieu souffle en chacun. Néanmoins, on peut dire que la pauvreté — et non la misère — est privilégiée car elle est le moyen le plus « aisé » pour vivre pleinement sur terre le désir de Dieu ; à savoir, être à son image : libre. Dans cette économie, la pauvreté est une libération en même temps qu’une liberté : elle est processus et fin, risque et promesse. On n’a alors plus à sauvegarder nos richesses et nos privilèges dérisoires, on peut s’ouvrir vraiment, recevoir, donner sans nos petites mesures habituelles. Elle est l’expérience, si dérangeante, de vulnérabilité existentielle que rappelle la conscience aiguë qu’au fond « tu ne t’appartiens pas à toi-même ». Peu de croyants font le choix de la pauvreté car — c’est compréhensible — on préfère domestiquer le Christ et son appel en choisissant ce qui nous attire et nous convient. Le cœur partagé, on fait des petits arrangements avec la vie, même si c’est un peu au-dessous de nous-mêmes. Ceci dit, le désir et le choix de la pauvreté peuvent venir petit à petit au cours de la vie, et de la maturation spirituelle de chacun ; ce choix ne prend pas nécessairement la forme extraordinaire d’une révolution soudaine comme ce fut le cas pour François d’Assise. Cet appel est valable pour toute situation de vie et n’est le privilège de personne. Du coup, oui, on peut nuancer la mise en pratique, mais on ne peut nuancer la radicalité de l’appel en lui-même. Quant au protestantisme — bien plus vaste et complexe que la maigre restitution que j’en ai fait plus tôt —, Luther critiquait non seulement la richesse de l’Église, mais également l’instrumentalisation qu’elle faisait de la pauvreté en considérant qu’elle était bonne car elle permettait aux riches pratiquant la charité de mériter leur rédemption. D’où la valorisation qu’il fait du salut par la grâce et non par les œuvres et le mérite. La charité devient une conséquence de la foi et non la condition du salut. Les œuvres deviennent non un moyen de salut mais la réponse à la grâce de Dieu. Ce faisant, les œuvres et, progressivement, le travail manifestent cette réponse. Un renversement se produit alors, faisant du pauvre celui qui ne répond pas à cette grâce divine et vit aux crochets de ceux qui répondent à l’appel de Dieu par le travail. Au motif théologique, le pauvre se surajoute à un problème économique.
Vous combattez l’idée d’un christianisme entendu comme « posture identitaire », celui de la Manif pour tous et d’une partie de la droite, extrême ou non. Votre « engagement chrétien » n’aurait donc rien de défensif ?
Pierre-Louis Choquet : Pour juger de notre « engagement chrétien » et savoir s’il est défensif ou non, il faut tenter au préalable de répondre à cette question : qu’est-ce qui, précisément, serait à défendre ? Peut-être bien moins que ce que les catholiques ne voudraient penser… Le message évangélique ? D’une certaine façon, celui-ci se défend probablement très bien tout seul : comme vous le savez, le cœur de la prédication de Jésus a toujours interpellé — y compris ceux qui n’avaient pas la « foi » — et elle continuera très probablement à le faire. Alors, que faudrait-il défendre ? Une « certaine influence » pour le christianisme en France et en Europe ? Peut-être. En attendant, il faut regarder les faits en face : notre continent est marqué par la lame de fond de la sécularisation, et la France n’est pas épargnée. Nous vivons, comme le dit le sociologue Yves Lambert, la « fin de la civilisation paroissiale ». En ce qui concerne les pratiquants, le christianisme est déjà devenu une religion de diaspora. Peut-on pousser le raisonnement jusqu’à dire qu’il pourrait disparaître en Europe ? Même si cela semble peu probable à ce jour, il ne faut pas oublier qu’au IVe siècle quasiment toute l’Afrique du Nord était chrétienne : aujourd’hui, les chrétiens en sont quasiment absents — à part en Égypte. Nous pouvons gesticuler et nous accrocher à des images d’un passé fantasmé (qui auront d’ailleurs tôt fait de devenir des idoles !), cela ne servira pas à grand-chose ! Il est normal qu’une telle situation génère des inquiétudes : nous n’en sommes pas plus exemptés que les autres. Mais, parfois, on a quand même l’impression, en France, que beaucoup de catholiques s’imaginent, un peu orgueilleusement, que notre pays est le dernier bastion du christianisme — alors même que c’est de plus en plus faux ! Si tant est que les quantités comptent, il importe de souligner que l’Église catholique n’a jamais eu autant de fidèles qu’aujourd’hui, notamment parce qu’elle continue de s’ancrer en Afrique et en Asie. Sur tous ces points, il faut donc faire preuve de lucidité. Au vu de tout ceci, là où une posture défensive consisterait à revendiquer un attachement aux « racines chrétiennes de l’Europe », il me semble plus juste de parler d’une « histoire européenne du christianisme ». Car, en tant que tel, le message évangélique viendra toujours d’un ailleurs : quels que soient les lieux qu’il traverse, il y sera toujours de passage — de ce point de vue, l’Europe ne fait pas exception. Une fois que l’on se débarrasse de ce poids un peu écrasant (cette idée que le christianisme devrait rester « à tout jamais » fiché dans le sol européen) et que l’on prend acte de la fragilité de la situation, on peut se demander : comment continuer, nous autres chrétien·nes, à écrire cette histoire européenne et à faire preuve de créativité pour repenser la façon dont nous souhaitons participer à la vie de la Cité, avec tous les hommes et toutes femmes de notre temps ?
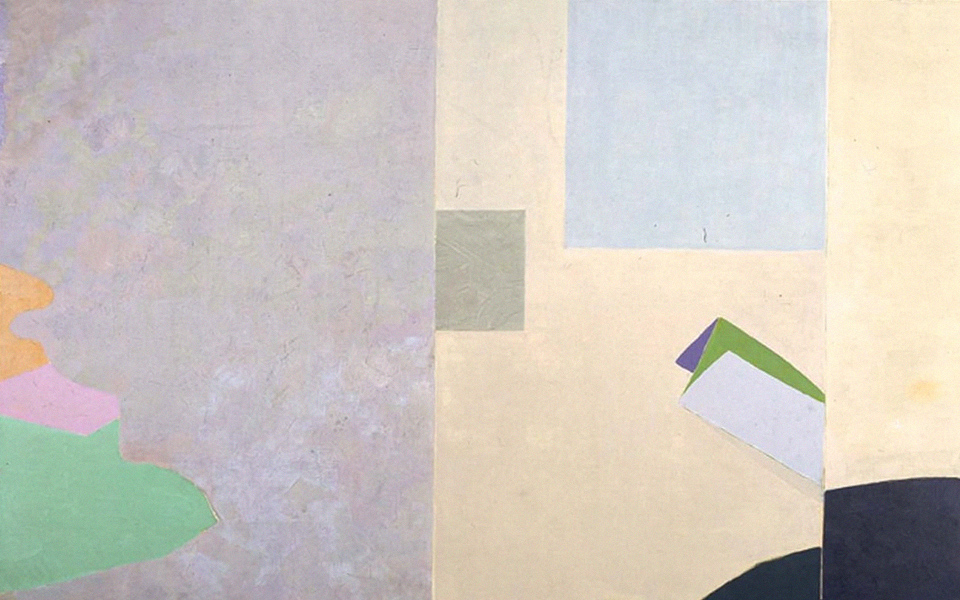
[Kenzo Okada]
Vous effectuez un lien entre la montée du « rigorisme islamique » et l’émergence d’un « catholicisme intransigeant » : quel est-il ?
Anne Guillard : L’une des raisons, assez simpliste mais néanmoins bien fondée, consiste à dire que les jeunes générations sont en recherche plus exigeante de sens que leurs aînés. Depuis plusieurs décennies, les sociétés européennes peinent à trouver une réelle consistance car elles ne nourrissent plus une relation vive à la chose commune, au bien commun. Par la médiation du droit, la sphère économique a colonisé l’ensemble des espaces de vie sociale et a progressivement vidé de son sens le souci de la chose publique. Face à cette inconsistance, inconsistance fondamentalement politique, se tourner vers la religion devient un catalyseur des frustrations. Avec l’art, la religion demeure l’un des derniers espaces où nommer une « transcendance » ne constitue pas un blasphème politique. Par conséquent, la proposition religieuse qui reconnaît ce besoin de transcendance peut constituer un excellent viatique à nos petites vies et nos individualités insignifiantes, en proposant un engagement dans des causes qui les dépassent. Les imaginaires mis à disposition des jeunes dans une société structurée par le néolibéralisme économique se trouvent assez monochromes, peu créatifs, peu stimulants, voire désespérants quand on est lucide !
« Par la médiation du droit, la sphère économique a colonisé l’ensemble des espaces de vie sociale et a progressivement vidé de son sens le souci de la chose publique. »
Une autre raison qui peut expliquer le rigorisme ou l’intransigeance religieuse contemporains est le fait d’une colère à l’égard de l’injustice politique que représente l’excommunication des religions dans le débat public. Vouloir à tout prix confiner les convictions religieuses dans la sphère du privé, comme la partition libérale public/privé le voudrait, débouche sur de fortes incompréhensions. Si ce retrait du religieux dans la sphère de l’intime était vital pour la paix sociale au lendemain des Guerres de religion en Europe, il n’en est plus ainsi aujourd’hui ; un espace civil qui se voudrait pacifié continuerait à respecter à égalité les convictions divergentes, mais proposerait également une reconnaissance substantielle de ces convictions religieuses comme une source de contribution réelle à la délibération publique. Évidemment, cela signifierait que ces convictions respectent certaines exigences des règles du droit moderne en termes de délibération politique. Cela implique, par exemple, qu’on ne puisse pas fonder son argumentation sur un « Dieu dit que… ». Cette idée d’un élargissement de la raison publique à la parole religieuse est défendue notamment par le philosophe Jean-Marc Ferry. Le travail sur les normes et sur les règles qui définissent notre façon de penser et d’agir est éminemment complexe, et a tout à gagner à élargir ses sources de réflexion. Les actes et les paroles violents portés par ces (jeunes) croyants mettent en relief avec acuité le conflit normatif entre les convictions privées et les valeurs autorisées publiquement, que les démocraties européennes pensaient avoir éludé.
Les convictions que vous défendez — la justice sociale ou l’écologie — concernent le monde commun et sont en elles-mêmes laïques ; en quoi pourrait consister une reconnaissance, dans l’espace public, de ces convictions dans leur dimension spécifiquement « religieuse » ?
Anne Guillard : Selon la conception du libéralisme à la Rawls, le but du contrat social est de fonder une base sur laquelle tous les citoyens peuvent raisonner en commun. Les prémisses religieuses seraient exclues, compte-tenu du fait qu’elles sont précisément plurielles et peu enclines à créer du commun. Une telle conclusion paraît néanmoins contre-intuitive, dans la mesure où elle semble contraire à l’esprit de liberté d’expression qui constitue la respiration même de la vie et de la culture démocratiques. Une telle conception sous-estime en réalité les engagements collatéraux des membres de la communauté politique, et ce que ces membres peuvent raisonnablement rejeter et apporter en regard de leurs valeurs et visions du monde. Une telle restriction des arguments était ou est justifiée en ce qu’elle permettait de fournir une stabilité et une sécurité à l’égard de formes de coercition illégitimes. Mais Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. ou Dorothy Day ne se sont pas restreints dans leurs assertions politiques comme l’envisagent les théoriciens du contrat social tels que Rawls… Le vocabulaire (abolitionniste, notamment) dans lequel ils conçoivent leur vision de la vie politique en commun est façonné par un contenu profondément religieux. Pourquoi auraient-ils dû abandonner leur vocabulaire et contenu religieux ? Certes, ces convictions découlent d’un rapport à Dieu, mais, au fond, peu importe de reconnaître la dimension spécifiquement religieuse de ces convictions : l’idée est d’expliciter la valeur opératoire actualisée des contenus et narrations religieux pour le monde séculier.

[Kenzo Okada]
Si on croit que Dieu a créé la nature et a fait des humains ses dépositaires, on peut le transposer en l’idée d’une responsabilité des humains à l’égard de celle-ci qui n’est pas leur propriété et qu’ils ne peuvent traiter comme bon leur semble. Les personnes qui n’adhèrent pas à ce contenu de croyance d’une Création par un Dieu unique ne seront pas nécessairement opposés à la conséquence pratique de cette assertion — à savoir le devoir de sa préservation. Les seules prémisses religieuses qui peuvent être exclues sont celles qui se réduisent à être des proclamations de foi car elles deviennent alors des « conversation-stopper » du débat public, comme les nomme Richard Rorty. Or chacun nourrit la conversation publique par des raisons issues d’un certain nombre de croyances, qu’elles soient religieuses ou non. Il ne s’agit pas de censurer la raison religieuse sous prétexte qu’elle est non-justifiable et donc illégitime politiquement ; nombreuses sont les visions du monde non-religieuses qui n’ont pas davantage de justification rationnelle alors même qu’on leur donne une valeur épistémique plus forte. Croire, par exemple, en l’égalité radicale entre les êtres humains n’est pas justifié rationnellement, mais cette croyance est devenue progressivement, par effet de contagion, une valeur aujourd’hui non-
Dans la biographie Vie de Jésus, Renan évoquait le « communisme délicat » porté par le Christ et les siens. Nous n’allons pas refaire ici l’histoire de cette religion : pourrait-on néanmoins avancer que l’institutionnalisation du « message » causa sa perte ?
« La destruction des écosystèmes planétaires est, sous toutes ses modalités, largement l’effet d’une accumulation et d’une circulation accrue du capital. »
Anne Guillard : Il est difficile de percevoir ce qu’aurait été le christianisme sans l’institutionnalisation de son message. La question de savoir si une sagesse spirituelle doublée d’une croyance existentielle peut s’incarner dans des pratiques et se transmettre sans la médiation institutionnelle est délicate : comment donner corps et faire exister socialement un message s’il n’est pas relayé par l’activité concrète et organisée de ceux et celles qui se réclament de lui ? Votre question suppose l’idée que toute institutionnalisation implique corruption de sa source. Les partis politiques, le travail des juges, toute activité institutionnelle se trouve en effet confrontée à cet écueil. Mais pour autant est-ce une malédiction ? Cela invalide-t-il son existence ? Il y a pourtant à chaque époque des mouvements et des personnes qui tentent de régénérer l’institution pour faire sortir de sa gangue le précieux trésor et laisser se déployer sa puissance transformatrice. Le pape François semble être de cette étoffe-là. Faut-il discréditer, de l’extérieur, toute institution alors même que nombre de conflits internes témoignent de sa vitalité, de son instabilité et de son incertitude fondamentales ? Les antagonismes et contradictions internes contrastent avec l’image et les discours officiels qui fournissent un régime de certitudes à assimiler. L’ampleur des conflits est repérable surtout empiriquement, dans les pratiques divergentes et les justifications que les chrétiens donnent de leurs pratiques — que ce soit entre catholiques, orthodoxes et protestants, aussi bien qu’au sein même de chaque branche confessionnelle. C’est un peu comme une sorte de grande famille où l’on est très fréquemment en désaccord avec certains de ses membres… C’est intéressant que vous employiez le terme de « perte » pour caractériser le message chrétien ; la perte constitue en effet le fondement de son message, dans la mesure où il invite à ne pas craindre de se perdre, d’être abîmé, de se donner et laisser fleurir plutôt que de chercher à se préserver. La pire chose qui puisse arriver audit message serait d’être conservé tel quel comme une relique, un sanctuaire, une langue morte, alors même qu’il est un Verbe qui s’incarne, qui se vit dans le kaléidoscope des vies humaines, se décline et se conjugue dans des contextes historiques et culturels en évolution permanente. Foncièrement, ce Verbe est une présence agissante en chacun. Ce qui signifie que ce message vivant se renouvelle réellement dans une vraie rencontre du croyant à un « extérieur » de son institution d’appartenance. Il n’est plus question de laisser à la hiérarchie institutionnelle le soin d’interpréter les Béatitudes5, mais il revient à chaque chrétien.ne, par petits groupes actifs, laïcs et religieux, de dire aujourd’hui qui sont les « pauvres », les « affamés de justice », les « exclus », les « affligés » et les « artisans de paix ». Puis de s’investir en conséquence.
Hugo Chávez avait dissocié deux figures : « le vrai Jésus, pas le Jésus de l’oligarchie ou le Jésus des élites ». Cette coupure a‑t-elle un sens à vos yeux ?
Pierre-Louis Choquet : Non, pas vraiment ! Il ne revient pas à Chávez, pas plus qu’à nous, de décréter que les personnes appartenant à l’oligarchie ou à l’élite ne peuvent pas être saisies par l’appel de Dieu. Ceci étant dit, il n’y a guère de doute sur le fait qu’amasser le pouvoir et les richesses encombre l’âme et que ceux qui font l’étalage de leur foi, en politique ou en affaires, finissent bien souvent par passer à côté de l’appel évangélique !
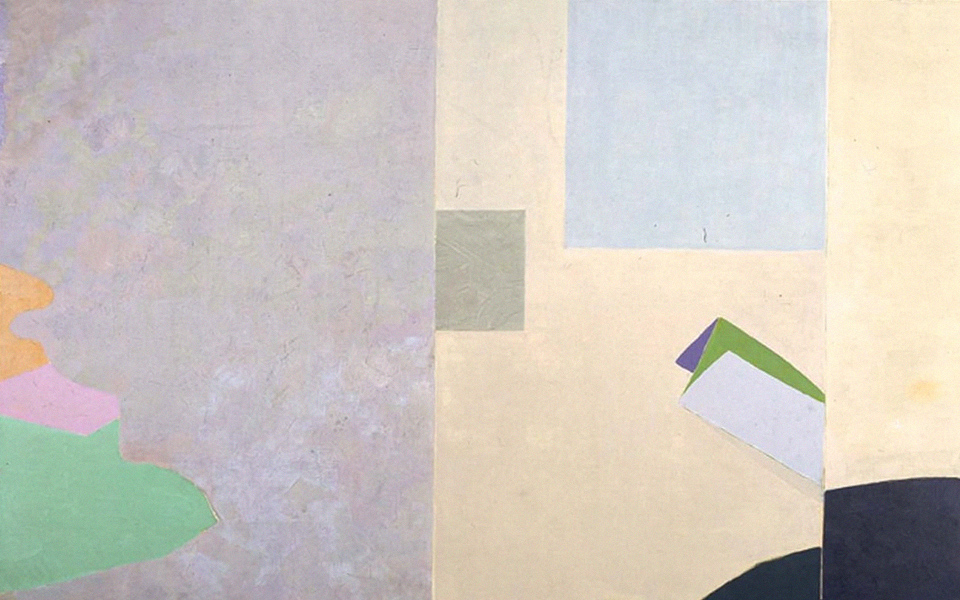
[Kenzo Okada]
« Réactualiser le geste paulinien », écrivez-vous. Le philosophe marxiste Alain Badiou assure que saint Paul « est la première pensée universaliste au sens strict, liant l’universel à son avènement, à son événement, mais c’est aussi une proposition tout à fait égalitaire » : cet universalisme serait-il un pont entre l’idéal chrétien et le matérialisme socialiste ?
Pierre-Louis Choquet : Il ne me semble pas très judicieux de poser une telle antinomie : l’« idéal chrétien » et le « matérialisme socialiste ». Je ne m’étendrai pas sur le « matérialisme socialiste » mais, ce qui est sûr, c’est qu’en tant que telle, la foi chrétienne ne rentre dans aucun des camps à propos du débat entre idéalisme et matérialisme. Au cours des derniers siècles, les théologiens ont repoussé l’idée que celle-ci puisse s’accommoder d’un matérialisme scientiste/déterministe — celui de la IIe Internationale — ou d’un idéalisme débarrassé de tout ancrage concret ! Bref, les Écritures ne s’intéressent pas vraiment à cette question (qui, d’ailleurs, n’aurait probablement eu aucun sens pour leurs rédacteurs). En revanche, l’accent est mis, dans les Évangiles et les lettres de Paul, sur les pratiques concrètes des individus, celles de Jésus et de Paul, bien sûr, mais aussi celles de la myriade de protagonistes qui interviennent dans ces textes. S’ouvrir à l’événement de la venue du Royaume, c’est être invité à imiter la manière qu’a Jésus d’entrer en relation avec ses prochains6. Mais qu’est-ce cela veut dire ? Chez Paul, il est clair que cela invite à réfléchir à une « forme de vie7 », dans laquelle la question de l’égalité est centrale. C’est le sens du fameux passage de la lettre aux Galates8. Il est maintenant assez clairement établi que les premières communautés chrétiennes ont vécu en « mettant en pratique » cette exhortation de Paul.
Vous associez, nous avez-vous dit, la foi au « besoin de transcendance ». Elle enveloppe donc une adhésion à un principe idéaliste. Ou un refus du strict principe matérialiste. Peut-on véritablement embrasser une ontologie matérialiste — dénuée de toute référence à la transcendance — sans en même temps renoncer à la foi ?
« L’accent est mis, dans les Évangiles et les lettres de Paul, sur les pratiques concrètes des individus, celles de Jésus et de Paul, bien sûr, mais aussi celles de la myriade de protagonistes qui interviennent dans ces textes. »
Pierre-Louis Choquet : Comme je l’ai suggéré, il ne me semble pas que le christianisme soit plus un idéalisme qu’un matérialisme — ou qu’il ait à se décider entrer les deux. Le ou la chrétien·ne affirme croire que la transcendance s’est intégralement exprimée à l’intérieur des limites spatio-temporelles du monde immanent, dans la personnage de Jésus, dont il ou elle atteste qu’il a authentiquement été « homme » (le qualificatif « Christ », qu’il ou elle lui rattache dans la profession de foi, désigne quant à lui la provenance et destination divine de l’homme Jésus). Je décris là un article de foi, et non pas vraiment un argument philosophique. Ceci étant dit, et si l’on sort du contexte chrétien, il ne me semble pas que l’on puisse embrasser avec passion une ontologie matérialiste en se privant complètement d’une certaine forme de transcendance, pourvu que l’on ait une acception assez « lâche » du terme. Il ne s’agit évidemment pas de prouver que tout le monde se réfère à Dieu « d’une certaine façon », sans le savoir : cet argument, en plus d’être faux, est bêtement paternaliste et infantilisant. Mais il me semble tout à fait clair que, dans le monde contemporain, l’art offre par exemple des occasions d’expérimenter une réelle ouverture à la transcendance — étant entendu, évidemment, que celle-ci ne se réfère pas à une « verticalité prescriptive » qui relèverait peu ou prou de la magie mais qu’elle se manifeste plutôt par une puissance de densité existentielle qui nous conquiert et nous bouleverse, sans que nous ne l’ayons réellement choisi. Or ces expériences surviennent dans le monde tel qu’il nous est présenté, ici et maintenant — fait d’atomes, de vagues sur la mer, de rêves et de symphonies musicales. L’hétérogénéité fondamentale des catégories d’existants que je viens de mentionner (auxquels un matérialiste pur et dur n’a aucun mal à admettre l’existence) montre bien que la réalité de notre monde concret matériel est en fait une incroyable concaténation de choses assez incommensurables les unes aux autres. Un « bon matérialisme » doit s’acquitter de la diversité de ces textures s’il ne veut pas être réductionniste. S’il prend acte de cette pluralité irréductible et chaotique de l’expérience, et essaie, de temps à autre, de formuler l’intuition de leur participation à « quelque chose » de plus large et plus profond (par exemple en écrivant ou en lisant de la poésie) sans chercher nécessairement à qualifier ce « quelque chose », il se situe déjà sur le plan de la transcendance — sans que celle-ci s’exprime dans un langage religieux…
Un chrétien pourrait-il chercher en Jésus un strict modèle de vie, en omettant sa nature divine, tout en restant chrétien ?
Pierre-Louis Choquet : Selon la formule stabilisée avec le concile de Chalcédoine, en 451, les chrétien⋅nes attestent dans leur foi de l’humanité et de la divinité de Jésus-Christ — et ce de façon rigoureusement indissociable. Pour ceux qui ne font pas ce saut (qui n’est pas tout à fait irrationnel, comme l’a montré Denis Moreau dans son livre Comment peut-on être catholique ?), pour celles et ceux qui ne partagent pas notre foi, donc, il reste évidemment tout à fait possible de considérer Jésus comme une figure humaine remarquable, dont la prédication et le style peuvent être source d’inspiration. À cet égard, les Évangiles sont des textes d’une puissance narrative assez époustouflante — et les exégètes ont fait un travail considérable au cours des dernières décennies pour les resituer dans leur contexte historique, et leur donner plus de relief !

[Kenzo Okada]
Votre livre peut se lire comme un plaidoyer pour l’écologie : que peut l’éthique catholique, telle que vous la défendez, contre la destruction des écosystèmes, l’acidification des océans, la déforestation de masse ou le déclin progressif des réserves de pétrole ?
Pierre-Louis Choquet : Il est important de rappeler que l’éthique chrétienne n’a, à proprement parler, pas de « contenu » : elle n’est ni un catalogue, ni une liste de préceptes à suivre. Sa capacité à faire vivre ne peut que découler d’une rencontre authentique avec Jésus-Christ : c’est cette rencontre qui ouvre un nouvel horizon éthique. Dans les récits évangéliques, celui-ci affleure de bien des manières, lorsque Jésus parle du « Royaume », lorsqu’il invite ses disciples à exercer leur autorité dans le service, à pardonner soixante-dix-sept fois, à tout laisser pour marcher à sa suite — mais aussi, tout simplement, lorsqu’il fait lui-même preuve de compassion, ou de colère ! Car il ne faut pas oublier que si Jésus a chassé les marchands du Temple, c’est précisément parce qu’ils faisaient obstacle à la recherche de ce fameux « Royaume » ! La question qui se pose aujourd’hui n’a pas beaucoup changé ; c’est celle des idoles. L’idole, au fond, c’est cette chose qu’on sacralise et qui nous fait puissamment oublier que nous avons justement cet horizon éthique à déployer, avec et pour les autres. Il n’est pas besoin d’aller bien loin pour dire que l’argent est (toujours) l’idole des temps actuels, et de loin le plus problématique. La destruction des écosystèmes planétaires est, sous toutes ses modalités, largement l’effet d’une accumulation et d’une circulation accrue du capital : les relations que nous tissons avec les non-humains ou avec les générations futures sont évidemment toutes dignes de considération — mais, dans l’état actuel des choses, elles restent largement subordonnés au type de rapport que nous nouons avec l’argent. Sur ce point, il faut éviter la simple posture d’une dénonciation morale, mais aller dans les détails. C’est justement la force du livre que Gaël Giraud a consacré à l’« illusion financière » ; sa critique de l’idolâtrie se double d’un diagnostic très clair de ce qui doit être exigé, sur le plan technique, dans le cadre d’un « réformisme radical ». Il faut poursuivre ce combat sur tous les fronts possibles : on ne peut vivre authentiquement la joie, la simplicité, la miséricorde de l’Évangile tout en étant complice d’un pillage qui, s’il est organisé par les voies du droit, n’en reste pas moins un pillage.
Vous êtes entrés en contact avec nous tout en sachant, sans doute, que la foi ne compte pas au nombre de nos préoccupations majeures. Tous unis contre le capitalisme, donc ?
Anne Guillard : Comme croyants, nous pensons que la manifestation de Dieu passe par l’engagement personnel et collectif aussi bien dans l’Église qu’hors d’elle-même, car rien ne saurait enfermer ni contraindre son action. Quand bien même nous n’aurions pas d’accord métaphysique sur le fondement du réel et la destination finale du vivant, nous partageons avec vous des aspirations communes, que ce soit à propos de la justice sociale et environnementale ou de l’organisation de la communauté politique. De ce point de vue, il nous semble important d’envisager la possibilité que des traditions de pensée qui se sont déchirées au XIXe et au XXe siècles (on pense bien sûr au choc entre le christianisme et l’athéisme) puissent cohabiter de façon plus pacifique et se porter une plus grande estime mutuelle. Car aujourd’hui, « l’évidence » de l’athéisme ne va plus de soi — pas plus que celle de la foi, d’ailleurs : les progrès de la connaissance scientifique nous laissent devant une « béance », et il revient à chaque tradition de pensée de rendre raison de l’interprétation qu’elle propose des fins dernières. Dans ces conditions, on peut œuvrer à ce qu’une discussion entre croyant·es et non-croyant·es puisse s’opérer « sans triomphalisme, ni ressentiment » (que ce soit d’un côté ou de l’autre), dans un souci d’honnêteté et de compréhension mutuelle. C’est un vrai défi, mais il en vaut la chandelle. Si nous pouvons montrer qu’en dépit de nos convictions différentes, nous sommes capables d’une action commune et de solidarité, alors peut-être que la convergence de nos combats trouvera crédit et importance aux yeux de ceux qui y sont pour l’instant indifférents.
Illustrations de bannière et de vignette : Kenzo Okada
- « L’unité de cette lutte réellement révolutionnaire de la classe opprimée combattant pour se créer un paradis sur la Terre nous importe plus que l’unité d’opinion des prolétaires sur le paradis du Ciel. Voilà pourquoi, dans notre programme, nous ne proclamons pas et nous ne devons pas proclamer notre athéisme ; voilà pourquoi nous n’interdisons pas et ne devons pas interdire aux prolétaires, qui ont conservé tels ou tels restes de leurs anciens préjugés, de se rapprocher de notre Parti. Nous préconiserons toujours la conception scientifique du monde ; il est indispensable que nous luttions contre l’inconséquence de certains
chrétiens
, mais cela ne veut pas du tout dire qu’il faille mettre la question religieuse au premier plan, place qui ne lui appartient pas […]. » Lénine, « Socialisme et religion », 3 décembre 1905.[↩] - Selon le sondage Ifop/Le Pèlerin du 23 avril 2017, 46 % des catholiques pratiquants ont voté pour F. Fillon au premier tour de l’élection présidentielle en 2017, contre seulement 12 % pour J.-L. Mélenchon et 2 % pour B. Hamon. Le reste des voix se partageant entre Emmanuel Macron (19 %) et Marine Le Pen (15 %).[↩]
- « Au milieu des sollicitudes ». Lettre encyclique aux archevêques, évêques, au clergé et à tous les catholiques de France, 16 février 1892.[↩]
- La « pastorale » est l’activité de l’Église qui permet de donner à chacun selon ses besoins spirituels.[↩]
- Les Béatitudes, ou Sermon sur la Montagne, est un discours de Jésus dans lequel il révèle le chemin d’accès au Royaume de Dieu que tout un chacun peut parcourir s’il le désire — car c’est une invitation : « Heureux êtes-vous. » Ce Royaume est une réalité vivante fondée sur la puissance de l’amour qui s’accroît à l’intérieur du temps qui passe. Il n’est donc pas uniquement une réalité à venir dans la vie après la mort, mais il est avant tout ce qui se joue silencieusement dans nos vies singulières, les choix que nous faisons, les relations que nous tissons, jour après jour. Voir l’Évangile selon Matthieu, 5, 3–12.[↩]
- Voir l’Évangile selon Marc, 3, 31–35.[↩]
- La lettre à Timothée est souvent critiquée pour la misogynie que Paul y exprime. On oublie souvent, au passage, de noter à quel point elle est peut-être l’un des premiers documents à décrire ce que l’on appelle aujourd’hui une « forme de vie ».[↩]
- Épître aux Galates, 3, 28.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Nedjib Sidi Moussa : « Ne rien céder aux illusions identitaires », juin 2017
☰ Lire notre entretien avec Alain Gresh : « On peut être croyant et révolutionnaire », novembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Ivan Segré : « Être à l’affut de toutes les convergences progressistes », septembre 2016
☰ Lire notre entretien avec Almamy Kanouté : « Il faut fédérer tout le monde », juillet 2015


