Texte inédit | Ballast | Série « Agriculture paysanne »
Pour indispensables que soient les expérimentations locales à l’agriculture productiviste, ces pratiques ne sauraient, à elles seules, contester le modèle dominant. C’est donc à la généralisation de l’agroécologie et à un changement de modèle agricole et alimentaire radical que travaille l’Atelier Paysan. Cette coopérative défend son Manifeste sur les routes de France depuis sa parution, en mai 2021. Nous avons retrouvé deux de ses auteurs dans le Finistère, ainsi qu’une centaine d’intéressés — paysans, militants ou simples curieux — à la faveur d’un rassemblement dans une ferme collective. Un week-end de discussions, d’ateliers et de conférences : reportage. ☰ Par Roméo Bondon
[lire le deuxième volet de notre semaine « Agriculture paysanne »]
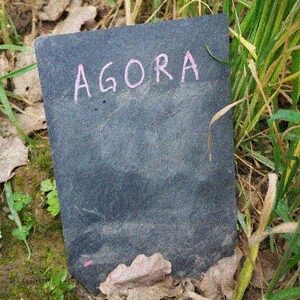
Solutions collectives
La route, imbibée de pluie et de brume, s’élève avec le relief. Je gagne les hauteurs du très vieux Massif armoricain, ses landes et son granit qui affleure entre les pousses brunes et rousses des graminées. Le jaune de genets rend criard celui du colza, seule culture en fleur à ce début de mois d’avril. Je passe l’un des cols peu élevés de la région. Au bord d’un lac, en contre-bas, des bâtiments attirent le regard. C’est le site nucléaire de Brennilis, où se trouve l’ancienne centrale des Monts d’Arrée, en démantèlement depuis des dizaines d’années. Après une dizaine d’années d’exploitation à titre expérimental, les réacteurs ont dû être arrêtés. Les déchets produits alors, eux, n’ont pas fini de perdurer. Je quitte la départementale pour une route plus étroite. Au détour d’un virage, des dizaines de véhicules annoncent un rassemblement. La nature des autocollants et du flocage de certains fourgons renseignent sur la teneur de celui-ci. Depuis novembre 2021, L’Atelier Paysan, une « coopérative d’autoconstruction », organise deux journées de rencontres chaque mois autour de l’ouvrage collectif Reprendre la terre aux machines. Livre au sous-titre bienvenu : Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire.
C’est une ferme collective de la commune de Commana, au cœur du Finistère, qui accueille la cinquième édition de ces discussions. Un peu de retard nous amène à entrer dans une salle déjà réchauffée par les voix de participant·es enthousiastes. Environ quatre-vingts personnes venues de toute la Bretagne se déplacent au gré des indications d’Hugo, salarié de l’Atelier Paysan, à l’initiative de ces rencontres. Les groupes se font et se défont en fonction du lieu d’origine ou de l’activité exercée. Des maraîcher·es en cours d’installation et des éleveurs à la retraite s’aperçoivent qu’ils sont voisin·es ; des collectifs venus de Brest rencontrent ceux arrivés de Rennes ; des militant·es antinucléaires, des faucheurs et faucheuses volontaires s’enquièrent des élaborations pour une Sécurité sociale de l’alimentation1. En somme, on piétine gaiement, dans un brouhaha qui témoigne d’un désir commun de partager son expérience. Jean-Claude, ancien éleveur, figure historique des luttes paysannes en Bretagne et coanimateur des rencontres, donne de la voix pour que le bruit retombe. Hugo reprend la main. Afin de lancer les discussions, deux questions sont abordées successivement. À l’écoute de la première, l’assemblée se coupe en deux en fonction de son accord ou de son désaccord avec la proposition : pour changer le monde, doit-on d’abord se changer soi ? Les arguments s’enchaînent pour tenter de convaincre l’autre camp. L’un note que les plus actifs et actives politiquement sont aussi, souvent, celles et ceux qui font passer le collectif avant toute chose, tandis qu’une autre avance qu’on ne peut dissocier les deux niveaux d’action. Puis, à l’écoute de la seconde proposition, deux groupes se reforment et une même division s’opère : la valeur d’une technologie dépend-elle des usages que l’on en fait ? Action individuelle, organisation collective, valeur et usage d’une technologie appliquée à l’agriculture : voilà trois points sur lesquels reviendront Jean-Claude et Hugo tout le long de la matinée. L’un et l’autre ont participé à l’écriture de Reprendre la terre aux machines, livre qu’ils proposent d’arpenter quelques heures durant.
« La production est abondante, c’est vrai, comme sont abondants les produits jetés, impropres, parfois gaspillés dans le seul but de faire monter le cours d’une marchandise. »
Le premier témoigne de son parcours. Issu d’une famille ouvrière militante où « la droite était le Parti socialiste et la gauche le Parti communiste », Jean-Claude a quitté la ville et sa profession de couvreur au début des années 1970 pour, dit-il, « s’échapper de la condition prolétaire » et « refuser l’industrialisation de la vie ». À tout juste 20 ans, le voilà qui conduit quotidiennement quelques vaches dans la campagne bretonne, et ce pour les quarante années à suivre. Une activité agricole qui s’est vite doublée d’un infatigable militantisme : vente directe pour se défaire des intermédiaires, constitution du premier réseau d’agriculture biologique dans le Finistère2, marché de plein vent aux pieds des barres HLM de Brest… L’homme nous rassure : il n’est pas un général faisant état de décorations pour service rendu. Car il le rappelle : malgré les initiatives, l’échec collectif est patent. Face à une insécurité alimentaire croissante pour un grand nombre de Français·es, à une détérioration de la qualité des produits, l’agriculture paysanne fait figure de niche intéressante, certes, mais en rien capable de faire vaciller soixante-dix ans d’industrialisation. Hugo rebondit : « Ça n’est pas avec la création de l’Atelier Paysan que John Deere [marque spécialisée dans les machines agricoles, ndlr] recule. » Malgré les rires, le constat d’impuissance est amèrement partagé. Une dépossession en cours depuis plus d’un demi-siècle.
Sur un rythme soutenu, l’histoire de la modernisation agricole française est passée au crible. Si les notions d’économie semblent à certain·es un peu ardues, le développement convainc sans peine une assistance déjà conquise. Une piqure de rappel, chiffres à l’appui, ne fait jamais de mal. Les grandes dates de la modernisation agricole sont passées en revue et les principales institutions sont détaillées. Puis critiquées. La PAC, notamment, est décrite comme « une subvention à la baisse des prix » — PAC qu’il faudrait supprimer, nous a dit cette même semaine la journaliste Lucile Leclair. Si la plateforme « Pour une autre PAC » tente d’insuffler des idées neuves au sein d’une institution obsolète, la nouvelle mouture reconduit les standards d’une agriculture industrielle qui se teinte se vagues reflets verts. Hugo résume : la modernisation agricole a été justifiée par une recherche de l’abondance alimentaire. Et la production est abondante, c’est vrai, comme sont abondants les produits jetés, impropres, parfois gaspillés dans le seul but de faire monter le cours d’une marchandise. En somme : une contradiction propre au système capitaliste. Une impasse.

[Roméo Bondon | Ballast]
Mais des solutions existent. Pour Hugo, elles se déclineraient en « un grand mouvement social » à même de « contrer l’escalade technologique » dans le monde agricole et sur ses bords. Des mécanismes de mutualisation et de socialisation sont convoqués pour rendre envisageable une transformation à l’échelle d’une région, voire d’un pays entier. Mais, pour cela, il convient de « ne plus raisonner en économie ouverte » — des propos en bute avec le marché des matières premières agricoles, régi pour les céréales et oléagineux par des transactions boursières depuis Chicago. Des propos, aussi, qui prendront tout leur sens quelques semaines plus tard lorsque, sur le pont supérieur d’un ferry quittant Dublin pour Cherbourg, le bruit des vagues et des oiseaux sera étouffé par les meuglement de centaines de veaux. Sur le pont inférieur, des bétaillères stationneront en effet le temps d’une nuit avant de reprendre la route vers l’un ou l’autre des pays du continent. Il est possible de laisser ces animaux quarante-huit heures ainsi, me renseignera-t-on — misères d’une loi acquise au libre-échange.
Renouveau paysan
La plénière laisse place à des ateliers. L’un est consacré aux alternatives locales, celles qui prennent racine dans cette partie de la Bretagne. Mais, avant qu’on n’échange les tuyaux et les bons plans des environs, ce sont des situations difficiles qu’on entend. Cela fait deux ans que Gaël, grand trentenaire à la barbe fournie, cherche avec sa compagne quelques hectares dans sa commune du Finistère pour y faire pâturer des brebis. Mais des terres, il n’y en a pas, qu’elles soient déjà occupées ou que le système d’attribution ne privilégie pas des projets comme le leur. Les tommes et les fromages frais que produisent les deux paysan·nes ne répondent pas encore aux critères d’homogénéité que la standardisation a généralisés. Dans l’attente, certains client·es se lassent, tandis que des ami·es persistent et encouragent. Fatigué·es par tant d’obstacles à leur installation, les acolytes ont décidé de sortir des clous. Ils organisent désormais un « marché clandestin », explique Gaël, en un lien de rencontre non-déclaré où les produits sont vendus à prix libre. À ces mots, on pense spontanément aux « non-marchés » de Notre-Dame-des-Landes, de Bure ou d’ailleurs, comme on songe aux « marchés rouges » des squats urbains où des denrées récupérées sur les étals sont offertes aux plus défavorisés. On se dit que les ventes doivent être joyeuses et bien vivantes dans ce coin reculé de la Bretagne. Gaël poursuit et tempère : « On a la double casquette. On vit dans la précarité, donc on consomme dans la précarité. » Les images festives se brouillent, remplacées par la brume des frais, des freins, des dettes. Lui et sa compagne ne s’en sortent pas.
« On a la double casquette. On vit dans la précarité, donc on consomme dans la précarité. »
Une fois quittée l’effervescence militante, les modes de vente alternatifs disent souvent autre chose de la production et de l’alimentation : la difficulté de s’installer en tant que paysan·ne sans un apport financier important, l’étroitesse des dispositifs mis en œuvre pour faciliter les nouveaux et les nouvelles venu·es dans le monde agricole, la solitude dans des communes où cohabitent des micro-fermes, des exploitations industrielles et de grandes entreprises agro-alimentaires. Non loin du marché clandestin, sur une commune voisine, un hangar rutilant vient d’être construit. Pour Alain, paysan des environs, la découverte du nouveau bâtiment a été « un grand coup dans le ventre ». Il s’explique : « Ce marché-là, il a été lancé par deux producteurs de porcs et de vaches allaitantes conventionnelles sur des champs en bio — car c’est aussi ça, la bio. Ils n’étaient pas allés assez loin dans leur démarche. Ils se lancent dans la production fermière : leurs cochons industriels, ils vont le vendre comme un produit fermier. » L’indignation est évidente, le découragement proche. Alain conclut : « Moi j’étais producteur pour faire mon salaire ; eux, c’est pour faire du capital. »
Une même tension vécue au quotidien se répercute dans les mots échangés. Christophe, maraîcher et cultivateur de plantes médicinales au regard lavé par le soleil, rappelle que « quand on est en précarité on met énormément d’énergie dans la ferme et on n’a pas le temps pour le réseau ». S’il ne peut guère participer aux réunions après une journée de travail, il a à cœur de proposer des sessions de jardinage dans des quartiers de Brest. Quelques chaises plus loin, c’est au tour de Sandrine de prendre la parole. Éleveuse de chèvres sur un espace conventionné par le Parc naturel régional d’Armorique, elle ne tient pas à produire plus que ce que le petit troupeau qu’elle laisse pâturer sur de larges espaces lui apporte. Mais, là encore, l’arbitrage entre un minimum vital pour soi et un prix bas est difficile. « J’ai calculé mes coûts de production et je me suis aperçue que ça n’était pas accessible », déplore-t-elle, la gorge serrée. À ces difficiles constats, certain·es opposent des positions qui rassurent, à même de passer de la culpabilité à la colère. Et, en colère, un maraîcher dit l’être « parce que je n’arrive pas à nourrir tout le monde ». Néanmoins, ce dernier refuse de trop réduire le prix de vente de ses produits. Lui et ses associé·es sont payés au Smic horaire, un salaire qui lui paraît juste pour le travail effectué. « J’aimerais que les gens comprennent que ce qu’ils mangent est subventionné », ajoute-t-il, faisant référence au prix d’achat des produits inférieur à leur coût de production sur les marchés alimentaires. Les expériences ricochent les unes sur les autres et, peu à peu, la camaraderie chasse pour un moment les obstacles quotidiens. Olivier, animateur d’une « librairie rurale et politique depuis près de dix ans » dans le département, témoigne de sa gratitude pour les personnes ayant partagé leurs difficultés ; Renaud insiste sur l’importance de conserver des terres vivrières au sein même de fermes productives pour la vente — le collectif dans lequel il s’inscrit a décidé de laisser trois hectares libres afin qu’avec « un peu de terre et beaucoup de temps » la ferme et des voisin·nes puissent subvenir en partie à leurs besoins. De temps en temps, Hugo, passant d’un atelier à un autre, intervient parfois pour tempérer : la plupart des souhaits exprimés « à l’échelle d’une ferme ne sont pas atteignables ». Pour lui, il est « de salut public » de diffuser cette idée. Allant plus loin, il rappelle que « c’est le propre d’une idéologie réactionnaire que de transformer un problème socio-économique en une responsabilité individuelle ». Une militante venue de Rennes rebondit : à l’échelle de sa ville, elle participe à des récupérations de nourriture pour approvisionner des lieux de lutte, des squats, des cantines… Elle conclut : « Le but n’est pas de nourrir les pauvres mais d’éradiquer la pauvreté. Donc il faut soutenir les luttes de transformation sociale. » Un même élan saisit les participant·es. L’atelier touche à sa fin mais les discussions continueront longtemps encore.

[Roméo Bondon | Ballast]
*
La journée d’échanges et de débats s’achève en même temps que la pluie s’arrête. Toan me désigne un point indistinct au-dehors — rien d’autre que le jeu de la lumière sur les flaques et les arbustes imbibés. On quitte ensemble la promiscuité joyeuse de la salle. Autour de la ferme, la bâche opaque d’une serre, dissimulées par des genêts et des trognes, flotte dans le vent. Plus loin, des vaches paissent tandis que les arbres s’égouttent de la récente averse. Toan est installé à Douarnenez, près de la pointe du Raz, l’une de ces extrémités géographiques qu’il dit aimer découvrir. S’il n’est pas lui-même investi dans le monde agricole, sa curiosité l’a conduit à participer aux deux journées organisées par l’Atelier Paysan. Des ami·es maraîcher·es l’ont quelque peu familiarisé avec les cultures, mais pour l’heure, c’est la réparation de vélo et la soudure qui l’occupent. On se tait un moment pour profiter du soleil avant qu’un nuage ne le cache de nouveau. Après un regard pour la cuisine collective et un autre pour un hangar attenant, Toan reprend : « Ce que je cherchais dans les squats, je le trouve maintenant dans les fermes. » Je souris. L’autonomie, la débrouille, l’entraide, la camaraderie : autant d’aspects reconnus l’espace d’une semaine dans les mots et les pratiques de paysan·es de tous âges, de militant·es opposé·es à l’industrialisation, de salarié·es déboussolé·es en quête de sens. Comme le suggère un livre récent3, cette « condition paysanne » que certains sociologues4 ont cru disparue persiste et se renouvèle sous d’autres formes, avec des soutiens qui excèdent le seul milieu agricole. Je songe à cet objectif repris par l’Atelier Paysan à la Confédération paysanne : un million d’agriculteurs et d’agricultrices installé·es dans les dix années à venir. Espérons que les moyens pour réaliser un tel souhait seront trouvés, qu’il faille pour cela bloquer des semenciers industriels, semer sauvagement dans des parcelles en cours d’urbanisation où, simplement, en travaillant la terre pour soi et pour les autres.
[lire le quatrième volet | Marie et Thierry : le pain et la terre]
L’auteur tient à remercier l’association Triptolème, l’Atelier Paysan, ainsi que les participants et les participantes rencontrés durant les événements pour leur accueil et leur enthousiasme durant les échanges.
Photographies de bannière et de vignette : Roméo Bondon | Ballast
- Pour plus d’information, voir Laura Petersell et Kévin Certenais, Régime général — Pour une sécurité sociale de l’alimentation, Riot éditions, 2022.[↩]
- On distingue le bio, qui fait référence au label Agriculture biologique (AB) et à son cahier des charges, de la bio, qui correspond à l’éthique, aux pratiques et aux valeurs partagées par les adeptes d’un mode de culture particulier.[↩]
- L’Observatoire de l’évolution, Manifeste pour l’invention d’une nouvelle condition paysanne, L’Échappée, 2019.[↩]
- Au premier desquels Henri Mendras, La Fin des paysans, Babel / Actes Sud, 1992 (1967).[↩]
REBONDS
☰ Lire notre article « Casamance : résister au sel et attendre la pluie », Camille Marie et Prosper Champion, décembre 2021
☰ Lire notre article « Kurdistan Nord : une ferme écologique en résistance », novembre 2021
☰ Lire notre traduction « Des graines fugitives », Christian Brooks Keeve, juillet 2020
☰ Lire notre entretien avec Les Grains de sel : « Un supermarché contre la grande distribution », novembre 2019
☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « La gauche est inaudible parce qu’elle ne politise pas le travail », juin 2019


