Texte paru dans le n° 9 de la revue papier Ballast (juin 2020)
« Face à une montée d’un nouveau conservatisme […] le Président de la République continue de porter un agenda progressiste et féministe ». C’est du moins ce qu’on pouvait lire, le 8 mars 2022, sur le site officiel de l’Élysée. Ses outrances proférées en défense d’un fameux comédien accusé de viols nous reviennent en mémoire — on s’étouffe. Outre les mots, qu’on retourne comme un gant, il y a les chiffres. En février 2024, le collectif Nous Toutes rappelait que 900 féminicides avaient eu lieu sous la présidence Macron. « Chaque année, le compteur est remis à zéro, mais les féminicides ne s’arrêtent jamais » rappelle la juriste et membre du collectif Maëlle Noir. Derrière la lenteur à agir se trouve, on le sait, un système patriarcal à la peau dur. Pour participer à sa méticuleuse destruction, a‑t-on seulement fini de le décrire et d’en faire la critique ? Selon le professeur de sciences politiques et essayiste anarchiste Francis Dupuis-Déri, un concept manque encore dans le lexique francophone : celui de « suprématie mâle ». Dans ce texte, il revient sur son émergence et propose de « l’intégrer dans la boîte à outils féministe », ce qui, espère-t-il, « pourrait contribuer à la lutte de démolition du patriarcat ».

Au début des années 1980, la philosophe féministe étasunienne Marilyn Frye2 a identifié six principes structurants de la suprématie mâle. Soit : 1) la prétention que certains droits sont associés naturellement aux hommes du simple fait d’être homme (la liberté de mouvement, l’intégrité physique, un emploi, une propriété, une épouse et des enfants, etc.) ; 2) l’homosocialisation des boys clubs3 et l’homoérotisme, qui consiste à réserver aux autres hommes le respect, l’admiration et l’idolâtrie ; 3) le mépris et la haine à l’égard des femmes (la misogynie) et des hommes dits « efféminés » ; 4) la sacralisation du pénis comme symbole de supériorité (phallocratie) ; 5) donnée à la sexualité masculine ; 6) la présomption que le pénis peut — et doit — tout pénétrer, y compris avec violence, et que cette pénétration est synonyme de puissance, de conquête et de victoire. On associe alors à un crime de lèse-majesté la privation de certains privilèges auxquels un homme croit avoir droit en tant qu’homme : un emploi, une conjointe, la sexualité à volonté, des espaces de non-mixité masculine, la possibilité de pénétrer tous les espaces, etc.
Un monde de seigneurs
« La suprématie mâle stipule que les femmes doivent être au service des intérêts, des désirs et des besoins des hommes, lesquels se prétendent leurs protecteurs pour mieux les contrôler. »
L’idéologie suprémaciste est originellement associée à la notion d’« entitlement », qui fait référence à un titre (title) de noblesse et reste difficile à traduire : « attitré », en français. Au Moyen-Âge, un tel titre accordait plusieurs droits et privilèges : on se découvrait au passage des nobles ; des bancs d’église leur étaient réservés ; eux seuls pouvaient monter à cheval ou chasser tel ou tel gibier ; on leur devait des corvées… Les gens de la plèbe (les « sans titre », pour reprendre l’expression du philosophe Jacques Rancière) étaient assujettis — ce qui signifie ne plus être sujet de soi mais sujet d’autrui, comme on est « sujet du roi ». Il s’agissait d’un crime de lèse-majesté d’empiéter sur les domaines des seigneurs et de s’arroger leurs privilèges. Les rituels de mise à mort soulignaient la distinction du seigneur, décapité et enterré avec cérémonie, alors que le gueux était pendu et son cadavre abandonné aux corbeaux.
De nos jours, un titre de suprématie peut être fondé sur le sang, la couleur de peau, un diplôme, un droit de propriété ou même un simple pénis. Déjà, en 1902, l’Allemande Hedwig Dohm mentionnait, dans son ouvrage sur l’antiféminisme, les « partisans des droits seigneuriaux » qui défendent la supériorité des hommes sur les femmes4. Ainsi, la suprématie mâle stipule que les femmes doivent être au service des intérêts, des désirs et des besoins des hommes, lesquels se prétendent leurs protecteurs — comme le seigneur avec ses serfs — pour mieux les contrôler. La suprématie mâle implique dès lors une ségrégation sexuelle du travail avec des emplois qualifiés de « masculins », plus prestigieux et mieux payés, et d’autres qualifiés de « féminins », moins prestigieux et moins payés — voire pas payés du tout : les corvées. Les femmes doivent exécuter ces dernières pour des hommes : cuisiner, nettoyer et laver, se livrer sexuellement, soutenir affectivement et psychologiquement, soigner, etc. C’est d’ailleurs pour défendre cette ségrégation sexuelle du travail que le mari a longtemps pu interdire à son épouse d’occuper un emploi, que des ordres professionnels et des syndicats se mobilisaient contre l’entrée de femmes dans certains métiers ou qu’un homme est entré à l’École polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989, pour abattre quatorze femmes en déclarant détester les féministes et vouloir leur faire la guerre. Le même homme avait constitué une liste de plusieurs « premières » femmes dans leur domaine, qu’il identifiait comme des cibles à abattre, dont la première policière, la première pompière et la première commentatrice sportive à la radio. Comme ses futurs admirateurs, il reprochait aux femmes d’empiéter sur des domaines réservés aux hommes, au point de justifier leur liquidation5.
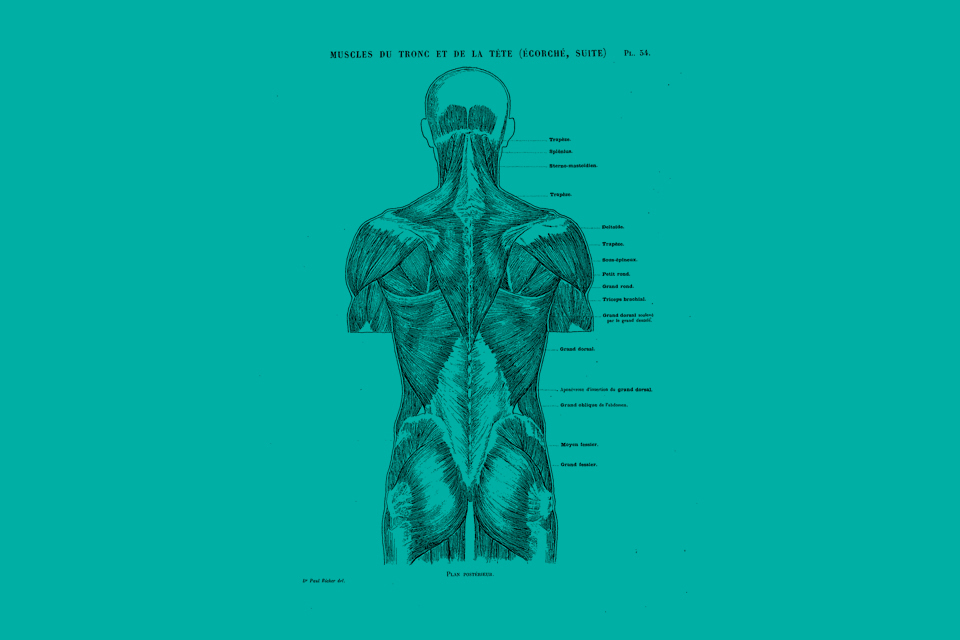
Un monde de « pureté »
Tout comme le suprémacisme blanc, le suprémacisme mâle est obsédé par la « pureté ». Il défend le masculin contre le féminin, sous prétexte que toute hybridation n’est qu’une dégénérescence, une contamination, une pathologie, une mort annoncée. En français, le mot « féminisme » désignait au départ les hommes que la tuberculose rendait efféminés6. Il faut donc croire et faire croire qu’il y aurait des qualités naturelles masculines et féminines, qui deviennent des défauts chez l’« autre ». Le masculin est associé à l’autonomie, à la raison, à l’autodiscipline, à l’action et à la compétitivité, à la force, voire à l’agression et la violence, et même à l’efficacité ; le féminin au relationnel, à la dépendance, aux émotions, à l’incontrôlable, à la passivité, à la sollicitude (le care), à la douceur, voire la faiblesse et même à l’égalité (selon le psychologue masculiniste Yvon Dallaire). Ces stéréotypes font écho à ceux du suprémacisme blanc colonialiste : les peuples européens incarneraient les qualités masculines et les peuples colonisés les défauts féminins (comme l’ont souligné des féministes décoloniales, dont Gayatri Chakravorty Spivak).
Or il s’agit de qualités humaines. La mère monoparentale est autonome, active et efficace, alors que le soldat obéit passivement, ne fait plus appel à sa raison, cultive certaines émotions, dépend de la logistique, collabore avec les membres de son unité et pratique le care lorsqu’un frère d’armes est blessé. Le suprémacisme mâle est effrayé par cette réalité humaine non genrée et refuse de voir les qualités dites « féminines » chez les hommes ou « masculines » chez les femmes, sauf pour crier au scandale, prétendre qu’il y a « crise de la masculinité » et stigmatiser les uns (trop efféminés) et les autres (trop masculines). L’égalité des sexes est ici synonyme d’indifférenciation des sexes, et vice versa — ce qui représente un danger réel pour la suprématie mâle.
Sexisme et racisme : quel parallèle historique ?
« Le suprémacisme mâle est effrayé par cette réalité humaine non genrée et refuse de voir les qualités dites « féminines » chez les hommes ou « masculines » chez les femmes, sauf pour crier au scandale, prétendre qu’il y a « crise de la masculinité » »
Aux États-Unis, ce concept a récemment été mobilisé pour parler des hommes machistes et misogynes qui participent aux événements néonazis. En 2018, le Southern Poverty Law Center (SPLC), une association de défense des droits civiques, a publié un rapport intitulé Male Supremacy. En octobre 2019, l’Institute for Research on Male Supremacism (IRMS) a quant à lui été fondé pour comprendre de quelle façon le suprémacisme mâle « interagit avec le suprémacisme blanc, l’antisémitisme et les idéologies anti-homos et anti-trans ». Le croisement entre le racisme et le sexisme n’est pas nouveau : au milieu du XIXe siècle déjà, la féministe Rebecca R. Eyster évoquait « le principe selon lequel l’homme blanc est le seigneur de toutes choses7 », si bien qu’il impose à son épouse le nom de sa lignée et attribue de nouveaux noms à ses esclaves. Mais c’est dans les années 1960 que des féministes ont repris une expression déjà en usage dans la « vieille gauche », « male supremacism », pour faire comprendre que la domination masculine s’avère plus ou moins comparable à l’oppression raciste.
D’autres expressions féministes avaient été forgées en s’inspirant du registre antiraciste. C’est le cas de l’expression « male chauvinism », généralement traduite par « machisme », forgée à partir de « white chauvinism » (« chauvinisme blanc ») et en référence au légendaire soldat de Napoléon, Nicolas Chauvin, incarnation du patriotisme le plus bête et le plus brutal. L’expression « white chauvinism » était utilisée au sein du Parti communiste dans les années 1930 et 1940 pour qualifier les militants qui faisaient preuve de « racisme ». Ce dernier mot était alors utilisé avec parcimonie car il évoquait les théories du nazisme. L’expression « male chauvinism » se popularise, plus tard, à peu près au moment où apparaît un nouveau mot, « sexism », qu’aurait inventé Pauline M. Leet en 1965 afin de dénoncer l’habitude d’éliminer toute référence à des œuvres de femmes dans l’enseignement de la littérature, ce qu’elle percevait comme une forme de ségrégation8.
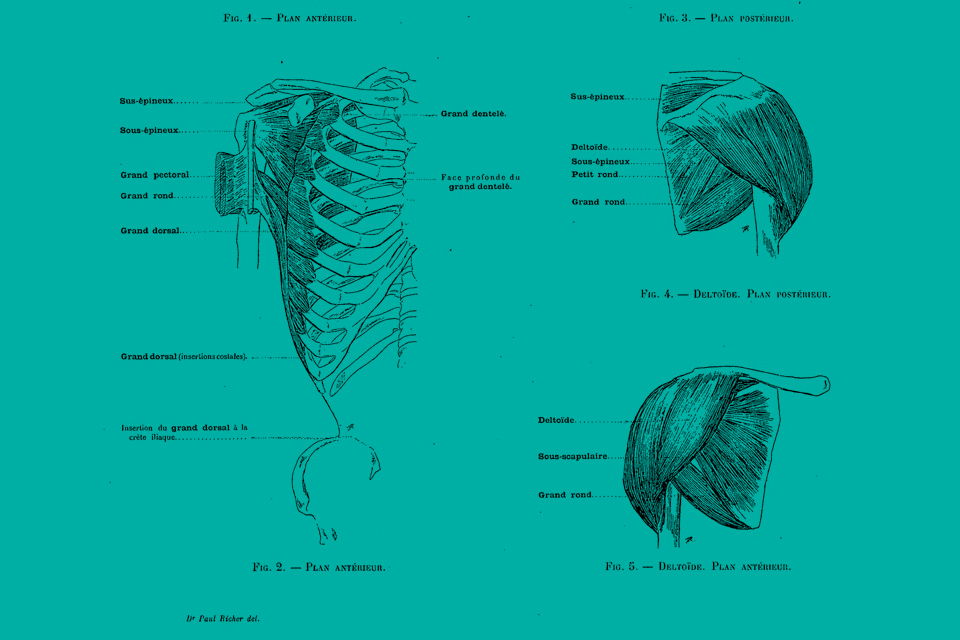
À cette époque, des militantes blanches s’engageaient dans ce qu’on appelait « le Mouvement », lequel regroupait diverses tendances : l’antimilitarisme (Vietnam) et l’anti-impérialisme (Algérie, Cuba, etc.), le Black Power, le Red Power (autochtone) ainsi que des groupes marxistes-léninistes et quelques collectifs anarchistes. Ces militantes sont devenues féministes en constatant que le Mouvement était contrôlé par des hommes qui se désintéressaient du patriarcat et se comportaient en parfaits machistes. Elles ont alors calqué leur vocabulaire sur celui d’une force politique devenue incontournable, le Black Power, pour souligner l’importance de la cause des femmes et la légitimité de leur mouvement — au Québec, au même moment, le mouvement qui prônait une révolution indépendantiste et socialiste, incarné notamment par le Front de libération du Québec (FLQ), qualifiait les Canadiens français de « nègres blancs d’Amérique » en s’inspirant des mouvements de décolonisation et en maintenant des liens avec les Black Panthers aux États-Unis, alors que les commerçants anglophones de Montréal exigeaient qu’on leur « speak white » (« parle blanc »)9.
Plusieurs textes féministes vont reprendre la notion de « male supremacy ». Dans « Why Women’s Liberation », paru en 1969, Marlene Dixon considérait que le suprémacisme mâle « est une forme de racisme10 » qui remplace la couleur de la peau par le sexe anatomique comme stigmate d’infériorité. Plus précisément, « l’idéologie de la suprématie mâle affirme l’infériorité biologique et sociale des femmes pour justifier l’oppression de masse institutionnalisée11 ». Or les féministes savent que la suprématie mâle « est un mensonge » : « Elles savent qu’elles ne sont pas des animaux, des objets sexuels ou des biens12. » La même année, le Redstockings Manifesto de féministes radicales de New York déclarait que « [l]a suprématie mâle est la plus ancienne et la plus simple expression de domination. Toutes les autres formes d’exploitation et d’oppression (racisme, capitalisme, impérialisme, etc.) sont des extensions de la suprématie mâle : les hommes dominent les femmes et quelques hommes dominent tout le reste. […] Tous les hommes retirent des bénéfices économiques, sexuels et psychologiques de la suprématie mâle13 ».
Une comparaison questionnée
« Il peut être problématique que des féministes blanches comparent le racisme et le sexisme, surtout si elles prétendent que le sexisme est la cause première de tous les maux — donc un enjeu plus important que le racisme. »
L’afroféministe communiste bell hooks a pourtant indiqué qu’il peut être problématique que des féministes blanches comparent le racisme et le sexisme, surtout si elles prétendent que le sexisme est la cause première de tous les maux — donc un enjeu plus important que le racisme14. On risque alors d’oublier la réalité spécifique des hommes noirs, mais surtout celle des femmes noires, touchées à la fois par le racisme et par le sexisme. L’avocate africaine-américaine Kimberlé Williams Crenshaw a elle aussi traité de ce problème chez les féministes blanches, tout en enjoignant du même souffle les militantes antiracistes à ne pas oublier le patriarcat et le sexisme15.
Pour sa part, la sociologue féministe Sirma Bilge a distingué l’« analogie par assimilation ou annexion », qui efface un des deux termes de l’équation, de l’« analogie par recomposition », qui permet d’éclairer une réalité spécifique en la comparant à une autre, mieux connue et mieux comprise. C’est ainsi par un jeu d’analogie par recomposition que « l’analogie sexe-classe a permis la théorisation de la catégorie femme
comme une caste, une classe16 ». Comparer le racisme et le sexisme peut donc aider à traduire et à saisir la réalité spécifique des femmes, trop souvent ignorée dans les mouvements progressistes, majoritairement composés de Blancs et de Blanches exprimant leur appui à des luttes antiracistes et les jugeant plus importantes que la lutte contre la suprématie mâle — laquelle les concerne pourtant bien souvent plus directement, à tout le moins dans leur organisation militante et leurs relations « privées » amoureuses et sexuelles.
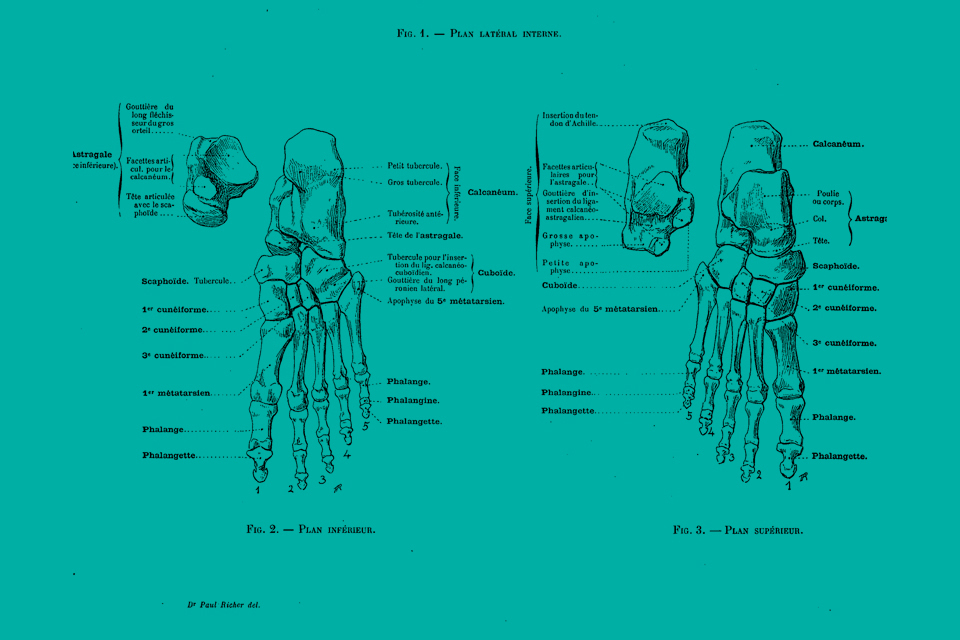
Des afroféministes ont également fait usage de la notion de « male supremacism », dont la communiste Angela Davis, évoquant « les attaques suprémacistes mâles » lancées contre des femmes blanches luttant pour l’abolition de l’esclavage au XIXe siècle17. Elle discute des avantages et des risques, pour les féministes d’alors, de comparer le mariage et l’esclavage, tout en soulignant que l’analogie par recomposition peut faciliter des alliances entre catégories ou classes subalternes et contestatrices, par exemple pour lutter en même temps contre le sexisme et le racisme18. D’autres afroféministes ont mobilisé la notion de « suprématie mâle » pour critiquer le machisme des hommes du Black Power. Dans « Double Jeopardy : To Be Black and Female » (« Un double handicap : être noire et femme »), Frances M. Beal écrivait ainsi en 1969 : « Certains hommes noirs prétendent qu’ils ont été castrés par la société, mais que les femmes noires ont pu d’une certaine manière échapper à cette persécution et qu’elles ont même contribué à cette émasculation. […] Il est vrai que nos maris, nos pères, nos frères et nos fils ont été émasculés, lynchés et brutalisés. […] Mais il s’agit d’une grave déformation que de prétendre que les femmes noires ont opprimé les hommes noirs19. »
Ce mythe d’un matriarcat imposé aux Africains-Américains par « leurs » femmes a également été dénoncé par Mary Ann Weathers, dans son manifeste An Argument for Black Women’s Liberation as a Revolutionary Force (1969), par Michelle Wallace, dans son essai Black Macho and the Myth of the Superwoman (1979), ainsi que par bell hooks dans Ne suis-je pas une femme ? (1981). Pour sa part, Frances M. Beal déplorait que les Africaines-Américaines aient été reléguées à des tâches subalternes dans le mouvement du Black Power, y compris dans la lutte armée, et les appelait à combattre tout à la fois le racisme et le sexisme (et le capitalisme)20.
Actualité du concept
« Les hommes attaquent souvent quand ils n’ont pas ce qu’ils croient leur être dû ou parce que leur conjointe a fait preuve d’insoumission. »
De nos jours, la notion de « suprématie mâle » est mobilisée pour saisir le sens politique du discours de la « crise de la masculinité » et les échos qu’il reçoit dans les réseaux d’extrême droite. Aux États-Unis, le journaliste David Futrelle a ainsi constaté que « si vous pouvez vous convaincre que les hommes sont les premières victimes du sexisme, il n’est pas difficile de vous convaincre que les Blancs sont les premières victimes du racisme. Et il est tout aussi facile pour les membres de ces deux mouvements de voir l’homme blanc comme le pauvre type le plus opprimé de tous21 ».
La notion de « suprématie mâle » aide à préciser ce qui est en jeu lorsque des hommes prétendent qu’« on ne peut plus draguer » ou même qu’« on ne peut plus rien dire », en tant qu’homme blanc hétérosexuel22. Le suprémacisme mâle s’exprime aussi avec violence quand les subalternes — les femmes — ne font pas preuve de déférence face aux hommes et ne se contentent pas de la place et du rôle qui leur sont assignés. Des études sur les violences masculines et les féminicides ont démontré que les hommes attaquent souvent quand ils n’ont pas ce qu’ils croient leur être dû (leur plat préféré, des relations sexuelles, etc.) ou parce que leur conjointe a fait preuve d’insoumission (elle est rentrée tard, elle veut rompre, etc.). En Amérique du Nord, la mouvance des involuntary celibates (célibataires involontaires) dits « incels », a développé la thèse que trop de femmes refusent aux jeunes hommes la sexualité à laquelle ils devraient avoir droit. Voici la version contemporaine du droit de cuissage, associé dans l’imaginaire collectif à la noblesse féodale.

Pire, des hommes ont perpétré des attentats au nom de la cause incel. Des commentaires sur le Web affirmaient qu’il s’agissait de gestes héroïques contre les femmes qui n’avaient que ce qu’elles méritaient. L’auteur d’un tel attentat expliquait dans son manifeste que « les femmes ne devraient pas avoir le droit de choisir avec qui elles se mettent en couple et se reproduisent » et qu’elles ne devraient même pas avoir de droits du tout. Pour d’autres, de futurs « massacres » ne seront évités que si les hommes apprennent à draguer23, ou se mettent en couple avec des femmes thaïlandaises (prétendument dociles) et que l’État développe le marché de la « prostitution légalisée24 ». Il n’est pas anodin de constater qu’un blogueur admirateur du tueur de l’École polytechnique a nombre d’adeptes parmi les incels25 : il y a des affinités entre les différents réseaux militants qui prônent la suprématie mâle.
Il est à déplorer que la suprématie mâle se retrouve également dans les réseaux militants progressistes contemporains, et même possiblement dans les mouvements LGBTQIA+. Déjà, en 1981, Marilyn Frye constatait que la suprématie mâle pouvait s’exprimer dans les bars et les groupes militants gays, souvent aux dépens des lesbiennes26. Des hommes qui se prétendent « révolutionnaires » veulent encore dicter aux femmes — et aux féministes — leurs objectifs, leurs priorités, leurs stratégies et leurs tactiques. On continue de leur expliquer qu’elles ne devraient surtout pas lutter contre le patriarcat, ni contre les hommes, ni même contre leurs agresseurs, surtout s’ils sont des camarades, car il ne faut pas « diviser » le mouvement et le « détourner » de ses priorités — c’est-à-dire l’anticapitalisme (ou, parfois, l’antiracisme). Bref, on leur demande encore et toujours d’écouter les hommes et de servir leurs intérêts et leurs désirs.
L’auteur remercie Mélissa Blais et Geneviève Pagé, pour avoir lu et commenté une version préliminaire de ce texte.
Illustrations de bannière et de vignette : DR
- MWASI, Afrofem, Syllepse, 2018, p. 17.[↩]
- Voir son article « Lesbian Feminism and the Gay Rights Movement : another View of Male Supremacy, another Separatism », paru dans The Politics of Reality : Essays in Feminist Theory en 1983.[↩]
- On pourra lire Le Boys club de Martine Delvaux, publié aux Éditions du remue-ménage en 2019.[↩]
- Voir Diane J. Guido, The German League for the Prevention of Women’s Emancipation : Antifeminism in Germany (1912–1920), Peter Lang, 2010, p. 19.[↩]
- Voir l’ouvrage de Mélissa Blais, « J’haïs les féministes » : le 6 décembre 1989 et ses suites, paru en 2009 aux Éditions du remue-ménage.[↩]
- Voir la thèse de doctorat en médecine de Ferdinand-Valère Faneau de la Cour, « Du féminisme et de l’infantilisme chez les tuberculeux », publiée en 1871.[↩]
- Alice S. Rossi, The Feminist Papers : From Adams to de Beauvoir, Columbia University Press, 1973, p. 245.[↩]
- Voir Fred R. Shapiro, « Historical Notes on the Vocabulary of the Women’s Movement », American Speech, vol. 60, n° 1, 1985, p. 3–16 et Lorraine Code, « Sexism », Encyclopedia of Feminist Theories, Routledge, 2003, p. 441 (merci à Sophie-Anne Morency pour cette référence).[↩]
- Voir l’ouvrage Nègres blancs d’Amérique de Pierre Vallières, paru aux éditions Parti pris en 1968, et le poème « Speak White » de Michèle Lalonde. Voir aussi l’analyse de la position de féministes québécoises blanches dans « « Est-ce qu’on peut être racisées, nous aussi ? » Les féministes blanches et le désir de racisation », dans Le Sujet du féminisme est-il blanc ? Femmes racisées et recherche féministe, paru en 2015.[↩]
- Voir Marlene Dixon, « Why Women’s Liberation », dans B. A. Crow (dir.), Radical Feminism : A Documentary Reader, New York University Press, 2000, p. 74.[↩]
- Ibid., p. 73.[↩]
- Ibid., p. 81.[↩]
- Dans B. A. Crow (dir.), op. cit., p. 223.[↩]
- Voir son ouvrage Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme, traduit en 2015 par les éditions Cambourakis. Cela dit, bell hooks a forgé dans les années 1990 l’expression « white supremacist capitalist patriarchy » (dans son article « Sexism and Misogyny : Who Takes the Rap ? — Misogyny, Gangsta Rap, and The Piano », Outlaw Culture : Resisting Representations, Routledge, 2015 [1994]).[↩]
- Voir son article « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du genre, vol. 39, n° 2, 2005, p. 51–82.[↩]
- Voir son article « De l’analogie à l’articulation : théoriser la différenciation sociale et l’inégalité complexe », L’Homme & la Société, n° 176–177, 2020, pp. 43–64.[↩]
- Voir son livre Women, Race and Class, Random House, 1981, p. 41.[↩]
- Une fois mariée, la femme perdait son nom et la liberté de choisir le lieu de la résidence conjugale, de gérer ses avoirs, d’occuper un emploi sans l’autorisation du mari qui jouissait d’une impunité en cas de violence ou de viol conjugal.[↩]
- Frances Beale, « Double Jeopardy : To Be Black and Female », dans The Black Woman : An Anthology, Washington Square Press, p. 112. Elle a aussi expliqué que les Africains-Américains ont adopté et adapté le « suprémacisme mâle » de la culture dominante blanche (« Slave of a Slave No More : Black Women in Struggle », The Black Scholar, vol. 6, n° 6, 1975).[↩]
- En 1998, l’Africain-Américain Gary Lemons a comparé les suprémacistes blancs et mâles en présentant la tradition proféministe africaine-américaine incarnée par l’ex-esclave Frederick Douglass et le sociologue W.E.B. DuBois (« A New Response to “Angry Black [Anti]Feminists” : Reclaiming Feminist Forefathers, Becoming Womanist Sons », Men Doing Feminism, Routledge, 1998, p. 288).[↩]
- Voir son article « Men’s‑Rights Activism Is the Gateway Drug for the Alt-Right », The Cut, 17 août 2017. Voir aussi « Entre terreur et misogynie : en-trevue avec la chercheuse Léa Clermont-Dion », Le Devoir, 28 avril 2018.[↩]
- Richard Martineau, « L’Homme blanc n’a plus le droit de rien dire », TVA Nouvelles, 12 mars 2018. Pour une perspective critique, voir Éric Fassin et Mara Viveros Vigoya, « Intersectionnalité », Manuel indocile de sciences sociales, La Découverte, 2019, p. 515.[↩]
- Au sujet de la misogynie et de l’antiféminisme chez les « apprentis séducteurs », voir le livre Alpha mâle de l’anthropologue Mélanie Gourarier, publié au Seuil en 2017.[↩]
- Voir l’ouvrage de Matthew N. Lyons, Insurgent Supremacists : The U.S. Far Right’s Challenge to State and Empire, Kersplebedeb-PM Press, 2018, p. 67–68 et p. 70.[↩]
- Voir l’article de Tristan Péloquin, « Haine envers les femmes : Jean-Claude Rochefort rejoignait 60 000 lecteurs », La Presse, 12 décembre 2019.[↩]
- Voir également l’article de Shannon Gilreath, « A Feminist Agenda for Gay Men (or : Catharine MacKinnon and the Invention of a Sex-Based Hope », Law & Inequality, vol. 35, n° 2, 2017.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre abécédaire de bell hooks, novembre 2021
☰ Lire notre article « 30 ans après, (re)lire Backlash de Susan Faludi »,R. R. Cèdre, juin 2020
☰ Lire notre entretien avec Valérie Rey-Robert : « Le problème, c’est la manière dont les hommes deviennent des hommes », avril 2020
☰ Lire les bonnes feuilles « Not All Men
: vraiment ? », Valérie Rey-Robert, mars 2020
☰ Lire notre entretien avec Mélissa Blais : « Le masculinisme est un contre mouvement social », décembre 2019
☰ Lire notre entretien avec Christine Delphy : « La honte doit changer de bord », décembre 2015


