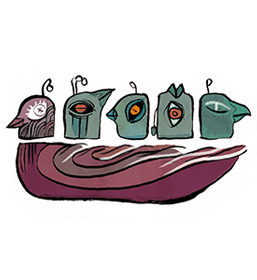Texte inédit pour le site de Ballast
« On attend de l’art contemporain qu’il disperse les émotions et les réactions, qu’il les partage, mais pas qu’il les rassemble. Je comprends cela mais cette histoire ne m’appartient pas. Je ne suis pas Européen. […] Je viens d’une histoire qui est précisément en manque de cohésion et de communauté1. » Pour raconter la dernière pièce de Wajdi Mouawad, Tous des oiseaux, il nous faut passer par la voix de ses acteurs, si singulièrement habités : leurs parcours étoffent le sens et la justesse de cette expérience de création collective. Plusieurs d’entre eux retracent ici les premiers temps de ce projet et nous parlent de l’écriture incisive de son auteur libano-canadien, qui travaille le réel sans jamais perdre en poésie. Sur scène, quatre heures et quatre langues — allemand, hébreu, arabe et anglais (sur-titrées en français) — pour remonter le cours de l’Histoire aux côtés de deux amants, Wahida et Eitan, et d’une famille juive. La pièce nous emporte jusqu’en Israël et en Palestine : une collision, racontée au Théâtre de la Colline à Paris, où nous étions présents il y a peu. ☰ Par Maya Mihindou
« Il y a quelques jours, il y a eu une attaque chimique à Damas. J’étais sur scène, à attendre en coulisse. J’ai dit à Wajdi : Il y a des attaques chimiques, il y a quarante personnes qui sont mortes !
Il m’a répondu d’entrer sur scène pour raconter l’histoire de l’Oiseau amphibie. Il m’a dit Notre armée, c’est l’art
. Pour ces raisons, mon histoire avec Wajdi, avec toute cette équipe, avec La Colline, c’est très personnel, touchant et profond », nous racontera Jalal Altawil, acteur originaire de Syrie. Mais quelle est-elle, cette histoire de l’Oiseau amphibie qui éclaire le titre de la pièce ? Celle d’un oiseau qui se trouvait à ce point fasciné par l’existence des poissons qu’il ne songeait qu’à plonger sous l’eau, qu’à s’y laisser tomber afin d’y découvrir leur monde. Ses congénères le prirent pour fou et le mirent en garde à de nombreuses reprises, lui promettant mort immédiate : oiseaux et poissons ne sauraient se mélanger — aucun ne parviendrait à respirer dans le monde de l’autre. Il vécut longtemps une vie monocorde, dénuée de rêves, puis n’y tint plus : il plongea. Au contact de l’eau, des ouïes poussèrent, lui permettant de respirer ; il devint amphibien et fut émerveillé du bleu du fond de l’eau et des couleurs de ces poissons dont il ignorait tout. « C’est moi, je suis l’un des vôtres, je suis l’oiseau amphibie », leur dit-il. Il devint celui qui était capable de parler aux oiseaux comme aux poissons.
« Un nom sur une pierre ne dit rien des peines et des joies… »
« Que faire d’al-Wazzān dans une pièce d’aujourd’hui racontant la vie d’une famille juive et d’un garçon juif qui tombe amoureux d’une fille arabe ? »
Cette parabole est racontée en arabe par Hassan al-Wazzān, ambassadeur et géographe du XVe siècle, incarné par Jalal Altawil, également traducteur du récit écrit par Mouawad. Quelques jours après la première représentation, nous rencontrons le comédien dans un café aux abords du théâtre. Il ne fut pas évident pour lui de comprendre son rôle, la place de ce diplomate musulman que les décennies déplacèrent — parfois de force — de Fez à Tombouctou, de Gao au lac Tchad, de l’Égypte jusqu’à La Mecque, Istanbul, Tripoli ou Tunis pour finir capturé par des pirates et vendu dans l’Europe chrétienne d’il y a six siècles. « Que faire de ce personnage dans une pièce d’aujourd’hui, racontant la vie d’une famille juive et d’un garçon juif qui tombe amoureux d’une fille arabe ? » L’auteur de Description de l’Afrique, ouvrage de référence de l’époque, dut se convertir au christianisme — de la main du pape — et se fit lui-même traducteur : en cette ère de divisions et de conquêtes entre chrétiens et Arabes, il fut une passerelle, portant sur les cultures qu’il traversait un regard de découvreur. « Wajdi m’a expliqué que sans lui, on perdrait toute la magie du théâtre pour rester dans le drame ou le cinéma. Al-Wazzān est le morceau de poésie de cette pièce. » Présent en filigrane, c’est en effet par sa parole que se produit l’envol final, permettant de surplomber l’ensemble des conflits familiaux auxquels le spectateur est confronté.
De nombreux traducteurs furent réquisitionnés pour la pièce : « C’était un autre challenge pour moi. Je suis professeur de théâtre, je travaille la voix et la prononciation en langue arabe, classique et plus ancien. Et je parle araméen, langue proche de l’hébreu et de l’arabe. Il m’a fallu traduire l’écriture de Wajdi Mouawad : ce n’était pas facile ! Puis passer par l’arabe classique pour la réécrire et la connecter à la langue d’Hassan al-Wazzān. » Jalal Altawil est, avant tout, un regard ; il a le sourire sincère et doux, une allure certaine et un français parfait, piqué de quelque accent syrien. Il se prépare une cigarette. « Le monologue de l’Oiseau amphibie a, dans sa version originale, la musicalité de la langue du Coran, qu’il fallait respecter. Il ne s’agissait pas de respecter seulement la langue arabe mais aussi celle de Wazzān — qui a appris le Coran par cœur et qui parlait sept langues ! Ce n’était pas un homme normal, c’était un fou ! (rires) » La personnalité d’al-Wazzān, un œil bleu et l’autre noir, hante la pièce ; « hante », oui, car il est le seul personnage ayant réellement existé à sillonner, avec une étrange bienveillance, le plateau. Il rappelle le chœur des tragédies grecques chères à l’auteur. « Il était capable de changer la couleur de son regard, d’où notre choix des deux couleurs pour ses yeux… »

Jalal Altawil par Maya Mihindou
Le parcours de ce géographe natif de Grenade nourrit le dramaturge libano-canadien, qui consacra plus de cinq ans à l’écriture de sa pièce, accompagné par le travail de l’historienne Nathalie Zemon Davis. « Nous avons trouvé une clé : qu’est ce que signifie l’identité
? Comment passes-tu de l’Est à l’Ouest, de l’islam au christianisme en restant clair avec toi-même, sans devenir schizophrène ? al-Wazzān trouve la sienne dans le fait d’être vivant et libre, simplement. » Le comédien renchérit : « Je suis syrien. Qui est mon ennemi ? L’Israélien ? Pendant cinquante ans, les Assad nous ont dit que l’Israélien était l’ennemi. Mais maintenant, mon ennemi c’est Bachar el-Assad. Si je deviens français sur le papier… cela deviendrait-il mon identité ? Non. » Figure reconnue du théâtre syrien (36 pièces à son actif), ses prises de position contre la République arabe syrienne le poussèrent à fuir son pays. « Cette révolution m’a changé profondément, a changé mon rapport à mon métier, lui a donné un sens. » Jalal Altawil est arrivé en France en 2015 après être passé par plusieurs pays du Moyen-Orient, où il accompagna, sous forme d’ateliers, des enfants syriens victimes du conflit. « En Syrie, il y a Daech. Il y avait des Syriens dans Daech, il y avait des Américains, des Français… beaucoup de nationalités. Alors mon ennemi, ce ne sont pas les nationalités. L’identité régionale est extrême, pour moi. Tu es une marionnette, tu n’es pas libre. » Il se dit aussi « survivant », et il y tient. « Je ne suis pas réfugié
— ça, c’est pour les papiers français. Je suis survivant, comme les Juifs sont survivants de l’Holocauste ; nous, les Syriens, sommes survivants de cette guerre que mène Bachar el-Assad. »
« Les murs bougent au fil de la pièce, évoquant tour à tour ceux d’une bibliothèque, d’une boîte de nuit, d’un hôpital ou d’une maison d’enfance. Puis la cicatrice du mur de Berlin, le mur de séparation, celui des Lamentations. »
L’homme avait répondu à une annonce : « Recherche acteur français parlant arabe.
Je suis un acteur arabe qui parle un peu français ! (rires) Je ne connaissais ni La Colline, ni le travail de Wajdi. On s’est rencontrés tous les deux, on a discuté quarante minutes dans son bureau. Je lui ait dit que ma vie c’était celle d’al-Wazzān dans l’autre sens, comme une boucle. » Il précise : « J’ai voyagé en Syrie, en Égypte, en Jordanie, en Turquie, au Liban, et je suis arrivé en France… Lui est passé par l’Afrique pour arriver en Italie : on a dessiné un cercle à nous deux ! J’ai lu à Wajdi un poème d’Ibn Arabi… » Poème qu’il prendra le temps de nous envoyer : « Avant ce jour, je reniais mon ami / Puisque ma religion diffère de la sienne. / Mais mon cœur est devenu le cadre / Capable d’accueillir chaque image / Il est pâturage pour les gazelles / Et abbaye pour les moines / Temple pour les idoles / Et Ka´ba pour qui en fait le tour. / Il est les Tables de la Torah / Et les feuilles du Coran / Je crois en la religion de l’amour / Où que se dirigent ses caravanes / Car l’amour est ma religion et ma foi. » Wajdi Mouawad lui dit alors « que c’était bon, sans test, sans rien : on a juste tissé un lien, ensemble ».
« Notre peuple ferait-il subir à un autre ce qu’il a subi lui-même ? »
Savoir passer d’un monde à l’autre, d’une langue à l’autre. Ce symbole du passeur et du passage est ce qui borde la pièce. L’incarner est aussi le défi tendu à chacun des personnages — tous ne sauront l’honorer. Hassan al-Wazzān constitue justement le sujet de thèse de la jeune Wahida (jouée par Souheila Yacoub), alors étudiante dans une université de New York ; elle tente de comprendre les déplacements identitaires du géographe avant d’être interrompue par une rencontre — un coup de foudre — avec un chercheur prénommé Eitan (Jérémie Galiana). Pour ce généticien, nulle épigénétique2, tout se résume, identité comprise, à 46 chromosomes. « Eitan a été bercé dans la religion juive. Quand il a commencé à penser pour lui-même, il a vu le monde de façon très cartésienne et mathématique », nous expliquera son interprète. Traversés par l’amour, ils tresseront, pour un temps, leurs deux solitudes. Elle est une jeune femme de son temps, d’une beauté qui prend tout l’espace, une Américaine née de parents marocains mais orpheline : « Wahida est celle qui se fiche de tout : elle est cool, au-dessus des divisions de religion, elle dépasse ça. C’est l’extérieur qui l’y ramène. On lui hurle qu’elle est arabe, musulmane, mais elle s’en fiche : c’est dans un premier temps ce qui fait sa force », nous racontera Souheila Yacoub dans un restaurant du 10e arrondissement de Paris. Sur scène, il ne faudra pas attendre vingt-cinq minutes après le début de la pièce pour assister à la naissance d’un grand amour en pleine capitale américaine, rejeté par toute une famille venue de Berlin, achevé par une bombe palestinienne jetée sur un pont. La scénographie d’Emmanuel Clolus arrondira les angles narratifs : on passe d’un pays et d’une temporalité à l’autre dans une fluidité toute cinématographique. Les murs bougent au fil de la pièce, évoquant tour à tour ceux d’une bibliothèque, d’une boîte de nuit, d’un hôpital ou d’une maison d’enfance. Puis la cicatrice du mur de Berlin, le mur de séparation, celui des Lamentations.

Hassan al-Wazzân et Wahida, par Simon Gosselin
La pièce se découpe en quatre parties 3. Deux scènes — une catastrophe qui en engendrera une autre — sont à extraire, sans trop en dire, de ces deux premiers chapitres : le déjeuner de Pessah organisé par Eitan et le contrôle au checkpoint à la frontière jordanienne. Dans la première, le jeune scientifique a fait venir ses parents d’Allemagne : son père David (Raphaël Weinstock), sa mère Norah (Judith Rosmair) et son grand-père Etgar (Rafael Tabor). Il a pris soin de convier un rabbin (Victor de Oliveira) pour honorer les traditions chères à ses parents et compte leur présenter son aimée, qui patiente derrière la porte d’entrée. Mais tout s’écroule avant la première bouchée, sitôt qu’il prononce son prénom : Wahida. La mère, une psychologue allemande ayant découvert sa judéité sur le tard, se décompose et peine à soutenir son fils ; le père, fils d’un survivant de la Seconde Guerre, est quant à lui préoccupé par l’abandon d’un patrimoine qui, hurle t‑il, se transmet par la mère. « Vis ta vie avec cette fille et je t’appellerais parricide », rugit David, retirant sa kippa. Le grand-père tente de tempérer les choses, de calmer fils et petit-fils ; rien n’y fait. « Auschwitz au complet n’a pas affecté le moindre gène, le plus petit ADN de mon grand-père ! », assène Eitan à David…
«
Auschwitz au complet n’a pas affecté le moindre gène, le plus petit ADN de mon grand-père !, assène Eitan à David… »
Un père se lève pour s’en aller ; un fils fait asseoir son père… « Cette scène, on l’a d’abord approchée doucement, on ne savait pas comment la faire. C’est très fort en émotion, on l’a jouée une fois puis on s’est arrêté pour en parler », nous dira Raphaël Weinstock, venu d’Israël pour incarner ce colosse haineux, pétri de certitudes et portant la douleur d’un père rescapé des camps de la mort. « Le jour suivant, nous l’avons rejouée, nous l’avons laissée nous pénétrer. Et, très doucement, Wajdi a relevé des moments de grâce qui sont apparus — comme celui, trouvé dès la première fois, où je prends ma veste, m’en vais, et mon fils m’ordonne de m’asseoir. » Dans la salle, la scène laisse la masse de spectateurs dans un silence sans souffle. « Nous avions Jérémie et moi la sensation d’être en dehors du plateau jusqu’à ce que je m’assois. Nous avons compris peu à peu ce que représentait cet instant. Et la scène devient d’autant plus forte quand on réalise qu’il n y a, dans la pièce, aucune scène d’échanges entre David et Eitan, seuls. Il n’y aura pas de réconciliation. »
Tout est en morceaux. À la table de la défaite, Eitan débarrasse les plats ; il a ce curieux réflexe de prélever l’ADN de ses parents, de vouloir les regarder par le prisme de son microscope. Le jeune généticien découvre que son père n’est pas le fils d’Etgar, son grand-père. Il décide de rejoindre la seule a détenir la clé de ce mystère : sa grand-mère inconnue restée en Israël, Leah (Leora Rivlin). Avec Wahida, ils s’envolent vers Jérusalem. Se font recaler par ladite grand-mère, qui fait mine de ne connaître personne. Et c’est à une autre intersection géographique que tout explose : Eitan et Wahida se trouvent dans la zone de checkpoint du pont Allenby, ce pont qui connecte les rives jordaniennes et palestiniennes du fleuve Jourdain. Il doit, d’un côté, répondre aux questions des militaires israéliens ; Wahida aussi, de l’autre — la jeune femme a encore le sourire aux lèvres : ces choses-là sont des formalités, l’histoire de cette famille n’est pas la sienne, ce pays non plus. Elle ne se froisse donc pas face à l’Israélienne de son âge, vêtue en tenue militaire, mais peine à comprendre l’acharnement des questions comme des sous-entendus. « Dans ce face à face, l’une est le bourreau de l’autre, mais ça pourrait être l’inverse. Il est là le lien : elles sont le miroir d’une même génération », nous en dira Souheila Yacoub. Pour se faire comprendre, Wahida parle à la soldate avec sincérité de son amour pour Eitan, évoque les raisons de leur présence sans saisir qu’elle n’est perçue, dans cet espace, que comme « arabe ». Elle lui parle d’Hassan al-Wazzān, qu’elle étudie et connecte à ce lieu : un possible « terroriste » pour celle qui la dévisage.

Eitan et Wahida, par Simon Gosselin
La jeune militaire israélienne — qui jalonnera le reste du récit — joue la démesure, enchaîne les questions de plus en plus indiscrètes, la soupçonne d’être une espionne, lui impose de se déshabiller pour une fouille au corps. Abuse quelques minutes de sa position. « Eden, mon personnage, porte un sac à dos depuis toujours », nous précisera celle qui l’incarne sur scène, Darya Sheizaf. « C’est ainsi que Wajdi me l’a expliqué : elle a toujours fait ce qu’on lui a dit de faire, et l’armée en fait partie. Elle veut sincèrement défendre son pays car c’est ce qu’on lui a dit qu’il fallait faire. Toute sa vie, on a ajouté des petites pierres à son sac. Elle a 20 ans, se retrouve avec un sac rempli de pierres, et c’est lourd. Mais elle est tellement habituée qu’elle ne les sent plus. Et puis elle rencontre Wahida. Et à la seconde où elle touche la peau de Wahida, elle veut comme l’aspirer. » De nouveau, la salle ne respire plus. Une bombe vise le checkpoint. Wahida se rhabille. Il y a des morts. Eitan est plongé dans un profond coma… Nous n’en révélerons pas davantage.
« On ne sait pas raconter le passé aux enfants sans les traumatiser. »
« Nous nous tenons dans un tableau commun, parents de la vieille Europe impériale, parents de la Palestine mise à sac, descendants de colonisés, de colons, d’ici et d’ailleurs — bourreaux, victimes, fils ou filles… »
« Je crois que cette pièce se situe au-delà du politique. Ce que David combat avant de découvrir sa réelle identité, c’est politique. Mais tout le reste est simplement humain », avancera Raphaël Weinstock lorsque nous le rencontrerons, avant qu’il n’entre en scène. « La pièce montre très brutalement la différence entre les individus et la politique qui divise les peuples. » C’est en effet la force centrale de Tous des oiseaux : la mise en scène est une constellation de liens, de causes et de conséquences heureuses et malheureuses — d’accidents entre les personnages, chacun muni de sa langue et son histoire. Mouawad se fait fin cartographe de notre époque. Cartographe des narrations et des émotions qui invitent le spectateur, très doucement, à se défaire de ses réflexes innocents et de ses certitudes pour cheminer avec lui et rouvrir, outils en main, le ventre de l’Histoire. Celle de l’Europe coloniale du XXe siècle qui entra en guerre contre elle-même, colonisée par l’un de ses membres, germanique. « J’entends encore le bruit de leur mastication », monologue le vieil Etgar en songeant à ce frère donné en pâture aux chiens sous ses yeux. De ce sillon, celui des pogroms et des drames engendrés par l’idéologie nazie, finira par naître l’État d’Israël. De cette urgence un nouveau foyer national, imaginé depuis le XIXe siècle, prit définitivement place sur une terre bel et bien habitée : cette jeune nation est aussi l’enfant de l’Europe à genoux, agonisante de ses contradictions fondamentales. « Sommes-nous condamnés à reproduire ce que notre peuple a vécu ? », interroge Eitan, révolté par l’aveuglement de son père à l’amour qu’il porte à une jeune femme que tous ne voient qu’à travers le spectre d’une Palestine qu’elle ne connaît pas.
Sommes-nous, oui, condamnés à reproduire l’histoire de nos parents ? Cette interrogation demeure désespérément la nôtre. Elle ne nous lâche pas. Le spectateur se retrouve, chaque soir, en lien profond avec les autres ; parce que ces mémoires à moult voix, langues, géographies et générations ne manquent pas d’en rappeler les enracinements complexes, nous attrapent et nous jettent sur la carte dessinée par son auteur : en nous rendant partie intégrante de la constellation. Écoutons ici le poète roumain Benjamin Fondane : « L’écrivain s’adresse non au social mais à l’individu, et l’individu, non de passion de surface à passion de surface, mais de région profonde à région profonde. » Nous y voilà, en région profonde, et collectivement. Dans la délicatesse des « blessures sacrées » d’un autre poète, Aimé Césaire. Nous nous tenons dans un tableau commun, parents de la vieille Europe impériale, parents de la Palestine mise à sac, descendants de colonisés, de colons, d’ici et d’ailleurs — bourreaux, victimes, fils ou filles… À tout instant : interchangeables, broyés par les mécanismes de la grande Histoire et les caprices des États comme des religions. Cet empilement d’émotions collectives pourrait se montrer par trop épais, mais il n’en est rien : on en rit aussi, dans Tous des oiseaux. Ironie maitrisée des jeux de l’Israélienne Léora Rivlin (Léah, la grand-mère) et de Judith Rosmair (Norah, la mère de Eitan), comédienne à la Schaubühne de Berlin, qui rendent leur souffle aux spectateurs en poussant l’assemblée à rire, même, et surtout, du pire.

Jérémie Galiana, par Maya Mihindou
À l’instar de ses grands-parents avant lui, Eitan porte dans son amour pour Wahida cette possibilité de bâtir autre chose, de rendre féconds ces parcours d’exilés. « Cette pièce est comme un médicament. Je dis médicament
comme les enfants, mais l’image est forte. Toi et moi, on porte les maladies de nos parents, de nos grands-parents. Qu’ils soient noirs, qu’ils soient blancs, qu’ils soient juifs, qu’ils soient arabes. Le mur qu’il y a sur scène, c’est le mur de Berlin, c’est celui entre la Palestine et Israël, c’est le mur entre le Mexique et Trump le fou… ce sont les frontières », commentera Jalal Altawil. Il sera temps, alors, de retrouver la parabole d’Hassan al-Wazzān, survolant la scène de son regard bleu et noir. « C’est un mélange entre une tragédie grecque, une pièce de Tennessee Williams et Rûmî. De la poésie. Il y a ce travail des langues, mais ce travail sur les langues qui te laisse ensuite penseur. Il y a des instants du spectacle tellement fragiles : c’est comme deux instruments qui jouent un air extrêmement délicat », précisera Raphaël Weinstock. Ce comédien nomade (il a sillonné l’Europe durant vingt ans) est également musicien. « Il y a des moments que j’ai beau écouter tous les soirs, à l’intérieur des scènes, c’est comme un concert différent à chaque fois, que tu regardes avec le souffle de l’audience, un pas de côté. Une live session. C’est rare cette intensité-là, aujourd’hui. » Il y a, dans ce bouleversement, quelque chose à conserver. Nos cages thoraciques s’ouvrent et se font caisses de résonance d’un écho, d’une solidarité qui tend à nous sortir du cercueil des origines. Ne restent que des motifs applicables à chaque famille, individu, à chaque exilé : propriétés de tous.
« La diversité linguistique est à l’image de l’éclatement du récit : elle permet à des morceaux d’inconscient de dialoguer. »
« En allant dans Forêts — qui est une pièce qui n’est pas moyen-orientale mais plus européenne —, j’ai réalisé que, dans l’histoire européenne, on parvenait à nommer [les lieux, ndla] parce que le travail européen avait eu lieu : les Allemands ont fait leur travail. Les Français ont fait le travail. Pas parfaitement, mais il a été tenté », nous confiait Wajdi Mouawad il y a quelques mois. L’auteur né au Liban écrit sous cette forme constellée depuis ses pièces des années 1990. Depuis, nous assistons, spectateurs, au combat de taureaux entre un sculpteur/écrivain et son bloc de glaise. Il en est ainsi de toute son œuvre : Tous des oiseaux était en germe dès Littoral ; le spectre du conflit israélo-palestinien hantait Le Sang des promesses. Anima, roman qu’il publia en 2012, précisait davantage les lieux. Cette dernière pièce jette l’ancre : les États-Unis, l’Allemagne, le Maroc, Israël, la Palestine et le Liban nous font face, par ce choix de conserver la langue des personnages (Souheila Yacoub a dû prendre des cours d’arabe et Jérémie Galiana d’hébreu) et par un fin travail technique sur le son. Dans ce théâtre national, des avions de chasse rasent nos oreilles. Les cris de Sabra et Chatila nous parviennent en même temps qu’à Léah et Etgar, les grands-parents horrifiés. Nous devons écouter ces bombardements que d’autres vivent. « Personne ne voulait raconter cette guerre [du Liban, ndla]. J’étais aussi dans cet état : dans l’impossibilité de la nommer. En ne la nommant pas, elle est devenue innommable », nous disait encore le dramaturge. Raconter en mettant les langues au centre de l’histoire fut le moyen, pour Mouawad, de se distancer de la question de sa propre légitimité d’auteur ; la diversité linguistique est à l’image de l’éclatement du récit : elle permet à des morceaux d’inconscient de dialoguer.
Le poète palestinien Mahmoud Darwich écrivit que « la terre se transmet comme la langue ». Eitan et Wahida se rencontrent en anglais ; les autres alternent, parfois dans un même échange, l’allemand et l’hébreu ; al-Wazzān parle en arabe ; Mouawad achève la pièce avec l’allemand, qui serait, ici, « la langue de la réconciliation ». La pièce ne pouvait qu’assembler une équipe d’acteurs polyglottes, ayant, tous, « deux yeux de trop ». La pièce met finement le doigt sur une évidence devenue amnésique : chacun est, à son échelle, relié à l’histoire du monde. Chaque rencontre, chaque conflit appartient à une chaîne de conflits et de rencontres plus vastes encore ; le temps ne saurait se relever de son horizontalité. Une décision ne tranche rien : elle crée des excroissances. Les pays ne s’arrêtent jamais à la porte des frontières, qui sont sans queue ni tête. Dans Tous des oiseaux, les interprètes envahissent leurs personnages.

Eitan et Wahida, par Simon Gosselin
« Écouter entre les étages l’effondrement des rêves de ma génération. »
En sortant du théâtre, nous avons immédiatement songé au cinéma de Ronit Elkabetz, où les protagonistes passent semblablement d’une langue à l’autre. « En Israël, on vit tous avec plusieurs langues sous nos toits. Mes parents viennent de Roumanie, d’autres sont d’Autriche, d’Espagne… », nous rappellera Raphaël Weinstock. « On parlera une langue à la maison et dehors on parlera l’hébreu. Tout est mélangé. L’hébreu et l’arabe, l’hébreu et l’anglais, l’hébreu et le russe, l’hébreu et le français… Il y a des choses que nous ne saurons dire qu’en arabe. Depuis plusieurs siècles, nous nous mélangeons, nous apprenons et nous exprimons dans d’autres langues, nous pensons en plusieurs langues. » L’enjeu de la traduction força l’auteur à changer ses habitudes en livrant une forme très avancée du script en amont des répétitions (même s’il en a fragmenté la quatrième partie quelques jours avant la première). Les acteurs nous raconteront tous, avec la même intensité, ces quinze jours de partage où ils se rencontrèrent — comédiens, traducteurs et techniciens du projet. « Wajdi a été très fort dès le départ, il a intégré tout le monde au processus créatif : on a appris à se connaître en juin, on a découvert le texte tous ensemble après quatre jours. Au milieu de ça, il tenait à ce que tout le monde ait son mot à dire, ça a donné lieu à des échanges très riches. Ça m’a galvanisé », dira Jérémie Galiana, arrivé dans le projet par l’entremise de Valérie Nègre, assistante à la mise en scène. Nous le rencontrons dans un café non loin du cimetière du Père-Lachaise, après quinze jours passés à interpréter Eitan. « C’est difficile d’être impliqué de la même manière à chaque représentation. » Le jeune comédien, qui intervenait la veille dans un collège pour parler de la pièce, est américain, allemand et français — il sort des cours Florent. « Petit, l’allemand était la langue que je parlais le mieux ; j’avais un accent quand je parlais français. Les autres se moquaient de moi : j’ai fait un blocage, du mutisme. J’ai décidé de ne parler que français. J’ai désappris
l’allemand. Il a fallu que je revienne à Berlin pour le reconstruire. » Il assure avoir « des racines courtes » et ajoute : « Mais je ne suis pas déraciné. Pour moi c’est une force immense. »
« Là où je rejoins Eitan, c’est qu’on ne peut pas se laisser abattre par l’Histoire, même s’il est important de la connaître, de ne pas l’oublier. Il ne faut pas se laisser assommer. »
Jérémie Galiana porte son personnage de cartésien ébranlé par le poids de l’histoire familiale avec une justesse rare et sans fausse note. Eitan se refuse à confondre l’identité, vue comme constamment en mouvement, et l’origine, point fixe de l’histoire de chacun. « On ne peut pas un jour se définir comme une chose si le lendemain, on peut en être un autre. C’est en relation aux rencontres que l’on fait, aux expériences vécues, aux endroits où l’on va. Là où je rejoins Eitan, c’est qu’on ne peut pas se laisser abattre par l’Histoire, même s’il est important de la connaître, de ne pas l’oublier. Il ne faut pas se laisser assommer », nous livrera-t-il. Nous lui demandons comment il envisage la colère écrasante de son « père », David, en contradiction avec la bienveillance du grand-père, pourtant revenu des camps. « Ce sont les fils ou filles de survivants de l’Holocauste qui ressentent une douleur et une responsabilité vis-à-vis de leurs parents. » Cette Allemagne, c’est aussi la mère d’Eitan, une Juive élevée dans une famille communiste, qui peine visiblement à s’en remettre. « Elle a remplacé les dogmes du communisme par les dogmes du judaïsme. » Et, pour le jeune Allemand, c’est la période d’après-guerre qui est encore obscure : « Il y a une sorte de cancer sur la période de la République est-allemande. À la chute du Mur, on a peu été fouiller là-dedans… Aujourd’hui, ceux qui votent le plus à l’extrême droite sont ceux qui étaient dans l’ex-Allemagne communiste. Ce sont des plaies profondes qui n’ont jamais été pansées. »
Souheila Yacoub évoquera également ces premiers moments en groupe : « On était tous au même niveau avec l’équipe des techniciens. On a parlé ensemble de nos parcours personnels, échangé sur Israël pour savoir si ce que Wajdi écrivait était juste. On s’est sentis à l’aise, mais on a tous craqué à un moment : il y a eu des larmes ! » La comédienne, ancienne gymnaste professionnelle qui a grandi en Suisse de parents flamand et tunisien, est à l’aise dans les langues. Elle a rejoint l’équipe de la pièce une fois passée par le Conservatoire national. « On ne pourrait pas jouer cette pièce sans avoir une totale confiance dans les autres. Je me fais gifler, je me fais traiter d’arabe, de pute, etc… Je ne pourrais pas me laisser toucher par Eden ou insulter par le père si je ne savais pas que Raphaël [le père d’Eitan, ndla] me donne, au fond, tout autant d’amour… Il faut s’aimer fort. Ce n’est pas un job parmi un autre, c’est spécial. Ce que le public nous rend permet de réaliser l’ampleur de ces liens, de cette justesse. Ce que Wahida m’apporte, je ne suis pas la seule à le vivre. »

Souheila Yacoub, par Maya Mihindou
Les spectateurs appréhendent l’ensemble du récit à travers le point de vue de Wahida, jusqu’à ce qu’elle-même entre dans le drame qui divise le territoire d’Israël où Eitan l’emmène, et s’y perde. Elle porte sur ses épaules la charge symbolique de la pièce, en sa condition de femme et, plus encore, de femme arabe, dans cette géographie tumultueuse. Un emblème parfois lourd pour un seul personnage. « Je suis la seule dans la pièce qui n’a, à aucun moment, sa langue maternelle. » La jeune femme, qui s’exprime essentiellement en anglais sur scène, s’inquiétait de ne pas être assez convaincante. Nul autre n’en douta. « Pendant les quinze jours de travail autour de la table, il a fallu travailler à s’écouter. » Pourtant, celle qu’elle incarne ne s’est pas bâtie sans sueur : le cheminement identitaire de Wahida — « l’unique », en arabe — peut se lire à l’aune de celui de Souheila, qui se retrouva désemparée, en quittant sa Suisse « multiculturelle » où il n’y avait « que des Croates, des Serbes, Portugais, Arabes, Italiens — tous Suisses ! », d’être réduite, lors de castings parisiens, aux projections liées à son nom… « Je me suis demandée pourquoi j’avais le rôle d’Aïcha, de Yasmine, la meilleure amie étrangère », nous confiera-t-elle. « J’ai même failli changer mon nom. Et les attentats n’ont rien arrangé. Dans la pièce, j’ai cet énorme monologue sur le fait d’être arabe — que je vomis presque —, où je dis qu’on ne m’a jamais appris à en être une… C’est proche de ce que je vis. Avoir dû réapprendre l’arabe pour la pièce, même si je ne le maîtrise pas, m’a rendu fière de quelque chose que j’avais oublié. » La puissance que lui apporte ce projet est aussi contagieuse que marquante.
« Par rapport à l’armée, il est problématique de dire à des personnes aussi jeunes que ce qu’elles font est mal, quand on leur donne tous les pouvoirs, sans les surveiller. »
« Nous avons parlé, de 9 à 18 heures, tous les jours autour d’une table », commentera à son tour Darya Sheizaf (Eden). En service militaire obligatoire, son personnage va entrer, de force, dans l’histoire de Wahida. « Chaque personne est comme un animal sauvage qui a un besoin tabou », lui expliqua Wajdi Mouawad. « Le tabou d’Eden est d’avoir la douceur de Wahida pour elle. Ce n’est pas pour excuser le viol ! » Car cette scène s’y apparente — les deux actrices ne poseront toutefois pas les mêmes mots pour en parler. L’étudiante en cinéma à la Sorbonne, native de Jaffa, réside en France depuis 2014 : « Je ne sais pas si les situations de viols dans l’armée sont très courantes… Ça doit forcément arriver. Et ça ne paraît pas évident avec des filles. Mais en même temps, et ça, c’est ma réflexion propre par rapport à l’armée, c’est problématique de dire à des personnes aussi jeunes que ce qu’elles font est mal, quand on leur donne tous les pouvoirs, sans les surveiller. »
Darya Sheizaf a refusé de faire son service militaire en Israël : « J’ai échappé à l’armée de manière tout à fait légale. Mais les raisons qui m’ont fait sortir de l’armée ne sont pas réellement les miennes. Ce sont des prétextes qu’il a fallu faire entrer dans leur cadre. Tu peux faire de la prison si tu imposes tes raisons politiques de déserter l’armée en Israël. » Elle ressent avec « ironie » ce rôle à l’opposé de ce qu’elle est dans la vie, alors que ce refus a représenté pour elle un point de bascule. « Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois, c’est la première chose qu’on va te demander : que faisais-tu dans l’armée ? C’est tellement ancré dans la culture. Je n’ai pas trouvé de travail à cause de ça. Je jouais dans une série télé et on me disait de ne pas dire que je n’avais pas fait l’armée. C’est oppressant. » Elle envisage dans l’avenir de se tourner vers la réalisation, davantage attirée par l’écriture. Son père, reporter, lui a permis de vivre dans d’autres pays dès son enfance, ce qu’elle conçoit comme un énorme privilège.

Eden et Wahida, par Simon Gosselin
L’un des projets qui lui tient à cœur concerne ces jeunes Israéliens qui font le choix de retourner en Europe. « Je me suis intéressée aux raisons pour lesquelles j’étais de retour
sur ce continent qui a vu la mort de la majorité de ma famille. » Elle y interroge à sa manière les ruptures de générations : « Celle des grands-parents, qui est souvent celle de survivants de l’Holocauste, originaires d’autres pays qu’Israël ; ils s’y sont installés avec cette idée commune du rêve sioniste. Puis celle de mes parents, qui ne sont plus capables d’échapper aux problématiques liées à cette utopie, sans pouvoir ni vouloir faire face à la rupture du rêve de leurs parents : ceux-là vivent en majorité en Israël. Luttant, parfois, ou fermant leurs oreilles. Enfin, il y a ma génération, qui est divisée et qui, de plus en plus, déménage en Europe — surtout à Berlin. » Darya Sheizaf a pris un aller simple pour la France, pays incarnant à ses yeux une plus grande tolérance, une terre étrangère capable « d’enrichir sa pensée ». « Tous les pays au monde ont vécu des guerres atroces, de la violence, mais ces pays existent depuis plus longtemps qu’Israël ; ils ont eu le temps d’apprendre de leurs fautes », nous dira-t-elle encore. « Je comprends, et ça me renforce, qu’Israël est comme un enfant qui ne connaît rien de la vie et teste sa force — ce qui signifie qu’il va changer, que nous allons grandir et nous améliorer. Et en même temps, ma génération, celle qui a 16, 20, 30 ans, il faut qu’on vive, qu’on s’aime, qu’on échappe à la violence et à l’injustice si on ne peut pas les changer pour le moment. »
« Il faut guérir lentement, consoler lentement. Ne rien jeter trop vite contre le mur de la connaissance. »
« David est le seul personnage de la pièce à qui tout le monde ment. Et il n’arrive pas à mettre le doigt dessus, et il le sent… Il est comme un aveugle. »
Pour trouver les acteurs qui incarneraient David, Leah et Etgar, Wajdi Mouawad s’est rendu en Israël. Weinstock nous avouera : « J’étais dans un moment de ma vie où j’envisageais précisément de revenir en Europe, où j’ai déjà vécu vingt ans (en Allemagne, en Suisse et en Autriche). Je me sens à l’étroit en Israël, c’est un pays où tout doit filer droit, être quadrillé : j’y ai la sensation qu’il est impossible de sortir du rang. » Le comédien se réjouit de ce passage en France, pays qu’il connaît peu mais espère y vivre un temps, et de cette possibilité de rejouer avec des collègues qu’il respecte, Leora Rivlin et Rafael Tabor. L’homme a une carrure imposante, son aura aux antipodes de la dureté du personnage que nous avons découvert sur scène. « Nous avons répété des journées entières et Wajdi n’a jamais haussé le ton. Il reste doux, ferme et te rend libre. Il te pousse hors de tes zones de confort. J’ai travaillé avec tellement de metteurs en scène qui ont une vision toute prête, qui te conditionnent, te tordent pour leurs besoins au lieu de te parler de ce qu’ils veulent, simplement. Ils ont besoin de sentir que c’est eux qui créent, c’est quelque chose de l’ordre de l’ego. » Nous discutons avec un comédien ayant près de trente ans de plateau derrière lui, habitué des comédies musicales. Une expérience qui le pousse à s’impliquer dans son corps comme dans sa voix. « Dans ce projet, mon agent était terrifié que je ruine ma voix. Car je parle d’une manière qui est en contradiction avec tout ce que j’ai appris comme chanteur, où l’important est précisément ta manière de sonner
. Ici, dès que j’attache de l’importance à la technique vocale dans ce projet, je perds aussitôt l’authenticité qui naît. » Pour Tous des oiseaux, il a dû puiser dans d’autres ressources afin d’incarner cet homme étouffé de colère, inspiré, lors de la phase d’écriture, par le père de Mouawad : « Le moteur a été aussi, précisera Weinstock, la relation avec mon propre père, mon propre peuple. Ne pas avoir peur de la toucher avec électricité chaque soir. Ce n’est pas automatique, mais je peux la convoquer sur commande. Parfois ça vient tout seul, d’autres fois je dois la construire. C’est ce qui garantit que le spectacle est toujours différent. »
Quand nous échangeons avec Raphaël Weinstock, celui-ci s’apprête à retourner sur scène dans l’heure qui suit. De nombreuses personnes attendent à l’entrée du théâtre, affichant complet. Tous les soirs depuis vingt-six jours, 800 personnes vivent, quatre heures durant, l’implosion de cette famille. « David est le seul personnage de la pièce à qui tout le monde ment. Et il n’arrive pas à mettre le doigt dessus, et il le sent… Il est comme un aveugle. » Il enchaîne : « Dans la première scène de la bibliothèque, où tout le monde marche, on passe tous, déguisés, avec un élément, une intention. Wajdi m’a demandé : comment veux-tu entrer ? Je lui ai répondu que je voulais marcher avec mon bâton d’aveugle, entrer en aveugle. Il a été surpris et m’a dit : ″Dans une bibliothèque ?!″ On pense à Œdipe roi, à Antigone… Il y a un conflit profond entre ce qu’il ressent et ce qu’il vit. Et ce conflit lui est très douloureux. » Weinstock le rappellera : sur scène se nouent des liens qui pourraient difficilement exister ailleurs. Le mantra de Mouawad — « Écrire pour ceux qu’on lui a appris à détester » — pèse son poids dans ces régions du monde et devient le ciment qui lie les acteurs entre eux. Leora Rivlin, actrice israélienne qui porte la « vieille sorcière » pince-sans-rire de la pièce, confiera au journal Libération qu’« entre l’équipe syrienne et les Israéliens, il y avait une réticence. J’avais peur de la suspicion que je croyais déceler. Le vrai lien s’est établi ensuite, insécable ».

Norah, David, Etgar, par Simon Gosselin
En Israël, en Syrie ou au Liban, il serait compliqué de croiser l’une ou l’autre de ces nationalités : cela va parfois à l’encontre des lois. D’ailleurs, chaque acteur nous dira espérer que la pièce tourne dans son propre pays. « Les frontières sont de papier. Mais pour le comprendre personnellement, il faut rencontrer quelqu’un de Syrie, comme Jalal. Il faut comprendre, après quelques jours de répétitions, que nous sommes frères. Je ne sais pas combien de Juifs il avait côtoyé avant, mais de mon côté, j’ai toujours côtoyé des personnes arabes — j’ai vécu à Haïfa, à Jaffa, à Tel Aviv, où les communautés arabophones sont importantes. Ce n’est pas « exotique » pour moi, l’arabe. » Weinstock, toujours. Cette langue est depuis quelques années enseignée dans les écoles d’Israël, nous apprendra d’ailleurs le comédien. « Pourtant, c’est au contact de Jalal que l’arabe m’est revenu, soudainement. »
« L’égalité est le seul moyen d’évoluer en tant qu’espèce. De la faire grandir et de la soutenir. »
Jalal Altawil s’en souviendra : le premier titre de la pièce était Le Chant de l’oiseau amphibie. « Wajdi l’a changé. Nous sommes tous des oiseaux, et si un oiseau tombe, on tombe tous. Cette réalité est lourde et profonde. » Weinstock complètera : « J’ai vécu près d’une forêt pendant longtemps. Chaque plante ne pourrait vivre sans les autres : elles sont toutes connectées. Les feuilles de l’une seront la nourriture de l’autre. C’est cette chaîne, extrêmement organique, qui nous lie dans la pièce. » Une grande tranquillité se dégage de ce comédien qui assume nourrir son jeu, pourtant, de ses propres démons. « Je ne crois pas que la mort soit ce que l’on pense. Je ne pense pas que ce soit triste
; il me semble que ça l’est de penser que c’est triste. Ce que je vois, c’est que la seule chose que nous ayons, ce sont finalement ces quelques prochains pas. Rien d’autre n’est certain. Tout ce que nous avons, c’est le prochain souffle, le prochain choix. Et cela inclut de pouvoir regarder le monde de cette manière, ou d’une autre. Ce choix peut changer à chaque seconde, et c’est très bien ! Il n y a pas à se sentir coupable de changer d’avis ou de manière de penser. Blâmer cela, c’est encore de l’ego. » L’équipe de comédiens se retrouve régulièrement après les représentations dans ce café, à l’angle du théâtre ; un serveur propose à l’acteur des frites, ils rient ensemble. « Il y a des choses sacrées : l’égalité en est une. L’égalité est le seul moyen d’évoluer en tant qu’espèce. De la faire grandir et de la soutenir. » Le comédien se prépare ; c’est bientôt son tour de maquillage. « La seule chose dont nous soyons responsables, c’est de nous-mêmes. De personne d’autre. On ne peut être responsable que de nos propres choix, comme ces pas que fait David dans la pièce. Ces pas que nous faisons : sont-ils commandés par la peur ou par l’amour ? Les faisons-nous parce que nous fuyons quelque chose ou parce que nous allons vers quelque chose ? ″Je dois le faire″ ou ″Je veux le faire″ ? »
La pièce tournera t‑elle au Moyen-Orient ? En février, les comédiens se retrouveront sur scène à Villeurbanne. En attendant, Jérémie Galiana et Judith Rosmair retourneront à Berlin, Souheila Yacoub s’envolera pour l’Inde avec sa classe du Conservatoire. Darya Sheizaf, achevant ses partiels révisés dans les coulisses, s’en ira retrouver sa famille pour les vacances. Raphaël Weinstock, Leora Rivlin et Rafit Tabor rentreront en Israël. Quant à celui qui incarne al-Wazzān, il se prépare à la diffusion d’une série de la réalisatrice Farah Allameh, produite clandestinement au Liban (contre le régime d’Assad et Daech) : Amal (« l’espoir », en arabe). En attendant, Jalal Altawil rentrera chez lui, à une soixantaine de kilomètres de Paris. « Il y a quelque chose de rassemblé autour d’une trace qui témoigne que ce monde qu’on avait en tête existe, aurait existé, peut exister, existe encore. Et, ensemble, il faut le refaire. Et de plus en plus préciser, d’œuvre en œuvre, de pièce en pièce, de rencontre en rencontre, ce qu’était cette ancienne trace sur le mur » ; pour Mouawad, écrire des pièces de théâtre, c’est aller à la recherche d’un tableau perdu.
REBONDS
☰ Lire notre article « Poésie, anarchie et désir (II) », Adeline Baldacchino, septembre 2017
☰ Lire notre entretien avec Mohammad Bakri : « Le droit en lui-même est un cri », juin 2017
☰ Lire notre entretien avec Michel Warschawski : « Il y a une civilisation judéo-musulmane », mars 2017
☰ Lire notre entretien avec Wajdi Mouawad : « Je viens d’une histoire qui ne se raconte pas », mars 2017
☰ Lire notre entretien avec Tahar Bekri : « Poète dans la Cité », juillet 2016
☰ Lire notre témoignage : « Théâtre social : quand Philippe Durand raconte les Fralib », juin 2016
☰ Lire notre article « Traduire ? Accomplir son voyage dans la langue », Maya Mihindou, juin 2016
☰ Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015
- Tout est écriture, Actes Sud, 2017, entretien avec Sylvain Diaz.[↩]
- « La mise en lumière récente de ces moyens épigénétiques d’adaptation d’une espèce à son environnement est selon Joël de Rosnay en 2011
la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années
car elle montre que dans certains cas, notre comportement agit sur l’expression de nos gènes. »[↩] - « L’Oiseau de beauté », « L’Oiseau de hasard », « L’Oiseau de malheur », « L’Oiseau amphibie ».[↩]