Article inédit pour le site de Ballast
« Je suis une contradiction profonde », reconnaît l’écrivain du Mozambique Mia Couto. Un pseudonyme de femme qui, d’emblée, brouille les pistes. Ancien journaliste aux parents d’origine portugaise, il s’impliquera dans le FRELIMO, le Front de libération, avant que celui-ci n’accède au pouvoir. Biologiste de métier, il porte sur sa terre un regard complet. On s’approche réellement d’un pays quand on connaît sa langue : comment cela est-il possible sur un continent qui en parle deux mille ? La figure de l’écrivain comme du poète, dans ces pays d’Afrique où tant de langues se bousculent, est complexe. L’auteur n’a jamais ignoré l’enjeu politique de la langue comme autre métaphore de l’histoire de son pays : il a ainsi repris, dans ses livres, ce portugais hybride du Mozambique, le verbe de l’ancien colon remodelé par les idiomes locaux dont il ne manque pas de s’inspirer. Le travail du traducteur, en littérature africaine, est un enjeu de taille : il est le témoin et le passeur direct de ce métissage qui s’opère sans demander son reste. C’est ce point précis qui nous intéresse ici. Nous avons interviewé sa traductrice, Elisabeth Monteiro Rodrigues, et l’écrivain lusophone — premier volet. ☰ Par Maya Mihindou
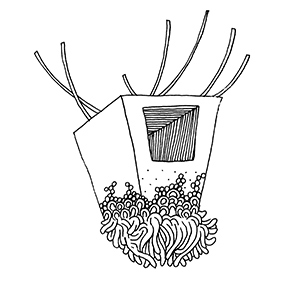
« On est ici face à deux traits d’union entre un pays d’Afrique à la fois bantouphone et lusophone, anciennement colonisé, et la France, ancien empire colonial. »
Dans le cas de ce binôme, c’est une collaboration réussie, car les traductions de l’œuvre de Couto par Monteiro Rodrigues nous font pleinement entrer, sans forcer, dans la réalité organique d’une autre langue : le portugais du Mozambique, qui est aussi une langue africaine. Le dépaysement est certain, mais il n’y a pourtant rien de moins évident. L’écrivain, qu’on nous pardonne les poncifs, est l’interprète subjectif d’une époque et d’une réalité sociale ; le choix d’un genre narratif, d’un style et d’une langue sociale en est une autre. L’approche poétique, proche du conte, est chez Couto le liant. Une langue riche en métaphores, gonflée d’une audace lexicale propre et de fétichismes imbriqués dans l’expression locale, qui est une autre interprétation du réel. « Ces lions ne surgissaient pas de la brousse. Ils étaient nés du dernier conflit armé. Le même désordre de toutes les guerres se répétait à présent : les gens sont devenus des animaux, et les animaux des humains. Pendant les combats, on a laissé les cadavres dans la campagne, sur les routes. Les lions les ont mangés. À ce moment précis, les bêtes ont brisé le tabou : elles se sont mises à regarder les gens comme des proies. » (La Confession de la lionne) Mia Couto, ancien journaliste, réfute l’inscription de son travail dans le courant littéraire sud-américain du « réalisme magique » : ce serait enfermer dans quelque guêpier conceptuel et rationnel une approche du monde plus poreuse, inscrite dans le quotidien, qui va simplement de soi dans la culture qu’il côtoie et connaît. D’ailleurs, ce biologiste de formation voit cette discipline, scientifique et rationnelle, comme une autre langue, qu’il maîtrise aussi, mais qui n’est pas en opposition ni dans une position hiérarchique vis-à-vis de la langue du commun, ou la langue poétique.
Lors de cette rencontre, Elisabeth Monteiro Rodrigues soulignait la difficulté qu’avait été la sienne de traduire ce nouveau manuscrit d’un auteur avec qui elle collabore pourtant depuis 2005. « J’ai longtemps porté ce livre avant de pouvoir le traduire. » Intrigués, en lecteurs attentifs depuis plusieurs années, nous avions tenu à l’interroger en parallèle d’un entretien avec l’auteur mozambicain : une manière de mettre en écho leurs approches littéraires respectives. « Les œuvres de Mia Couto nous enjoignent en effet de nous débarrasser de nos idées préconçues afin de nous laisser pénétrer par ce qu’il appelle l’Autre côté, Là-Bas. Dans le cas de La Confession de la lionne, il a fallu que je laisse advenir dans le réel cette possibilité que l’homme a de se transformer, d’être un animal, ici, une lionne. C’est cette idée que le monde animal et humain n’est pas étanche, qu’il n’y a pas de séparation, que l’humain fait partie du règne animal et vice versa, qu’il n’est pas question de fantastique et encore moins de réalisme magique. Une fois cette possibilité admise, le livre de l’anthropologue Harry G. West, O poder e o invisível em Mueda, Moçambique, m’a permis d’en comprendre les enjeux historiques et politiques. Puis il se passe généralement un ou deux mois, parfois davantage, avant que je ne commence. Je travaille par couches, je réalise au moins trois versions de ma traduction : la première, je la veux comme un calque de l’original, une sorte de langue à mi-chemin entre le portugais et le français, la deuxième aborde la rive du français et, enfin, la troisième, je l’espère, aura accompli son voyage dans la langue. Je pense souvent à la rumination médiévale, « ingurgiter » le texte afin de le laisser cheminer en moi et en déplier le sens. »
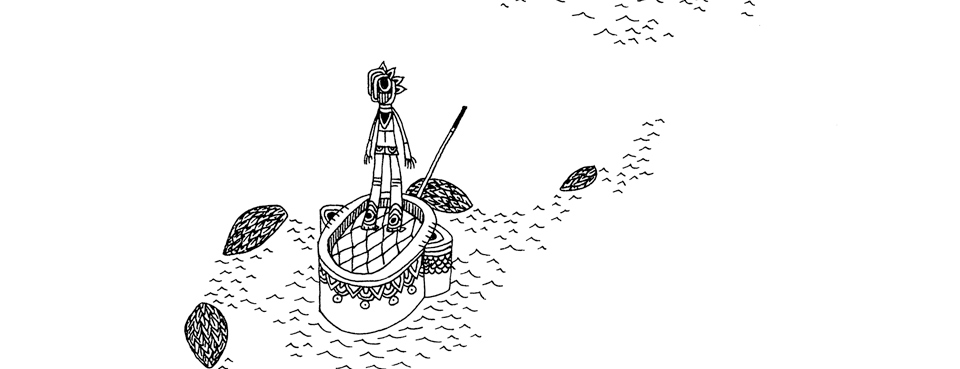
Accomplir son voyage dans la langue. Démarche que l’auteur, né de parents portugais et ancien membre du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), dut faire lui-même. C’est cette chaîne de rencontres — du « téléphone arabe », pour reprendre une expression populaire — qui nous intéresse ici, cette zone de métissage par le langage, qui permet d’effleurer la culture de celui qu’on nous a appris à mépriser. Ils sont nombreux en littérature, ces « bâtards » incasables qui se nourrissent de la chair tendre des langues en territoire multilingue : des Antillais Fanon, Glissant et Chamoiseau à Jean Sénac l’Algérien, de Kateb Yacine (qui écrivit son théâtre en arabe dialectal) à l’Afrikaner Breyten Breytenbach ; de la Sénégalaise Fatou Diome à l’Angolais José Luandino Vieira. L’écrivain kenyan Ngugi wa Thiong’O — mis au ban de son idiome maternel et de son pays — incarne un positionnement radical sur la question des langues coloniales et de la traduction. Tous des exilés, un œil dehors, l’autre rentré, permettant une conscience multipliée. L’essayiste Lise Gauvin parle d’ailleurs de « surconscience linguistique ». L’écrivain-poète est un réceptacle et un transmetteur, le traducteur en est un autre, tout aussi essentiel — voire primordial, dans notre siècle. C’est cette figure, celle du passeur, que nous cherchons à effleurer, en nous intéressant au voyage des langues dans les livres.
« Les Centres colonialistes avaient projeté leurs langues comme des filets. La langue, en ces temps d’expansion, ne servait pas à questionner le monde. »
« La littérature écrite sur le continent africain et dans les Caraïbes occupe une place très importante dans mon parcours, nous dit Monteiro Rodrigues. En 1998, en rentrant d’un séjour au Ghana, je suis passée par Lisbonne, et dans une librairie j’ai acheté Terra sonâmbula de Mia Couto. La lecture de ce roman fut pour moi un véritable éblouissement. Je n’avais jamais lu un texte aussi beau, avec une telle puissance évocatrice, et un style aussi novateur. J’ai ensuite eu l’occasion de faire plusieurs entretiens avec Mia Couto. Ce n’est que bien plus tard, alors que j’étais déjà libraire à la Librairie portugaise & brésilienne, que j’ai proposé à Anne Lima et Michel Chandeigne de publier Tombe, tombe au fond de l’eau (Mar me quer). Un texte magnifique empreint de poésie et d’humour, qui déploie tout l’art poétique de Mia Couto. J’ai depuis le bonheur de traduire son œuvre, publiée aux éditions Chandeigne et Métailié. » Le traducteur des littératures africaines doit faire face à une réalité linguistique contradictoire, nouée, avec plus ou moins de conscience politique, au pari décolonial. « Je suis une contradiction profonde : je suis un scientifique qui écrit, je suis un écrivain dans une société orale, je suis blanc dans un pays d’Africains », clama Mia Couto lors de son passage en France. Car au vu de leur foisonnement (près de 2 000 langues vivantes — soit un tiers des langues mondiales — existent sur le continent), les langues sont, de l’Algérie à Madagascar, un enjeu considérable. Langues indigènes broyées par le système colonial, avec plus ou moins de détermination selon la politique de l’Empire (Louis-Jean Calvet parle d’ailleurs de glottophagie comme d’une sorte de relation « cannibale », où le colon venu d’Europe, non seulement « a dévoré le colonisé », mais a également « dévoré ses langues »). Chamoiseau, dans Écrire en pays dominé, en dira encore : « Les Centres colonialistes avaient projeté leurs langues comme des filets. La langue, en ces temps d’expansion, ne servait pas à questionner le monde. Elle devenait un tamis d’ordre par lequel le monde, clarifié, ordonné, devait se soumettre aux déchiffrements univoques d’une identité… ».
La plupart du temps, les langues régionales d’Afrique ne sont pas aidées, depuis les indépendances, par le peu de gouvernements qui se sont succédé au pouvoir, trouvant trop souvent l’urgence ailleurs que dans la vie de leur peuple : peu d’entre elles se développent sur les bancs de l’école et des universités. Forcément, cet état de fait ne participe pas à la création d’une réelle cohésion nationale. Au Mozambique, si quelques initiatives voient le jour, aucune démarche rigoureuse venant de l’État n’a abouti pour traduire et transmettre le savoir des différentes langues entre elles (la guerre civile ayant étouffé dans l’œuf toute entreprise de cet ordre pendant longtemps). Tout au plus, les hommes politiques se souviennent qu’ils parlent autre chose que le portugais au moment des élections, quand, dans les tribunaux on fait appel à des traducteurs pour la majorité de la population qui ne s’exprime pas en portugais. Sur l’ensemble du continent africain, seuls les livres religieux — la Bible ou le Coran — sont traduits dans un panel large d’idiomes. Définir le Mozambique comme un pays lusophone fera rire nombre de socio-linguistes : le pays est, dans sa grande majorité, « bantouphone », la plupart des langues parlées étant issues de la souche bantoue. La langue de l’ancien colon fut utile au moment des indépendances pour balayer sous le tapis les divisions régionales à l’intérieur du mouvement de Libération. Aujourd’hui, les différentes langues du pays sont souvent instrumentalisées, car liées à de sérieux enjeux de pouvoir et de clan. C’est aussi là qu’une guerre de classe se joue. Aujourd’hui, le portugais du Mozambique est une langue urbaine, scolaire, médiatique et associée à l’élite politique. « Une dispute s’empare du lieu. Soudain, plus personne ne parle en portugais. Cette dispute se produit dans un autre monde, dans un monde où, pour se comprendre, les morts et les vivants ont besoin de traduction. », dit le narrateur de La Confession de la lionne, lui-même extrêmement soucieux de considérer dans son œuvre les diverses langues du Mozambique.

Dans un tel contexte, un grand nombre de Mozambicains, à l’instar d’autres pays d’Afrique, grandissent en éprouvant au cœur de leur croissance une scission forte entre la langue sensible, instinctive (souvent « orale » : la langue maternelle), et la langue de l’intellect (écrite, celle de l’école) — autrement dit, la langue du foyer, du chant, de l’imaginaire et celle de l’ancien colon, devenue, dans une partie des anciennes colonies n’ayant pu saisir l’urgence linguistique, une langue de liaison. Mais une langue de liaison tombée dans la rue, comme on tombe dans la potion magique : rien de plus vivant et insaisissable que les langues, dans les pays où l’écrit n’est pas au centre des intentions collectives. De la « littérature du bouche à oreille », écrira le linguiste congolais Musanji Ngalasso-Mwatha. Mia Couto nous dit à ce propos qu’il est possible d’« hériter des choses, mais on n’hérite pas des langues ni des créatures vivantes. » Rien de plus évident en pays bantou. Ce à quoi répondra sa traductrice : « Oui, la langue vient de plus loin que nous, elle est en variation constante, on ne peut donc pas la posséder au sens matériel. Pourtant, il me semble que la question peut se poser lorsqu’on a deux langues, lorsqu’une autre langue s’est substituée à la langue maternelle stricto sensu. Quel serait alors le statut de cette langue maternelle ? Ne serait-elle pas un « héritage » ? Je crois que je traduis pour faire entendre le portugais en français, la langue qui est devenue la mienne à l’âge de quatre ans. À chaque traduction, j’accomplis ce voyage du portugais au français qui m’a fait naître en français. » Le voyage d’une langue est un cheminement sans retour. Le français injecté dans les rues d’un certain nombre de pays, bien en dehors de l’Académie métropolitaine, est donc devenu une langue africaine qui peine à gonfler ses poumons dans l’air très comprimé de la « francophonie » ; comme le sont l’anglais, l’espagnol et le portugais sur d’autres terres, qui les ont intégrés à leur culture nationale sans attendre de permission. En d’autres termes — ceux de Kateb Yacine : la langue de l’ancien colon est un butin de guerre. Les rues du Mozambique dé-latinisent le portugais pour la bantou-iser ! D’où la difficulté de traduction. Mia Couto, écrivain d’une terre encore dans l’ombre de la guerre civile, s’insère dans cette réalité complexe : écrire dans une langue à la fois minoritaire mais dominante, et en constante mutation.
« Je me suis rendue pour la première fois au Mozambique en 2013, à l’invitation du centre culturel franco-mozambicain, pour une rencontre avec Mia Couto, lorsque l’Accordeur de silences a reçu le prix de la francophonie », nous dit encore Elisabeth Monteiro Rodrigues. « J’ai ainsi pu voir, écouter, sentir, respirer les mots. Secouez les pieds, les poussières aiment voyager
est devenu une expérience concrète. S’agissant de l’oralité, je pense qu’il convient de préciser ce qu’on entend par ce mot — que l’on voit partout dès qu’il est question de littérature dite africaine. L’oralité telle que je l’envisage chez Mia Couto, ce sont d’abord les histoires dont les personnages de ses romans et de ses nouvelles sont porteurs ; les personnages de Mia Couto constituent à eux seuls une narration, ils n’ont de cesse de vouloir remettre en cause la véracité du récit, la possibilité même de l’écriture du récit, et parfois le rapport à l’écrit. Dans son œuvre, l’écrit est oral et l’oral est écrit. L’oralité, c’est ensuite celle des différentes langues du Mozambique (rappelons qu’il existe une vingtaine de langues, et que seuls 3 % de la population possèdent le portugais comme langue maternelle, le portugais étant souvent la deuxième ou troisième langue apprise à l’école), leurs façons de nommer, de représenter les choses, de penser, de recourir aux proverbes que Mia Couto recrée dans ses romans et nouvelles. Ainsi, pour dire que quelqu’un ne parle pas portugais, il dira qu’il « lèche sa propre langue » ; quelqu’un qui n’a rien à dire « meuble la poussière de voix », un showneral est une fête organisée à l’occasion des funérailles. C’est donc cette langue, ce mode de rapport au monde que je traduis. Mais pour moi, c’est quelque chose qui existe partout, en France aussi. La langue française a aussi cette capacité d’exprimer cela. »
« J’aime beaucoup le mot illuné que l’on trouve chez Rimbaud pour traduire un mot portugais très courant : enluarada (
baigné par le clair de lune). Rimbaud est une lecture à laquelle je reviens souvent quand je traduis Mia Couto. »
Glissant l’affirmait, la traduction « n’est pas une mécanique ». Tout à la fois ouverture à l’œuvre d’un auteur, mais également trahison et menace constante de la distorsion, de la perte d’un propos et des vibrations en retrait d’une langue. « Une femme a été violée et presque tuée dans ce village. Et ce ne sont pas les lions qui l’ont fait. […] Vous êtes revenus à Kulumani, Arcanjo Baleiro ? Eh bien, faites la chasse à ces violeurs de femme », lance Naftalinda dans La Confession. Le traducteur doit pouvoir regarder un auteur droit dans ses pupilles et trouver, au cœur même du langage, une zone de confiance partageable. « Quand on traduit de l’ineffable, quand on traduit de l’indicible, les trucs d’équivalence ne suffisent pas, il faut un imaginaire du traducteur qui invente quelque chose de nouveau par rapport aux trucs d’équivalence d’une langue à l’autre », Glissant, toujours. Il s’agit de tenir les deux bouts de corde de l’imaginaire d’une langue à l’autre. L’expérience de la perte et du deuil est une donnée de base de la traduction comme de tout processus créatif nous dira Monteiro Rodrigues : « Dans Encore un métier impossible, Pontalis écrit que le traducteur doit être doué d’une capacité infinie d’être triste
. Mais heureusement ce n’est pas tout, les joies et les compensations sont là, sur le fil de la phrase. Je pense bien sûr ici aux créations lexicales, aux mots-valises, aux proverbes fixés ou détournés, aux jeux de mots que l’on retrouve abondamment dans la plupart des romans de Mia Couto et dans ses nouvelles. » Les traducteurs sont ceux qui doivent faire entrer une mentalité, une culture, une musicalité… dans un mouchoir de poche. Traduire une langue poétique qui convoque tant de particularismes culturels et historiques, comme nous l’expliquions plus haut concernant celle de Couto, oblige fondamentalement à trouver d’autres leviers que de simples équivalences. « Ce sont autant de singularités que je fais en sorte de restituer par des archaïsmes en français, en détournant l’emploi sémantique ou grammatical des mots, en créant des mots composés ou des néologismes. Je tente de recourir aux mêmes processus de formation des mots pour créer des néologismes en français. […] Lorsque cela ne fonctionne pas, apparaît forcé ou artificiel, j’ai alors recours à la compensation, en glissant une création possible ailleurs dans le texte : j’aime beaucoup le mot illuné que l’on trouve chez Rimbaud pour traduire un mot portugais très courant : enluarada (« baigné par le clair de lune »). Rimbaud est une lecture à laquelle je reviens souvent quand je traduis Mia Couto. »

L’écrivain nous le dira lui-même : « Je dois tomber amoureux de ces gens que j’invente peu à peu à partir de rencontres, à partir de récits. Ils ne doivent pas trop coller à la réalité, mais ils ont des liens avec le quotidien. » Alors, de la même manière : faut-il connaître, maîtriser la philosophie d’un auteur pour pouvoir le traduire ? Que faut-il privilégier ou sacrifier du sens, de la sonorité ou du rythme ? Comment rendre compte de la part silencieuse du langage, et de métaphores qui ne puisent pas dans l’imaginaire européen ? Allons plus loin : faut-il aimer un auteur pour s’emparer de son texte et accomplir le voyage dans la langue ? Une chose est sûre : au cœur même des différents dictionnaires, une relation irrationnelle se crée. « Je ne pourrais pas traduire un livre dont je n’aime pas la langue, le style, nous répond Monteiro Rodrigues. Je traduis Mia Couto depuis une dizaine d’années maintenant. Si son univers, son écriture me sont à ce point familiers, j’essaie toujours, autant que possible, de considérer chaque livre comme si c’était le premier que je traduisais (et cela me paraît toujours aussi difficile, peut-être même plus difficile à chaque fois). C’est très important de conserver une distance entre mon empathie profonde pour cette œuvre et l’œuvre à proprement parler, ce afin de ne pas imposer mon propre rythme, mais d’écouter celui de l’original. Le sens et le rythme sont indissociables, de même que la musicalité et la chair des mots sont au cœur de mes préoccupations. La lecture à voix haute est une constante dans mon travail. Je convoque aussi beaucoup les images pour essayer de trouver le mot juste et je laisse une part à l’instinct. »
Édouard Glissant nommait « créolisation » la part d’imprévu que génèrent les courts-circuits dans l’histoire humaine, phénomène accéléré aujourd’hui : des peuples lointains s’affrontent, se cognent, s’assemblent et, malgré les divisions, ne cessent d’inventer, de s’inventer. Dans un entretien sur la question, le penseur du Tout-Monde estimait, quant à lui, que « la traduction est un élément primordial
, car ayant une fonction poétique générale du rapport de toute langue à toute langue. […] La traduction devient un art en soi, avec son champ qui est non pas le champ des langues, mais le champ du rapport des langues. »
Toutes les illustrations sont de Popcube
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Mia Couto : « Les langues sont des entités vivantes », juin 2016
☰ Lire notre article avec Abdellatif Laâbi : « La bataille des idées est de nouveau devant nous », juin 2016
☰ Lire notre entretien avec Reza Afchar Naderi : « Ici, la poésie est coupée de l’homme », janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015
☰ Lire notre article : « Serge Michel — amour, anarchie et Algérie », Émile Carme, février 2015
☰ Lire notre article : « Jean Sénac, poète assassiné », Éric Sarner, novembre 2014


